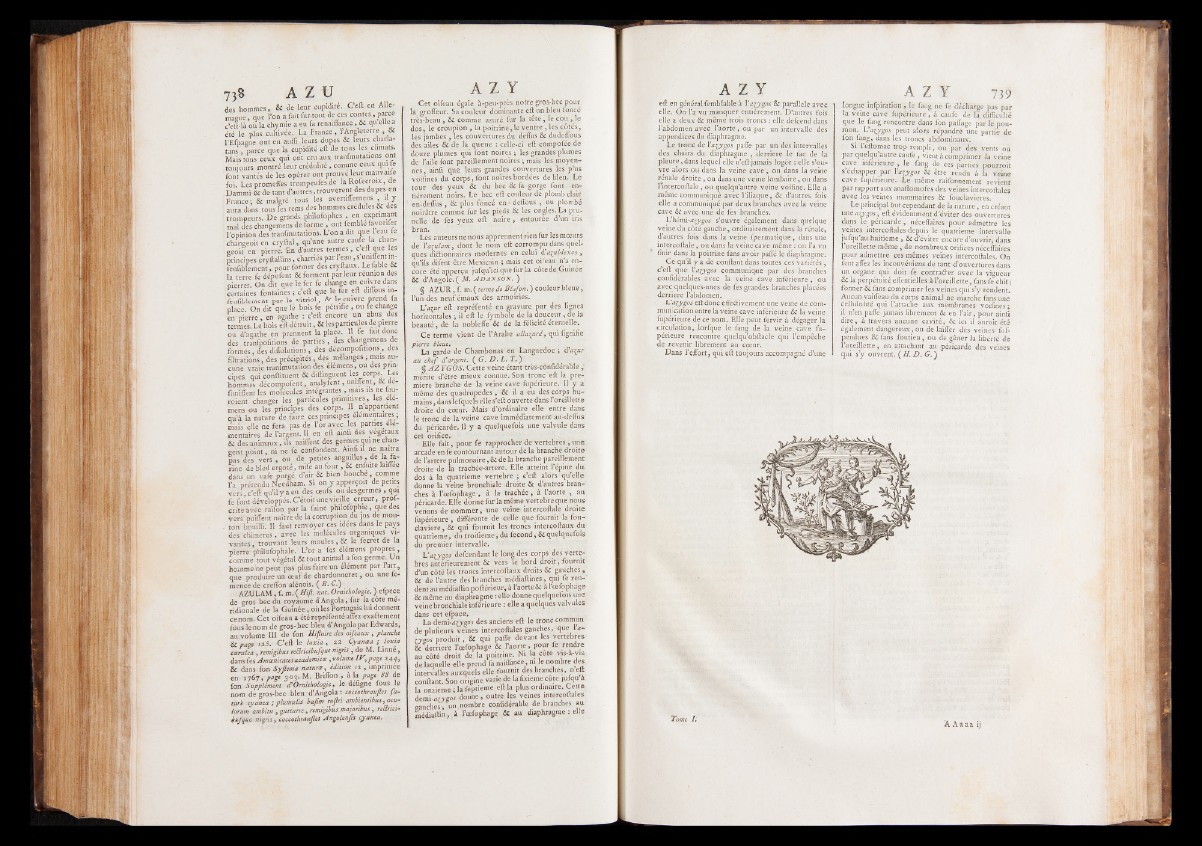
738 A Z U
des hommes, & de leur cupidité. C eft- en Allemagne
, que l’on a fait fur-tout de ces contes, parce
c’elt-là où la chymie a eu fa renaiffance, &c qu elle a
été le plus cultivée. La France, l’Angleterre , &
l’Efpaene ont eu auffi leurs dupes & leurs charlatans
, parce que la cupidité eft de tous les climats.
Mais tous ceux qui ont cru aux tranfmutations ont
toujours montré leur crédulité, comme ceux qui le
font vantés de les opérer ont prouve leur mauvaife
foi. Lespromeffes trompeufes.de laRolecroix, de
Dammi & de tant d’autres, trouvèrent des dupes en
France; & malgré tous les avertiffemens , il y
aura dans tous les tems des hommes crédules & des
trompeurs. De grands philofophes | en exprimant
mal des changemens de forme , ont femble fayoriler
l ’opinion des tranfmutations. L’on a dit que 1 eau le
changeoit en cryftal, qu’une autre caufe la chan-
eeoit en pierre. En d’autres termes, ce lt que les
principes cryftallins. charriés par l’eau, s'unifient m-
fenfiblement, pour former des cryftaux. Le fable
la terre fe dépofent & forment par leur réunion des
pierre’s On dit que le fer fe change en cuivre dans
certaines fontaines ; c’eft que le fer eft diffous in-
fenfiblement par le vitriol, & le cuivre prend fa
place. On dit que le bois fe pétrifie , ou fe change
en pierre, en agathe : c’eft encore un abus des
termes. Le bois eft détruit, & les particules de pierre
ou d’agathe en prennent la place. Il fe fait donc
des tranfpofitions de parties, des changemens de
formes, des diffolutions, des décompofitions , des
filtrations, des précipités, des mélanges ; mais aucune
vraie transmutation des elemens, ou des principes
qui .conftituent & diftinguent les corps. Les
hommes décomppfent, analyfent, unifient, & de-
luniffent les molécules intégrantes , mais, ils ne fau-
roient'changer les particules primitives, les elemens
ou les principes des corps. Il n appartient
qu’à la nature de faire ces principes élémentaires;
mais elle ne fera pas de l’or avec les parties élémentaires.
de l’argent. U en eft ..ainfi des végétaux
& des animaux, ils naiffent des germes qui ne changent
.point, ni ne fe confondent. Ainfi il ne naîtra
pas des vers , ou de petites anguilles , de la fa-
rine debled ergoté, mife au four , & enfuite laiflee
dans un vafe purgé d’air & bien bouche comme
l’a prétendu Needham. Si on y apperçoit de petits
v e r s ,c ’eft qu’i ly a e u des oeufs ou des germes , qui
fe font développés. C’étoit une vieille erreur, prof-
criteavec raifon parla faine philofophie, que des
vers puiffent naître de la corruption du jus de raou-
. ton bouilli. Il faut renvoyer ces idées dans le pays
des chimères, avec les molécules organiques vivantes,
trouvant leurs moules, & le fecret de la
pierre philofophale. L’or a tes élémens propres ,
comme tout végétal & tout animal a fon germe. Un
homme ne peut pas plusfaire un élément par l’art,
que produire un oeuf de chardonneret, ou une femence
de creffon alénois. ( 2?. C.) , .
AZULAM, f. m. { Hiß. nat. Ornithologie. ) efpece
de gros bec du royaume d’Angola, fur la côte méridionale
de la Guinée, où les Portugais lui donnent
ce nom. Cet oifeau a étérepréfentéaffez exaâement
fous le nom de gros-bec bleu d’Angola par Edwards,
au volume III de fon Hißoire des oifeaux , planche
& page ixS. C’eft le loxia, XX Cyanaa ; loxia
carulea, remigibus reclricibufque nigris, de M. Linné,
dans fes Amanitatesacademicce ,■ volume IV ,page 244,
& dans fon Syfiema naturel, édition i x , imprimée
en 1767, page 303. M. Briffon., à la page 88 de
fon Supplément d?Ornithologie, le défigne fous le
nom de gros-bec bleu d’Angola : coccothraufles fa-
turï cyanea ; plumuhs bafim roßri ambientibus, ocu-
lorum ambitu , gutturre , remigibus majoribus, reclrici-
bujque nigris, coccothraußes Angofenßs cyanea.
A Z Y
Cet oifeau égale à-peu-pres notre grosrbec pour
là groffeur. Sa couleur dominante eft un bleu fonce
très-beau , & comme azuré: fur la tête, le cou , le
dos, le croupion , la poitrine, le ventre, les côtes,
les jambes , les couvertures du defîùs & dudeffous
des ailes & de la queue : celle-ci eft compofée de
douze plumes qui font noires ; les grandes plumes
de l’aile font pareillement noires ; mais les moyennes
, ainfi que leurs grandes couvertures les plus
vbifines du corps, font noires bordées de bleu. Le
tour des yeux & du bec & fa gorge font entièrement
noirs. Le bec eft couleur de plomb clair
en-deflùs , & plus foncé en - deffous , ou plombé
noirâtre comme fur les pieds & les ongles. La prunelle
de fes yeux eft noire , entourée d’un iris •
brun. ' . , . 1
Les auteurs ne nous apprennent rien fur les moeurs
de Yaçulam, dont le nom eft corrompu dans quelques
dictionnaires modernes en celui d açul-lexos ,
qu’ils difent être Mexicain ; mais cet oifeau n a encore
été apperçu jufqu’ici que fur la cotedeGuinee
& d’Angole. ( Af. A d a n so n . )
§ AZUR, f. m. ( terme de Blafoh. ) couleur bleue,
l’un des neuf émaux des armoiries.
Va{ur eft repréfenté en gravure par des lignes
horizontales ; il eft le fymbole de la douceur, de la
beauté, de la nobleffe & de la félicité éternelle.
Ce terme vient de l’Arabe alla^urd, qui lignifie
pierre bleue.
La garde de Chambonas en Languedoc ; d’^«r
au chef d'argent. ( G. D . L. T .) ^ f
§ A Z Y G O S . Cette veine étant très-cônfidérable
mérite d’être mieux connue. Son tronc eft la première
branche de la veine cave fupérieure. Il y a
même des quadrupèdes, & il a eü des corps humains
, dans lefqùels elle s’eft ouverte dans l’oreillette
droite du coeur. Mais d’ordinaire elle entre dans
lè tronc de la veine cave immédiatement au-deflùs
du péricarde. Il y a quelquefois une valvule dans
cet orifice.' -
Elle fait, pour fe rapprocher de vertebres , une
arcade enfe contournant autour de la branche droite
de l’artère pulmonaire, & de la branche pareillement
droite de la trachée-artere. Elle atteint l’épine du,
dos à la quatrième vertebre ; c’eft alors qu’elle
donne la veine bronchiale droite & d’autres branches
à l’oefophage , à la trachée, à l’aorte , au
péricarde. Elle donne fur la même vertebre que nous
venons de nommer,- une veine intercoftale droite
fupérieure, différente de celle que fournit la fou-
claviere, & qui fournit les troncs intercoftaux dit
quatrième, du troifieme, du fécond, & quelquefois
du premier intervalle.
"L'azygos defeendant le long des corps des vertebres
antérieurement & vers le bord droit, fournit
d’un côté les troncs intercoftaux droits & gauches,
& de l’autre des branches médiaftines, qui fe rendent
au médiaftin poftérieur, à Faorte & à 1 oefophage
& même au diaphragme : elle donne quelquefois une
veine bronchiale inférieure : elle a quelques valvules
dans cet efpace.
La demi-azygos des anciens eft le tronc commun
de plufieurs veines intercoftales gauches, que la -
W m produit, & qui paffe devant les vertebres
& derrière l’oefophage & l’aorte, pour fe rendre
au côté droit de la poitrine. Ni la côte vis-à-vis
de laquelle elle prend fa naiffance, ni le nombre des
; intervalles auxquels elle fournit des brandies, n eft
confiant. Son origine varie de la fixieme cote jnlqu à
la onzième ; la feptieme eft la plus ordinaire. Cette
demi-azygos donne, outre les veines intercoftales
gauches, un nombre çonfidérable de branches ap.
médiaftin, à l’oefophagq & au diaphragme : elle
A Z Y
eft en général femblabie à Y azygos & parallèle avec
elle. On l’a vu manquer entièrement. D’autres fois
elle a deux & même trois troncs : elle defeend dans
l ’abdomen avec l’aorte , ou par un intervalle des
appendices du diaphragme.
Le tronc de Y-a^ygos paffe par un des intervalles
des chairs du diaphragme , derrière le fac de la
pleure, dans lequel elle n’eft jamais logée : elle s’ouvre
alors ou dans la veine cave , ou dans la veine
renale droite, ou dans une veine lombaire, ou dans
l’intercoftale , ou quelqu’autre veine voifine. Elle a
meme Communiqué avec l’iliaque, & d’autres fois
elle a communiqué par deux branches avec la veine
cave & avec une de fes branches.
Uhémi-açygos s’ouvre également dans quelque
veine du côté gauche, ordinairement dans la rénale,
d’autres fois dans la veine fpermatiqùe, dans une
intercoftale, ou dans la veine cave même : on l’a vu
finir dans la poitrine fans avoir paffé le diaphragme.
Ce qu’il y a de confiant dans toutes ces variétés ,
c’eft que Y azygos communique par des branches
confidérables avec la veine: cave inférieure , ou
.avec quelques-unes de fes grandes branches placées
derrière l’abdomen.
Y-’açygos eft donc effectivement une veine de communication
entre la veine cave inférieure & la veine
fupérieure de ce nom. Elle peut fervir à dégager la
circulation, Jorfque le fang de la veine cave fupérieure
rencontre quelqu’obftacle qui l’empêche
de revenir librement au coeur. '
Dans l’effort, qui eft toujours accompagné d’une
A Z Y 739
longue infpiration, le fang ne fe décharge pas par
la veine cave fupérieure, à caufe de la difficulté
que le fang rencontre dans fon paffage par le poumon.
L’azygos peut alors répandré une partie de
fon fang, dans les troncs abdominaux.
Si leftomac trop rempli, ou par des vents ou
par quelqu alitre caufe , vient à comprimer la veine
.cave inférieure , le fang de ces parties pourroit
5 échapper par Y azygos & être rendu à la veine
cave fupérieure. Le même raifonnement revient
par rapport aux anaftomofes des veines intercoftales
avec les veines mammaires & fouclavieres.
Le principal but cependant de la nature, en créant
une azygos, eft évidemment d’éviter des ouvertures
dans J e péricarde , néceffaires pour admettre les
veines intercoftales depuis le quatrième intervalle
■ jusqu’au huitième, & d’éviter encore d’ouvrir, dans
l’oreillette même, de nombreux orifices néceffaires
pour admettre ces mêmes veines intercoftales. Oh
fent affez les inconvéniens de tant d’ouvertures dans
un organe qui doit fe contrarier avec la vigueur
6 la perpétuité effentielles à l’oreillette, fans fe chif -j
fonner & fans comprimer les veines qui s’y rendent.
Aucun vaiffeau du corps animal ne marche fans une
cellulofité qui l’attache aux membranes voifines ;
il n’en paffe jamais librement & en l’air, pour ainfi
dire, à travers aucune cavité, & ici il auroit été
également dangereux, ou de laiffer des veines fuf-
pendues & fans foutien, ou de gêner la liberté de
•l’oreillette, en attachant au péricarde des veines
qui s’y ouvrent. ( H. D . G. )