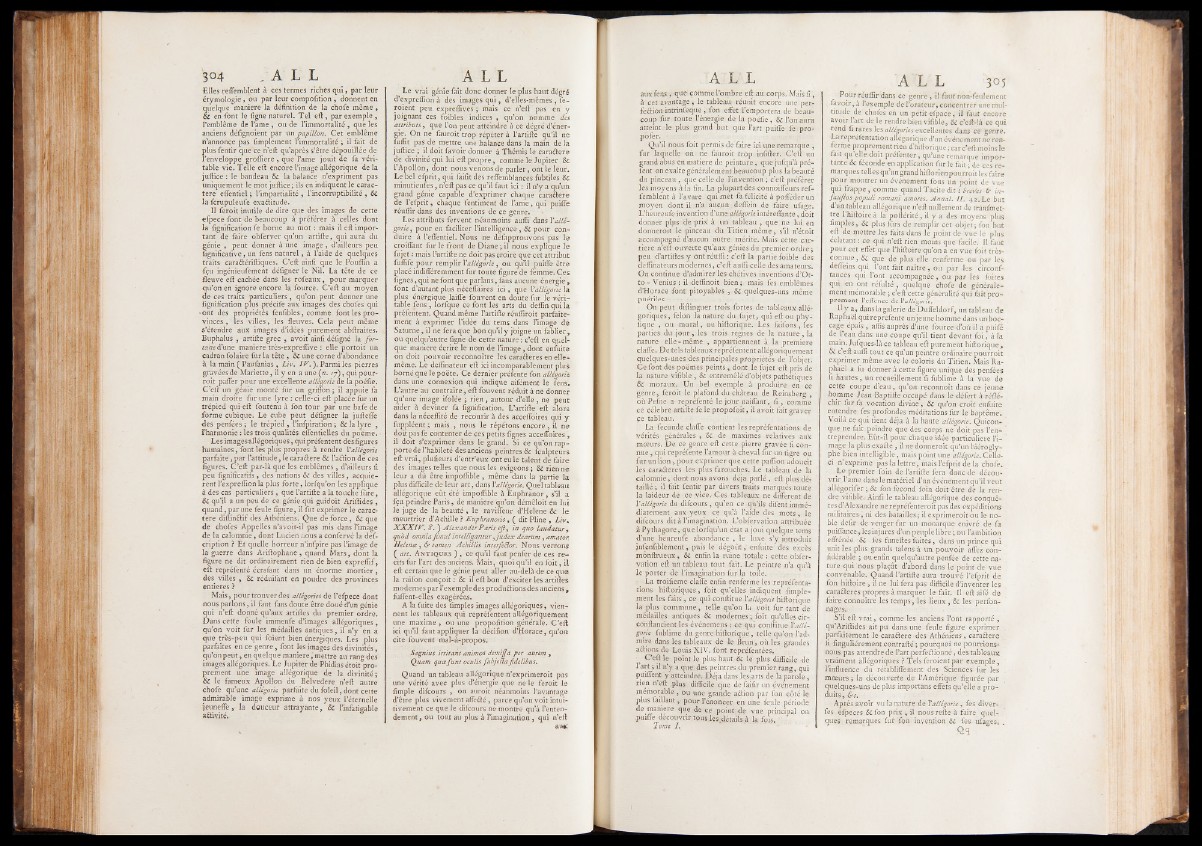
Elles reffemblent à ces termes riches q ui, par leur
étymologie, ou par leur compofition , donnent en
quelque maniéré la définition de la chofe même,
& en font le ligne naturel. T e l e ft, par exemple ,
l’emblème de l’ame , ou de l’immortalité , que les
anciens défignoient par un papillon. Cet emblème
n’annonce pas Amplement l’immortalité ; il fait de
plus fentir que'ce n’eft qu’après s’être dépouillée de
l’enveloppe grofliere , que l’ame jouit de fa véritable
vie. Telle eft encore l’image allégorique de la
juftice : le bandeau 8c la balance n’expriment pas
uniquement le mot juftice; ils en indiquent le caractère
effentiel ; l’impartialité , l’incorruptibilité , 8c
la fcrupuleufe exaCritude.
Il feroit inutile de dire que des images de cette
efpece font de beaucoup à préférer à celles dont
la lignification fe borne au mot : mais il eft important
de faire obferver qu’un artifte, qui aura du
génie , peut donner à une image, d’ailleurs peu
fignificative, un fens naturel , à l’aide de quelques
traits cara&ériftiques. C’eft ainli que le.Pouffin a
fçu ingénieufement défigner le Nil. La tête de ce
fleuve eft cachée dans les rofeaux, pour marquer
qü’on en ignore encore la fource. C ’eft au moyen
de ces traits particuliers, qu’on peut donner une
lignification plus précife aux images des chofes qui
«ont des propriétés fenfibles, comme font les provinces
, les ville s,.le s fleuves. Cela peut même
s’étendre aux images d’idées purement abftraites.
Buphalus , artifte grec , avoit ainli défigné la fortune
d’une maniéré très-expreffive : elle portoit un
cadran folaire fur la tête ,. 8c une corne d’abondance
à. la main ( Paufanias , Liv. IV . ). Parmi les pierres
gravéesde Mariette, il y en a une («. i f ) , qui pour-
roit palier pour une excellente allégorie de la poéfie.
C ’eft un génie monté, fur un griffon ; il appuie fa
main droite fur une lyre : celle-ci eft placée fur un
trépied qui eft foutenu à fon tour par une bafe de
forme cubique. Le cube peut déligner la jufteffe
des penfées ; le trépied, l’infpiration ; & la lyre ,
l’harmonie : les trois qualités éffentielles du poëme.
Les images allégoriques, quipréfentent des figures
humaines, font les plus propres à rendre X allégorie
parfaite, par l’attitude, le caraftere & l’a dion de ces
figures. C ’eft par-là que les emblèmes , d’ailleurs li
peu fignificatifs, des nations & des villes, acquièrent
l’expreflion la plus forte, lorfqu’on les applique
à des cas particuliers , que l’artifte a la touche fûre,
& qu’il a un peu de ce. génie qui guidoit Ariftides ,
quand, par une feule figure, il fut exprimer le c a r a c tère
diftindif des Athéniens. Que de force, 8c que
de chofes Appelles n’avoit-il pas mis dans l’image
de la calomnie, dont Lucien nous a confervé la def-
cription ? Et quelle horreur n’infpire pas l’image de
la guerre dans Ariftophane , quand Mars, dont la
figure ne dit ordinairement rien de bien expreflif,
eft repréfenté écrafant dans un énorme mortier,
des villes , & réduifant en poudre des provinces
entières }
Mais, pour trouver des allégories de l’efpece dont
nous parlons, il faut fans doute être doué d’un génie
qui n’eft donné qu’aux artiftes du premier ordre.
Dans cette foule immenfe d’images allégoriques,
qu’on voit fur les médailles antiques, il n’y en a
que très-peu qui foient bien énergiques. Les plus
parfaites en ce genre, font les images des divinités,
qu’on peut, en quelque maniéré, mettre au rang des
images allégoriques. Le Jupiter de Phidias étoit proprement
une image allégorique de la divinité;
8c le fameux Apollon du Belvedere n’eft autre
chofe qu’une allégorie parfaite du foleil, dont cette
admirable image exprime à nos yeux l’éternelle
jeuneffe, la douceur attrayante, 8c l’infatigable
activité. . .
Le vrai génie fait donc donner le plus haut dégré
d’expreffion à des images q u i, d’elles-mêmes , fe-
roient peu expreflives ; mais ce n’eft pas en y
joignant ces foibles indices , qu’on nomme des
attributs, que l’on peut atteindre à ce dégré d’énergie.
On ne fauroit trop répéter à l’artifte qu’il ne
fuffit pas de mettre une balance dans la main de la
juftice ; il doit favoir donner à Thémis le caraâere
de divinité qui lui eft p ropre, comme le Jupiter &
l’Apollon, dont nous venons de parler, ont le leur.
Le bel efprit, qui faifit des reflèmblances fubtiles 8c
minutieufes, n’eft pas ce qu’il faut ici : il n’y a qu’un
grand génie capable d’exprimer chaque caraftere
de l’efprit, chaque fentiment de l’ame, qui puiffe
réuflir dans des inventions de ce genre.
Les attributs fervent néanmoins aufîi dans \allégorie
, pour en faciliter l’intelligence , & pour conduire
à l’effentiel. Nous ne défapprouvons pas le
croiffant fur le front de Diane ; il nous explique le
fujet : mais Bartifte ne doit pas croire que cet attribut
fuffife pour remplir l’allégorie , ou qu’il puiffe être
placé indifféremment fur toute figure de femme. Ces
lignes, qui ne font que parlans, fans aucune énergie ,
font d’autant plus néceffaires i c i , que Vallégorie la
plus énergique laiffe fouvent en doute fur le véritable
fens , lorfque ce font les arts du deffin qui la
préfentent. Quand même l’artifte réuffiroit parfaitement
à exprimer l’idée du tems dans l’image de
Saturne, il ne fera que bon qu’il y joigne un fablier,
ou quelqu’autre ligne de cette nature : c’eft en quelque
maniéré écrire le nom de l’image, dont enfuite
on doit pouvoir reconnoître les carafteres en elle-
même. Le deffinateur eft ici incomparablement plus
borné que le poëte. Ce dernier préfente fon allégorie
dans une connexion qui indique aifément le fens.
L’autre au contraire, eft fouvent réduit à ne donner
qu’une image ifolée ; rien, autour d’e lle , ne peut
aider à deviner fa lignification. L’artifte eft alors
dans la néceffité de recourir à des acceffoires qui y
fuppléent ; mais , nous le répétons encore, il ne
doit pas fe contenter de ces petits lignes acceffoires,
il doit s’exprimer dans le grand. Si ce qu’on rapporte
de l’habileté des anciens peintres & fculpteurs
eft vrai, plufieurs d’entr’eux ont eu le talent de faire
des images telles que nous les exigeons ; & rien ne
leur a dù être impoflible, même dans la partie la
plus difficile de leur art, dans Xallégorie. Quel tableau
allégorique eût été impoflible à Euphranor, s’il a
fçu peindre Paris, de maniéré qu’on démêloit en lui
le juge de la beauté, le raviffeur d’Helene 8c le
meurtrier d’Achille ? Euphranoris, ( dit Pline , Liv,
X X X IV . 8. ) Alexander P aris ejlt in quo laudatur,
quod omriiaJimul intelligantur 9judex dearum, amator,
Helence, & tamen Achillis interfeclor. Nous verrons
( art. Antiques ) , ce qu’il faut penfer de ces récits
fur l’art des anciens. Mais, quoi qu’il en fo i t , il
eft certain que le génie peut aller au-delà de ce que
la raifon conçoit : & il eft bon d’exciter les artiftes
modernes par l’exemple des productions des anciens ,
fuffent-elles exagérées.
A la fuite des fimples images allégoriques, viennent
les tableaux qui repréfentent allégoriquement
une maxime , ou une propofition générale. C ’eft
ici qu’il faut appliquer la décifion d’Horace, qu’on
cite fouvent mal-à-propos.
Segnius irritant animos demifja per aurem ,
Quant quee funt oculis fubjecla fidelibus.
Quand un tableau allégorique n’exprimeroit pas
une vérité avec plus d’énergie que ne le feroit le
fimple difeours , on auroit néanmoins l’avantage
d’être plus vivement affeCté, parce qu’on voit intuitivement
ce que le difeours ne montre qu’à l’entendement
, ou tout au plus à l’imagination, qui n’eft
auac
aux fens 5 que: comme l’ombre eft au corps.' Mais f i ,
à cet avantage, le tableau réunit encore une perfection
intrinfeque , fon effet Temportera de beaucoup
fur toute l’énergië de la poéfie, 8c l’on aura
atteint . le plus grand but que l’art puiffe fe. pro-
pofèr. ■ y
Qu’il nous foit permis de faire ici une remarque ,
fur laquelle on rie fauroit trop infifter. C’eft un
grand abus en matière de peinture, que jufqu’à prévient
on exalte généralement beaucoup plus la beauté
du pinceau , que celle de l’invention; c’eft préférer
les moyens à la fin. La plupart des connoiffeurs ref-
femblent à l’avare qui met fa félicité à pofféderun
moyen dont.il .n’a aucun, deffein de faire ufage.
L’heureufe invention d’une allégorie intéreffante, doit
donner plps de prix’ à un tableau , que ne lui en
donneront le pinceau du Titien même, s’il n’étoit
accompagné d’aucun autre mérite. Mais cette carrière
n’eft-.ouverte qu’aux génies du premier ordre ;
peu d’artiftes y ontréuffi: c’eft la partie foible dès
aeflmateursmodernes, c’eft au-flî celle des amateurs.
On continue-d’admirer'lès chétives inventions d’Otto
- Venius : il -deflînoit bien ; triais ■ fes emblèmes
d’Horace font pitoyables , 8c quelques-uns même
puériles.
On peut diftinguer trois fortes de tableaux allégoriques,
félon la nature du.fujet, qui eft ou phy-
iique , ou moral, ou hiftorique. Les faifons, les
parties du jo u r ,. les trois régnés de la nature , la
nature elle-même , appartiennent, à la prerniere
claffe. De tels tableaux repréfentent allégoriquement
quelques-unes-des principales propriétés de l’objet.
Ce font des poèmes peints , dont , le fujet eft pris de
la nature vifible , & entremêlé d’objets pathétiques
8c moraux. Un bel exemple' à produire en ce
genre, feroit le plafond du château de Reinsberg -, '
o ù Pefine a repréfenté le jo'ur naiffant, f i , comme
ce célébré artifte fe le propofoit, il avoit fait graver
ce tableau.
La fécondé claffe contient les repréfentations de
vérités générales , 8c de maximes relatives aux
moeurs. De c'é genre eft cette pierre gravée fi connue
, qui repréfente l’amour à cheval fur un tigre ou
fur-un lion, pour exprimer que cette p'affion'adoucit
les caractères les plus farouches. Le tableau de la
calomnie, dont nous avons déjà parlé , eft plus.dér
taillé ; il fait fentir par divers traits marqués, toute
la laideur de ce ;vice.- Ges tableaux ne different de l’allégorie du difeours , qu’en ce qu’ils difent immédiatement
aux yeux ce,qu’à l’aide des mots, le
difeours dit à l’imagination. L’obfervation attribuée
à Pythagore * queibrfqû’un état a joui quelque tems
d’une heureufe abondance , le luxe s’y. introduit
jnfenïiblernerit, puis le dégoût,' enfuite' des excès
mbhftrueux, 8c enfin la ruine totale : cette observation
eft un tableau tout fait. Le peintre n’a qu’à
le porter de l’imagination fur la toile.
: -La trojfieme claffe enfin renferme les repréfentations
hiftoriques, foit qu’elles indiquent fimplement
les faits, ce quiconttitueX allégorie hiftorique
la plus commune, telle qu’on la voit fur tant de
médailles antiques 8c modernes ; foit qu’elles cir-
cdriftancient les événemens : ce qui conftitue Xallégorie
fublime du genre hiftorique, telle qu’ôn l ’admire
dans les tableaux de Le Brun, dù les grandes
aérions de Louis XIV. font repréfentées.
C’èft le point le plus haut & lé plus difficile de
1 art ; il n’y a que des peintres du premier rang, qui
puiffent y atteindre. Déjà dans les-arts de la parole-,
rien n’eft .plus difficile que défaillir un événement
mërhorable, ou une grande aCtion par fon côté le
plus faillant y pour l’énoncer en une feule période!
de,maniéré que de ce point' de vue principal ou
•puiffe découvrir tous les.dé.tails à la fois, ‘
Tome 1% ■ • -
Pour réuflir dans ce genre, il faut non-fëulement
■ favoir, à l’exemple de l’orateur, concentrer une multitude
de chofes en un petit efpace, il faut encore
avoir l’art de le rendre bien vifible, 8c c’eft-là ce qui
-lend fi rares les allégories excellentes dans Cè" genre.
La représentation allégorique.d’un événement ne ren-
ferriie proprement rien d’hiftorique ; car c’eft moins le
fait q u ’ e lle doit préfenter, qu’une remarque importante
8c féconde en application fur le fait ; de ces remarques
telles qu’un grandhiftorienpourroit les faire
pour montrer un événement fous un point de vue
qui frappe, comme quand Tacite dit : brèves & in-
faufios populi romani amores. Annal. II. 42. Le but
d’un tableau allégorique n’eft nullement de tràrifmet-
tre 1 hiftoire à la poftérité, il y a des moyens plus
fimples, 8c plus fûrs de remplir cet objet ; fon but
eft de mettre les faits dans le point de vue le plus
éclatant : ce qui n’eft rien moins que- facile. Il faut
pour cet effet que l’hiftoire qu’on a en vue foit très-
connue , & que de plus elle renferme ou par les
deffeins qui l’ont fait naître , ou par .les circonstances
qui l’ont accompagnée, ou par les fuites
qui en ont réfulté , quelque chofe de généralement
mémorable ; c’eft cette généralité qui fait proprement
Peffence de Xallégorie.
ll y a, dans la galerie de Duffeldorf, un tableau de
Raphaël quirepréfente un jeune homme dans unboc-
cage épais , affis auprès d’une fource d’où il a piiifé
de l’eau dans une coupe qu’il tient devant fo i , à la
main. Jufques-là ce tableau eft purement hiftorique,
& c’eft aufli tout ce qu’un peintre ordinaire pourroit
exprimer même avec le coloris du Titien. Mais Raphaël
a fu donner à cette figure unique des penfées
fi hautes, un recueillement fi fublime à la vue de
cetee coupe d’eau, qu’on reconnoît dans ce jeune
homme Jean Baptifte occupé dans le défert à réfléchir
fur fa vocation divine, & qu’on croit enfuite
entendre fes profondes méditations fur le baptême.
Voilà ce qui-tient déjà à la haute allégorie. Quicon-
que ne fait peindre que des corps ne doit pas l’en-
treprendre. Eût-il pour, chaque idée particulière l’i-
mage la plus exafte , il ne donneroit qu’un hiéroglyphe
bien intelligible, mais point une allégorie. Celle-
ci ri’exprime pas la lettre, mais l’efprit de la chofe.
Le premier foin de l’artifte fera donc de décou-
vrir l’ame dans le matériel d’un événement qu’il veut
allégorifer ; 8c fon fécond foin doit être ,de la rendre
vifible. Ainli le tableau allégorique des conquêtes
d’Alexandre nerepréfenteroit pas des expéditions
militaires , ni des batailles ; il exprimeroit ou le noble
defir de venger fur un monarque enivré de fa
puiffance , les injures d’un peuple libre ; ou l ’ambition
effrénée 8c fes funeftes fuites, dans un prince qui
unit les plus grands talens à un pouvoir affëz con-
fidérable ; ou enfin quelqu’autre penfée de cette nature;
qui nous plaçât d?abord dans le point de vue
convenable. Quand l’artifte aura trouvé l’efprit de
fon hiftoire , il ne lui fera pas difficile d’invèriter les
.carafteres propres à marquer le fait. Il eilaifé de
faire;eonnoître les temps-, les lieu x, 8c les perfon-
-nàges;
S’il eft v ra i, comme les anciens l’ont rapporté ,
qu’Ariftides ait pu dans une feule figure exprimer
parfaitement le caraûere des Athéniens, caraftere
ii finguliérement contrafté ; pourquoi ne pourrions-
nous pas attendre de l’art perfectionné, des tableaux
vraiment allégoriques ? Telsferoientpar exemple,
l’influerice du rétabliffement des Sciences fur les
moeurs; la découverte de l’Amérique figurée par
quelques-uns de plus importans effets qu’elle a produits
, &c. ■
Après avoir vu la nature de Xallégorie , fes diver-
fes efpeces & fon prix , il nousrefte à faire quelques
remarques fur Ton invention 8c fes ufage s , . IS