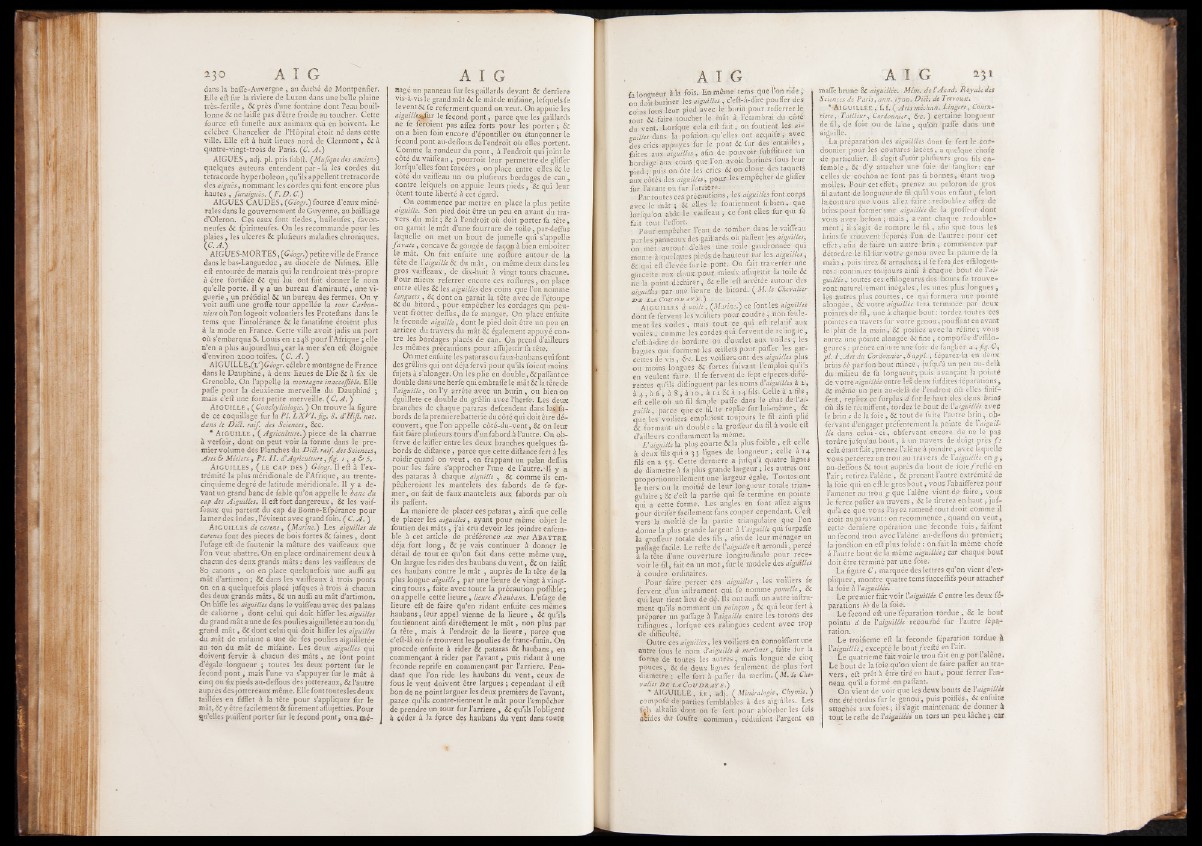
23° A I G
dans la baffe-Auvergne , au duché de Montpenfièr.
Elle eft fur la riviere de Luzon dans une belle plaine
très-fertile, & près d’une fontaine dont l’eau bouillonne
& ne laiffe pas d’être froide au toucher. Cette
fource eft funefte aux animaux qui en boivent. Le
célébré Chancelier de l’Hôpital étoit né dans cette
ville. Elle eft à huit lieues nord de Clermont, & à
quatre-vingt-trois de Paris. (C. A .)
AIGUES, ad j. pl. pris fubft. (.Mujîquedes anciens)
quelques auteurs entendent par - là les cordes du
tetracorde hyperboleon, qu’ils appellent tretracorde
des aiguës, nommant les cordes qui font encore plus
hautes , fur aiguës. ( F. D. C.)
AIGUES CAUDES, (Géogr.) fource d’eaux minérales
dans le gouvernement de Guyenne, au bailliage
d’Oleron. Ces eaux font tiedes, huileufes , favon-
neufes & fpiritueufes. On les recommande pour les
plaies, les ulcérés & plufièurs maladies chroniques.
{C.A.-) ................................
AIGUES-MORTES, (Géogri) petite ville de France
dans le bas-Languedoc, au diocèfe de Nifmes. Elle
eft entourée de marais qui la rendroient très-propre
à être fortifiée & qui lui ont fait donner le nom
qu’elle porte. Il y a un bureau d’amirauté, une vi-
guerie, un préfidial & un bureau des fermes. On y
“voit auffi une groffe tour appellée la tour Carbon-
niere oh l’on logeoit volontiers les Proteftans dans le
tems que l’intolérance & le fanatifme étoient plus
à la mode en France. Cette ville avoit jadis un'port
où s’embarqua S. Louis en 1248 pour l’Afrique ; elle
n’en a plus aujourd’hui, car la mer s’en eft éloignée
d’environ 2000 toifes. (C. A .')
AIGUILLE,(C)Gèogr. célébré montagne de France
dans le Dauphiné, à deux lieues de Die & à fix de
Grenoble. On l’appelle la montagne inaccejjible. Elle
paffe pour la deuxieme merveille du Dauphiné ;
mais c’eft une fort petite merveille. (G. A. )
Aiguille , ( Conchyliologie. ) On trouve la figure
de ce coquillage fur la Pl. LX V l.fig. 8. dîHiJl. nat.
dans le Dict. raif. des Sciences, &c.
* Aiguille , ( Agriculture.) piece de la charrue
à verfoir, dont on peut voir la forme dans le premier
volume dés Planches du Dict. raif. des Sciences,
Arts& Métiers , Pl. I I . d?Agriculture, fig. / , 4 6* 5.
A ig u il l e s , ( le ca p des) Géogr. Il eft à l’extrémité
la plus méridionale de l’Afrique, au trente-
cinquieme degré de latitude méridionale. Il y a de- ,
Vant un-grand banc de fable qu’on appelle le banc du
cap des Aiguilles. 11 eft fort dangereux, & les vaif-
feaux qui partent du cap de Bonne-Efpérance pour
la mer des Indes, l’évitent avec grand foin. (C. A . )
Aiguilles de caréné, (Marine.) Les aiguilles de
carénés font des pièces de bois fortes & faines, dont
l’ufage eft de foutenir la mâture des vaiffeaux que
l’on veut abattre. On en place ordinairement deux à
chacun des deux grands mâts : dans les vaiffeaux de
80 canons , on en place quelquefois une auffi au
mât d’artimon ; & dans les vaiffeaux à trois ponts
on en a quelquefois placé jufques à trois à chacun
des deux grands mâts, & un auffi au mât d’artimon.
On hiffe les aiguilles dans le vaiffeau avec des palans
de caliorne , dont celui qui doit hiffer les .aiguilles
du grand mât a une de fes poulies aiguilletée au ton du '
grand mât, & dont celui qui doit hiffer les aiguilles
du mât de mifaine a une de fes poulies aiguilletée i au ton du mât de mifaine. Les deux aiguilles qui ■
doivent fervir à chacun des mâts , ne Font point
d’égale longueur ; toutes les deux portent fur le
fécond pont, mais l’une va s’appuyer fur le mât à
cinq ou fix pieds au-deffous des jottereaux, & l’autre
auprès des jottereaux même. Elle font toutes les deux
taillées en fifflet à la tête pour s’appliquer fur le
mât, & y être facilement & furement affujetties. Pour
qu’elles puiffent porter fur le fécond pont, on a mé-
A I G
nagé un panneau fur les gaillards devant & derrière
vis-à-vis le grand mât & le mât de mifaine, lefquelsfe
lèvent & fe referment quand on veut. On appuie les
aiguillt$/ff\x le fécond pont, parce que les gaillards
ne fe fèroient pas affez forts pour les porter- ; &
on a bien foin encore d’épontiller ou étançonner le
fécond pont au-deffous de l’endroit où elles portent.
Comme la rondeur du pont, à l’endroit qui joint le
cote du vaiffeau -, pourroit leur permettre de gliffer
lorfcpi elles font forcées, on place entre elles & le
cote du vaiffeau un ou plufièurs bordages de can,
contre lefquels on appuie leurs pieds, & qui leur
ôtent toute liberté à cet égard.
On commence par mettre en place la plus petite
aiguille. Son pied doit être un peu en avant du travers
du mât ; & à l’endroit où doit porter fa tête,
on garnit le mât d’une fourrure de toile, par-deffus
laquelle on met un bout de jumelle qui s’appelle
favate , concave & gougée de façon à bien emboîter
le mât. On fait enfuite une rofture autour de la
tête de Y aiguille & du mât, ou même deux dans les
gros vaiffeaux, de dix-huit à vingt tours chacune.
Pour mieux referrer encore ces roftures, on place
entre elles & les aiguilles des coins que l’on nomme
languets , & dont on garnit là tête avec de l’étoupe
& du bitord, pour empêcher les cordages qui peuvent
frotter deffus, de fe manger. On place enfuite
la fécondé aiguille, dont le pied doit être un peu en
arriéré du travers du mât 8c également appuyé contre
les bordages placés de can. On prend d’ailleurs
les mêmes précautions pour affujettir fa tête.
On met enfuite les pataras ou faux-haubans qui font
des grelins qui ont déjafervi pour qu’ils foient moins
fujets à s’alonger. On les plie en double, &paffant ce
double dans une herfe qui embraffe le mât & la tête de
Y aiguille, on l’y arrête avec un burin , ou bien on
éguillete ce double du grêlin avec l’herfe. Les deux
branches de chaque pataras defcendent dans lesjüfa-
bords de la première batterie du côté qui doit être découvert
, que l’on appelle côté-du-vent, & on leur
fait faire plufièurs tours d’unfabord à l’autre. On ob-
ferve de laiffer entre les deux branches quelques fa-
bords de diftance , parce que cette diftance fert à les
roidir quand on v e u t , en frappant un palan deffus
pour les faire s’approcher l’une de l’autre. *11 y a
des pataras à chaque aiguille , & comme ils empêcheraient
les mantelets des fabords de fe fermer
, on fait de faux mantelets aux fabords par où
ils paffent.
La maniéré de placer ces pataras, ainfi que celle
de placer les aiguilles, ayant pour même objet le
foutien des mâts, j’ai crû devoir les joindre enfem-
ble à cet article de préférence au mot Abattre
déjà fort lon g , & je vais continuer à donner le
détail de tout ce qu’on fait dans cette même vue.
On largue les rides des haubans du vent, & on faifit
ces haubans contre le mât , auprès de la tête de la
plus longue aiguille, par une Heure de vingt à vingt-
cinq tours, faite avec toute la précaution poffible;
on appelle cette Heure, Heure d haubans. L’ufage de
Heure eft de faire qu’en ridant enfuite ces mêmes
haubans, leur appel vienne de la Heure , & qu’ils
foutiennent ainfi directement le mât, non plus par
fa tête, mais à l’endroit de la Heure, parce que
c’eft-là où fe trouvent les poulies de franc-funin. On
procédé enfuite à rider & pataras & haubans, en
commençant à rider par l’avant, puis ridant à une
fécondé reprife en commençant par l’arriere. Pendant
que l’on ride les haubans du vent, ceux de
fous le vent doivent être largues ; cependant il eft:
bon de ne point larguer les deux premiers de l’avant,
parce qu’ils contre-tiennent le mât pour l’empêcher
de prendre un tour fur l’arriere , & qu’ils l’obligent
à céder à la fçrce des haubans du vent dans toufç
A I G
fa longueur à la fols. En même tems que l’on rHe ;
on doit buriner les aiguilla., c’eft-à-dire pouffer des
coins fous, leur pied .avec le Burin pour refferrerle
tout Si faire toucher 'le mât ,à. l’étambrai du côté
du vent. iLorfque cela eft fait, on fondent! les ai-
zuUics dans la pofirion qu’elles ont acquife avec
Ses crics appuyés fur de pont & fur des entailles,
faites aux aiguilUs, afin de pouvoir fubltituer un
bordave aux coins ;que Ton. .avoit burinés -fous leur
pied ' ' pilis on ôte les crics Si on cloue des. taquets
aux côtés des aiguilla, pour-les-empêcheride gltffer
fur liaV.ant ou fur .rarriere.i. ■ . _ -
Par.toutes ces précautions, les aiguilla font corps .
avec le mât ; & elles le foutiennent fi'bien, que j
lorfqu’on abat le vaiffeau ;■ ce font elles: fur qui fe j
fait tout l’effort. ,
Pour' empêcher Téaurde tomber datisi le vaalleau ;
par lesparineaux deS-gail)'.ards.ou pàfient les aiguilles,
on miét autour dr’elles fine .toile gaudronnée qui <
monte à^quelques pieds deihaateur fur les.aiguilles4 .
& . qui eft élevée fur le pont; On fait trav.erfer une |
gàrcette aux cloux. pour mieux affujettir la toile &
ne la point déchirer , & elle eft iarrêtée autour des ;
aiguilles : par ■ une. Heur e de bitord. QM. le Chevalier
JDE L A1 COU DR A Y E . )
A iguilles ù voile, (Murine.') ce font les 'aiguilles :
dônt f ê fervent les'voiliers pour coudre , non feule- j
ment les vo ile s , niais:•’.terni ee qui eft relatif auk j
voilés -, comme les cordes qui fervent de relingue:, •
c’eft-à-dire de bordure:■ ou d'ourlet aux voiles ; les j
bagues qui forment les oeillets pour paffer les gar- ;
cettes de vis , &c. Les voiliers ont des aiguilles plus
ou moins longues & fortes fuivant l’emploi qu’ils
en veulent faire. 11 fe fervent de fept ef'peces diffé- .
rentes qu’ils diftinguent par les noms d'aiguilles à 2 , :
à 4 , à 6 , à § | à 10 , à 11 & à 14 fils. Celle à 2 fils , ■
eft celle où un fil fimple paffe dans le chat du-Yaiguille
, parce que ce fil te replie fur lui-meme , &
que les vôiliers emploient toujours le fil ainfi plié
& formant Un double : la groffeur du fil à voile eft
d’ailleurs conftamment la même.
U aiguille la plus courte 8üâ plus foible , eft celle
à deux'fils qui a 35 lignes de longueur ; celle à 14
fils en a 55. Cette derniere a jufqu’à quatre lignes
de diamètre à fa plus grande largeur ; les autres ont
proportionnellement une largeur égale. Toutes ont
le tiers ou la moitié de leur longueur totale triangulaire
; & c’eft la partie qui fe termine en pointe
qui a cette forme. Les angles' en font allez aigus
pour divifef facilement fans couper cependant. C ’eft
vers la moitié de la partie triangulaire que l’on
donne la plus grande largeur à Y aiguille qui furpaffe
la groffeur totale des fils , afin de leur ménager un
paflage facile. Le refte de Y aiguille eft arrondi, percé
à la tête d’une ouverture longitudinale pour recevoir
le fil, fait en un mot, fur le modèle des aiguilles
à coudre ordinaires.
Pour faire percer ces aiguilles , les voiliers fe
fervent d’un infiniment qui fe nomme pomelle, &
qui leur tient Heu de dé. Ils ont auffi un .autre infiniment
qu’ils nomment un poinçon , & qui leur fert a
préparer un paffage à Y aiguille entre les torons des
ralingues , lorfque ces ralingues cedent avec trop
de difficulté. . -
Outre ces aiguilles, les voiliers en Connoiffent une
autre fous le nom d'aiguille à merliner, faite fur la
forme de toutes les autres, mais longue de cinq
pouces, & de deux lignes feulement de plus fort
diamètre : elle fert à paffer du merlin. (M. le Chevalier
DE LA CoVDRAYE.) 4 î
* AIGUILLÉ , ée , adj. ( Minéralogie, Chyme. )
compofé de parties femblables à des aiguilles. Les
iels alkàlis âont on fe fert pour abforber les fels
acides dit fôufre commun, r-éduifent l’argent en
A I G ^31
maffe brune & aiguillée'. Mem. de l'Acad. Royale des
Sciences de Paris, ann.,fjoo_. Dict',. dé Trévoux.
* Aiguillée , f. € i( Arts médian,, fingere, Couturière
, 1 TailleurCordonnier, &c. ) certaine longueur
de fil, de foie ou "de laine, qu’on paffe dans une
aiguille.
La préparation des ‘aiguillées dont fe fert le cof-
dopnier po.mr les coutures lacées, a quelque chofe
de particulier. Il-s’agit d’unir plufièurs gros fils èn-
fembLév, & d’y attacher une foie de fanglier: car
celles de1 cochon ne font pas fi bonnes., étant trop
molles: Pour cet effet, prenez au peloton de gros
fil autant de.longueur de fil qii?il vous enfant, félon
ja-couture queivo.us allez faire : redpublez alfez de
brinseppui fermer, une aiguillée de la groffeur dont
Vous avez'befoin ^mais , avant chaque redouble-
mênt ,' ibsagit de rompre de f i l , afin que tous les
brins:fe ufeiLvent ifépàrés L’un de l’antfe : pour cet
effc:t«, afiiâ de fairei un autre brin ; commencez par
détordre le fil fur.votre .genou avec la pàuine de la
main.j-puis tirez & arrachez ; il fe fera des effilogeu-
resri-oontinuez. ton jours ainfi à Chaque bóutde Yaif
§■ ^^8:^1011165 ceseffilogeuresdes bouts fe trouve-?
rontJnatureliement inégales ,' les Unes plus1 longues ,
lès .autres plus courtes, ce qui formera Aine pointé
alongée, êe votre aiguillée fera terminée par deux
pointesde fil, une àcchaquerbout : tordez toutes ces
pointes en travers fur votre’genou, pouflarit en avant
le i plaît de là mainlj & poiftèz avec la réline ; -vous
aurez.Une pointe alongée & fine , compofée tPeffilo-
geures .: prenez eniuiteuriè foie de fanglier æ ., fig. 0 ,
j pl. I ,Art du Cordonnier, Suppl. , féparez-la • en deux
■ brins bb parfon bout mince , jufqu’ à un peu au - delà
du milieu de fa longueut; puis avançant là pointé
de votreaiguillée enXre lesdeuxfufdites réparations,
8c même un peu au-delà de l ’endroit où elles finif-
fent, repliez cefiirplus .d.ûir le haut des deux brins
où ils fe réunifient,, tordez le bout de Y aiguillée avec
le brin e de la foie , & tout dé fuite l’autre brin, ob-
ferVant d’engager préfentement.la peinte de Yaiguillée
dans celui-ci-, obfervant encore de ne le pas
tordre jufqu’au bout, à un travers de doigt près f ;
cela étantfait, prenez l’alêne à joindre ; avec laquelle
vous percerez un trou au travers de Y aiguillée en g ,
au-deffous & tout auprès du bou-t de foie/refté en
l’air ; retirez l’alêne ? & prenant l’autre extrémité de
la foie qui en eft le gros bout, vous l’abaifferez pouf
! l’amener au trou g que l’alêne vient de faire ; vous
le ferez paffer au travers, & le tirerez en h aut, juf-
: qû’à ce que: vous l’ayez ramené tout droit comme il
étoit auparavant : on recommence, quand bn v eu t,
cette derniere opération une fécondé fois, faifant
un fécond trou avec l’alêne au.-dèffous du premier;
la jonflion en eft plus folide : on fait-la même chofe
à l’autre bout de la même aiguillée; car chaque bout
doit être terminé par une foie.
La figure C , marquée des lettres qu’on vient d’expliquer,
montre quatre tems fucceffifs pour attacher
la foie à Y aiguillée.
Le premier fait voir Y aiguillée C entre les deux réparations
W de la foie.
Le fécond eft une féparation tordue , & le bout
pointu d de Y aiguillée recourbé fur l’autre réparation.
- ,
Le troifieme eft la fécondé réparation tordue à
Y aiguillée, excepté le bout ƒ refté en l’air.
/."Le quatrième fait voir le trou fait en g- par l’alene*
Le bout de la foie qu’on vient de faire paffer au travers
, eft prêt à être tiré en haut, pouf ferrer l’anneau
qu’il a formé en paffant»
On vient de voir que les deux bouts de Yaiguillée
ont été tordus fur le genou, puis poiffés, & enfuite
attachés aux foies-; il s’agit maintenant de donner- à
to.itt le refte de l'aiguillée un tors un peu lâche i caf.