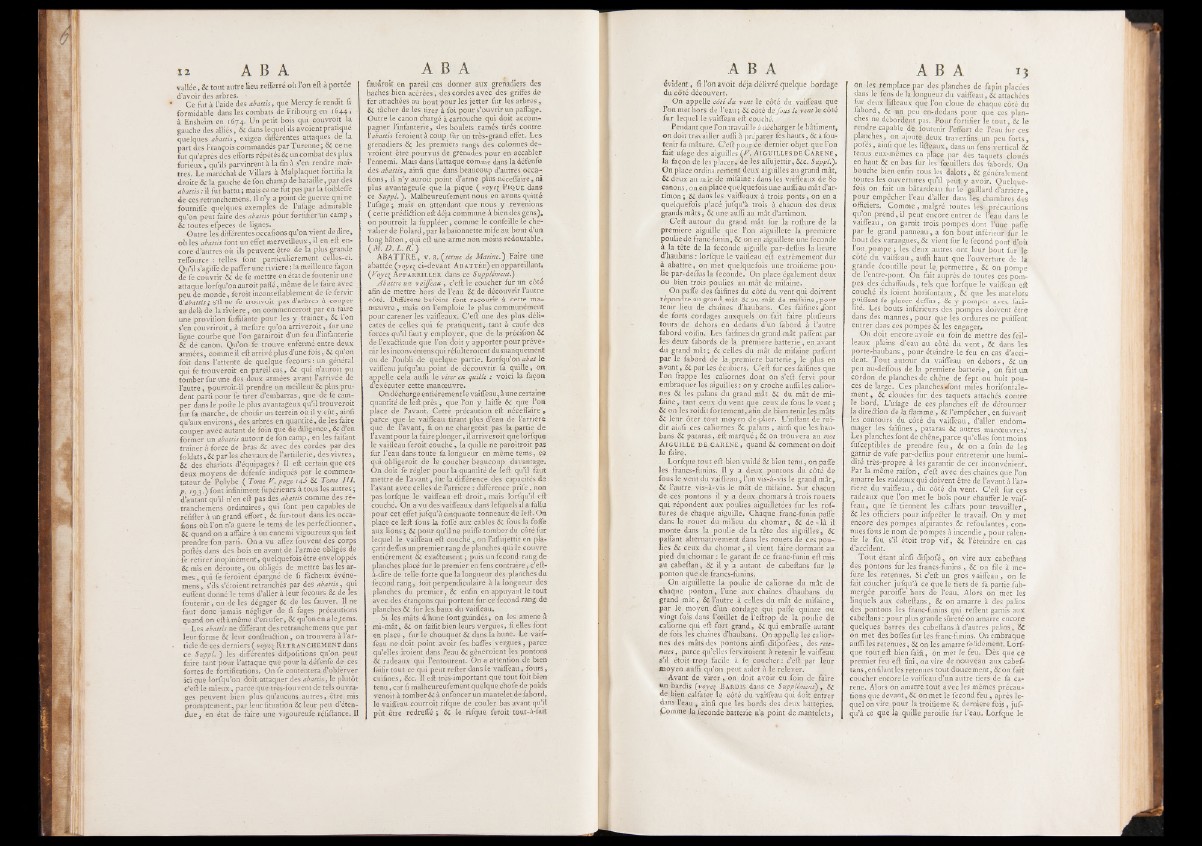
vallée, & tout autre lieu refferré oh l’on eft à portée
d’avoir des arbres. '
Ce fut à l’aide des abattis, que Mercy le rendit li
formidable dans les combats de Fribourg en 1644,
à Ensheim en 1674. Un petit bois qui couvroit la
gauche des alliés, 8c dans lequel ils avoient pratiqué
quelques abattis, exigea differentes attaques de la
part des François commandes par Turenne ; 8c ce ne
fut qu’après des efforts répétés 8c un combat des plus
furieux, qu’ils parvinrent à la fin à s’en rendre maîtres.
Le maréchal de Villars à Malplaquet fortifia la
droite 8c la gauche de ion champ de bataille, par des
abattis : il fut battu ; mais ce ne fut pas par la foibleffe
de ces retranchemens. Il n’y a point de guerre qui ne
fourniffe quelques exemples de l’ufage admirable
qu’on peut faire des abattis pour fortifierun camp,
& toutes efpeces de lignes. _
Outre les différentes occafions qu’on vient dedire,
oh les abattis font un effet merveilleux, il en eft encore
d’autres oh ils peuvent être de la plus grande
reffource : telles font particulièrement celles-ci.
Qu’il s’agiffe de paffer une riviere : la meilleure façon
de fe couvrir 8c de fe mettre en état de foutenir une
attaque lorfqu’on auroit paffé, même de le faire avec
peu de monde, feroit inconteftablement de fe fervir
d'abattis; s’il ne fe trouvoit pas d’arbres à couper
au delà de la riviere, on commenceroit par en faire
une provifion fuffifante pour les y traîner, & Ion
s’en couvriroit, à mefiire qu’on a r r iv e ro itfu r une
ligne courbe que l’on garnirait d’un feu d’infanterie
& dé canon. Qu’on fe trouve enfermé entre deux
armées, comme il eft arrivé plus d’une fois, 8c qu’on
foit dans l’attente de quelque fecours : un général
qui fe trouveroit en pareil cas, Sc qui n’aurait pu
tomber fur une des deux armées avant l’arrivée de
l’autre , pourroit-il prendre un meilleur 8c plus prudent
parti pour fe tirer d’embarras, que de fe camper
dans le pofté le plus avantageux qu’il trouveroit
fur fa marche, de choifir un terrein oh il y eût, ainfi
qu’aux environs, des arbres en quantité, de les faire
couper avec autant de foin que de diligence, & d’en
former un abattis autour de fon camp, en les faifant
traîner à force de bras & avec des cordes par des
foldats, 8c par les chevaux de l’artillerie,, des vivres,
& des chariots d’équipages ? Il eft certain que ces
deux moyens de defenfe indiqués par le commentateur
de Polybe ( Tome V . page 14S 8c Tome III.
p . 1^3.) font infiniment fupérieurs à tous les autres;
d’autant qu’il n’en eft pas des abattis comme des ré-
tranchemens ordinaires, qui font peu capables de
réfifter à un grand effort, 8c fur-tout dans les occafions
où l’on n’a guère le teins de les perfeôionner,
& quand on a affaire à un ennemi vigoureux qui fait
prendre fon parti. On a vu affez fouvent des corps
poftés dans des bois en avant de l’armée obligés de
fe retirer inopinément, quelquefois être enveloppés
& mis en déroute, ou obligés de mettre bas les armes
, qui fe feroient épargné de fi fâcheux événe-
mens, s’ils s’étoient retranchés par des abattis , qui
euffent donné le tems d’aller à leur fecours & de les
foutenir, ou de les dégager 8c de les fauver. Il ne
faut donc jamais négliger de fi fages précautions 1
quand on eftàmême d’enufer, 8c qu’on eh aleJ:ems.
Les abattis ne différant des retranchemens que par
leur forme & leur conftruftion, on trouvera à l’article
de ces derniers (v&ye^ Retranchement dans
ce Suppl. ) les différentes difpofitions qu’on peut
faire tant pour l’attaque que pour la défenfe de ces
fortes de fortifications. On fe contentera d’obferver
ici que lorfqu’on doit attaquer des abattis, le plutôt
c’eft le mieux, parce que très-fouvent de tels ouvrages
peuvent bien plus qu’aucuns autres,.être mis
promptement, par leur fituation 8c leur peu d’étendue
, en état de faire une vigoureufe réfiftançe. Il
faudroit en pareil cas donner aux grenadiers des
haches bien acérées, des cordes avec des griffes de
fer attachées au bout pour les jetter fur. les arbres,
8c tâcher de les tirer à foi pour s’ouvrir un paffage.
Outre le canon chargé à cartouche qui doit accompagner
l’infanterie, des boulets ramés tirés contre
Xabattis feroient à coup fûr un très-grand effet. Les
grenadiers 8ç les premiers rangs des colonnes de-
vroient être pourvus de grenades pour en accabler
l’ennemi. Mais dans l’attaque comme dans la défenfe
des abattis, ainfi que dans beaucoup d’autres occafions
, il n’y auroit point d’arme plus néceffaire, ni
plus avantageufe que la pique ( voye^ Pique dans
ce Suppl. ). Malheureufement nous en avons quitté
l’ufage; mais en attendant que nous y revenions
( cette prédiction eft déjà commune à bien des gens),
on pourroit la fuppléer, comme le confeille le chevalier
de Folard, par la baïonnette mife au bout d’un
long bâton, qui eft une arme non moins redoutable.
( M. D . L. R . )
A BA TTR E , v . a. ( terme de Marine.) Faire une
abattée (yoyt{ ci-devant Abattée) en appareillant.
(J^oye^ Appareiller dans ce Supplément.)
Abattre un vaijfeau, c’eft. le coucher fur un côté
afin de mettre hors dé Peau 8c de découvrir l’autre
côté. Différens befoins font recourir à cette manoeuvre
, mais on l’emploie le plus communément
pour carener les vaiffeaux. C’eft une des plus délicates
de celles qui fe pratiquent, tant à caufe des
forces qu’il faut y employer, que de la précifion 8c
de l’exaCtitude que l’on doit y apporter pour prévenir
lesinconvéniens qui réfulteroient dumanquement
ou de l’oubli de quelque partie. Lorfqu’on abat le
vaiffeau jufqu’au point de découvrir fa quille, o n ,
appelle cela aufli le virer en quille : voici la façon
d’exécuter cette manoeuvre.
On décharge entièrement le vaiffeau, à une certaine
quantité de left près , que l’on y laiffe & que l’on
place de l’avant. Cette précaution eft néceffaire ,
pafee que le vaiffeau tirant plus d’eau de l ’arriere
que de l’avant, fi on ne chargeoit pas la partie de
l’avant pour la faire plonger, il arriveroit quelorfque
le vaiffeau feroit couché, la quille ne paroîtroit pas
fur l’eau dans toute fa longueur en même tems, ce
qui obligeroit de le coucher beaucoup davantage.
On doit fe régler pour la quantité de left qü’il faut
mettre de l’avant, fur la différence des capacités de
l’avant avec celles de l’arriere : différence prife, non
pas lorfque le vaiffeau eft droit, mais lorfqu’il eft
couché. On a vu des vaiffeaux dans lefquels il a fallu
pour cet effet jufqu’à cinquante tonneaux de left. On
place ce left fous la foffe aux cables 8c fous'la foffe
aux lions ; 8c pour qu’il ne puiffe tomber du côté fur
lequel le vaiffeau eft couché,. on.l’aflujettit en plar
çant deffus un premier rang de planches qui le couvre
entièrement 8c exaélément ; puis un fécond rang de
planches placé fur le premier en fens contraire ,.c’eft-
à-dire de telle forte que la longueur des planches du
fécond rang , foit perpendiculaire à la longueur des
planches du premier, & enfin en appuyant le tout
avec des étançons qui portent fur ce fécond rang de
planches 8c fur les. baux du vaiffeau.
Si les mâts d’hune font guindés , on les amene à
mi-mât, & on faifit bien leurs vergues, fi elles font
en place, fur le ehouquet 8c dans la hune. Le vaiffeau
ne doit point avoir fes baffes vergues, parce
qu’elles iraient dans l’eau 8c gêneroient les pontons
& radeaux qui l’entourent. On a attention de bien
faifir tout ce qui peut refter dans le vaiffeau, fours,
cuifines, &c. Il eft très-important que tout foit bien
tenu, car fi malheureufement quelque chofe de poids
venoit à. tomber 8c à enfoncer un mantelet de fabord,
le vaiffeau courrait rifque de couler bas avant qu’u
pût être redreffé ; & le rifque feroit tout-à-fait
évident, fï l’on avoit déjà délivré quelque bordage
du coté découvert.
On appelle côté du vent le côté du vaiffeau que
l’on met hors de l’eau; 8c côté de fous le vent le côté
fur lequel le vaiffeau eft couché. r ^
Pendant que l’on travaille à décharger le bâtiment,
on doit travailler aufli à préparer fes hauts, Sc à foutenir
fa mâture. C’eft pour ce dernier objet que l’on
fait ufage des aiguilles (Z'. Aiguilles de Caréné,
la façon de les placer, de les affujettir, 8cc. Süppl.').
On place ordinairement deux aiguilles au grand mât,
& deux au mât de mifaine : dans les vaiffeaux de 80
canons, on en place quelquefois une aufli au mât d’artimon
; 8c dans les vaiffeaux à trois ponts, on en a
quelquefois placé jufqu’à trois à chacun des deux
grands mâts, 8ç une aufli au mât d’artimon.
C ’eft autour du grand mât fur la rofture de la
première aiguille que l’on aiguillete la première
poulie de franc-funin, 8c on en aiguillete une fécondé
à la tête de la fécondé aiguille par-deffus la Heure
d’haubans : lorfque le vaiflèau eft extrêmement dur
à abattre, on met quelquefois une troifieme poulie
par-deffus la fécondé. On place également deux
ou bien trois poulies au mât de mifaine.
On paffe des faifines du côté du vent qui doivent
répondre au grand, mât 8c au mât de milaine,pour
tenir lieu de chaînes d’haubans. Ces faifines /ont
de forts cordages auxquels on fait faire plufieurs
tours de dehors en . dedans d’un fabord à l’autre
fabord voifin. Les faifines du grand mât paffent par
les' deux fabôrds de la première batterie , en avant
du grand mât ; 8c celles du mât de mifaine paffent
par le fabord de la.première batterie, le plus en
avant, 8c par les écubiers. C ’eft fur ces faifines que
l’on frappe les .caliornes dont on s’eft fervi pour
embraquer les aiguilles : on y croche aufli les caUor-
nes 8c les palans du grand mât 8c du mât de mifaine
, tant ceux du vent que ceux de fous le vent ;
8c on les raidit fortement, afin de bien tenir les mâts
& leur ôter tout moyen de-plier. L’inftant de roi-
dir ainfi ces caliornes 8c palans , ainfi que les haubans
8c pataras, eft marqué ; 8c on trouvera au mot
A iguille de caréné, quand & comment on doit
le faire.
Lorfque.tout eft bien vuidé 8c bien tenu, on paffe
les françs-funins. Il y a deux pontons du côté de
fous le vent du vaiffeau , l’un vis-à-vis le grand mât,
8c l’autre vis-à-vis le mât de mifaine. Sur chacun
de ces pontons il y a deux chomars à trois rouets
qui répondent aux poulies aiguilletées fur les rof-
tures de chaque aiguille. Chaque franc-funin paffe
dans le rouet du milieu du chomar, 8c d e - là il
monte dans la poulie de la tête des aiguilles, 8c
paffant alternativement dans les rouets de ces poulies
8c ceux du chomar y il vient faire dormant au
pied du chomar.: le garant de ce franc-funin eft mis
au çabeftan, 8c il y a autant de cabeftans fur le
ponton que: de francs-funins.
On aiguillette la poulie de caliorne du mât de
chaque ponton , l’ùne aux chaînes d’haubans du
grand mât, & l’autre à celles du mât de mifaine,
par le moyen d’un cordage qui paffe quinze ou
vingt fois dans l’oeillet de l’eftrop de la poulie de
.caliorne qui eft fort grand, 8c qui embraffe autant
de fois, les chaînes d’haubans. On appelle les caliornes
des mâts des pontons ainfi difpofées, des retenues,
parce qu’elles ferviroient à retenir le vaiffeau
s’il étojjt trop facile à fe coucher : C’eft par leur
moyen aufli qu’on peut aider à le relever.
Avant de .vire r , on doit avoir eu foin de faire
«n bardis (voyeç Bardis. dans ce Supplément) , 8c
de bien .calfater le côté du vaiffeau qui doit entrer
dans? l’eau , ainfi que les bords des deux batteries.
£pmme la fécondé batterie n’a point de mantelets,
on les remplace par des planches de fapin placées
dans le fens de la longueur du vaiffeau, & attachées
fur deux lifteaux que l’on cloue de chaque côté du
fabord, ôc un peu en-dedans pour que ces planches
ne débordent pas. Pour fortifier le tout, 8c le
rendre capable de foutenir l’effort de l’eau fur ces
planches, on ajoute,deux traverfins un peu forts,
pofes, ainfi que les lifteaux, dans un fens .vertical 8c
tenus eux-mêmes en place par des taquets cloués
en haut 8c en bas fur les foeuillets des fabords. On
bouche bien enfin tous les dalots, 8c généralement
toutes les ouvertures qu’il peut y avoir. Quelquefois
on fait un batardeau fur le gaillard d’arriere,
pour empecher l’eau d’aller dans les chambres des
officiers. Comme , malgré toutes les précautions
qu’on prend, il peut encore entrer de l’eau dans le
vaiffeau, on garnit trois pompes dont l’une paffe
par le grand panneau, a fon bout inférieur fur le
bout des varangues, 8c vient fur le fécond pont d’où,
l’on, pompe ; les deux autres ont leur bout fur le
côté du vaiffeau, aufli haut que l’ouverture de la
grande écoutille peut le. permettre, 8c on pompe
de l’entre-pont. On fait auprès de toutes ces pompes
des échaffauds, tels que lorfque le vaiffeau eft
couché ils foient horifontaux, 8c que les matelots
puiffent fe placer deffus, 8c y pomper avec facilite.
Les bouts -inférieurs des pompes doivent être
dans des mannes, pour que les ordures ne puiffent
entrer dans ces pompes 8c les engager.
On doit encore avoir eu foin de mettre des feil-
leaux pleins d’eau au côté du vent, 8c dans les
porte-haubans, pour éteindre le feu en cas d’accident.
Tout autour du vaiffeau en dehors, 8c un
peu au-deffous de la première batterie , on fait un
cordon de planches de chêne de fept ou huit pouces
de large. Ces planches-font mifes horifontale-
ment, 8c clouées fur des taquets attachés contre
le bord. L’ufage de ces planches eft de détourner
la direction de la flamme , 8c l’empêcher, en fuivant
les contours du côté du vaiffeau, d’aller endommager
les faifines, pataras 8c autres manoeuvres."
Les planches font de chêne, parce qu’elles font moins
fufceptibles de prendre fe u , 8c on a foin de les
garnir de vafe par-deffus pour entretenir une humidité
très-propre à les garantir de cet inconvénient.
Par la même raifon, e’eft avec des chaînes que l’on
amarre les radeaux qui doivent être de l’avant à l’arriere
du vaiffeau, du côté du vent. C ’eft fur ces
radeaux que l’on met le bois pour chauffer le v a iffeau
, que fe tiennent les calfats pour travailler ,
8c les officiers pour infpe&er le travail. On y met
encore des pompes afpirantes 8c refoulantes, connues
fous le nom de pompes à incendie , pour ralentir,
le feu s’il étoit trop v i f , 8c l’éteindre en cas
d’accident.
Tout étant ainfi difpofé, on vire aux cabeftans
des pontons fur les francs-funins , 8c on file à me-
fore .les retenues. Si c’eft un gros vaiffeau, on le
fait coucher jufqu’à ce que le tiers de fa partie fub-
mergée paroiffe hors de l’eau. Alors on met les
Hnquels aux cabeftans, 8c on amarre à des palins
des pontons les frànc-funins qui reftent garnis aux
cabeftans : pour plus grande sûreté on amarre encore
quelques barres des cabeftans à d’autres palins, 8c
on met des boffes fur les franc-funins. On embraque
aufli les retenues, 8c on les amarre folidemeht. L o r fque
tout eft bien faifi, ôn met le feu. Dès que ce
premier feu eft fini, on vire de nouveau aux cabeftans,
en filant les retenues tout doucement, 8con fait
coucher encore le vaiffeau d’un autre tiers de fa caréné.
Alors on amarre tout avec les mêmes précautions
que devant, 8c on met le fécond feu , après lequel
on vire pour la troifieme 8c derniere fo is , jufqu’à
ce que la quille paroiffe fur l’eau. Lorfque le