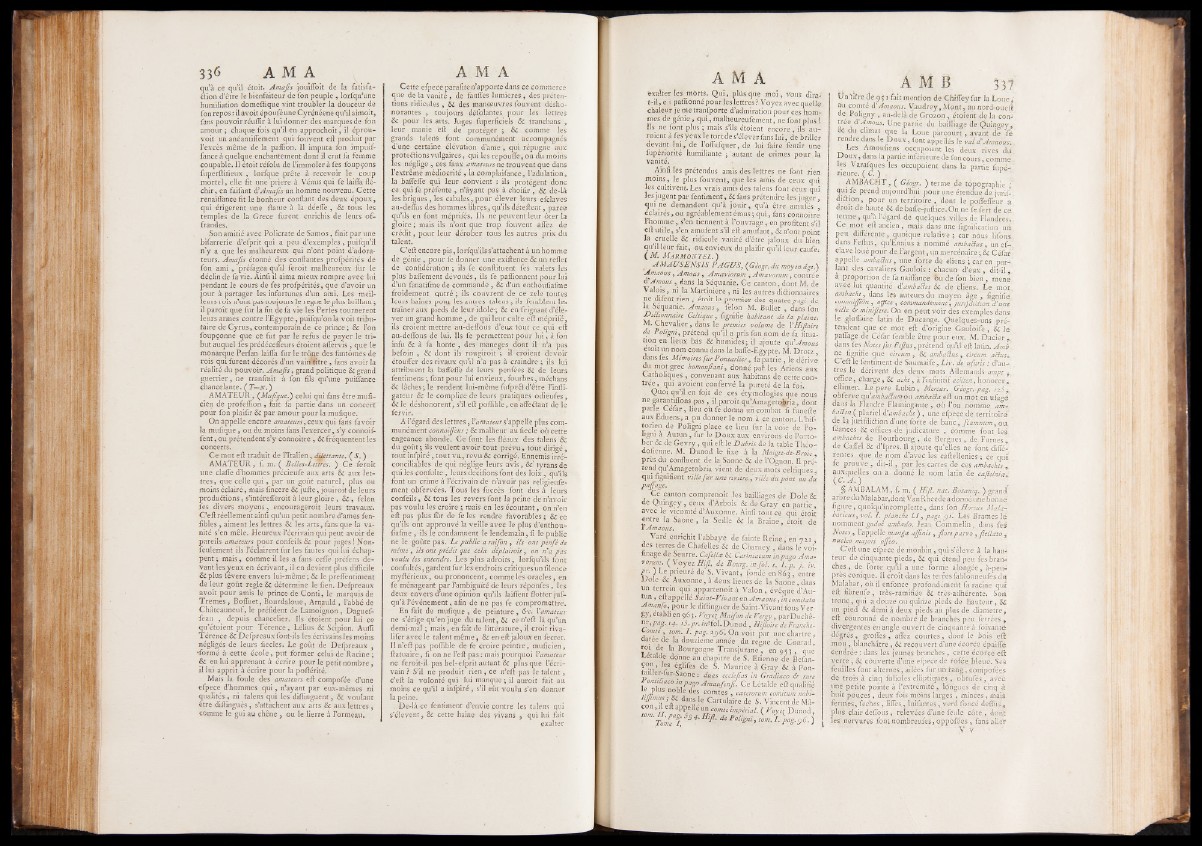
qu’à ce qu’il ëtoit. Amafis jouiffoit de la fatisfa-
âion d’être le bienfaiteur de fon peuple | lorfqu’une
humiliation domeftique vint troubler la douceur de
fon repos : il avoit époufé une Cyrénéene qu’il aimoit,
fans pouvoir re'uflir à lui donner des marques de fon
amour ; chaque fois qu’il en approchoit, il éprou^-
yoit un anéantiffement qui fouvent eft produit par
l’excès même de la paffion. 11 imputa ion impuif-
fance à quelque enchantement dont il crut fa femme
coupable. Il étoit réfolu de l’immoler à fes foupçons
fuperflitieux , lorfque prête à recevoir le coup
mortel, elLe fit une priere à Vénus qui fe lailfa-fléchir,
en faifant d'Amafis un homme nouveau. Cette
renaiffance fit le bonheur confiant des deux époux,
qui érigerent une ftatue à la déeffe , & tous les
temples de la Grèce furent enrichis de leurs offrandes.
Son amitié avec Policrate de Samos, finit par une
bifarrerie d’efprit qui a peu d’exemples, puifqu’il
n’y a que les malheureux qui n’ont point d’adorateurs.
Amafis étonné des confiantes profpérités de
fon ami , préfagea qu’il feroit malheureux fur le
déclin de fa vie. Ainfi il aima mieux rompre avec lui,
pendant le cours de fes profpérités, que d’avoir un
jour à partager les infortunes d’un ami. Les meilleurs
rois n’ont pas toujours le régné le plus brillant;
il paroît que fur la fin de fa vie les Perfes tournèrent
leurs armes contre l’Egypte, puifqu’onla voit tributaire
de Cyrus, contemporain de ce prince; Sç l’on
foupçonne que ce fut par le refus de payer le tribut
auquel fes prédéceffeurs étoient affervis , que le
monarque Perfan laifla fur le trône des fantômes de
rois qui furent décorés d’un vainüitre , fans avoir la
réalité du pouvoir. Amafis, grand politique & grand
guerrier, ne tranfmit à fon fils qu’une puiflanee
chancelante. ( T—n . )
AMATEUR, (Mufique.) celui qui fans être mufi-
cien de profeflîon , fait fa partie dans un concert
pour fon plaifir & par amour pour la mufique.
On appelle encore amateurs, ceux qui fans favoir
la mufique, ou du moins fans l’exercer, s’y connoif-
fent, ou prétendent s’y connoître , & fréquentent les
concerts.
Ce mot eft traduit de l’Italien, dilatante. ( S . )
AMATEUR, f. m. ( B elles-Lettres. ) Ce feroit
une claffe d’hommes précieufe aux arts & aux lettres,
que celle q u i, par un goût naturel, plus ou
moins éclairé, mais fincere & jufte, jouiroit de leurs
produirions, s’intérefleroit à leur gloire , Sç-, félon
fes divers moyens, encourageroit leurs travaux.
C ’eft réellement ainfi qu’un petit nombre d’ames fen-
fibles , aiment les lettres & les arts, fans que la vanité
s’en mêle. Heureux l’écrivain qui peut avoir de
pareils amateurs pour confeils & pour juges ! Non-
feulement ils l’éclairent fur les fautes qui lui échappent
; mais , comme il les a fans ceffe préfens devant
les yeux en écrivant, il en devient plus difficile
&plus fevere envers lui-même; & le preflentiment
de leur goût réglé & détermine le lien. Defpreaux
avoit pour amis le prince de Conti, le marquis de
Tremes, Boffuet, Bourdaloue, Arnauld , l’abbé de
Châteauneuf, le préfident de Lamoignon , Daguef-
feau , depuis chancelier. Ils étoient pour lui ce
qu’étoient pour Térence, Lélius & Scipion. Auffi
Térence & Defpreaux font-ils les écrivains les moins
négligés de leurs fiecles. Le goût de Defpreaux ,
‘formé à cette éco le, put former celui de Racine ;
& en lui apprenant à écrire pour le petit nombre,
il lui apprit à écrire pour la pofiérité.
Mais la foule des amateurs efi compofée d’une
efpece d’hommes q u i, n’ayant par eux-mêmes ni
qualités, ni talens qui les difiinguent, & voulant
être diftingués , s’attachent aux arts & aux lettres,
comme le. gui au chêne, ou le lierre à l’ormeau.
Cette efpece parafiten’apporte dans ce commerce
que de la vanité, de faulTes lumières , des prétentions
ridicules , Sç des manoeuvres fouvent déshonorantes
, toujours défolantès. pour les lettres
& pour les arts. Juges fuperficiels Sç tranchans ,
leur manie ëft de protéger ; Sç comme les
grands talens font communément accompagnés
d’une certaine élévation d’ame, qui répugne aux
protégions vulgaires, qui les réponde, ou du moins
les néglige , ces faux amateurs ne trouvent que dans
l’extrême méd io c r ité la complaifance, l’adulation,
la baffe fie qui leur convient ; ils protègent donc
ce qui fe préfente , n’âyant pas à choifir , Sç de-là
lés brigues, les cabales- pour élever leurs efclaves
au-deffus des hommes libres, qu’ils détellent, parce
qu’ils en font méprifés. Ils ne peuvent leur ôter la
gloire ; mais ils n’ont que .trop fouvent affez de
crédit, pour leur dérober tous les autres prix du
talent.
C ’eft encore pis, lorfqu’ils s’attachent à un homme
de génie , pour fe donner une exifte.nce Sç un reflet
de confidération ; ils fe conftituent fes valets les
plus baffement dévoués, ils fe paffionnent pour lui
d’un fanatifme de commande, & d’un enthoufiafme
froidement Qutré ; ils couvrent de ce zele toutes
leurs haines pour les autres talens, ils femblent les
traîner aux pieds de leur idole*; & en feignant d’élever
un grand homme , de qui leur culte eft méprifé,
ils croient mettre au-deffous d’eux tout ce qui eft:
au-deffous de lui. Ils fe permettent pOur lu i, à fon
infu & à fa honte , des maneges dont il n’a pas
befoin , Sç dont ils rougiroit ; il" croient devoir
étouffer des rivaux qu’il n’a pas à craindre ; ils lui
attribuent la baffeffe dé leurs penfées & de leurs
fentimens ; font pour lui envieux, fourbes, méchans
& lâches ; le rendent lui-même fufpeéi d’être l’infti-
gateur & le complice de leurs pratiqués odieufes,
Sç Je déshonorent, s’il eft poffible, en affectant de le
fervir.
A l’égard des lettres, Y amateur s’appelle plus communément
connoijfeur ; & malheur au fieele où cette
engeance abonde. Ce font les fléaux des talens &z
du goût; ils veulent avoir tout prévu, tout dirigé ,
tout infpiré, tout v u , revu & corrigé. Ennemis irréconciliables
de qui néglige leurs avis, Sç tyrans de
qui les confulte , leurs decifions font des lo ix , qu’ils
font un crime à l’écrivain de n’avoir pas religieufe-
ment obfervées. Tous les fuçcès font dus à leurs
confeils, & tous les revers font la peine de n’avoir
pas voulu les croire ; mais en les écoutant, on n’en
eft pas plus fur de fe les rendre favorables ; & ce
qu’ils ont approuvé la veille avec le plus d’enthou-
fiafme , ils le condamnent le lendemain, fi le public
ne le goûte pas. Le public a raifon , ils ont penfé de
même , ils ont prédit que cela déplairoit, on ri a pas
voulu les entendre. Les plus adroits, lorfqu’ils font
confultés, gardent fur les endroits critiques un filence
myftérieux, ou prononcent, comme les oracles, en
fe ménageant par l’ambiguïté de leurs réponfes, les
deux envers d’une opinion qu’ils laiffent flotter juf-
qu’à l’événement, afin de ne pas fe compromettre.
En fait de mufique , de peinture , &c. Yamateur
ne s’érige qu’en juge du talent, & ce n’eft là qu’un
demi-mal; mais, en fait de littérature, il croit riva-
lifer aveclé talent même, & en eft jaloux en fecret.
11 n’eft pas poffible de fe croire peintre, muficien,
ftatuaire, fi on ne l’eft pas : mais pourquoi Y amateur
ne feroit-il pas bel-efprit autant Sç plus que l’écrivain
? S’il ne produit rien , ce n’eft: pas le talent,
c’eft la volonté qui lui manque ; il auroit fait au
moins ce qu’il a infpiré , s’il,éût voulu s’en donner
la peine.
. De-là ce fentiment d’envie contre les talens qui
s’élèvent, & cette haine des vivans , qui lui fait
exalter
Exalter tes morts. Q u i, plus que moi, Vous dira-
t-il, eii paffionnépour les lettres? Voyez avec quelle
chaleur je nie transporte d’admiration pour ces hommes
de génie, qui, malheureufement, ne font plus 1
Ils ne font plus ; mais s’ils étoient encore , ils au-
roient à fes ÿéux le tort de s’élever fans lui, de briller
devant lu i, de l’offufquer, de lui faire Sentir une
Supériorité humiliante ; autant de crimes pour la
vanité.
Ainfi les prétendus amis des lettres ne fönt rien
moins,de plus fouvent, que les aniis de ceux qui
les cultivent. Les vrais amis des talens font ceux qui
les jugent par fentiment, Sç fans prétendre les juger,
qui ne demandent qu’à jouir, qu’à être amufés ■
éclairés, ou agréablement émus; qui, fans connoître
l’homme , s’en tiennent à l’ouvrage en profitent s’il
eft utile, s’en amufent s’il eft amufant, & n’ont point
la cruelle & ridicule vanité d’être jaloux du bien
qu’il leur fait, ou envieux du plaifir qu’il leur caufei
(M . M à r m o n t e l . )
A MAUSENS IS PAGUS, (Géogr. du moyen âge,)
Amaous, A mous, Amaviorum , Amavorum, contrée
ü A mous, dans la Séquanie. Ce canton, dont M. de
. Valois, ni la Martiniere , ni les autres diérionnaires
ne difent rien , étoit le premier des quatre pagi de
la Séquanie. Amaous, félon M. Bullet , dans fon
Dictionnaire Celtique , fignifie habitant de la plainei
M. Chevalier, dans le premier volume de YHifioire
de Poligni, prétend qu’il a pris fon nom de fa fitua-
tion en lieux bas & humides; il ajoute qu’Amous
etoitun nom connu dans la baffe-Egypte. M ; Drotz ,
dans fes Mémoires fur P omar lier, fa patrie , le dérive
du mot grec homoufiani, donné paf les Ariens aux
Catholiques', convenant aux habitans de cette contrée,
qui avoient confervé la pureté de la foi.
Quoi qu’il en foit de ces étymologies que nous
ne garantiffons pas , il paroît qu’Àmageîojjria, dont
parle Cé far, lieu où fe donna un combat li funefte ~
aux Eduens, a pu donner le nom à ce canton. L’hif*
torien. de Poligni place ce lieu fur la voie de Poligni
à Autun, fur le Doux aux environs de Porto-
ber & de G e v ry , qui eft le Dubris de la table T héo-
dofienne. M. Dunod le fixe à la Moigte-de-Broie ,
près du confluent de la Saône & de l’Ognon. Il pré*
tendqu’Amagetobria vient de'deux mots celtiques,
qui lignifient ville fur une rivière f ville du pont ou du
pajfage.
Ce canton comprenoit .les bailliages de Dole &
de Quingey, ceux d’Afbois & de Gray en partie,
avec le vicomté d’Àuxonne. Ainfi tout ce qui étoit
entre la Saône , la Seille Sç la Braine, étoit de
Y Amaous.
Varë enrichit l’abbaye de faîntè Reine, en 721
des terres de Chafelles & de Charney , dans le voi-
linage de Seurre. Cafellce & Cariniacum in pago A ma-
vorum. (V o y e z H iß de Bourg, in fol. i. L p. j . iv.
pr. ) Le prieuré de S. Vivant, £ondé en #63 , entre
Dole & Auxonne, à deux lieues de la Saône, dans
un terrein qui^ appartenoit à Valon, évêque d’Àu-
tun ,• eft appellé Saint-Vivant en Amaous, in comitatu
Amanfo, pour le diftinguer de Saint-Vivant fous Ver-
gy, établi en 963. VoyeK Maifon de Vergy, par Duchê-
™,pag. i4. iS.pr. fol. Dunod, Hifioire de Franche-
Comté > um. J. pag. 2C)S. On voit par une chartre,
datée de la douzième année du regne de Conrad,
i° l r f la Bourgogne Transjurane. en 953 , que
Létalde donne au chapitre de S. Etienne de Befan-
ço n , les églifes de S. Maurice à Gray & à Pon-
ta\ er-iur-Saone : duas ecdefias in Gradiaco & rure
rontüiaco «2pago Amauftnfi. Ce Létalde eft qualifié :
US j ^es comtes , cceterorum comitum nobi- I
ipimus, r dans le Cartulaire de S. Vincent de Ma- i
con, il eft appelle un comte impérial. ( Voyer Dunod, '
m u m * + «INeeligm, L . i % .3S. )
Un'tiîre clé 9 ^ 1 fait mention de Çhiffey fur la Loue 3'
au comté d’Amaous. Vaudrey, M ont, au nord-oueft
de Poligny , au-delà de Grpzon , étoient de la contrée
d’Amous. Une partie du bailliage dè Quingey,
& du climat que la Loue parcourt, avant de le
rendre dans le D ou x, font appeliés le valdlAnmousi.
Les Amoufiens ocçupoient.les deux rives dii
D o u x , dans la partie inférieure de fon cours, cômmé .
les Varafques les o'ecupoienc dans la partie fupé- '
rieure; ( C. ) . 1
A MB A CH T , ( Géogr. ) terme de topographie |
qui le prend aujourd’hui pour une étendue de jurif- ;
diélion, pour un territoire,. dont le pôffeffeur a
droit de haute & de baffe-jufti,ce. Ôn ne fe iert de cé
terme , qu’à i’ôgard dé quelques, villes de Flandres;.
Ce mot eft ancien, mais dans une lignification un
peu différente, quoique, relative ; car nous . lifonS,
dans Feftus, qu’Ennius à nommé ambactus, un ef-
clave loué pour de l’argent, un mercénaire ; & Céfar
appelle ambactus, une forte de eliens ’; car en par-»,
lant des cavaliers Gaulois : chacun d’eux , clît-il 3
a proportion de fa naiffance ôu de fon bien , mené
avec lui quantité tfambactes Sç de tliens. Le mot,
àmbacht, dans les auteurs du moyen âge , fignifie.
commi fiôn , o ffice , commandement ; jurifdiclion £ une
ville & minifiere. On en peut voir des exemples dans
le gloflàire latin de Ducange. Quelques-uns ^prétendent
que ce mot eft d’origine Gauloife , & lé
paffage de Céfar femble être pour eux. M. Dacier 9.
dans fes Notes fur Feftus, prétend qu’il eft latin. Amb.
ne fignifie que circum, Sç ambactus, circum actus 1
C ’eft le fentiment de Saumaife, Liv. de ufuris .- d’au-*’
très le dérivent des deux mots Allemands' ampt 3
office, charge, Sç acht, à l’infinitif achten, honorer3
eftimer. Le pere Lubin, Mercur. . Gèogr. pag. 12J 3
obferve qu amb actum ôw ambaeta eft un mot, en ulagé
dans la Flandre Flamingante , où l’on, nomme am->
baffen f pluriel d'amb ackt ) , une efpece de'territoire
de là juritdiérion d’une forte de banc, fcamntim, oit
feances & ofîices-de judicature , conime font les
ambachts de Bourbourg , de Bergues, de Fumes
de Caffei Sç d’I près. Il ajoute qu’elles ne font diffé^
fentes, que de nom d’avec les càftellenies ; ce qui
fe prouve , dit-il , par lés. cartes, de ces ambachts ,
auxquelles on a donné le nom latin de cafteLnitz;
( < ^ ) - .
§ AMBALAM , f. m. ( Hifi. nat. Botaniq. ) grand
arbre du Malabar,dont VanRneede adonné une bonne
figure, quoiqu’incomplette, dans fon Hortüs Matai
baricus, vol. 1. planche LL, page g i. Lès Brames le
nomment.godoè ambodo.. Jean Cpmmelin, dans fes
Notes., Yü])-ç>e\\e mangce affinis , flore parvo , fiellato 3
nucleo. majori offeo.
C’eft une efpece de monbin , qui s’élève à la hauteur
de cinquante pieds, Sç qui étend peu fes bran-’
dies , de forte qu’il a une forme âipngée, à-peu-
près conique. Il croît dans les terres fablonneufes du.
Malabar, où il enfonce profondément fa racine qui
eft fibreufe , trcs-ramifiée Sç très-adhérente. Son
tronc, qui a douze ou quirize pieds de Hauteur, Sc
un pied Sç demi à deux pieds au plus dè diamètre,
eft .couronné de nombre de branchés peu ferrées ,
divergentes en angle ouvert de cinqiiâhtë à fôixanté
.degrés, groffes , affez courtes, dont le bois eft:
mou ».blanchâtre , Si recouvert d’une écorce épaiffé
cendrée : dans les jeunes branches , cefte écorce eft
verte ,.$ç couverte d’une efpece de rofée bleue. Ses
feuilles font alternes, ailées fur un fang, conipofées
de trois à cinq folioles elliptiques , ôbtufës , avec
unè petite pointe à l’extrémité , longues de cinq à
huit pouces , deux fois moins larges , minces, mais
fermes, feches, liffes;, luifarites, vèrd foncé defliis ,
plus clair deffous , relevées d’une feule côté , dont
les nervures font nombre lues* oppôfées , fans aller
...............T V . ■