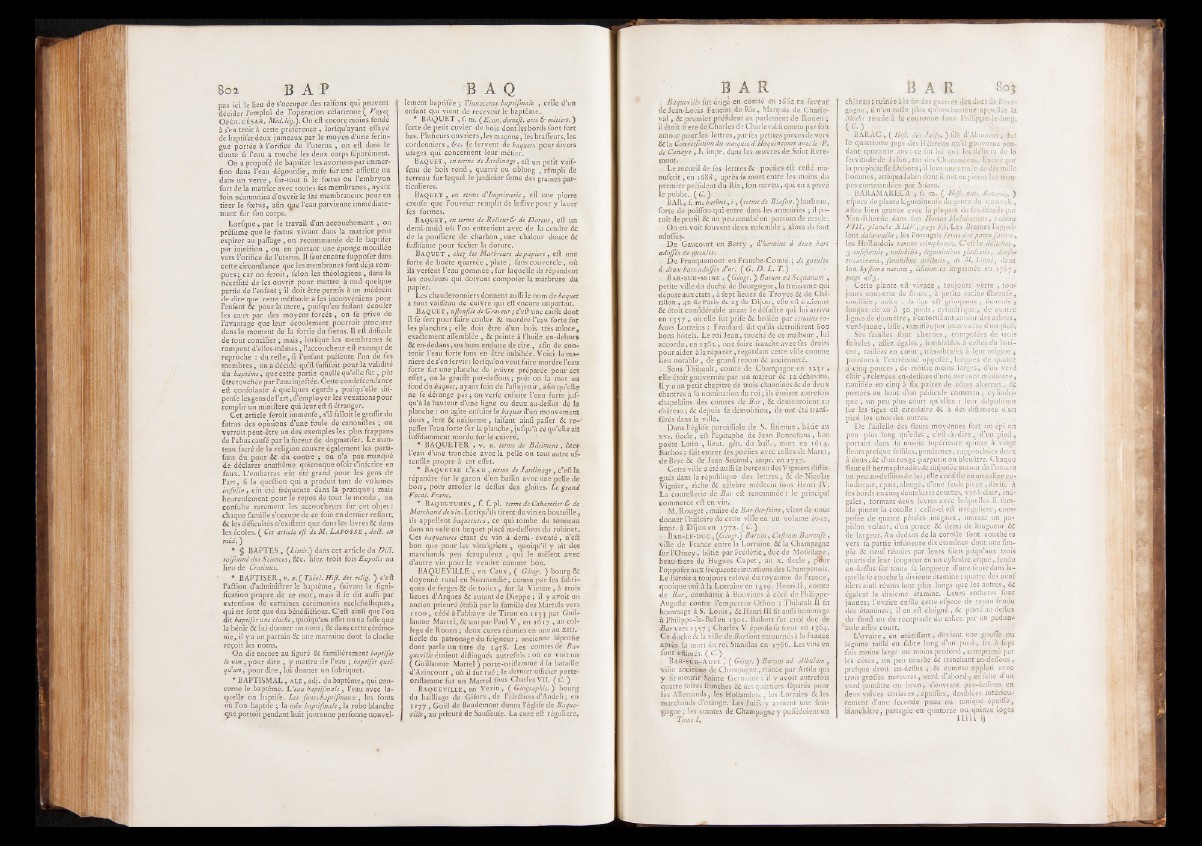
.pas ici le lieu de s’occuper des raifons qui peuvent
décider l’emploi de l’opération céfarienne ( Voye^
O p é r . c é s a r . Méd.lég.). On eft encore moins fondé
à s’en.tenir à cette préférence , lorfqu’ayant effayé
de baptifer deux jumeaux par le moyen d’une ferin-
gue portée à l’orifice de l’uterus , on eft dans le
doute fi l’eau a touché les deiix corps féparément.
On a propofé de baptifer les avortons par immer-
lion dans l’eau dégourdie, mife fur une affiette ou
dans un verre, fur-tout fi le foetus ou l’embryon
fort de la matrice avec toutes fes membranes, ayant
foin néanmoins d’ouvrir le fac membraneux pour en
tirer le foetus, afin que l ’eau parvienne immédiatement
fur fon corps-.
Lorfque-, par le travail d’un accouchement , on
préfume que le foetus vivant dans la matrice peut
expirer au paffage , on recommande de le baptifer
par injection , ou en portant une éponge mouillée
vers l’orifice de l’ uterus. Il faut encore fuppofer dans
cette circonftance que les membranes font déjà rompues
; car on feroit, félon les théologiens , dans la
néceffité de les ouvrir pour mettre à nud quelque
partie de l’enfant ; il doit être permis à un médecin
de dire que cette méthode a fes inconvéniens pour
l'enfant & pour la mere, puifqu’en faifant écouler
les eaux par des moyens forcés , on fe prive de
l’avantage que leur écoulement pourrait procurer
dans le moment de la fortie du foetus. Il eft difficile
de tout concilier ; mais, lorfque les membranes fe
rompent d’elles-mêmes, l’accoucheur eft exempt de
reproche : du refte, fi l^enfant ptéfente l’un de fes
membres, on a décidé qu’il fuffifoit pour la validité
du baptême, que Cette partie quelle qu’elle fu t , pût
"être touchée par l’eau in; eâée. Cette condefcendance
eft •confolante à quelques égards , puifqu’elle dif-
penfe les gens de l’art, d’employer les vexations pour
remplir un miniftere qui leur eft fi étranger.
Cet .article feroit immenfé, s’il falloit le groffir du
fatras des opinions d’une foule de canoniftes ; on
verrait peut-être un des exernples les plus frappans
de l’abus caufé par la fureur de dogmatifer. Le manteau
facré de la religion couvre également les parti-
fans du pour & du contre ; on n’a pas manqué
de déclarer anathème quiconque ofoit s’infcrire en
faux. L’embarras eût été grand pour les gens de
l’art, fi la queftion qui a produit tant de volumes
in-folio , eût été fréquente dans la pratique ; mais
heureufement pour le repos de tout le monde, on
confulte rarement les accoucheurs fur cet objet :
chaque famille s’occupe de ce foin en dernier reffort;
& les difficultés n’exiftent que dans les livres & dans
les écoles. ( Cet article tfl de M, L a f o s s e , docl. en
méd. )
* § BÂPTES , (Littér.) dans cet article du Dicl.
raifonné des Sciences, &C. lifez trois fois Eupolis au
lieu de Cratinus.
’ * BAPTISER, v. a. ( Théol. Hijl. des relig. ) c’eft
l’a&ion d’adminiftrer le baptême, fuivant la lignification
propre de ce mot; mais il fe dit auffi par
extenfion de certaines cérémonies eccléfiaftiques,
qui ne font que des bénédi&ions. C ’eft aiftfi que l’on
dit baptifer une cloche, quoiqu’en effet on ne faffe que
la bénir & lui donner un nom ; & dans cette cérémonie,
il y a un parrain & une marraine dont la cloche
réçoit les noms.
On dit encore au figuré & familièrement baptifer
le vin, pour dire , y mettre de l’eau ; baptifer quelqu'un
, pour dire, lui donner un fobriquet.
* BAPTISMAL, ale , adj. du baptême, qui Concerne
le baptême. L Ttau baptifmale , l’eau avec laquelle
on baptife. Les fonts-baptifmaux, les fonts
où l’on baptife ; la robe baptifmale , la robe blanche
que portoit pendant huit jours une perfonne nouvellement
baptifée ; l’innocence baptifmale , celle d’uft
enfant qui vient de recevoir le baptême.
* BAQUET , f. m. (Econ. domejl. arts & métiers. )
forte de petit cuvier de bois dont les bords font fort
bas. Plufieurs ouvriers, les maçons, les braffeurs, les
cordonniers , &c. fe fervent de baquets pour divers
ufages qui concernent leur métier.
B a q u e t , en terme de Jardinage, e ft un petit vaif-
feau de bois rond , quarré ou oblong , rempli de
terreau fur lequel le jardinier feme des graines par-,
ticulieres.
B a q u e t , en terme d'Imprirnerie., eft une pierre
creufe que l’ouvrier remplit de leffive pour y laver
fes formes.
B a q u e t , en terme de Relieur & de Doreur, eft un
demi-muid où l’on entretient avec de la cendre &
de la pouffiere de charbon, une chaleur douce &
fuffifante pour fécher la dorure.
B a q u e t , che^ les Marbreurs de papiers, eft une
forte de boëte quarrée , plate , fans couvercle, où
ils verfent l ’eau gommée, fur laquelle ils répandent
les couleurs qui doivent compofer la marbrure du
papier.
Les chaudéronniers donnent auffi le nom de baquet
à tout vaiffeau de cuivre qui eft encore imparfait.
B a q u e t , ujlenjîle de Graveur • c’eft Une caiffe dont
il fe fert pour faire couler & mordre l’eau forte fur
les planches; elle doit être d’un bois très mince,
exactement affemblée , & peinte à l’huile en-dehors
& en-dedans, ou bien enduite de cire , afin de contenir
l’eau forte fans en être imbibée. Voici la maniéré
des’en fervir : lorfqu’on veut faire mordre l’eau
forte fur une planche de cuivre préparée pour cet
effet, onia graiffe par-deffous; puis on la met au
fond du baquet, ayant foin de l’affujettir, afin qu’elle
ne fe dérange pas ; on verfe enfuite l’eau forte juf-
qu’à la hauteur d’une ligne ou deux au-defîus de la
planche : on agite enfuite le baquet d’un mouvement
doux, lent & uniforme, faifant ainfi paffer & re-*
paffer l’eau forte fur la planche, jufqu’à ce qu’elle ait
fuffifamment mordu fur le cuivre.
* BAQUETER , v. a. terme de Bâtiment, ôter
l’eau d’une tranchée avec la pelle ou tout autre uf-
tenfile propre à cet effet.
* Ba Q u e t e r l ’ e a u , terme de Jardinage , c’eftïa
répandre fur le gazon d’un baffin avec une pelle de
bois, pour arrofer le deffus des glaifes* Le grand.
Vocal. Franc.
* B a q u e t u r É S , f. f. pl. terme de Cabaretier & de
Marchand de vin. Lorfqu’ils tirent du vin en bouteille,
ils appellent baquetutes, ce qui tombe du tonneau
dans un vafe ou baquet placé au-deflous du robinet.
Ces baquetures étant du vin à demi - éventé , n’eft
bon que pour les vinaigriers , quoiqu’il y ait des
marchands peu fcrupuleüx , qui le mêlent avec
d’autre vin pour le vendre comme bon.
BAQÜEVILLE en Caux, ( Géogr. ) bourg &
doyenné rural en Normandie, connu par fes fabriques
de ferges & de toiles , fur la Vienne , à trois
lieues d’Arques & autant de Dieppe ; il y avoit un
ancien prieuré établi par la famille des Martels vers
i io o , cédé à l’abbaye de Tiron en 1133 par Guillaume
Martel, & uni par Paul V , en 1617 , au college
de Rouen ; deux cures réunies en une au xiiï.
fiecle du patronage du feigneur ; ancienne léprolie
dont parle un titre de 1458. Les comtes de Ba-
queville étoient diftingués autrefois 1 on en voit un
( Guillaume Martel ) porte-oriflamme à la bataille
d’Azincourt, oit il fut tué ; le dernier officier porte-
oriflamme fut un Martel fous Charles VIL ( C. )
B a q u e v ï l l e , en Vexin, ( Géographie. ) bourg
du bailliage de Gifors , de l’éle&ion d’Andelt ; en
1177, Goël de Baudemont donna l’églife de Baque-
villCf au prieuré de Sauffeufe. La cure eft régulière.
; Êâqüeville fut érige en comté en ï66o en faveur
de Jean-Louis Faucon de Ris , Marquis de Charle-
vai , & premier préfidentau parlement de Rouen ;
il étoit frere de Charles de Charleval fi connu par foii
amour pour les lettres,.parfes petites pièces de vers
& la Converfation du marquis d'Hoquincourt avec le P.
de Çànaye , J; impr.. dans les oeuvres de Saint Evré-
monti
Le recueil de fes. lettres & poéfies eft refté ma-
Bùfcrit, en 1688 * après fa mort entre les mains du
premier préfident du R is, fon neveu, qui en a privé
le public. ( C. )
: B A R , f. m. barbus, i , (terme de Blafon. ) barbeau,
forte: de poiffon qui entre dans les armoiries ; il paraît
de profil & un peu courbé en portion de cercle.
: Qn en voit fdùvent deux enfemble ; alors ils font
adofles.
De Gâücôurt en Berry , d'hermine à deux bars
adojfés de gueules-.
De Franquemortt en Franche-Comté ; de gueules
à deux bar S] adojfés <£or. ( G. D. L. T.) :
: B a r -s u r -SEINE , (Géogr. ) Barum ad Seqüaharh ,
petite ville du duché de Bourgogne, la treizième qui
députe aux états , à fept lieues de Troyes & de Châ-
îillon , 42. de Paris & 13 de Dijon ; elle eft ancienne
& étoit Confidérable avant le défaftre qui lui arriva
en 13 57 , oîi elle fut prife & brûlée par certains ro-
beurs Lorrains : Froiflard dit qu’ils détruifirent 600
bons hôtels. Le roi Jean, touché de ce malheur , lui
accorda, en 136 1 , une foire franche avec fes droits
pour aider àla réparerregardant cette ville comme
lieu notable , de grand renom & ancienneté,.
► .Sous Thibault, eomte.de Champagne en 1231 ;
elle étoit gouvernée par un majeur & 12 échevins.
Il y a un petit chapitre de trois'ehanoines & de deux
chantres à la nomination du roi ; ils étoient autrefois
chapelains dés comtes de Bar, & demeuroient au
château; & depuis fa démolition, ils ont ététranf-
férés dans la ville.
• Dans Téglife paroiffiale de S. Etieilne , bâtie au
xve. fiecle, eft l’épitaphe de Jean Bonnefons , bon
poète Latin , lieut. gén. du bail., mort en 1614.
Barbos a fait entrer fes poéfies avec celles de Maret,
deBeze & de Jean Second, impr. en 1757.
•• Cette v ille s été âuflile bercëau des Vigniers diftingués
dans la république des lettres, & de Nicolas
Vignier, riche & célébré médecin fous Henri IV*
La coutellerie dé Bar eft renommée : le principal
commerce eft en vin.
; M. R ouget, maire de Bar-fur-feine, vient de nous
donner l’hiftoire de cette ville en un volume in-i2,
impr. à Dijon en 1772. (C .)
•_ Ba r -LE-DUC , (Géogr.) Barum, Cajlrum Barrenfe ,
ville de France entre la Lorraine & la Champagne
fur l’Orney, bâtie par Frédéric, duc de Mofellaoe,
beau-frere de Hugues Capet, au x . fiecle , pmtr
l’oppofer aux fréquentesincurfions des Champenois.
Le Barois a toujours relevé, du royaume de France,
quoique uni à la Lorraine en 1419. Henri I I , comte
de Bar, combâttit à Bouvines à côté de Philippe-
Augufte contre l’empereur Othon : Thibault II fit
hommage à S. Louis à , & Henri III fit auffi hommage Philippe-le-Bel en 1301. Robert fut créé duc de
B a r y e rs 1357 ; Charles V époufa fa foeur en 1364.
Ce duché & la ville de Bar font retournés à la France
après la mort du rai Staniflas en 1766. Les vins en
font eftimés. (C. )
: B AR-s.fi r-A U B E * ( Géogr. ) Barum ad JlLbulam ,•
ville ancienne de Champagne, ruinée par Attila qui
y fit mourir Sainte Germaine : il y avoit autrefois
quatre foires franches & des quartiers féparés pour
les Allemands, les Hollandois , les Lorrains & les
marchands d’orange. Les Juifs y avoient une fina-
gogue ; les comtes de Champagne y poffédoient un
Tome
château ; ruinée àla fin des guerres des ducs de Bourgogne
, il n’en refte plus qu’une hauteur appellée là
Möthe réunie à là couronne fous Philipp e-le-long;
( c . ) H H 1 . . . . ,
BÂRÀC , ( Hiß. des. Juifs. )'fils d’Abinoëifi fut
■ le! quatrième juge des Hébreux qu’il gouverna pendant
quarante ans : ce fut lui qui les délivra de là
fervitude de Ja b in , r o i des Chananéens. Excité par
la prophétefle Debora, il leva une armée de dix m i lle
hommes, a t t a q u à ja b in dont il mit en pièces le s trou-
p e s com mand é es par S ifa ra . j
- B A R A M A R E Ç À j f; m, ( ffiß.ifiai., Èotaniq. )
efpece de plante légumineufe du genre du c a n â v a l i ,
,aflez bien grav’ée avec la plupart de fes détails-par
V a n -R h e e d e dans fon Hortus MaJabqßcUs, volume
VIII, planche XLIV^page 85. Les Brames l’appellent
dala-vallu ; les Portugais favas dos pafos fatiyo ;
-les Hollandois tamme crimphonen. C’eft le dolichos ,
■ g enfiformis volubilis j legurninibus gladiatis, dorfq<■
tricarinatis , feminibus arilkatis , de ’ M. Linné y dans
fon Syßema natur.cn ,; édition 12 imprimée en 1767 ;
page 483. o . . .-.b /.;,
Cette plante eft vivace , toujours verte , tou^
jours, couverte de fleurs, à petite racine fibreufe:,
ramifiée, noire : fa tige eft grimpante, finueufe*
longue de 20 à 3.0 pieds, cylindrique , de quatre
lignes de diamètre ; s’entortillant autour des arbres *
verd-jaune, lifte , ramifiée par intervalles d’un piedj
•’ Ses feuilles font alternes, com p o fé e s de trois
folioles j a fiez égales:, femblablés à celles du haricot,
taillées en coe u r ; trè.s-obtufes à leur origine *
pointues à l’extrémité oppofée, longues de quatre
à cinq pouces -, de m o it ié mo ins larges, d’un verd
clair , relevées, en-.defîbus d’une nervure médiocre f
ramifiée en cinq à fix paires de côtes alternes,
portées au bout d’ün pédicule commun ; c y lin d r iq
u e , un peu plus court qu’elles : leur d ilp o f i îio ii
fur les tiges eft circulaire & à des diftances d’un
pied les unes des autres*
De l’aiffelle des fleurs m o y e n n e s for! un épi un
peu plus long qu’elles., c’eft-à-dire, d’un pied,
portant, dans fa mçitié fupérieure quinze à vingt
fleursptefque feffiles,pendantes, rapprochées deux
à'deux j& d’unroüge purpurin ou bleuâtre. Chaquq
fleur eft hermaphrodite & difpofée autour de l’ovaire
un. peu au-deftousde lui ; elle co n fifte en un c a lic e cylindrique,
épais, alongé, d’une feule p ie c e , divifé . à
fes bords en cinq dentelures courtes, yerd-clair, inégales,
formant deux levres a v e c lefquelles iTfem-
ble pincer la corolle : celle-ci eft ir r é g u liè r e , c om f
p.ofée .de quatre pétales inégaux,- imitant un pa-4
pillon volant* d’un pouce .& demi de longueur &c
de largeur. Au dedans de la corolle1 font couchées
vers fa partie inférieure dix étamines dont une Amp
le & neuf réunies par leurs filets jufqn’aux trois
quarts de leur longueur en un cylindre arqué, fendu
en-deffus fur toute fa longueur d’une fente dans laquelle
fe couchela dixième étamine : quatre des neuf
nlëts ainfi réunis font plus longs que le s a u t r e s , Sc
égalent la dixième étamine* Leurs anthères fo n t
jaunes; l’ovaire enfile cette e fp e c e de tuyau fendu
des étamines; il en eft éloigné , & porté an-deffus
du fond, ou du réceptacle du calice par. un pédun±
yule affez court*
L’ovaire, en mûriflant* devient une gouffe ou
légume taillé en fabre long d’un pied, fix a fept
fois moins large ou moins profond,1 comprimé par
les côtés., un peu courbe & tranchant en-deffous,
prefque droit en-deffus * & comme applati avec
trois greffes nervures, v e r d d’abord * enfuite d’un
verd jaunâtre ou brun, s’ouvrant par-deffous en
deux v a lv e s coriaces, épaiffes, doublées intérieurement
d’une fécondé peau ou tunique épaiffe,
blanchâtre, partagée en quatorze ou^qui.nze loges
I l i i l ij