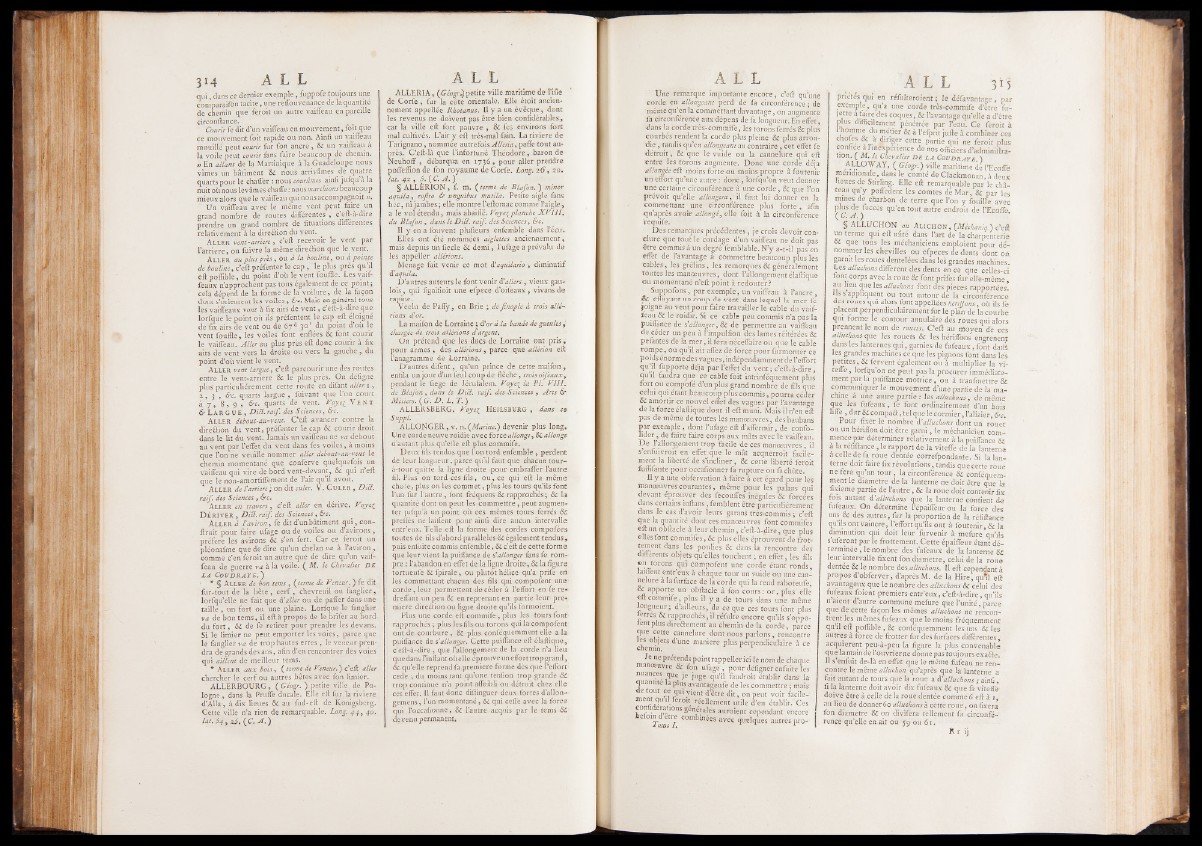
q u i, dans ce dernier exemple, fuppofe toujours une
comparaifön tacite, une reffouvenance de la quantité
de chemin que feroit un autre vaiffeau en pareille
circonftance.
Courir fe dit d’un vaiffeau en mouvement, foit que
ce mouvement foit rapide ou non. Ainfi un vaiffeau
mouillé peut courir fur fon ancre , & un vaiffeaii à
la voile peut courir fans faire beaucoup de chemin.
» En allant de la Martinique à la Guadeloupe nous
vîmes un bâtiment & nous arrivâmes de quatre
quarts pour le chaffer : nous courûmes ainfi jufqu’à la
nuit oimous levâmes chaffe : nous//wrrizio/zj beaucoup
mieux alors que le vaiffeau qui nous aeçompagnoit ».
Un vaiffeau avec le même ^ vent peut faire un
grand nombre de routes differentes , c eft-a-dire
prendre un grand nombre de fituations differentes
relativement à la dire&ion du vent.
A l l e r vent-arriéré, c’ eft recevoir le vent par
l’arriere , ou fuivre la même dire dion que le vent.
A l l e r au plus pris, ou à la bouline, ou à pointe
de bouline, c’eft préfenter le cap , le plus près qu’il
eft poffible, du point d’où le vent fouffie. Les vaif-
feaux n’approchent pas tous également de ce point;
cela dépend de la forme de la voilure, de la façon
dont s’orientent les voiles., 6‘c. Mais en general tous
les vaiffeaux vont à fix airs de v en t , c’eft-a-dire que
lorfque le point où ils préfentent le cap eft éloigné
de fix airs de vent ou de 67d 30' du point d’où le
Vent fouffle, les voiles font enflees & font courir
le vaiffeau. Aller au plus près eft donc courir à fix
airs de vent vers la droite ou vers la gauche, du
point d’où vient le vent.
A l l e r vent largue, c’eft parcourir une des routes
entre le vent-arriere & le plus près. On defigne
pluS particuliérement cette route en difant aller 1 ,
2 , 3 , &c. quarts largue , fuivant 'que l’on court
à 7 , 8 , 0 , 6*c. quarts de vent. Voye1 V £ NT
6* L a r g u e , Dicl.raif. des Sciences, &c.
A l l e r debout-au-vent. C’eft avancer contre la
diredion du vent, préfenter le cap & courir droit
dans le lit du vent. Jamais un vaiffeau ne va debout
au vent par l’effet du vent dans fes voile s, à moins
que l’on ne veuille nommer aller debout-au-vent le
chemin momentané que conferve quelquefois un
vaiffeau qui vire de bord vent-devant, & qui n’eft
que le non-amortiffement de l’air qu’il avoit.
A l l e r de tarriéré; on dit culer. V. CuLER, Dicl.
raif. des Sciences , &c, - ;
A l l e r en travers, c’eft aller en dérive. Voye^
DÉRIVER, D ici. raif. des Sciences, &c.
A l l e r a C aviron, fe dit d’un bâtiment q ui, con-
ftruit pour faire ufage ou de voiles ou d’avirons,
préféré les avirons & s’en.fert. Car ce . feroit un
pléonafme que de dire qu’un chelan va à l’aviron ,
comme c’en feroit un autre que de dire qu’un vaiffeau
de guerre va à la voile. ( M. le Chevalier DE
L A C o u D R A Y E . )
■ * § A l l e r de bon tems, ( terme de Veneur. ) fe dit
fur-tout de la bête , cerf , chevreuil ou fanglier,
lorfqu’elle ne fait que d’aller ou de paffer dans une
taille , un fort ou une plaine. Lorfque le fanglier
va de bon tems, il eft à propos de le brifer au .bord-
du fo r t , & de fe retirer pour prendre les devans.
Si le limier ne peut emporter les voies, parce que
lè fanglier va de trop hautes erres , le veneur prendra
de grands devans, afin d’en rencontrer des voies
qui aillent de meilleur tems.
* ALLER aux bois, {terme de Veneur. ) c’eft aller
chercher le cerf ou autres b,êtes avec fon limier.
ALLERBOURG, ( Géogr. > petite ville de Pologne
, dans la Prüfte ducale. Elle eft fur la riviere
d’Alla , à dix lieues & au fud-eft de Königsberg.
Cette ville n’a rien de remarquable. Long, 44 , 40.
lat, 5 4 , zS, {C. A .)
ALLERIA, (Géogri) petite ville maritime de Pille
de Corfe , fur la côte orientale. Elle étoit anciennement
appellée Rhotanus. Il y a un évêque, dont
les revenus ne doivent pas être bien confidérables,
car la ville eft fort pauvre , & fes environs fort
mal cultivés. L’air y eft très-mal fain. La riviere de
Tarignano, nommée autrefois AUeria, paffe tout auprès.
C’ eft-là que l’infortuné Théodore, baron de
Neuhoff , débarqua en 1736, pour aller preridre
poffeflion de fon royaume de Corfe. Long. 2.6, 20.
lat. 42 , S. (C. A . )
§ ALLÊRION, f. m. (terme de Blafon. ) minor
aquila, rofro & unguibus mutila. Petite aigle fans
bec, ni jambes ; elle montre l’eftomac comme l’aigle ,
a le vol étendu, mais abaiflê. Voye^_planche X V I I I .
du Blafon, dans le Dicl. raif. des Sciences, &c.
Il y en a fouvent plufieurs enfemble dans récit.
Elles ont été nommées aiglettes anciennement,
mais depuis un fiecle & demi,. l’ufage a prévalu de
les appeller aliénons.
Ménagé fait venir ce mot d'aquilario , diminutif
à? aquila.
D ’autres auteurs le font venir Paliers, vieux gaulois
, qui fignifioit uné efpece d’oifeaux, vivans de
rapine.
Veelu de Paffy, en Brie ; de Jinople à trois aliénons
(for.
La maifon de Lorraine ; d’or à la bande de gueules
chargée de trois aliénons d argent.
On prétend que les. ducs de Lorraine ont pris,
pour armes, des aliénions, parce que allérion eft
l’anagramme de Lorraine.
D ’autres difent, qu’un prince de cette maifon ,
enfila un jour d’un feul coup de flèche, trois oifeaux,
pendant le fiege de Jérufalem, Voye1 la PL VIII.
de Blafon, dans le Dicl. raif. des Sciences , Arts «S*
Métiers. (G . D . L .T . )
ALLERSBERG. Voye^ Heilsburg , dans co
Suppl.
ALLONGER, v . n. (Marine.) devenir plus long.
Une corde neuve roidie avec force allonge, & allonge
d’autant plus qu’elle eft plus commife.
Deux fils tendus que l’on tord enfemble , perdent
de leur longueur, parce qu’il faut que chacun tour-
à-tour quitte la ligne droite -pour embraffer l’autre
fil. Plus on tord ces fils.,. ou , ce qui eft la même
choie-, plus on les corpmet, plus les- tours qu’ils font
l ’un fur l’autre , font fréquens & rapprochés; & la
quantité dont on peut les commettre , peut augmenter
jufqu’à un point où ces mêmes tours ferrés &
preffés ne laiffent pour ainfi dire aucun, intervalle
entr’eux. Telle eft la forme des cordes compofées
' toutes de fils d’abord parallèles & également tendus,
i puis enluite commis enfemble, & c’eft de cette forme
que leur vient lapuiffance de s’allonger fans fe rompre
: l’abandon en effet de la ligné droite , & la figure
tortueufe & fpirale, ou plutôt hélice qu’a prife en
les commettant chacun des fils qui compofent une
; corde, leur permettent de céder à l’effort en fe re-
dréffant un peu & en reprenant en partie leur première
direction ou ligne droite qu’ils formoient.
Plus une eprde eft commife, plus les tours font'
rapprochés,; plus les-fils ou torons qui la compofent
| ont de, courbure , & plus.conféquemment elle a la
puiffance de s'allonger. Cette puiffance eft élaftique,
i c’eft-à-dire , que l’allongement de la corde n’a lieu
que dans l’inftant où elle éprouve un efforttrop grand ,
& qu’elle reprend fa .première forme dès que l’effort
c.ede ; du moins tant .qu’une tenfion trop grande &
trop continue n’a point affbibli ou détruit chez elle
cet effet. Il faut donc diftinguer deux fortes d’allon-
gejnens, l’un momentané, &c qui ceflê avec, la force
qui l’oçcalionne, & l’autre acquis par le tems 6c ‘
devenu permanent..
Une remarque importante encore, c’eft qn5une
corde en allongeant perd de fa circonférence ; de
même qu’en la commettant davantage, on augmente
fa circonférence aux dépens de fa longueur. En effet,
dans la corde très-commife, les torons ferrés & plus
courbes rendent la corde plus pleine & plus arrondie
, tandis qu’en allongeant au contrâire, cet effet fe
détruit, & que le vuide ou la cannelure qui eft
entre les torons augmente. Donc une corde déjà
allongée eft moins forte ou moins propre à foutenir
tin effort qu’ane autre : donc, lorfqù’on veut donner
une certaine circonférence à une corde, & que l’on
prévoit qu’elle allongera, • il faut lui donner en la
“commettant une circonférence plus fo r te , afin
qu’après avoir allongé, elle foit à la circonférence
Vequilè.
Des remarques précédentes, je crois devoir conclure
que tout le cordage d’un vaiffeau ne doit pas
être commis à un degré femblable. N’y a-t-il pas en
effet de l’avantage a commettre beaucoup plus les
cables, les grêlins, les remorques & généralement
toutes les manoeuvres, dont l’allongement élaftique
Ou momentané n’eft point à redouter?
Suppofons, par. exemple, un vaiffeau à l’ancre ,
& effuyant un coup de vent dans lequel 11 mer fe
joigne au ventpour faire travailler'le cable du vaiffeau
& le raidir. Si ce cable peu commis n’a pas la
puiffance de s'allonger, & de permettre au vaiffeau
de céder un peu à l’impulfion des lames réitérées &
pefantes de la m er, il fera néceffaire ou que le cable
, rompe, ou qu’il ait affez de force pour furmonter ce
poids énorme des vagues,indépendamment de l’effort
qu’il fiipporte déjà par l’effet du vent ; c’eft-à-dire,
qu’il faudra que ce cable foit intrinféquement plus
fort ou compofé d’un plus grand nombre de fils que
celui qui étant beaucoup plus commis , pourra céder
& amortir ce nouvel effet des vagues par l’avantage
de la force élaftique dont il eft muni. Mais il n’en eft
pas de même de toutes les manoeuvres, des haubans
par exemple , dont l’ufage eft d’affermir, de confo-
lider, de faire faire corps aux mâts avec le vaiffeau.
De rallongement trop facile de ces manoeuvres , il
s’enfuivroit en effet que le mât acquérroit facilement
la liberté de s’incliner, & cette liberté feroit
fuffifante pour occafionner fa rupture ou fa chiite.
Il y a une obfervation à faire à cet égard pour les
manoeuvres courantes, même pour les palans qui
devant éprouver des fecouffes inégales & forcées
dans certains inftans, femblent être particuliérement
dans le cas d’avoir leurs garans très-commis ; c’eft
que la quantité dont ces manoeuvres font commifes
eft un obffacle à leur chemin, c’eft-à-dire, que plus
elles font çommifësy & plus elles éprouvent de frottement
dans les poulies & dans la rencontre des
differents objets qu’elles touchent ; en effet, les fils
®u torons qui compofent une corde étant ronds
laiffent entr’eiLx à chaque tour un vuide ou une cannelure
à lafurface de la corde qui la rend raboteufe,
oc apporte un obftacle à fon cours : o r , plus elle
oft commife, plus il y a de tours dans une même
longueur; d’ailleurs, de ce que ces tours font plus
lerres & rapprochés, il réfulte encore qu’ils s’oppo-
-tplus dire&ement au chemin de la corde, parce
que cette cànnelure dont nous parlons, rencontre
chem ^ d,Une maniere Plus perpendiculaire à ce
Je ne prétends point rappeller ici le nom de chaque
manoeuvre & fon ufage, pour défigner enfuite les
nuances que je juge qu’il faudrait établir dans la
quantité la plus avantageufe de les commettre ; mais
e out ce qui vient d’être dit, on peut voir facile-
ineiltjCîu 1 . èr°tt réellement utile d’en établir. Ces
w l. “ Senefales auraient cependant encore
méeS avec ^ q î i e s autres F op
n e té s q u i eh r é fu lt e ro ie n t ; l e d é fa v a n t a g e , p a r
e x em p l e , q u ’a u n e c o r d e t rè s - c om m ife d ’ê t r e f u -
je t te à fa i r e d e s c o q u e s , & l ’a v a n ta g e q u ’e l le a d’ ê t r è
p lu s d iffic ilem en t p én é t r é e p a r l ’e a u . C e f e r o i t à
h om m e du m é t ie r & à l’ e fp r it ju f t e à c om b in e r c e s
K d in e e r c e t te p a r tie q u i n e f e r o i t p lu s
c o n fié e à 1 in e x p é r ie n c e d e n o s o ffic ie r s d’a dm in iftra -
t io n . ( M . U Chevalier d e l a Coud r a y e . )
ALLOWAY, ( Géogr.) ville maritime de l’Ecoffe
méridionale, dans le comté de Clackmonan, à deux
lieues de Stirling. Elle eft remarquable par le château
qu’y poffedent les comtes de Mar, & par les
mines de charbon de terre que l’on y fouille avec
plus de fuccès qu’en tout autre endroit de l’Ecoffe.
§ ALLUCHON ou A l i c h o n , (M é c h a n iq ) c’eft
un terme qui eft ufité dans l’art de la charpenterie
& que tous les méchaniciens emploient pour dénommer
les chevilles ou efpeces de dents dont on
garnit les roues dentelées dans les grandes machines.
Les alluchons different des dents en ce que celles-ci
font corps avec la roue & font prifes fur elle-même ,
au heu que les alluchons font des pièces rapportées.
Ils s appliquent ou tout autour de la circonférence
dçs roues qui alors font appellées h ériffons, où ils fe
placent perpendiculairement fur le plan de la courbe
qui forme le contour annulaire des roues qui alors
prennent le nom de rouets. C ’eft au moyen de ces
alluchons que les rouets & les hériffons engrenent
dans les lanternes qui, garnies de fufeaux, font darfà
les grandes machines ce que les pignons font dans les
petites, & fervent également ou à multiplier la vî-
teffe, lorfqu’on ne peut pas la procurer immédiatement
par la puiffance motrice, ou à tranfmettre &
communiquer le mouvement d’une partie de la machine
à une autre p a r tie : le s a llu c h o n s , d e m êm e
q u e le s fufeaux, fe font ordinairement d’un b o is
liffe, dur &compa£t, tel que le cormier, l’alizier, & c .
Pour fixer le nombre d:alluchon s dont un rouet
ou un hériffon doit être garni, le méchanicien commence
par déterminer relativement à la puiffance Ôc
à la réfiftance, le rapport de la vîteffe de fa lanterne
à celle de fa roue dentée correfpondante. Si la lanterne
doit faire fix révolutions, tandis que cette roue
ne fera qu’un tour, la circonférence & conféquemment
le diamètre de la lanterne ne doit être que la
fixieme partie de l’autre, & la roue doit contenir fix
fois autant d'a llu ch on s que la lanterne contient de
fufeaux. On détermine l’épaiffeur ou la force des
uns & des autres, fur la proportion de la réfiftance
qu’ils ont vaincre, l’effort qu’ils ont à foutenir, & la
diminution qui doit leur furvenir à mefure qu’ils
s’uferont par le frottement. Cette épaiffeur étant déterminée
, le nombre des fufeaux de la lanterne &
leur intervalle fixent fon diamètre, celui de la roue
dentée & le nombre des alluchons. Il eft cependant à
propos d’obferver, d’après M. de la Hire, qufil eft
avantageux que le nombre des allu ch on s & celui des
fufeaux foient premiers entr’eux, c’eft4-dire, qu’ils
n’aient d’autre commune mefure que l ’unité, parce
que de cette façon les mêmes allu ch on s ne rencontrent
les memes fufeaux que le moins fréquemment
qu’il eft poffible , & conféquemment les uns & les
autres à force de frotter fur des furfaces différentes,
acquièrent peu-à-peu la figure la plus convenable
que la main de l’ouvrier ne donne pas toujours exafte.
Il s’enfuit de-là en effet que le même fufeau ne rencontre
le même alluchon qu’après que la lanterne a
fait autant de tours que la roue a dé allu ch on s ; ainfi
fi la lanterne doit avoir dix fufeaux & que fa vîteffe
doive être à celle de la roue dentée comme 6 eft à 1,
au lieu de donner 60 a lluchon s à cette roue, on fixera
fon diamètre & on divifera tellement fa circonférence
qu’elle eit ait ou 59 ou 61.
R r ij