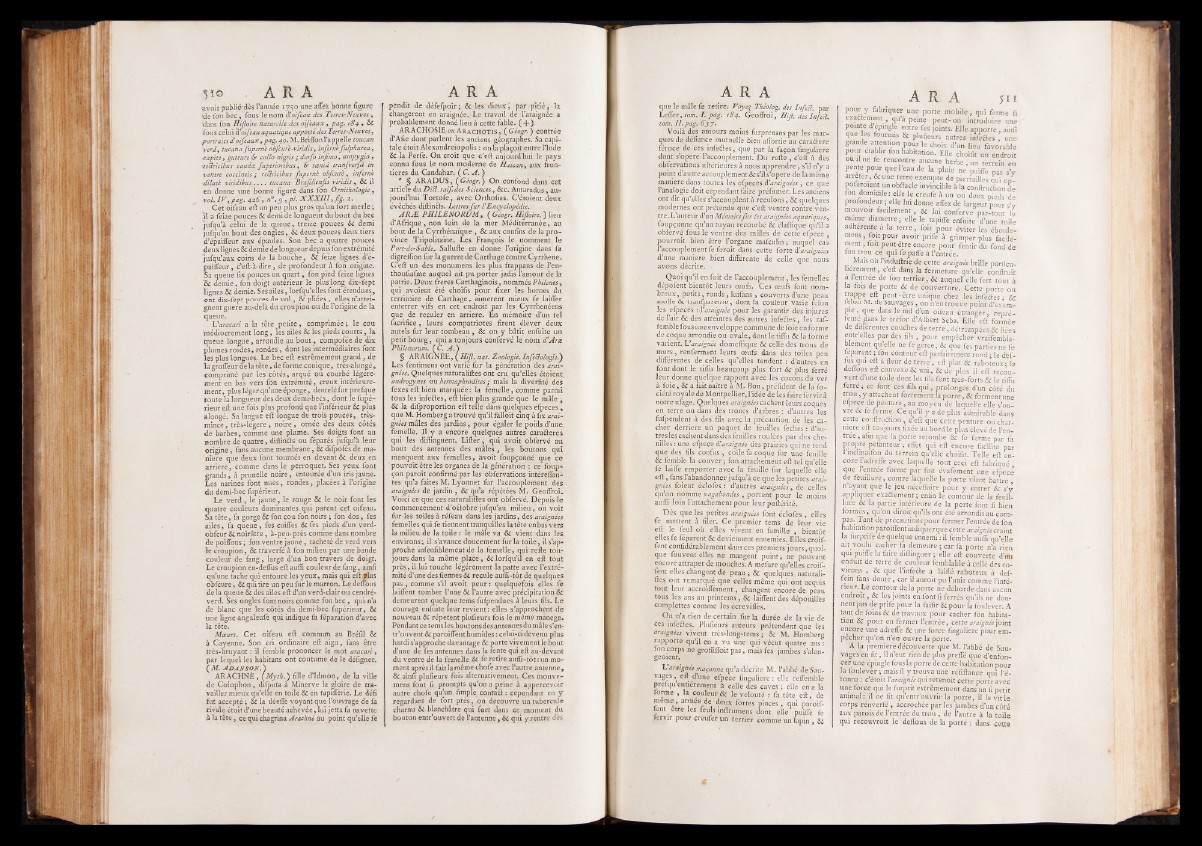
;aVoit publié-dès l’année 1750 une affefc bonne figure
•-de Ton bec, fous le nom à'oifeau des Terres-Neuvcs,
^ans fon tiijloire naturelle des oifeaux, pag. 184, &C
fous celui cl oifeau aquatique apporté des Terres-Neuves,
portraits à 'oifeaux, pag. 40. M. Briffon l’appelle toucan
verd, tucana fupernè obfcurè-viridis, inferne fulphurea ,
-capite, gutture 6* collo nigrisç dorfo infimo, uropygio ,
=tectricibus caudce fuperioribus, <5* tceniâ tranfvcifa in
ventre coccineis ; rectricibus fupernè obfcurè , inferne
•dilutè viridihus. . . . tucana Brajilienfis viridis , & il
en donne une bonne figuré dans fon Ornithologie,
■ vol. IV , pag. 426', 720.^9 , pl. X X X I I I , fig. 2.
Cet oifeau eft un peu plus gros qu’un fort merle ;
il a feize pouces & demi de longueur du bout du beç
jufqu’à celui de la queue, treize pouces & demi
jufqu’au bout des ongles, & deux pouces deux tiers
d’épaiffeur aux épaules. Son bec a quatre pouces
deux lignes & demie de longueur depuis fon extrémité
jufqu’aux coins de la bouché, & feize lignes d’é-
.paiffeur, c’eft-à-dire, de profondeur à fon origine»
Sa queue fix pouces un quart, fon pied feize lignes
Zc demie, fon doigt anterieur le plus long dix-fept
lignes & demie. Ses ailes, lorfqu’elles font étendues,
ont dix-fept pouces de v o l , & pliées, elles n’atteignent
guere au-delà du croupion ou de l’origine de la
queue.
Varacari a la tête petite, comprimée ; le cou
'médiocrement long, les ailes & les pieds courts, la
queue longue, arrondie au bout., compofée de dix
plumes roides, rondes, dont les intermédiaires font
les plus longues. Le bec eft extrêmement grand, de
la groffeur de la tête, de forme conique, très-alongé,
comprimé par les côtés, arqué ou courbé légèrement
en bas vers fôn ëxtrémité, creux intérieurement
, plus léger qu’une éponge, dentelé fur prefque
toute la longueur des deux demi-becs, dont le fupé*-
rieur eft une fois plus profond que l’inférieur & plus
alongé. Sa langue eft longue de trois pouces, très-
mince, très-légere, noire , ornée des deux côtés
de barbes-, comme une plume. Ses doigts font au
nombre de quatre, diftinfts ou féparés jufqu’à leur
origine, fans aucune membrane, & difpofés de maniéré
que deux font tournés en devant & deux en
arriéré, comme dans k perroquet. Ses yeux font
grands, à prunelle noire, entourée d’un iris jaune.
Les narines font nues, rondes, placées à l’origine
du demi-bec fupérieur.
Le v e rd , le jaune, le rouge & le noir font les
quatre couleurs dominantes qui parent cet oifeau.
Sa tête, fa gorge & fon cou fon noirs ; fon dos, fes
ailes, fa queue, fes euiffes & fes pieds d’un verd-
obfcur & noirâtre, à-peu-près comme dans nombre
de poiffons ; fon ventre jaune, tacheté de verd vers
le croupion, & traverfé à fon milieu par une bande
couleur de fang, large d’un bon travers de doigt.
Le croupion en-deffus eft auffi couleur de fang, ainfi
qu’une tache qui entoure les yeux, mais qui eft iflus
obfcure, & qui tire un peu fur le marron. Le delîous
de la queue & des ailes eft d’un verd-clair ou cendré-
verd. Ses ongles font noirs comme fon bec, qui -n’a
de blanc que les côtés du demi-bec fupérieur, &
une ligne anguleule qui indique fa féparation d’avec
la tête.
Moeurs. Cet oifeau eft commun au Bréfil &
à Cayenne. Son cri ordinaire.eft aigu, fans être
très-bruyant : il femble prononcer le mot aracari,
par lequel les habitans ont coutume de le défigner.
( M. A D A N SON . )
ARACHNÉ, ( Myth. ) fille d’Idmon, de la ville
de Colophon, difputa à Minerve la gloire de travailler
mieux qu’elle en toile & en tapifferie. Le défi
fut accepté ; & la déeffè voyant que l’ouvrage de la
rivale étoit d’une beauté achevée, lui jetta fa navette
à la tête, ce qui chagrina Arachné au point qu’elle fe
pèndit de défefpoir; & les dieux\ par pitié, la
changèrent en araignée. Le travail de l’araignée a
probablement donné lieu à cette fable. ( + )
ARACHOSIEokA racho tis , f Géogr.) contrée
d’Alie dont parlent les anciens géographes. Sa Capitale
étoit Alexandreïopoïis : onia plaçoit entre l’Inde
& la Perfe. On croit que c’eft aujourd'hui le pays
connu fous le nom moderne de Hdican, aux frontières
du Candahar. ( C. A . )
* § ARADUS, ( Géogr.) On confond dans cet
article du Dict.raif.des Sciences, &c. Antaradus, aujourd’hui
Tortofe, avec Orthofias. C’étoient deux
évêchés djftinâs. Lettres fur C Encyclopédie.
ARÆ P H ILE NO RUM, ( Géogr. Hifioire. ) lieu
d’Afrique, non loin de la mer Méditerranée, au
bout de la Cyrrhénaïque , & aux confins de la province
Tripolitaine. Les François le nomment le
Port-de-Sable. Sallufte en donne l’origine dans fa
digreflion fur la guerre de Carthage contre Cyrrhene.
C’eft un des monumens les plus frappans de l’en-
thoufiafme auquel ait pu porter jadis l’amour de la
patrie. D eux freres Carthaginois , nommés Philenes,
qui avoient été choifis pour fixer les bornes du
territoire de Carthage, aimèrent mieux fe laiffer
enterrer vifs en cet endroit par les Cyrrhenéens
que de reculer en arriéré. En mémoire d’un tel
facrifice, leurs compatriotes firent élever deux
autels fur leur tombeau, & on y bâtit enfuite un
petit bourg, qui a toujours confervé le nom d'Aroe
Pkilenorum. ( C. A.')
§ ARAIGNÉE, ( Hijl‘ nat. Zoologie. Infectologie.j
Les fentimens ont varié fur la génération des araignées.
Quelques naturalises ont cru qu’ellès étaient
androgynes ou hermaphrodites ; mais la diverfité des
fexes eft bien marquée : la femelle, comme parmi
tous les infeftes, eft bien plus grande que le mâle ,
& la difproportion eft telle dàns quelques efpeces ,
que M. Homberg a trouvé qu’il falloit cinq à fix araignées
mâles des jardins, pour égaler le poids d’une
femelle. Il y a encore quelques autres carafteres
qui les diftinguent. Lifter, qui avoit obfervé au
bout des antennes des mâles , les boutons qui
manquent aux femelles, kvôit foupçonné que ce
' pouvôit être les organes de la génération : ce foup-
çon paroit confirmé par les ôbfervâtions intéreffan-
tes qu’a faites M» Lyonnet fur l’acèouplenient des
araignées dè jardin , & qu’a répétées M» Geoffroi.
Voici ce que ces naturaliftes ont obfervé. Depuis le
commencement d’oûobre jufqu’au milieu , on voit
fur les toiles à réfeau dans les jardins, des araignées
femelles qui fe tiennent tranquilles la tête en bas vers
la milieu de la toile 1 le mâle va & vient dans les
environs; il s’avance doucement fur la toile , il s’approche
infenfiblement de la femelle, qui refte toujours
dans la même place, & lorfqu’il en eft tout
près, il lui touche légèrement la patte avec l’extrémité
d’une des fiertnes & recule auflî-tôt de quelques
pa s, comme s’il avoit peur : quelquefois elles fe
laiflent tomber l’une & l’autre avec précipitation &
demeurent quelque tems fufpendues à leurs fils. Le
courage enfuite leur revient: elles s ’approchent dè
nouveau & répètent plufieurs fois le même mânege.
Pendant ce tems les boutonsdes antennes du mâle s’en-
tr’ouvent & paroiffent humides : celui-ci devenu plus
hardi s’approche davantage & porte vivement je bout
d’une de fes antennes dans la fente qui eft au-devant
du ventre de la femelle &c fe retire aufli-tôt: un moment
après il fait la même chofe avec l’autre antenne,
& ainfi plufieurs fois alternativement» Ces mouve-
mens font fi prompts qu’on a peine à appercevoir
autre chofe qu’un fimple contaft : cependant en y
regardant de fort près, on découvre un tubercule
charnu & blanchâtre qui fort dans ce moment, du
bouton entr’ouveri de l’antenne, & qui y rentre dès
que le mâle fe retire. Voye^ Tkéolog. des Infect, par
Lefler, tom. I. pag. 184. Geoffroi, Hiß, des Infect,
tojn. U. pag. 63 J.
Voilà des amours moins furprenans par les marques
de défiance mutuelle bien affortie au caraétere
ferocé de ces infeétes, que par la façon finguliere
dont s’opère l’accouplement. Du refte , c’eft à des
observations ultérieures à nous apprendre, s’il n’y a
point d’autre accouplement & s’il s’opère de la même
maniéré dans toutes les efpeces d’araignées , ce que
l’analogie doit cependant faire préfumer. Les anciens
ont dit qu’elles s’accouplent à reculons, & quelques
modernes ont prétendu que c’eft ventre contre-ventre.
L’auteur d’un Mémoire fur les araignées aquatiques,
foupçonné qu’un tuyau recourbé & élaftique qu’il a
obfervé fous le ventre. des mâles de cette efpece ,
pourroit bien être l’organe mafculin; auquel cas
l’accouplement fe feroit dans cette forte d'araignées
d’une maniéré bien différente de celle que nous
avons décrite. ■
Quoi qu’il en foit de l’accouplement, les femelles
dépofent bientôt leurs oeufs. Ces oeufs fönt nombreux,.
petits , ronds, luifans , couverts d’une peau
molle & tranfparente, dont la couleur varie félon
les efpecës : f araignée pour les garantir des injures
de l’air & des atteintes des autres, infectes, les raf-
iemble fous une enveloppe commune de foie en forme
de coque arrondie ou ovale, dont le tiffu & la forme
varient. L’araignée domeftique & celle des trous de
murs, renferment leurs oeufs dans des toiles peu
différentes de celles qu’elles tendent : d’autres en
font dont le tiffu beaucoup plus fort & plus ferré
leur donne quelque rapport avec les cocons du ver
à foie, & a fait naître à M. Bon, préfident de la fo-
cieté royale de Montpellier, l’idée de les faire fervir à
nôtre ufage. Quelques araignées cachent leurs coques
en terre ou dans des troncs d’arbres : d’autres les
fufpendent à des fils avec la précaution de les cacher
derrière un paquet de feuilles feches : d’autres
les cachent dans des feuilles roulées par des chenilles:
une efpece d’araignée des prairies qui ne tend
que des fils confus, colle fa coque fur une feuille
& femble la couver; fon~attachemeut eft tel qu’elle
fe laiffe emporter avec la feuille fur laquelle elle
e f t , fans l’abandonner jufqu’à ce que les petites araignées
foient éclofes : d’autres araignées, de celles
qu’on nomme vagabondes , portent' pour le moins
auflï loin l’attachement pour leur poftérité.
Dès que les petites araignées font éclofes , elles
fe mettent à filer. Ce premier tems de leur vie
eft le feul où elles vivent en famille ., bientôt
elles fe féparent & deviennent ennemies. Elles croif-
fent confiderablement dans ces premiers jours,quoique
fouvent elles ne mangent point, ne pouvant
encore attraper de mouches. A mefure qu’elles croif-
fent elles changent de peau ; & quelques naturalises
ont remarqué que celles même qui ont acquis
tout leur accroiffement, changent encore de peau
tous les ans au printems, & -laiflent des dépouilles
complettes comme les écreviffes.
On n’a rien de certain fur la durée de la vie de
ces infe&es. Plufieurs auteurs prétendent que les
araignées vivent très-long-tems ; & M. Homberg
rapporte qu’il en a vu une qui vécut quatre ans : ■
fon corps ne grofliffoit pas, mais fes jambes s’alon-
geoient.
L araignée maçonne qu’a décrite M. l’abbé de Sauvages
eft d’une efpete finguliere : elle reffemble
prefqu entièrement à celle des caves ; elle en a la
forme , la couleur & le velouté : fa tête eft, de
meme, armee de deux fortes pinces , qui paroif-
lent être les feuls inftrumens dont elle puiffe fe
fervir pour creufer un terrier comme un lapin, &
p o lir y fabriquer une porte mobile, qui ferme fi
exactement qu’à peine peut-on introduire une
pointe d épingle entre fes joints. Elle apporte, ainfi
que les fourmis 8c plufieurs autres infeftes , une
r„ande-,a^ nr n , ' T r l ? choix d’“ " lieu favorable
! P ° ‘!f etaj?lir fon habitation. Elle choifit un endroit
où II ne fe rencontre aucune herbe , un terrein en
pente pour quel eau de la pluie ne puiffe pas s’y
arrêter , & une terre exempte de pierrailles qui op-
poferoient un obftacle invincible à la conftruaion de
ion domicile: elle le creufe à un ou deux pieds de
profondeur; elle lui donne affezde largeur pour s’v
mouvoir facilement, & lui conferve par-tout le
meme diamètre elle le tapiffe enfuite d’une toile
adhérente à la terre, foit pour éviter les éboule-
mens, fou- pour avoir prife à grimper plus facilement,
foit peut-être encore pour fentir du fond de
ion trou ce qui fe paflè à l’entrée.
Mais où î’induftrie de cette araignée brille particulièrement,
c’eft dans la fermeture qu’elle conftruit
a l«ntree de fon terrier, & auquel elle fert tout à
la fois de porte & de Couverture. Cette porte ou.
' J.raPpe eft peut - être unique chez les infeftes ; &
félon M. de Sauvages , on n’en trouve point d’exemple
, que dans le nid d’un oifeau étranger, repré-
fenté dans le tréfôr d’Albert Séba. Elle eft formée
de différentes couches de terre, détrempées & liées
entr elles par des fils , pour empêcher vraifembla-
blement qu’elle ne fe gerce, & que fes parties ne fe
ieparent ; fon contour eft parfaitement rond ; le def-
fus qui eft à fleur de terre , eft plat & raboteux; le
deffous eft convexe & uni, & d e plus il eft recouvert
d’une toile dont les fils font très-forts & le tiffu
ferre ; ce font ces fils qui, prolongés, d’un côté du
trou, y attachent fortement la porre, & forment une
efpece de penture, au moyen de laquelle elle s’ouvre
& fe ferme. Ce qu’il y a de plus admirable dans
cette conftruftion, c’eft que cette penture ou charnière
eft toujours fixée au bord le plus élevé de l’entrée
, afin que la porte retombe & fe ferme par fà
propre pelanteur ; effet qui eft encore facilité par
îinclinaifon du terrein qu’elle choifit. Telle eft encore
l’adreffe avec laquelle tout ceci eft fabriqué
que l’entrée forme par fon évafement une efpece
de feuillure, contre laquelle la porte vient battre ,
n’ayant que le jeu néceffaire pour y entrer & s’y
appliquer exaftement ; enfin le contour de la feuillure
& la partie intérieure de la porte font fi bien
formés, qu’on diroit qu’ils ont été arrondis au compas.
Tant de précautions pour fermer l’entrée de fon
habitation paroiffent indiquer que cette araignée craint
la furprife de quelque ennemi : il femble aufli qu’elle
ait voulu cacher fa demeure ; car fa porte n’a riçn
qui puiffe la faire diftinguer ;-elle eft couverte d’un
enduit de terre de couleur femblable à celle des environs
, & que l’infefte a laifîe raboteux à def-
fein fans doute, car il auroit pu l’unir comme l’inférieur.
Le contour delà porte ne déborde dans aucun
endroit, & les joints en font fi ferrés qu’ils ne donnent
pas de prife pour la faifir & pour la foulever. A
tant de foins & de travaux pour cacher fon habitation
&c pour en fermer l’entrée, cette araignée joint
encore une adreffe & une force finguliere pour env*
pêcher qu’on n’en ouvre la porte.
A la première découverte que M. l’abbé de Sauvages
en fit, il n’eut rien de plus preffé que d’enfoncer
une épingle fous la porte de cette habitation pour
la foulever ; mais il y trouva une réfiftance qui l’étonna
: c’étoit Varaignée qui retenoit cette porte avec
une force qui le furprit extrêmement dans un fi petit
animal:, il ne fit qu’entr’ouvrir la porte, il la vit le
corps rènverfé , accrochée par les jambes d’un côté
aux parois de l’entrée du trou , de l’autre à la toile
qui recouvroit le deffous de la porte : dans cette