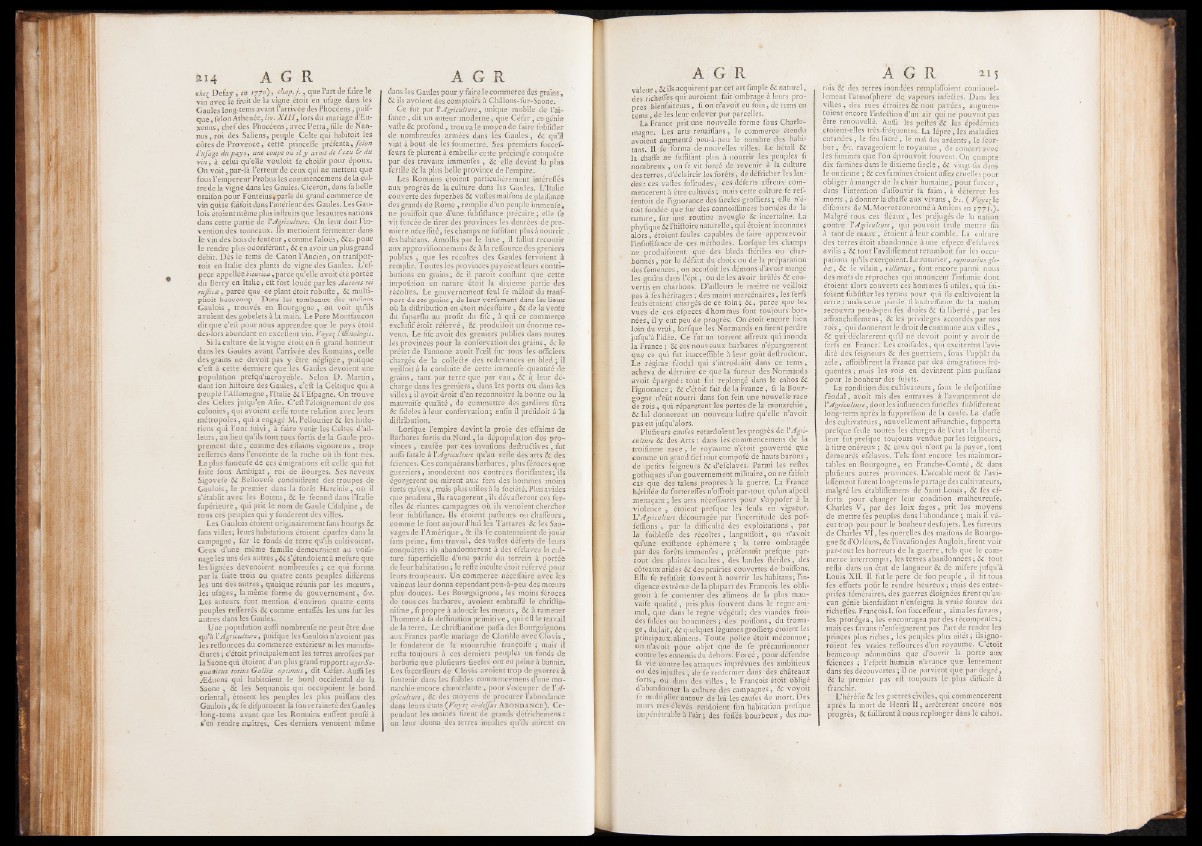
ih i i Defey ■; en /770), chap.j. ,.que l’art de faire le
vin avec le fruit de la vigne étoit en ufage dans les
Gaules long-tems avant l’arrivée des Phocéens, puisque
, félon Athenée, liv, X I I I , lors du mariage d’Eu-
xenus, chef des Phocéens, avec Petta, fille ae Nan-
iius, roi des Saliens, peuple Celte qui habitoit les
côtes de Provence, cette princeffe préfenta,yè/o/2
1'ufage du pays, une coupe ou il y àvoit de Veau & du
Vin, à celui qu’elle vouloit fe choifir pour époux.
On v o it , par-là l’erreur de ceux qui ne mettent que
fous l’empereur Probus les eommencemens de la cul-
trede la vigne dans les Gaules. Cicéron, dans fa belle
oraifon pour Fonteiusf parle du grand commerce de
vin qui le faifoit dans l’intérieur des Gaules. Les Gaulois
étoientmême plus infiruits que les autres nations
dans cette partie de l'Agriculture. On leur doit l ’invention
des tonneaux. Ils mettoient fermenter dans
l é vin des bois de lenteur, comme l’aloës, &c. pour
le rendre plus odoriférant, & en avoir un plus grand
débit. Dès le tems de Caton l’Ancien, on tranfpor-
toit en Italie des plants de vigne des Gaules. L’ef-
pece appellée biturica, parce qu’elle avoit été portée
du Berry en Italie, eft fort louée parles Autores rei
rujîicee, parce que ce plant étoit robufte, 6c multi-
plioit beaucoup. Dans les tombeaux des anciens
Gaulois , trouvés en Bourgogne , on voit qu’ils
avoient des gobelets à la main. Le Pere Montfaucon
dit que c’eft pour nous apprendre que le pays étoit
dès-lors abondant en excellent vin. Voye£ L'OEnologie,
Si la culture de la vigne étoit en fi grand honneur
dans les Gaules avant l’arrivée des Romains, celle
des grains ne devoit pas y être négligée, puifque
e’eft à cette derniere que les Gaules dévoient une
population prefqu’incroyable. Selon D . Martin,
dans fon hiftoire des Gaules, c’eft la Celtique qui a
peuplé l’Allemagne, l’Italie 6c l’Efpagne. On trouve
des Celtes jufqu’en Afie. C ’eft l’éloignement de ces
colonies, qui avoient ceffé toute relation avec leurs
métropoles, qui a engagé M. Pelloutier 6c les hifto-
riens qui l’ont fu iy i, à faire venir les Celtes d’ail-
leürs, au lieu qu’ils font tous fortis de la Gaule proprement
dite, comme des effaims vigoureux, trop
refferrés dansTenceinte de la ruche où ils font nés.
La plus fameufe de ces émigrations eft celle qui fut
faite fous Ambigat, roi de Bourges. Ses neveux
Sigovefe & Bellovefe conduifirent des troupes, de
Gaulois, le premier dans la forêt Hercinie, où il
s’établit avec les Boïens, & le fécond dans l’Italie
fupérieure, qui prit le nom de Gaule Cifalpine, de
■ tous ces peuples qui y fondèrent des villes.
Les Gaulois étoient originairement fans bourgs &
fans villes; leurs habitations étoient éparfes dans la
campagne, fur • le fonds de terre qu’ils cultivoient.
Ceux d’une même famille demeuroient au voifi-
nage les uns des autres, 6c s’étendoient à mefure que
les lignées devenoient nombreufes ; ce qui forma
par la fuite trois ou quatre cents peuples différens
les uns des autres, quoique réunis par les moeurs,
les ufages, la même forme de gouvernement, &c.
Les auteurs font mention d’environ quatre cents
peuples refferrés & comme entaffés les uns fur les
autres dans les Gaules.
Une population aufli nombreufe ne peut être due
qu’à l’Agriculture, puifque les Gaulois n’avoient pas
les reffources du commerce extérieur ni les manufactures
; c’étoit principalement les terres arrofées par
la Saône qui étoient d’un plus grand rapport : agerSe-
quanicus totius Gallice optimus, dit Céfar. Aufli les
Æduens qui habitoient le bord occidental de la
Saône , 6c les Sequanois qui occupoient le bord
oriental, étoient les peuples les plus puiffans des
Gaulois, & fe difputoient la fouveraineté des Gaules
long-tems avant que les Romains euffent penfé à
g’en rendre maîtres. Ces derniers venoient même
dans les Gaules pour y faire le commerce des grains ,
6c ils avoient des comptoirs à Châlons-fur-Saone.
Ce fut par l'Agriculture, unique mobile de i’ai-
fance , dit un auteur moderne, que Cé fa r , ce génie
vafte 6c profond, trouva le moyen de faire fubfifter
de nombreufes armées dans les Gaules, 6c qu’il
vint à bout de les foumettre. Ses premiers fuceef-
feurs fe plurent à embellir cette précieufe conquête
par des travaux immenfes , 6c elle devint la plus
fertile 6c la plus belle province de l’empire.
Les Romains étoient particuliérement fiitéreflés
aux progrès de la culture dans les Gaules. L’ Italie
couverte des fuperbes 6c vaftes maifons de piaifaace
des grands de Rome , remplie d’un peuple immenfe,
ne jouiffoit que d’une fubfiftance précaire ; elle fe
vit forcée de tirer des provinces les denrées de première
nécefliîé, fes champs ne fuffifant plus à nourrir
fes habitans. Amollis par le luxe , il fallut recourir
aux approvifionnemens & à la reffource des greniers
publics , que les récoltes des Gaules fervoient à
remplir. Toutes les provinces payoient leurs contributions
en grains; 6c il paroît confiant que cette
impofition en nature étoit la dixième partie des
récoltes. Le gouvernement feu! fe mêloit du tranfi
port de ces grains, de leur verfement dans les lieux
où la diftribution en étoit nécëffaire, 6c de la vente
du fuperflu au profit du fife, à qui ce commerce
exclufif étoit réfervé, 6c produifoit un énorme revenu.
Le fife avoit des greniers publics dans toutes
les provinces pour la confervation des grains, & lé
préfet de l’annone avoit l’oeil fur tous les officiers
chargés de la colle â e des redevances en bled ; il
veilloit à la conduite de cette immenfe quantité de
grains, tant par terre que par eau, & à leur décharge
dans les greniers, dans les ports ou dans les
villes ; il avoit droit d’en reconnoître la bonne ou la
mauvaife qualité , de commettre des gardiens fars
& fideles à leur confervation ; enfin il préûdoit à la
diftributiom
Lorfque l’empire devint la proie des effaims de
Barbares fortis du N o rd , la dépopulation des provinces
, caufée par ces invafions deftrudives , fut
aufli fatale à ¥ Agriculture qu’au refte des arts 6c des
fciences. Ces conquérans barbares, plus féroces que
guerriers, inondèrent nos contrées floriffantes ; ils
égorgèrent ou mirent aux fers dés hommes moins
forts qu’eux, mais plus utiles à la fociété. Plus avides
que prudens, ils ravagèrent, ils dévaluèrent ces fertiles
6c riantes campagnes où ils venoient chercher
leur fubfiftance. Ils étoient pafteurs ou chaffeurs,
comme le font aujourd’hui les Tartares & les Sauvages
de l’Amérique, & ils fe contentoient de jouir
fans peine, fans travail, des vaftes déferts de leurs
conquêtes : ils abandonnèrent à des efclaves la culture
fuperficielle d’une partie du terrein à portéè
de leur habitation ; le refte inculte étoit réfervé pour
leurs troupeaux. Un commerce néceffaire avec les
vaincus leur donna cependant peu-à-peu des moeurs
plus douces. Les Bourguignons, les moins féroces
de tous ces barbares, avoient embraffé le chriftia-
nifme, fi propre à adoucir les moeurs, & à ramener
l’homme à fa deftination primitive, qui eft le travail
de la terre. Le chriftianifme paffa des Bourguignons
aux Francs parole mariage de Clotilde avec Clovis
le fondateur de la monarchie françoife ; mais il
refta toujours à ces derniers peuples un fonds de
barbarie que plufieurs fiecles ont eu peine à bannir.
Les fucceffeurs de Clovis avoient trop de guerres à
foutenir dans les foibles eommencemens d’une monarchie
encore chancelante, pour s’occuper de YA-
griculture, 6c des moyens de procurer l’abondance
dans leurs états ( F o y t { ci-deffus Abondance). Cependant
les moines firent de grands çléfrichemens :
on leur donna des terres incultes qu’ils mirent en
valeur & ils acquirent par cet art Ample & naturel,
des richeffes qui auroient fait ombrage à leurs propres
bienfaiteurs, fi on n’a voit eu foin, de tems en
tems , de les leur enlever par parcelles.
La France prit une nouvelle forme fous Charlemagne.
Les arts renaiffans, le commerce étendu
avoient augmenté peu-à-peu le nombre des habitans.
Il fe forma de nouvelles villes. Le bétail 6c
la chaffe ne fuffifant plus à nourrir les peuples fi
nombreux , on fe vit forcé dé revenir à là culture
des terres, d’éclaircir les forêts, de défricher les landes:
ces vaftes folitudes,. ces déferts affreux-commencèrent
à être cultivés ; mais cette culture fe ref-
fentoit de l’ignorance des fiecles greffiers ; elle n’é-
toit fondée que fur des connoiffances bornées de la
nature , fur une routine aveugle & incertaine. La
phyfique & l ’hiftoire naturelle, qui étoient inconnues
alors, étoient feules capables de faire appercevoir
l’infuffifance de ces méthodes. Lorfque les champs
ne produifoient que des bleds ftériles ou char-
bonnés, par le défaut du choix ou de la préparation
des femences, on acciifoit les démons d’avoir mangé
les grains dans l’ép i, ou de les aŸoir brûlés ôc convertis
en charbons. D’ailleurs le maître ne veilloit
pas à. fes héritages ; des mains mercénairesylès ferfs
feuls étoient chargés de ce foin; & , parce que les
vues de ces efpeces d’hommes font toujours bornées,
il y eut peu de progrès. On étoit encore bien
loin du v ra i, lorfque les Normands en firent perdre
jufqu’à l’idée. Ce fut un torrent affreux qui inonda
la France ; 6c ces nouveaux barbares n’épargnerent
que ce qui fut inacceffible à leur goût deftructeur.
Le régime féodal qui s’introduifit dans ce tems,
acheva de détruire ce que la fureur des Normands
avoit épargné : tout fut replongé dans le cahos 6c
l’ignorance ; & c’étoit fait de la France, fi la Bourgogne
n’eût nourri dans fon fein une nouvelle race
de rois, qui réparèrent lès pertes de la monarchie ,
Sc lui donnèrent un nouveau luftre qu’elle n’avoit
pas eu jufqu’alors.
Plufieurs caufes retardoient les progrès de VAgriculture
6c des Arts : dans les eommencemens de la
îroifieme race , le royaume n’étoit gouverne que
comme un grand fief tout compofé de hauts barons ,
de petits leigneurs 6c d’efclaves. Parmi les reftes
gothiques d’un gouvernement militaire, on ne faifoit
cas que des taiens propres à la guerre. La France
hériffée de fortereffes n’offroit par-tout qu’un afpedl
menaçant ; les arts néceffaires pour s’oppofer à la
.violence , étoient prefque les feuls en' vigueur.
Al Agriculture découragée par l’incertitude des pof-
feflions , par la difficulté des exploitations , par
la foibleffe des récoltes, languiffoit, ou n’avoit
qu’une exiftence éphémère ; là terre ombragée
par des forêts immenfes , préfentoit prefque partout
des plaines incultes, des landes ftériles, des
coteaux arides & des prairies couvertes de buiffons.
Elle fe refufoit fouvent à nourrir les habitans; l’indigence
extrême de la plupart des François les obli-
geoit à fe contenter des alimens de la plus mauvaife
qualité , pris plus fouvent dans le régné animal,
que dans le régné végétal; des viandes froides
falées ou boucanées ; des poiffons, du fromage
, durait, 6c quelques légumes groflier#s étoient les
principaux.alimens. Toute police étoit méconnue;
on n’avoit pour objet que de fe précautionnner
contre les ennemis du dehors. Forcé, pour défendre
fa vie contre les attaques imprévues des ambitieux
ou des injuftes , de fe renfermer dans des châteaux
fortsy ou dans des villes , le François étoit obligé
d’abandonner la culture des campagnes, 6c voyoit
fe multiplier autour de lui les caufes de mort. Des
murs très-élevés rendoient fon habitation prefque
impénétrable à l’air ; des foffés bourbeux, des marais
6c des terres inondées rempliffoient continuellement
l’atmofphere de. vapeurs infeftes. Dans les
villes , des rues étroites & non pavées, augmen-
toient encore l’infeftion d’un air qui ne pouvoit pas
être renouvellé. Aufli lés peftes & les épidémies
étoient-elles très-fréquentes. La lèpre, les maladies
cutanées , le feu faCré, le mal des ardents, le feor-
b u t , <S*c. ravage oient le royaume , de concert avec
les famines que l’on éprouvoit fouvent. On compte
dix famines'dans le dixième fiecle, 6c vingt-fix dans
le onzième ; 6c ces famines étoient affez cruelles pour
obliger à manger de la chair humaine , pour forcer,
dans l’intention d’affo.uvir fa faim, à déterrer les
morts, à donner la chaffe aux vivans , 6*c. ( Voye^le
difcôurs de M. Morret couronné à Amiens en 17 7 1 .) .
Malgré tous ces fléaux, les préjugés de la nation
contre l’Agriculture, qui pouvoit feule mettre fin
à tant de maux , étoient à leur comble. La culture
des terres étoit abandonnée à une elpece d’efclaves
avilis ; 6c tout l’aviliffement retomboit fur les occupations
qu’ils exerçoient. Le roturier y ruptuarius glèbes
, 6c le vilain, villanus, font encore parmi nous
des mo.ts de reproches qui annoncent l’infamie dont
étoient alors couverts ces hommes fi utiles, qui fai-
foient fubfifter les tyrans pour qui ils cultivoient la
terre : mais cette partie fi intéreffante de la nation
recouvra peu-à-peu fes, droits 6c fa liberté , par les
affranchiflemens, & les privilèges accordés par nos
rois, .qui donnèrent le droit decommune aux villes ,
6c qui déclarèrent qu’il né devoit point y avoir de
ferfs en France.' Les crôi'fades, qui excitèrent l’avidité
des feigneurs 6c des guerriers, fous l’appât du
zèle, affoiblirent la France par des émigrations fréquentes
; mais les rois . en devinrent plus puiffans
poiir le bonheur des fujets. ,
La condition dès cultivateurs, fous le defpotifme
féodal, avoit mis des entraves à l’avancement de
Y Agriculture, dont les influences funeftes fubfifterent
long-tems après la fuppreflion de la caufe. La claffe
des cultivateurs , nouvellement affranchie, fupporta
prefque feule toutes les charges de l’état : la liberté
leur fut prefque toujours vendue par les feigneurs,
à.titre onéreux ; 6c ceux qui n’ont pu la payer, font
demeurés efclaves. Tels font encore les mainmor^
tables en Bourgogne, en Franche-Comté, 6c dans
plufieurs autres provinces. L’accablé ment 6c l’avi-
liffement furent long-tems le partage des cultivateurs,
malgré les établiffemens de Saint Louis, & fes e f forts
pour changer leur condition malheureufe.
Charles V , par des loix fages , prit les moyens
de mettre fes peuples dans l’abondance ; mais il vécut
trop peu pour le bonheur desfujëts. Les fureurs
de Charles V I , les querelles des maifons de Bourgogne
& d’Orléans, & l’invafîonçles Anglois, firent voir
par-tout les horreurs de la guerre , tels que le commerce
interrompu, les terres abandonnées; 6c tout
refta dans un état de langueur 6c de mifere jufqu’à
Louis XII. Il fut le pere de fon peuple , il fit tous
fes efforts pour le rendre heureux ; mais des entre-
prifes téméraires, des guerres éloignées firent qu’aucun
génie bienfaifant n’enfeigna la vraie fource des
richeffes. François I. fon fucceffeur, aima les favans,
les protégea, les encouragea par des récompenfes ;
mais ces favans n’enfeignerent paS l ’art de rendre les
princes,plus riches , les peuples plus ailés; ilsigno-
roient les vraies reffources d’un royaume. C ’étoit
beaucoup néanmoins que d’ouvrir la porte aux
fciences ; l’efprit humain n’avance que lentement
dans fes découvertes ; il ne parvient que par degré,
6c le premier pas eft toujours le plus difficile à
franchir.
L’héréfie 6c les guerres civiles, qui commencèrent
après la mort de Henri I I , arrêtèrent encore nos
progrès, 6c faillirent à nous replonger dans le cahos*