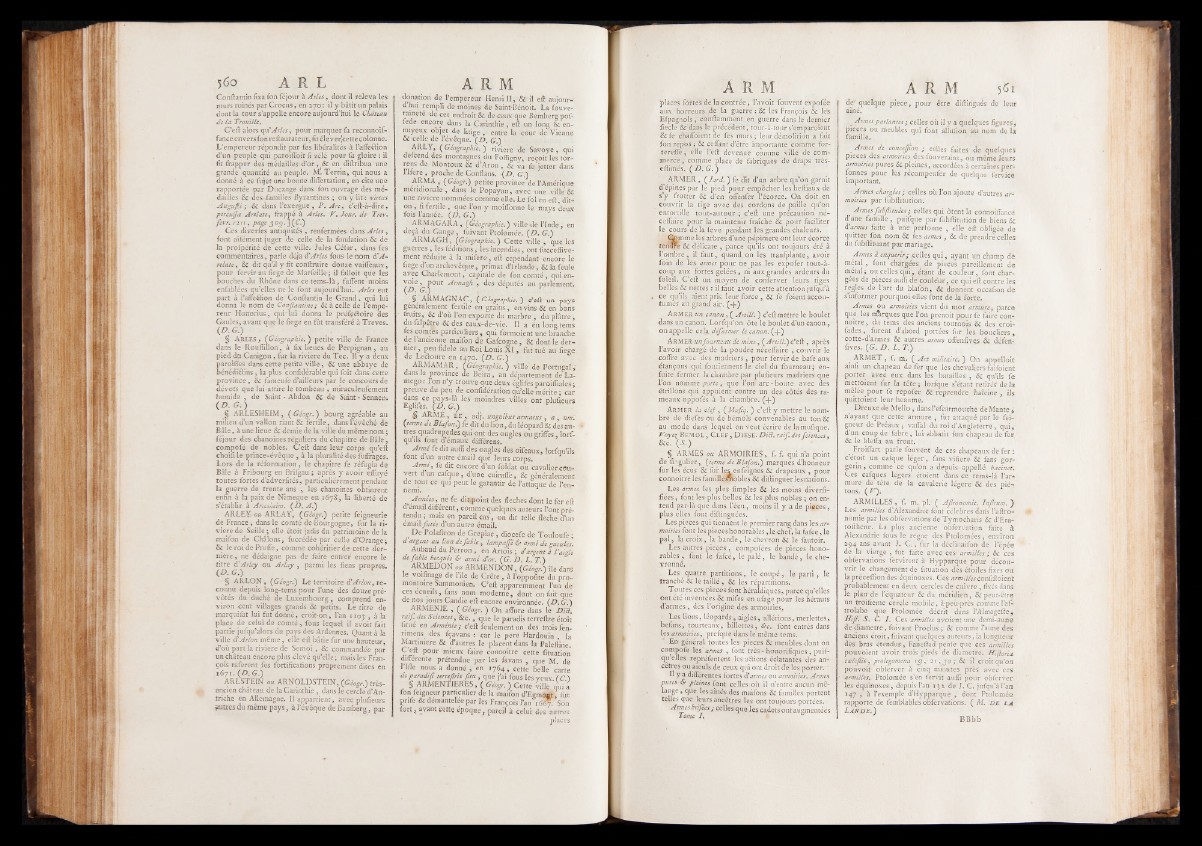
Conftantin fixa Ton féjour à Arles, dont il releva les
murs ruinés par Crocus, en 270: il y bâtit un palais
dont la tour s’appelle encore aujourd’hui le Château
de la Trouille.
C ’eft alors qu'Arles, pour marquer fa reconnoif-
fance envers fon reftaurateür, fit éleverjcette colonne.
L ’empereur répondit par fes. libéralités à l’affe&ion
d’un peuple qui paroiffoit fi zélé pour fa gloire : il
fit frapper des médailles d’o r , & en diftribua une
grande quantité au peuple. M. Terrin, qui nous a
donné à ce fujet une bonne differtation, en cite une
rapportée par Ducange dans fon ouvrage des médailles
& des-familles Byzantines ; on ylit'-i y mus
Augufii ; & dans l’exergue , P. Are, c’eft-à-dire,
percuffa A relate, frappé à Arles. V. Jour, de Trev.
f c v r .i in , page 3 os . \ (C )
Ces diverfes antiquités , renfermées dans Arles,
font aifément juger de celle de la fondation 8c de
la profpérité de cette ville. Jules Céfar, dans fes
commentaires, parle déjà à’Arles fous le nom d'A-
relate, 8c dit qu’il y fit conftruire douze vaiffeaux,
pour fervir au fiege de Marfeille ; il falloir- que les
bouches du Rhône dans cetems-là, fuffent moins
enfablées qu’elles ne le font aujourd’hui. Arles eut
part à l’affe&ion de Conftantin le Grand, qui lui
donna le nom de Conjlantine; 8c à celle de l’empe-
reiir Honorius, qui" lui donna le préfgôoire des
Gaules, avant que le fiege en fut transféré à Treves.
(p - g .) I . . .
§ A r l e s , (Géographie. ) petite ville de France
dans le Rouffillon, à fix lieues de Perpignan, au
pied du Canigou , fur la riviere du T ec. Il y a deux
pàroiffes dans cette petite v ille , 8c une abbaye de
bénédictins, la plus confidérable qui foit dans cette
province, & fameufe d’ailleurs par le concours de
dévots que lui attire le tombeau , miraculeufement
humide , de Saint - Abdon & de Saint - Sennen.
(Z?. G .)
§ ARLESHEIM, ( Glogr. ) bourg agréable au
milieu d’un vallon riant & fertile, -dans l’évêché de
Bâle, à une lieue & demie de la ville du même nom ;
féjour des chanoines réguliers du chapitre de Bâle ,
compofé de nobles. C’eft dans leur corps qu’eft
choifi le prince-évêque , à la pluralité des fuffrages.
Lors de la réformation, le chapitre fe réfugia de
Bâle à Fribourg en Brifgau ; après y avoir effuyé
toutes fortes d’adverfités, particuliérement pendant
la guerre de trente ans , les chanoines obtinrent
enfin à la paix de Nimegue en j 678, la liberté de
s’établir à Arusheim. (D . AJ)
ARLEY ou ARLAY, ( Géogr.) petite feigneurie
de France, dans le comté de Bourgogne, fur la riviere
de Seille ; elle étoit jadis du patrimoine de la
maifon de Châlons, fuccédée par celle d’Orange;
& le roi de Pruffe, comme cohéritier de cette dernière,
ne dédaigne pas de faire entrer encore le
titre d'Arley ou Arlay , parmi les liens propres.
(D . G.)
§ ARLON, (’Géogr.) Le territoire d'Arlon, reconnu
depuis long-tems pour l’une des douze prévôtés
du duché de .Luxembourg, comprend environ
cent villages grands 8c petits. Le titre de
marquifat lui fut donné, croit-on, l’an 1103 » à la
place de celui de comté, fous lequel il avoit fait
partie jufqu’alors du pays des Ardennes. Quant à la
ville 8 Arlon même, elle eft bâtie fur une hauteur
d’où part la riviere de Semoi, & commandée par
un château encore plus élevé qu’elle ; mais les François
raferent fes fortifications proprement dites en
1671. (D. G.)
ARLSTEIN ou ARNOLDSTEIN, (Géogr.) très-
i ancien château de la Carinthie, dans le cercle d’Autriche
en Allemagne. Il appartient, avec plufieurs
autres du même pays, à l’évêque de Bamberg, par
donation de l’empereur Henri II, & il eft aujour-
d hui rempli de moines de Saint-Bénoit. La fouve-
rameté de cet endroit & de ceux que Bémberg pof-
fede encore dans la Carinthie, eft un long & ennuyeux
objet de litige , entre la cour de Vienne
oc celle de l’évêque. (D . G.)
ARLY>. ( Géographie. ) riviere de Savoye , qui
delcend des montagnes du Folfigny, reçoit les tor-
rens de Montoux & d’Aron, 8c Va fe jetter dans
l’Ifere , proche de Conflans. (JD. G.)
ARM A, ( Géogr.) petite province de l’Amérique
méridionale, dans le Popayan, avec une ville 8c
une riviere nommées comme elle. Le fol en eft, dit-
on , fi fertile , que l’on y mqiffonne le mays deux
fois l’année. (D. G.)
ARMAGARA , (Géographie.) ville de l’Inde, en
deçà du Gange, fuivant Ptoloméé. (D . G.)
ARMAGH, (Géographie. ) Cette ville , que les
guerres, les feditions, les incendies, ont fueceffive-
ment réduite à la mifere, eft cependant encore le
fiege d’un archevêque, primat d’Irlande, &c la feule
avec Charlemont, capitale de fon comté, qui en-
(ZY’G ^°mr ^ rma& 9 ^es ^®Putés au parlement.
§ ARMAGNAC, ( Géographie. ) c’eft un pays
généralement fertile en grains , en vins & en bons
fruits, & d’ou l’on exporte du marbre , du plâtre,
du fàlpêtre 8c des eaux-de-vie. Il a eu long-tems
fes comtes particuliers, qui formoient une branche
d? l’ancienne maifon de Gafcogne, 8c dont le der-
nier, peu fidele au Roi Louis X I , fut tué au fiege
de Leéroure en 1470. (D. G J
ARMAMAR, (Géographie. ) ville de Portugal,
dans la province de Beira, au département de La-
mego : 1 on n’y trouve que deux églifes paroiffiales ;
preuve du peu de confidération qu’elle mérite ; car
dans ce pays-là les moindres villes ont plufieurs
Eglifes. (D . G.) r
§ ARMÉ , é e , adj. unguibus armatus , a , um.
( terme de BlafonJ)it dit du lion, du léopard & des au-
tres quadrupèdes qui ont des ongles ou griffes, lorf-
qu us font d’émaux différens.
Armé fe dit auffi des ongles des oifeaux, lorfqu’ils
font d un autre émail que leurs corps.
Arme, fe dit encore d’un foldat ou cavalier couvert
d’un cafque, d’une cuiraffe, & généralement
de tout ce qui peut le garantir de l’attaque de l’ennemi.
firmhs, ne fe dit,point des fléchés dont le fer eft
d’email différent, comme quelques auteurs l’ont prétendu
; mais en pareil cas, on dit telle fléché d’un
email futée d’un autre émail.
------------- , uwtcic ue î ouiouie ;
d argent au lion de fable, lampaffé & armé de gueules.
Aubaud du Perron, en Artois ; £ argent à Vaigle
de fable becquée & armé d’or. (G. D. L. T )
ARMEDON ou ARMENDON, (Giogr.) île dans
le voifinage de l’île de Crê te, à l’oppofite du promontoire
Sammonien. C’eft apparemment l’un de
ces écueils, fans nom moderne, dont on fait que
de nos jours Candie eft encore environnée. (D. G.)
ARMENIE , ( Géogr. ) On affure dans le Dicl.
raif. des Sciences, & e ., que le paradis terreftre étoit
fitué en Arménie ; c’eft feulement un des trois fen-
rimens des fçavans : 'car le pere Hardouin , la
Martiniere & d’autres , le placent dans la Paleftine.
C ’eft pour mieux faire connoître cette fituation
différente prétendue par les favans , que M. de
l ’Ifie nous a donné , en 1764, cette belle carte
de paradifi terrefiris Jîtu, que j;ai fous les veux. ( O
§ ARMENTIERES, ( Géogr. ) Cette ville qui a
fon feigneur particulier de la maifon d’Egmoat, fut
prife & démantelée par les François l’an 166% Son
fort ^ avant eettç époque ? pareil à celui des autres
p la c e s
places fortes de la contrée, l’avoit fouvent expofée
aux, horreurs .de la guerre : & les François & le‘s
Efpaghôls , conftamment en guerre dans le dernier
fiecle & dans le précédent, tour-à-tour s’empàroient
& f e chaffoient de fes murs; leur démolition a fait
fon rep'os ; & ceffant d’être importante comme for-
tereffe, elle l’eft devenue comme ville de Commerce
, comme place de fabriques de draps très-
èftimés^ (D .G .')
ARMER, (Jard. ) fe dit d’un arbre qu’on garnit
d’épines par le pied pour empêcher les beftiaux de
s y frotter & d’en offenfer l’écorce. On doit .en
Couvrir la tige avec des cordons de paille qu’on
entortille tput-autour ; c’eft une précaution né-
Ceffaire pour la maintenir fraîche oc pour faciliter
le cours de la feve pendant les grandes chaleurs.
femme les arbres d’une pépinière ont leur écorce
tendre & délicate , parce qu’ils ont toujours été à
l ’ombre, il faut, quand on les tranfplante, avoir
foin de les armer pour ne pas les expofer tout-à-
coitp aux fortes gelées, ni aux grandes ardeurs du
foleil. C ’eft un moyen de conferver leurs, tiges
belles & nettes : il faut avoir cette attention jufqu’à
ce qu’ils aient pris leur force, & fe foient accou- ’
tûmes au grand air. (+ )
A r m e r un canon, ( Artill. ) c’eft mettre le boulet
dans un canon. Lorfqu’on ôte le boulet d’un canon,
on appelle cela défarmer le canon, (-f-)
A r m e r un fourneau de mine, ( ArtillJ) c’eft , après
l’avoir chargé de la poudré néceffaire , couvrir le
coffre avec des madriers , pour fervir de bafe aux
étançons qui foutiennent le ciel du fourneau; en-
fuite .fermer la chambre par plufieurs madriers que
I on nomme porte, que l’on arc-boute avec des
étrillons qui appuient contre un des- côtés des rameaux
oppofés à la chambre. (+ )
A r m e r la clef , (Mufiq. ) c ’ e ft y m e t tr e le n om b
r e de d ie fe s o u de b ém o ls c o n v e n a b le s au to n &
a u m o d e dans le q u e l on v e u t é c r ir e de la niu fiqu e .
Voye[ B é m o l , C l e f , D ie s e . Dicl. raif. des fciences,
& c . ( S . )
§ ARMES ou ARMOIRIES, f. f. qui n’a point
de fingulier, (terme de Blafon.) marques d’honneur
fur les écus 8c fur les enfeignes & drapeaux , pour
connoître les famillelmobles & diftinguer les nations.
•Les armes les plus fimples & les moins diverfi-
fiées, font les:plus belles & les plus nobles ; on entend
par-là que dans, l’écu, moins il y a de piaces,
plus elles font diftinguées.
Les pièces qui tiennent le premier rang dans les armoiries
font les pièces honorables, le chef, la fafee, le
p a l, la croix, la bande, le chevron & le fautoir.
Les autres pièces, compofées de pièces honorables
, font le fafcé, lep a lé , le bandé, le che-
yronné. >
Les quatre partitions, le coupé, le parti, le
tranché 8c le taillé, 8c les répartitions.
Toutes ces pièces font héraldiques, parce qu’elles
ont été inventées 8c mifes en ufage pour les hérauts
d’armes , dès l’origine des armoiries,
Les lions, léopards, aigles, allérions, merlettes,
befans, tourteaux, billettes, &c. font entrés dans
les armoiries, prefque dans le même tems.
En général toutes les pièces & meubles dont oh
compofe les armes , font très - honorifiques, puif-
qu’eïles repréfentent les avions éclatantes des ancêtres
ou aïeuls de ceux qui ont droit de les porter. ■
Il y a differentes fortes d’armes ou armoiries. Armes
pures 6* pleines font celles où il n’entre aucun mê-
lange, que les aînés des maifons 8c familles portent
telles que leurs ancêtres les ont toujours portées.
Armesbrifées; celles que les cadets ont augmentées
Tome I , _ ' ,#
de* quelque piece, pour être diftihgués de leur
aîné.
Armes parlantes; celles où il y a quelques figures;
pièces ou meubles qui font allufion au nom de là
famille.
Armes de concefßon ; celles faites de quelques
pièces des armoiries des fouverains, ou même leurs
armoiries pures 8c pleines, accordées à certaines personnes
pour les récompenfer de quelque ferviee
important.
Armes chargées; celles où l’on ajoute d’autres armoiries
par fubftitution.
ArmesfuBfituéès ; celles qui ôteritla connoiffancé
d’une famille, puifqite par fubftitution de biens 8c
d’armes faite à une perfonne , elle eft obligée de
quitter fon nom 8c fes armes , 8c de prendre celles
du fubftituant par mariage.
Armes à enquérir; pelles qui, ayant un champ dé
métal, font chargées de pièces pareillement de
métal ; ou celles qui, étant de couleur, font chargées
de pièces auffi de coule'ur, ce qui eft contre les
réglés de l’art du blafon, 8c donnent occafion de
s’informer pourquoi elles fönt de la forte.
Armes ou armoiries vient du mot armure, parce
que les marques que l’on prenoit pour fe faire connoître,
du tems des anciens tournois & des croi-
fades, furent d’abord portées fur les boucliers ,
cotte-d’armes 8c autres armes offenfives & défen-
fives. (G. D . L. T.)
ARMET , f; m, ( Art militaire. ) On appelloit
ainfi un chapeau de fer que les chevaliers faifoient
porter avec eux dans les batailles , 8c qu’ils fe
m®Çt°ient fur la tête ; lorfque s’étant retirés de la
mêlée pour fe répofef & reprendre haleine, ils
quittoient leur heaume.
Dreuxe de Mello, dansl’éfcàrmouche de Mante î
n’ayant que cette armure , fut attaqué par le feigneur
de Préaux j vaffal du roi d’Angleterre, qui;
d’un coup de fabre, lui abbatit fon chapeau de fer
& le bleffa au front.
Froiffart parle fouvent de ces chapeaux de fer :
c’étoit un cafque léger, fans vifiere & fans gor-
gerin, comme ce qu’on a dépuis appellé bacineti
Ces cafques légers étoient dans ce tems-là l’ar-*
mure dé tête de la cavalerie légère & des piétons.
( F ) t '
ARM ILLES , f. m. pi.- ( Aßronomie. Infirum. )
Les drmilles d’Alexandrie font célébrés dans l’aftro-
fiomié par les obfervations de Tymocharis 8c d’Era-
tofthene. La plus ancienne obfervation faite à
Alexandrie fous le regne des Ptolomées, environ
294 ans avant J. C . , fur la déclinailon de l ’épée
de la vierge , fut faite avec ces armilles J 8c ces
observations fervirent à Hypparque pour découvrir
le changement de fituatiön des étoiles fixes où
lapréceffiondes équinoxes. Ces armillesconûûoierit
probablement en deux cercles de cuivre , fixés dans
lé plan- de l’équâteur & du méridien, & peut-être
un troifteme cerclé mobile, à-peu-près comme l’astrolabe
que Ptoloméé décrit dans l’Almagefte*
Hiß. S. C. I. Ces armilles avoient une demi-aune
de diamètre, fuivant Proclus ; & comme l’aune des
anciens étoit, fuivant quelques auteurs, la longueur
dès bras étendus, Faneftad penfe que ces drmilles
pouvoient avoir trois pieds de diamètre; Hiftoria.
cdleßis -, prolegomena / f), 21 , go ; 8c it Croit qu’on
pouvoit obferver à cinq minutes près avec ces
■ armilles. Ptoloméé s’en fervit auffi pour obferver
les équinoxes, depuis l’an 13 z de J. C. jufqu’à l’an
147 , à l’exemple d’Hypparquè , dont Ptoloméé
rapporte de femblables obfervations. ( M. d e l a
La n d e ,')
BBbb