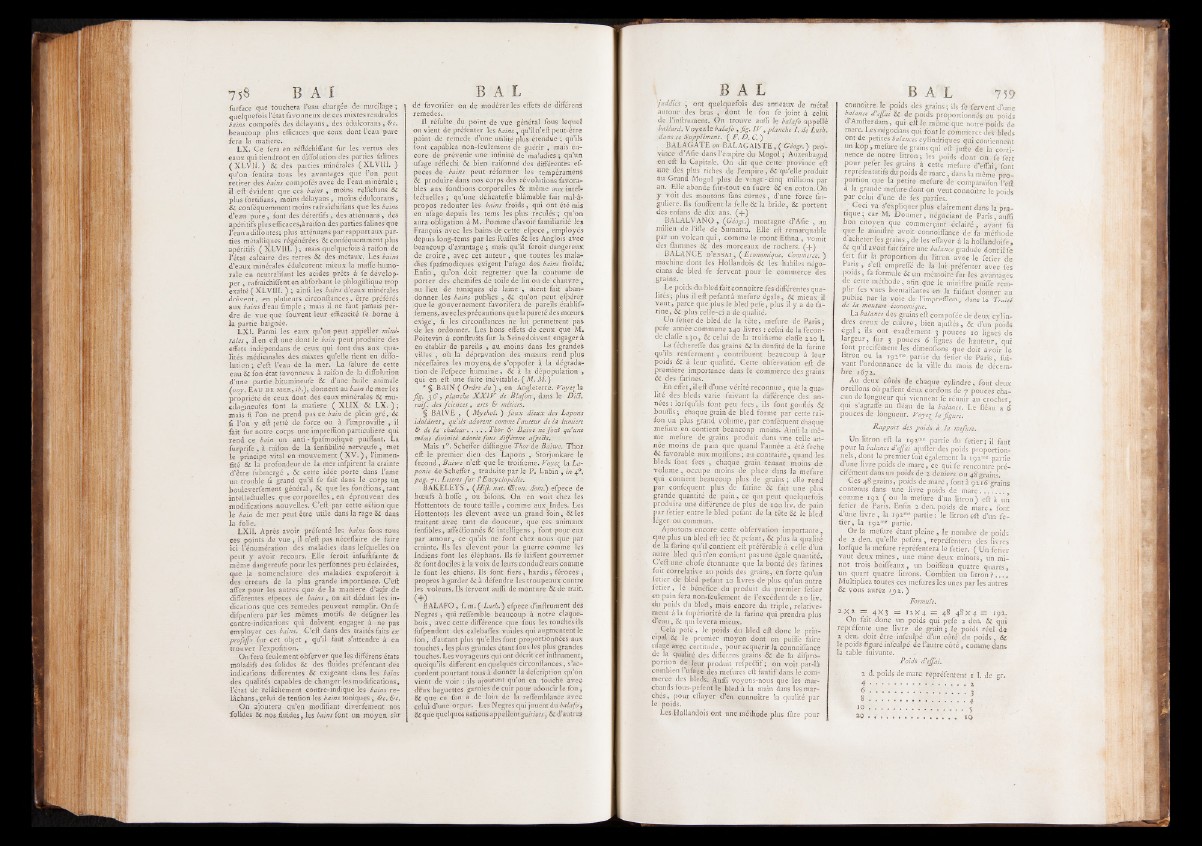
7 5 $ B A I
furface que touchera l’-eau chargée de mucilage ;
quelquefois l’état favonneux de: ces mixtes rendra les
bains compofés des délayans, des édulcorans, &c.
beaucoup plus efficaces que ceux dont l’eau pure
fera la matière.
LX. Ge fera en réfléchiffant fur les vertus des
eaux qui tiendront en diflolution des parties falines
(X LV II. ) & des parties minérales (XLVIII. )
qu’on fentira tous les avantages que l’on peut
retirer des bains compofés avec de l’eau minérale ;
il eft évident que ces bains , moins relâchans &
plus fortifians, moins délayans, moins édulcorans,
& conféquemment moins rafraîchiffans que les bains
d’eau pure, font des déterfifs , des attenuans, des
apéritifs plus efficaçes,àraifon des parties.falines que
l’eanadiffoutes; plus atténuans par rapport aux parties
métalliques régénérées & conféquemment plus
apéritifs (XLVIII. ) ; mais quelquefois à raifon de
l’état calcaire des terres & des métaux. Les bains
d’eaux minérales édulcorent mieux la maffe humorale
en neutralifant les acides prêts à fe développer
, rafraîchiffent en abforbant le phlogiftique trop
exalté (XLVIII. ) ; ainfi les bains d’eaux minérales
doivent, en plusieurs circonftances, être préférés
aux bains d’eau fimple ; mais il.ne faut jamais perdre
de vue que fouvent leur efficacité fe borne à
la partie baignée.
LXI. Parmi les eaux qu’ôn peut appeller minérales
-, il en eft une dont le bain peut produire des
effets indépendans de ceux qui font dus aux qualités
médicinales des mixtes qu’elle tient en diffo-
lution ; g’ eft l’eau de la mer. La falure de cette
eau & fon état favonneux à raifon de la diflolution
d’une partie bitumineufe & d’une huile animale
(voy-. Eau de mer, ib .f donnent au bain de mer les
propriété de ceux dont des eaux minérales & mu-
cilagineufes font la matière ( XLIX & LX. ) ;
mais fi l’on ne prend pas ce bain de plein gré, &
fi l’on y eft jetté de force ou à l’improvifte , il
fait fur notre corps une impreffion particulière qui
rend ce bain un anti - fpafmodique puiffant. La
furprife , à raifon de la fenfibilité nerveufe , met
le principe vital en mouvement (X V . ) , l’immen-
fité & la profondeur de la mer infpirent la crainte
d’être fubmergé , & cette idée porte dans l’ame
un trouble fi grand qu’il fe fait dans le corps un
bouleverfement général, & que les fondions, tant
inteüe&uelles que corporelles , en éprouvent des
modifications nouvelles. C ’eft par cette aélion que
le bain de mer peut être utile dans la rage & dans
la folie. ' _ v
LXII. Après avoir préfenté les bains fous tous
ces points de v u e , il n’eft pas néceffaire de faire
ici l'énumération des maladies dans lefquelles on
peut y avoir recours. Elle feroit infuffifante &
même dangereufe pour les perfonnes peu éclairées,
que la nomenclature des maladies expoferoit à
des erreurs de la plus grande importance. C’eft
affez pour les autres que de la maniéré d’agir de
différentes efpeces de bains, on ait déduit les indications
que ces remedes peuvent remplir. Onfe
difpenfera par les mêmes, motifs de défigner les
contre-indications qui doivent engager à ne pas
employer ces bains,, C ’eft dans des traités faits ex
profeffo fur cet objet , qu’il faut s’attendre à en
trouver l’expofition.
On fera feulement obferver que.les différens états
maladifs des folides & des fluides préfentant des '
indications differentes & exigeant dans les bains
des qualités capables de changer les modifications,
l’état de relâchement contre-indique les bains relâchans,
celui de tenfion les bains toniques, &c. &c.
On ajoutera qu’en modifiant diverfement nos
lolides & nos fluidesles bains font un moyen sûr
B A L
de favorifer ou de modérer les effets de différens'
remedes.
11 réfulte du point de vue général fous lequel
on vient de préfenter les bains , qu’il n’eft peut-être
point de remede d’une utilité plus étendue ; qu’ils
font capables non-feulement de guérir , mais encore
de prévenir une infinité de maladies ; qu’un
ufage réfléchi & bien raifonné dès’ différentes efpeces
de bains peut réformer les tempéramens
& produire' dans nos corps des révolutions favorables
aux fondions corporelles & même aux intellectuelles
; qu’une délicatefl'e blâmable fait mal-à-
propos redoutér lès bains froids -, qui ont été mis
en ufage depuis les tems les plus reculés ; qu’on
aura obligation à M. Pomme d’avoir familiarilé les
François avec les bains de cette efpece, employés
depuis long-tems par les Ruffes & les Anglois avec
beaucoup d’avantage ; mais qu’il feroit dangereux
de croire, avec cet auteur, que toutes les maladies
fpafmodiques exigent l’ufage des bains froids.'
Enfin, qu’on doit regretter que la coutume de
porter des chemifes de toile de lin ou de chanvre ,
au lieu de tuniques de laine , aient fait abandonner
les bains publics , & qu’on peut efpérer
que le gouvernement favorifera de pareils établif-
femens, avec les précautions que la pureté des moeurs
exigé, fi les circonftances ne lui permettent pas
de les ordonner. Les bons effets de ceux que M.
Poitevin à conftruits fur la Seine doivent engager à
en établir de pareils , au moins dans les grandes
villes , oit la dépravation des moeurs rend plus
néceffaires les moyens, de s’oppofer à la dégradation
de l’efpece humaine, & à la dépopulation ,
qui en eft une fuite inévitable. ( M. M. )
* § BAIN ( Ordre du ) , en Angleterre. Foye^ là
fig. 2 ,6 , planche X X I F de Blafon, dans le DiB.
raif. des fciences, arts & métiers.
§ BA1VE , ( Mythol. ) faux dieux des Lapons
idolâtres, quils adorent comme 1'auteur de la lumière
& de la chaleur..........Thor & Baivê ne font qu'une
même divinité adorée fous différens afpecls.
Mais 1°. Scheffer diftingué Thor de Baiwe. Thor
eft le premier dieu des Lapons ,• Storjunkare le
fécond, Baiwe n’eft que le troifieme. Voye£ la Laponie
de Scheffer , traduite parle P. Lubin , in-40.
pag. 7/. Lettres fur P Encyclopédie.
BAKELEYS , (Hiji. nat. OEcon. dom.') efpece de
boeufs à boffe , ou bifons. On en voit chez les
Hottentots de toute taille , comme aux Indes. Les
Hottentots les élevent avec un grand foin, & les
traitent avec tant de douceur, què ces animaux
fenfibles, affeûionnés & intelligens , font pour eux
par amour, ce qu’ils ne font chez nous que par
crainte. Ils les élevent pour la guerre comme les
Indiens font les éléphans. Ils fe laiffent gouverner
& font dociles à la voix de leurs condufteurs comme
le font les chiens. Us font fiers, hardis, féroces ;
propres à garder & à défendre les troupeaux contre
les voleurs. Ils fervent auffi de monture & de trait.
(+ ) > ' !
BALAFO, f. m. ( Luth.') efpece d’inftrument des
Negres, qui reffemble beaucoup à notre claque-
bois , avec cette différence que fous les touches ils
fufpendent des-^çalebaffes vuides qui augmentent le
fon, d’autant plus qu’elles font proportionnées aux
touches , les plus grandes étant fous les plus grandes
touches. Les voyageurs qui ont décrit cet infiniment;
quoiqu’ils different en quelques circonftances, s’accordent
pourtant tous à donner la defeription qu’on
vient de voir : ils ajoutent qu’on en touche avec
deux baguettes garnies de cuir pour adoucir le fon,
& que ce fon à de loin de la reffemblance avec
celui d’une orgue. Les Negres qui jouent du balafo',
&que quelques nations appellentguiriots, 6c d’autre?
BAL
juddics , ont quelquefois des anneaux de métal
autour des bras , dont le fon fe joint à celui
de l’inflrument. On trouve auffi fe balafo appelle
ballard. Voyez le balafo ■, -fig. I F , planche I. de Luth,
dans ce Supplément. ( F. D. C. )
BALAGATE oa BALAGAISTE, ( Géogr. ) province
d’Afie dans l’empire du Mogol ; Auzenbagad
en eft la Capitale. On dit que cette province eft
une des plus riches de l’empire,6 c qu’elle produit
au Grand Mogol1 plus de vingt- Cinq millions par
an. Elle abonde fur-tout en fucre & en coton. On
y voit des moutons fans cornes, d’une force fin-
gulierç. Ils fouffrent la Telle & la bride, 6c portent
desenfans de dix ans. ( -f)
BALÂLVANO , (Géogr.) montagne d’Afie , au
milieu de rifle de Sumatra. Elle eft remarquable
par un volcan q ui, comme le mont Ethna , vomit
des flammes 6c des morceaux de rochers. (-J-)
BALANCE d ’ e s s a i , ( Economique. Commerce. )
machine dont les Hollandois & les habiles négo-
cians de bled fe fervent pour le commercé des
grains.
Le poids du bled fait connoître fes différentes qualités;;
plus il eft pefant à mefure égale, & mieux il
vaut. parce que plus le bled pefe, plus il y a de farine,
6c plus celle-ci a de qualité.
Un fetier de bled de la tête, mefure de Paris,
pefe année commune 2 40 livres : celui de la fécondé
claffe 2 3 0 , & celui de la troifieme claffë 220 1.
La féèhereffe des grains 6c la denfité de la farine
qu’ils renferment , contribuent beaucoup à leur
poids 6c à Leur qualité. Cette obfervation eft. de
première importance dans le commerce des grains
6c des fariné?.
En effet, il eft d’une vérité reconnue, que la qualité
des bleds varie fuivant la différence des années
: lorfqu’ils font peu fecs, ils font gonflés &
bouffis; chaque grain de bled forme par cette raifon
un plus grand volume, par conféquent chaque
méfure en contient beaucoup moins. Ainfi la même
mefure de grains produit dans une telle année
moins de pain que quand l’année a été feche
& favorable aux moiffons ; au contraire, quand les
bleds font fecs , chaque grain tenant moins de
volume, occupe moins de place dans la mefure
qui contient beaucoup plus de grains ; elle rend
par conféquent plus de farine & fait une plus
grande quantité de pain, ce qui peut quelquefois
produire une différence de plus de 100 liv. de pain
par fetier entre le bled pefant de la tête & le bled
léger ou commun.
Ajoutons encore cette obfervation importante,
que plus un bled eft fec & pefant, & plus la qualité
de la farine qu’il contient eft préférable à celle d’un
autre bled qui n’en’contient pas une égale quantité. ;
C ’eft une chofe étonnante que la bonté des farines
foit corrélative au poids des grains, en forte qu’un
fetier de bled pefant 20 livres de plus qu’un autre i
fetier, lè bénéfice du produit du premier fetier
en pain fera non-feulement de l’excédent de 20 liv.
du poids du bled, mais encore du triple, relativement
à la fupériorité de la farine qui pendra plus
d’eau, & qui lèvera mieux.
Cela pofé, le poids du bled eft donc le principal
& le premier moyen dont on piaffe faire
ufage avec certitude, pour acquérir la connoiffancé
de la qualité des différens grains & de la difpro-
portion de leur produit refpeûif ; on voit par-là
combien l’ulâge des mefures eft fautif dans le commerce
des bleds. Auffi voyons-nous que les marchands
fous-pefent le bled à la main dans les marchés,
pour effayer d’en connoître la qualité par
le poids.
Les Hollandois ont une méthode plus fûre pour
BAL 759
connoître, le poids des grains ; ils fe fervent d’une
hatance d'effai ÔC de poids proportionnés au poids
d Amfterdam., qui eft le même que notre poids de
marc. Les-négocians qui font le commerce des bleds
ont de petites balances cylindriques qui contiennent
un k op , mefure de grains qui eft jufte de la continence
de notre litron ; les poids dont on fe fért
pour pefer les grains à cette mefure d’effai,'font
reprefentatifs du poids de marc, dans la même proportion
que la petite mefure dé comparaifon l’eft
à la grande mefure dont on veut connoître le poids
par celui d’une de fes parties.
’ Ceci va s’expliquer plus clairement dans la pratique;
car M. Doumer, négociant de Paris, auffi
bon citoyen que commerçant éclairé, ayant fu
que le mimftré avoir connoiffancé de fa méthode
d acheter les grains , de lés effayer à la hollandoife,
& qu il avoir fait faire une balance graduée dont il fe
fert fur la proportion du litron avec le fetier de
Paris , s’eft emprefle de la lui préfenter avec fes
poids, fa formule & un mémoire fur les avantagés
de cette méthode, afin cjue le miniftre puiffe remplir
fes vues bienfaifantes en la faifant donner au
public par la voie de l ’impreffion, dans le Traité
de la mouture économique.
La balance des grains eft eompofée de deux cylindres
creux de cuivre, bien ajuftés, & d’un pOid-s
égal ; ils ont exactement 3 pouces 10 lignes de
largeur, fur 3 pouces 6 lignes de hauteur, qui
font précifément les dimenfions que doit avoir le
litron ^ou la iç)>2me, partie du fetier de Paris-, fuivant
1 ordonnance de la ville du mois de décembre
1672.
Au deux cotes de chaque cylindre, font deux
oreillons ou paffent deux cordons de 7 pouces chacun
de longueur qui viennent fe réunir au crochet,
qui s agraffe au fléau de la balance. Le fléau a 6
pouces de longueur. Foye{ la figure.
Rapport des poids à la mefure.
Un litron eft la 192™ partie du fetier; il faut
pour la balance d'effai ajufter des poids proportionnels,
dont le premier foit également la 1.92me partie
d’une livre poids de marc, ce qui fe rencontre précifément
dans un poids de 2 deniers ou 48 grains.
Ces 48 grains, poids de marc, font à 9216 grains
contenus dans une livre poids de marc. . . . . . .
comme 192 ( ou la mefure d'un litron) eft à un
ïetier de Paris. Enfin 2 den. poids de marc, font
d’une livre , la 192™ partie : le litron eft d’un fetier,
la i92me partie.
Or la mefure étant pleine , le nombre de poids
de 2 den. qu’elle peféra, repréfentera des livres
lorfque la mefure repréfentera le fetier. ( Un fetier
vaut deux mines, une mine deux minots, un mi-
not trois boiffeaux, un boiffeau quatre quarts,
un quart quatre litrons. Combien un litron ? . . . .
Multipliez toutes ces mefures les unes par les autres
& vous aurez ig z . )
Formule.
z Xi = 4X3 = 12x4 = 48 4 8 x 4 = 191.
On fait donc un poids qui pefe 2 den. & qui
reprefente une livre de grain ; le poids réel de
2 den. doit être infculpé d’un côté' du poids , &
le poids figuré infculpé de l ’autre côté, comme dans
la table luivante.
Poids dleffai.
2 d. poids de marc repréfentent 1 1. de gr.
10
20 5 10