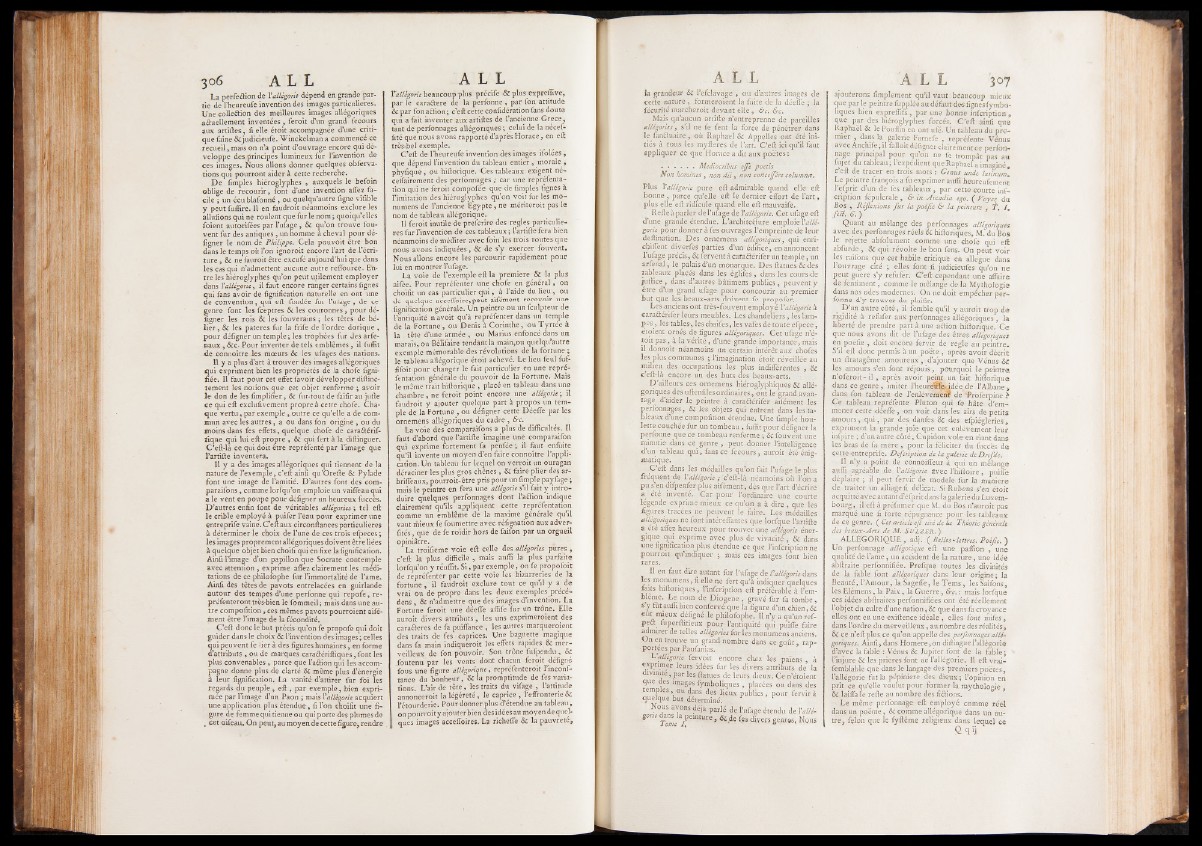
La perfeétion de l’allégorie dépend en grande partie
de l’heureufe invention des images particulières.
Une collection des meilleures images allégoriques
actuellement inventées, feroit d’un grand fecours
aux artiftes, li elle étoit accompagnée d’une critique
faine & judicieufe. "Winckelman a commencé ce
recueil, mais on n’a point d’ouvrage encore qui développe
des,principes lumineux fur l’invention de
ces images. Nous allons donner quelques obferva-
tions qui pourront aider à cette recherche.
D e fimples hiéroglyphes , auxquels le befoin
oblige de recourir, font d’une invention affez facile
; un écu blafonné, ou quelqu’autre ligne vifible
y peut fuffire. Il en faudroit néanmoins exclure les
allufions qui ne roulent que fur le nom ; quoiqu’elles
foient autorifées par l’ufage, & qu’on trouve fou-
vent fur des antiques , un homme à cheval pour défigner
le nom de Philippe. Cela pouvoit être bon
dans le temps oîi l’on ignoroit encore l’art de l’écriture
, & ne fauroit être excufé aujourd’hui que dans
les cas qui n’admettent aucune autre reflource. Eh-
tre les hiéroglyphes qu’on peut utilement employer
dans Yallégorie, il faut encore ranger certains fignes
qui fans avoir de fignification naturelle en ont une
de convention, qui eft fondée fur l’ufage ; de ce
genre font les feeptres & les couronnes, pour déligner
les rois & les fouverains ; les têtes de bélier
, & les pateres fur la frife de l’ordre dorique ,
pour défigner un temple; les trophées fur des arfe-
naux , &c. Pour inventer de tels emblèmes, il fuffit
-de connoître les moeurs & les ufages des nations.
Il y a plus d’art à trouver des images allégoriques
ui expriment bien les propriétés de la chofe figni-
ée. Il faut pour cet effet favoir développer diftinc-
tement les notions que cet objet renferme ; avoir
le don de les fimplifier, & fur-tout de faifir au jufte
ce qui eft exclufivement propre à cette chofe. Chaque
vertu, par exemple, outre ce qu’elle a de commun
avec les autres, a ou dans fon origine , ou du
moins dans fes effets, quelque chofe de caraCtérif-
tique qui lui eft propre , & qui fert à la diftinguer.
C ’eft-là ce qui doit être repréfenté par l’image que
l ’artifte inventera.
Il y a des images allégoriques qui tiennent de la
nature de l’exemple, c’eft ainfi qu’Orefte & Pylade
font une image de l’amitié. D ’autres font des com-
paraifons, comme lorsqu’on emploie un vaiffeau qui
a le vent en poupe pour défigner un heureux fucces.
D ’autres enfin font de véritables allégories ; tel eft
le crible employé à puifer l’eau pour exprimer une
entreprife vaine. C’eft aux circonftances particulières
à déterminer le choix de l’une de ces trois efpeces;
les images proprement allégoriques doivent être liées
à quelque objet bien choifi qui en fixe la fignification.
Ainfi l’image d’un papillon que Socrate contemple
avec attention , exprime affez clairement les méditations
de ce philofophe fur l’immortalité de l’ame.
Ainfi dès têtes de pavots entrelacées en guirlande
autour des tempes d’une perfonne qui repofe, re-
préfenteront très-bien le fommeil ; mais dans une autre
compofition, ces mêmes pavots pourroient aifément
être l’image de la fécondité.
C’eft donc le but précis qu’on fe propofe qui doit
guider dans le choix & l’invention des images; celles
qui peuvent fe lier à des figures humaines, en forme
d’attributs , ou de marques caraCtériftiques, font les
plus convenables , parce que l’a&ion qui les accompagne
donne plus de clarté & même plus d’énergie
à leur fignification. La vanité d’attirer fur foi les
regards du peuple, eft , par exemple, bien exprimée
par l’image d’un Paon ; mais Y allégorie acquiert
une application, plus étendue, fi l’on cnoifit une figure
de femme qui tienne ou qui porte des plumes de
. cet oife.au. On peut, au moyen de cette figure? rendre
Y"allégorie beaucoup plus précife & plus expreffive,
par le caraCtere de la perfonne , par fon attitude
& par fonaCtion; c’eft cette confidération fans doute
qui a fait inventer aux artiftes de l’ancienne Grece,
tant de perfonnages allégoriques ; celui de la nécef-
fité que nous avons rapporté d’après Horace , en eft
très-bel exemple.
C’eft de l’heureufe invention des images ifolées ,
que dépend l’invention du tableau entier, morale ,
phyfique, ou hiftorique. Ces tableaux exigent né-
celfairement des perfonnages ; car une repréfenta-
tion qui ne feroit compofée que de fimples fignes à
l’imitation des hiéroglyphes qu’on voit fur les mo-
numens de l’ancienne Egypte, ne mériteroit pas le
nom de tableau allégorique.
Il feroit inutile de preferire des réglés particulières
fur l’invention de ces tableaux ; l’artifte fera bien
néanmoins de méditer avec foin les trois routes que
nous avons indiquées, & de s’y exercer fouvent.
Nous allons encore les parcourir rapidement pour
lui en montrer l’ufage.
La voie de l’exemple eft la première & la plus
aifée. Pour repréfenter une chofe en general, on
choifit un cas particulier q u i, à l’aide du lieu , ou
de quelque acceffoire, peut aifément recevoir une
-fignification générale. Un peintre ou un fculpteur de
l’antiquité n avoit qu’à repréfenter dans un temple
de la Fortune, ou Denis à Corinthe, ou Tyrtée à
la tête d’une armée , ou Marius enfoncé dans un
marais, ou Bélifaire tendant la main,ou quelqu’autre
exemple mémorable des révolutions de la fortune ;
le tableau allégorique étoit achevé. Le lieu feul fuf-
fifoit pour changer le fait particulier en une repr'é-
fentation générale du pouvoir de la Fortune. Mais
le même trait hiftorique , placé en tableau dans une
chambre, ne feroit point encore une allégorie ; il
faudroit y ajouter quelque part à propos un temple
de la Fortune , ou défigner cette Déefle par les
ornemens allégoriques du cadre ,& c .
La voie des comparaifons a plus de difficultés. Il
faut d’abord que l’artifte imagine une comparaifon
qui exprime fortement fa penfée ; il faut enfuite
qu’il invente un moyen d’en faire connoître l’application.
Un tableau fur lequel on verroit un ouragan
déraciner les plus gros chênes , & faire plier des ar-
briffeaux, pourroit-être pris pour un fimpîe payfage ;
mais le peintre en fera une allégorie s’il fait y introduire
quelques perfonnages dont l’aCtion indique
clairement qu’ils appliquent cette repréfentation
comme un emblème de la maxime générale qu’il
vaut mieux fe foumettre avec réfignation aux adver-
fités, que de fe roidir hors de faifon par un orgueil
opiniâtre.
La troifieme voie eft celle des allégories pures ,
c’eft la plus difficile , mais aufii la plus parfaite
lorfqu’on y réuflit. S i, par exemple, on fe propofoit
de repréfenter par cette voie les bizarreries de la
fortune, il faudroit exclure tout ce qu’il y a^ de
vrai ou de propre dans les deux exemples précé-
dens, & n’admettre que des images d’invention. La
Fortune feroit une deeffe aflife fur un trône. Elle
auroit divers attributs, les uns exprimeroient des
caraCteres de fa puiffance , les autres marqueroient
des traits de fes caprices. Une baguette magique
dans fa main indiqueroit les effets rapides & merveilleux
de fon pouvoir. Son trône fufp.endu, &
.foutenu par les vents dont chacun feroit défigné
fous une figure allégorique, repréfenteroit l’inconf-
tance du bonheur, & la promptitude de fes variations.
L’air de tête, les traits du vifage , l’attitude
annonceroit la légéreté, le caprice , l’effronterie &
l’étourderie. Pôur donner plus d’étendue au tableau,
on pourroity ajouter bien des idées au moyen de quelques
images accefîbires. La richeffe & la pauvreté,
la grandeur & l’efclavage , ou d’autres images de
cette nature formeroient la fuite de la déefle ; la
fécurité marcheroit devant elle , &c. &c.
Mais qu’aucun artifte n’entreprenne de pareilles
allégories, s’il ne fe fent la force de pénétrer dans
le fanCtuaire, oit Raphaël & Appelles ont été initiés
à tous les myfteres de l ’art. C ’eft ici qu’il faut
appliquer ce que Horace a dit aux poètes :
.............. ... Mediocribusiffe poeds
Non homines, non d ïi, non concejfêre columnce.
Plus Y allégorie pure eft admirable quand elle eft
bonne, parce qu’elle eft le dernier effort de l’art,
plus elle eft ridicule quand elle eft mauvaife.
Refte à parler de l’Cifage de Y allégorie. Cet ufage eft
d’une grande étendue. L ’architeCture emploie Y allégorie
pour donner à fes ouvrages l’empreinte de leur
deftination. Des ornemens allégoriques, qui enri-
cfiiflènt diverfes parties d’un édifice, en annoncent
l ’ufage précis, & fervent à caraCtérifer un temple, un
arfenal, le palais d’un monarque. Des ftatues & des
tableaux placés dans les églifes , dans les cours de
juftice, dans d’autres bâtimens publics , peuvent y
être d’un grand ufage pour concourir au premier
but que les beaux-arts doivent fe propofer.
Les anciens ont très-fouvent employé Y allégorie à
caraCterifer leurs meubles. Les chandeliers, les lamp
e s , les tables*, les chaifes, les vafes de toute efpece,
etoient ornes de figures allégoriques. Cet ufage n’é-
toit pas, à la v érité, d’une grande importance, mais
il donnôit neanmoins un certain intérêt aux chofes
les plus communes ; l’imagination étoit réveillée au
milieu des occupations les plus indifférentes , &
c’eft-là encore un des buts des beaux-arts.
D ’ailleurs ces ornemens hiéroglyphiques & allégoriques
des uftenfiles ordinaires, ont le grand avantage
d’aider le peintre à caraCtérifer aifément les
perfonnages, & les objets qui entrent dans lesta- .
bleaux d’une compofition étendue. Une fimple houlette
couchée fur un tombeau, fuffit pour défigner la
perfonne que ce tombeau renferme ; & fouvent une
minutie dans ce genre , peut-donner l’intelligence
d’un tableau qui, fans ce fecours, auroit été énigmatique.
C ’eft dans les médailles qu’on fait l’ufage le plus
fréquentée Y allégorie ; c’eft-là néamoins oii l’on a
pu s’en difpenfer plus aifément , d.ès que l’art d’écrire
a été inventé. Car pour l’ordinaire une courte
légende exprime mieux ce qu’on a à dire, que les
.figures tracées ne peuvent le faire. Les médaillés
allégoriques ne font intéreffantes que lorfque l’artifte
a ete allez heureux pour trouver une allégorie énergique
qui exprime avec plus de vivacité, & dans
une fignification plus étendue ce que Pinfcription ne
pourroit qu’indiquer ; mais ces images font bien
Il en faut dire autant fur l’ufage de Vallégorie dans
les monumenSjfi elle ne fert qu’à indiquer quelques
faits hiftoriques, Pinfcription eft préférable à l’em-
bleme. Le nom de Diogene, gravé fur fa tombe,
s y fût aufii bien Conferve que la figure,d’un chien, &
eut mieux défigné le philofophe. Il n’y a qu’un ref-
peft fuperftitieux pour l’antiquité qui puiffe faire
admirer de telles allégories fur les monumens anciens.
On en trouve un grand nombre dans ce goût rapportées
par Paufanias.-
L’allégorie fervoit encore chez les païens , à
exprimer leurs idées fur les divers attributs de la
divinité, par les ftatues de leurs dieux. Ce n’étoient
que des images fymboliques , placées ou dans des
temples, ou dans des lieux publics, pour fervir à
quelque but déterminé.
Nous avons déjà parlé de l’ufage étendu de Y allé-
S°Ue « P P 9 N S f?s divers genres, Nous
ajouterons Simplement qu’il vaut beaucoup mieux
que par le peintre fupplée au défaut des fignes fymboliques
bien expreflifs, par une bonne mfeription,
que par des hiéroglyphes forcés. C ’eft ainfi que
Raphaël & le Pouffin en ont ufé. Un tableau du premier
, dans la galerie Farnefe , repréfente Vénus
avec Anchife ; il falloit defigner clairement ce perfoil-
nage principal pour qu’on ne fe trompât pas au
fujet du tableau; l’expédient que Raphaël a imaginé,
• e’ eft de tracer en trois mots : Genus unde latinum.
Le peintre françois a fu exprimer auffi heureufement
l’efprit d’un de fes tableaux, par cette courte inf-
cription fépulcrale , & in Arcadia ego. ( Foyer du
Bos , Réflexions fur la poèfie & la peinture * T I
J e ü .m )
Quant au mélange des perfonnages allégoriques
avec.des perfonnages réels & hiftoriques, M. du Bos
le rejette abfolument comme une chofe qui efl
abfur.de , & qui révolte le bon fens. On peut voir
les raifons que cet habile critique en allégué dans
l’ouvrage cité ; elles font fi judicieufes qu’on ne
peut guere s’y refufer. C ’eft cependant une affaire
de fentiment, comme le mélange de la Mythologie
dans nos odes modernes. On ne doit empêcher per*
fonne d’y trouver du plaifir.
D ’un autre côté, il femble qu’il y auroit trop de
rigidité à refufer aux perfonnages allégoriques , la
liberté de prendre part à une a&ion hiftorique. Ce
que nous avons dit de l’ufage des êtres allégoriques
en poéfîe , doit encore fervir de réglé au peintre.
S’il, eft donc permis à un poète , après avoir décrit
un ftratagême amoureux , d’ajouter que Vénus &
les,amours s’en font réjouis, pourquoi le peintre
n’oferoit- il , après avoir peint un fait hiftorique
dans ce genre , imiter l’heure^tetidée_de l’Albane *
dans fon tableau de l’enlévemènf de sProferpine ?
Ce tableau repréfente Pluton qui fe hâte d’emmener
cette déefle ;;>on voit dans les airs de petits
amours, qui, par desrdanfes & des efpiégleries>
expriment la grande joie que cet enlèvement leur
infpire ; d’un autre côté, Cupidon vole en riant dans
les bras dé fa mere , pour la féliciter du fuccès de
cette entreprife. Defcription de la galerie de Drefde.
Il n’y a point de connoifleur à qui un mélange
auffi .agréable <de Y allégorie avec l’hiftoire , puiffe
déplaire ; il peut fervir de modèle fur la maniéré
de traiter un alliage fi délicat. Si Rubens s’en étoit
acquitté avec autant d’éfprit dans la galerie du Luxembourg,
il eft à préfumer que M. du Bos n’auroit pas
marqué une fi forte répugnance pour les tableaux
de ce genre. ( Cet article efl tiré de la Théorie générale
des beaux-Arts de M. SuLZER. ):
ALLÉGORIQUE , adj. ( Belles*lettres,. Poéfle. )
Un perfonnage allégorique eft une paffion , une
qualité de l’ame, un accident de la nature, une idée
abftraite perfonnifîée. Prefque toutes les divinités
de; la fable font allégoriques dans leur origine; la
Beauté, l’Amour, la Sageffe, le Tems, lesSaifons,
les. Elémens, la Paix, la G uerre, &c. : mais lorfque
ces idées abftraites perfonnifiées ont été réellement
l’objet du culte d’une nation, & que dans fa croyance
elles ont eu une exiftence idéale , elles font mifes ,
dans l’ordre du merveilleux, au nombre des réalités,
& ce n’eft plus, ce qu’on appelle des perfonnages allé-
goriques. Ainfi, dans Homere,on diftinguel’allégorie
d’avec la fable : Vénus & Jupiter .font de la fable J
l’injure & les prières font de l’allégorie. Il eft vrai-
femblable que dans le langage des premiers poètes,
l’allégorie fut la pépinière des dieux ; l’opinion en
prit ce qu’elle voulut pour former la mythologie ,
& laiflale refte au nombre des fi étions.
Le même perfonnage eft employé comme réel
dans un poème, & comme allégorique dans un autre,
félon que le fyftême religieux dans lequel ce
û q ' j