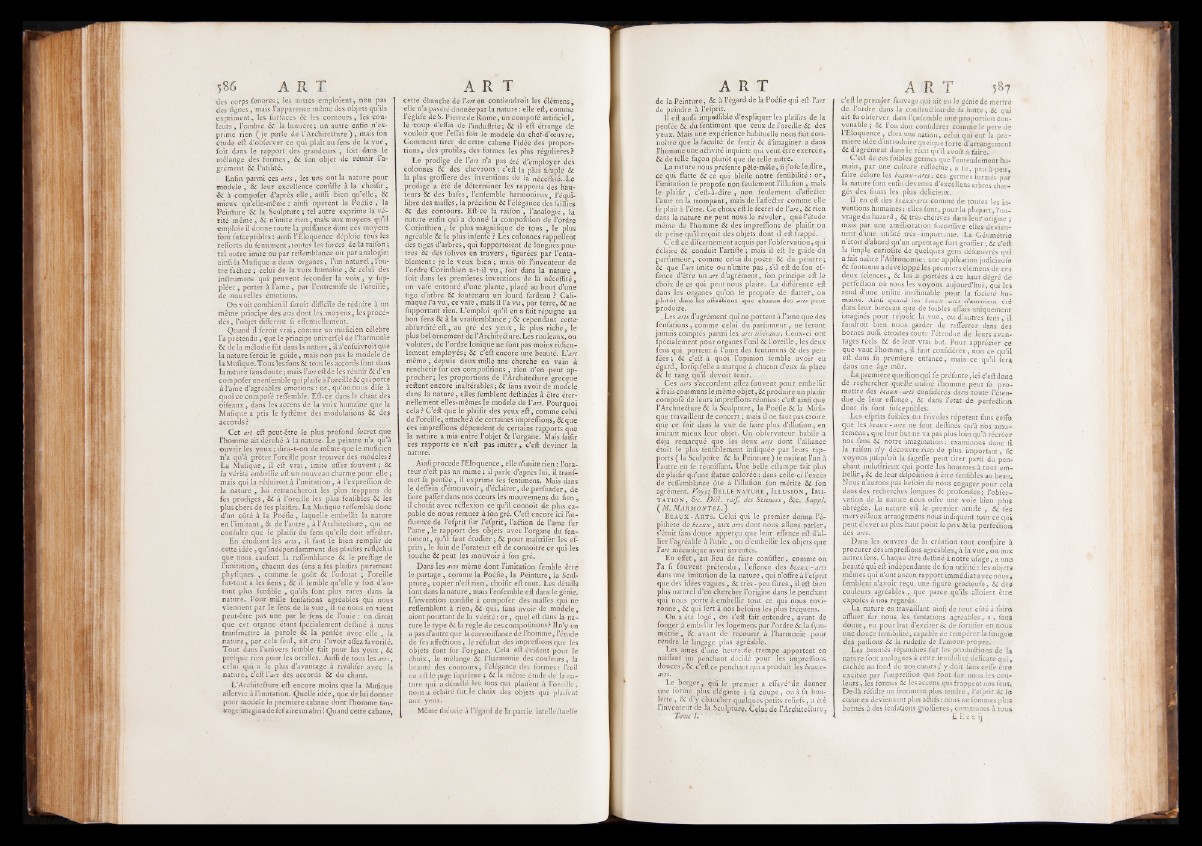
‘des corps fofiores ; les. autres .emploient , non pas
des lignes, mais l’apparence même des objets qu’ils
expriment , les furfaces & les. contours, les couleurs
, l’ombre & la lumière; un autre enfin n’exprime
rien ( je parle de l’Architeâure ) , mais fon
étude eft d’obferver ce qui plaît au fens de là vue',
Toit dans le rapport des grandeurs , Toit dans le
mélange des formes, & Ion objet de réunir l’agrément
& l’utilité.
Enfin parmi ces ans, les uns ont la nature pour
modèle, & leur excellence confifte à la choifir,
de à compofer d’après elle, auffi bien qu’elle, &
mieux qu’elle-même : ainfi opèrent la Poéfie , la
Peinture & la Sculpture ; tel autre exprime la vérité
même , & n’imite rien , mais aux moyens qu’il
emploie il donne toute la puiffance dont ces moyens
font fufceptiblesî ainfi l’Éloquence déploie tous les
refforts du fentiment,toutes les forces de l'a raifon;
tel autre imite ou par reffemblance ou par analogie:
ainfi la Mufique a deux organes, l’un naturel, l’autre
faCtice ; celui de la voix humaine , & celui des
infirumens qui peuvent féconder la voix, y fup-
pléer, porter à l’ame , par l’entremifè de l’oreille,
de nouvelles émotions.
On voit combien il feroit difficile de réduire à im
même principe des arts dont les moyens., les procédé
s , l’objet different fi effentiellement.
Quand il feroit vrai, comme un muficien célébré
l’a prétendu, que le principe univerfel de l’harmonie
& de la mélodie fut dans la nature, il s’enfuivroit que
la nature feroit le guide, mais non pas le modèle de
la Mufique. Tous les fons & tous les acc'ords font dans
la nature fans doute ; mais Y art eft de les réunir & d’en
■ compofer un enfemble qui plaife à l’oreille & qui porte
à l’ame d’agréables émotions : o r, qu’on,nous dife à
quoi ce compofé reffemble. Eft-ce dans le chant des
oifeaux, dans les açcens de la voix humaine que la
Mufique a pris le fyftême des modulations & des
accords ?
Cet art eft peut-être le plus profond fecret que
l’homme ait dérobé à la nature. Le peintre n’a qu’à
ouvrir les yeux; dira-t-on de même que le muficien
n’a qu’à prêter l’oreille pour trouver des modèles ?
La Mufique,. il eft v ra i, imite affez fouvent ; &
la vérité embellie .eft un nouveau charme pour elle ;
mais qui la réduiroit à l’imitation, à l’expreffion de
la nature , lui retrancheroit les plus frappans de
fes prodiges , & à l’oreille les plus.fenfibles & les
plus chers de fes plaifirs. La Mufique reffemble donc
d’un côté à la Poéfie, laquelle embellit la nature
en l’imitant, & de l’autre, à l’Architeâure, qui ne
confulte que le plaifir du fens qu’elle doit affeâer.
En étudiant les arts, il faut fe bien remplir de
cette idée ,qu’indépendamment des plaifirs réfléchis
que nous caufent la reffemblance & le preftige de
Fimitation, chacun des fens a fes plaifirs purement
phyfiques , comme le goût & l’odorat ; l’oreille
fur-tout a les liens ; & il femble qu’elle y foit d’autant
plus fenfible , qu’ils font plus rares dans la
nature» Pour mille fenfations agréables qui nous
viennent par le fens de la vu e, il ne nous en vient
peut-être pas une par le fens de l’ouie : on diroit
que cet organe étant fpécialement deftiné à. nous
tranfmettre la parole & la penfée avec elle , la
nature, par cela feul, ait cru l’avoir affezfavorifé.
Tout dans l’univers femble fait pour les yeux , &
prefque rien pour les oreilles. Auffi de tous les ans,
celui qui a le plus d’avantage à rivalifer avec la
nature, c’ett l’art des accords & du chant.
L’Architcâure eft encore moins que la Mufique
affervie à l’imitation. Quelle idée, que de lui donner
pour modèle la première cabane dont l’homme fau-
yage imagina de fe f aire un abri ! Quand cette cabane,
cette ébauche de l’art en contiendroit les élémens ,
elle n’a pasété donnée par la nature : elle eft, comme
l’églife de S. Pierre de Rome, un compofé artificiel,
le xoup- d’effai de l’induftrie ; & il eft étrange de
vouloir que^ l’effai foit le modèle du chef-d’oeuvre.
Comment tirer de cette cabane l’idée des proportions,
des profils, des formes les plus régulières?
Le prodige de l’art n’a pas été d’employer des
colonnes & des chevrons : c’ eft la plus firaple Scia
plus groffiere des inventions de la néceffité»-Le
prodige a été de déterminer les rapports des hauteurs
& des bafes, l’enfemble harmonieux, l’équilibre
des tnaffes, la précifion & l’élégance des faillies
& des contours. Eft-ce la raifon , l’analogie, la
nature enfin qui a donné la compofition de l’ordre
Corinthien, le plus magnifique de tous , le plus
agréable & le plus infenfé ? Les colonnes rappellent
des tiges d’arbres , qui fupportoient dè longues, poutres
& des folives en travèrs, figurées par l’entablement
: je le veux bien ; mais oit l’inventeur de
l’ordre Corinthien a-t-il v u , foit dans la nature ,
foit dans les premières inventions de la néceffité ,
un vafe entouré d’une plante, placé au bout d’une
tige.d'arbre & foutenant un lourd fardeau? Cali-
maque l’a vu , ce vafe, mais il l’a v u , par terre, & ne
fupportant rien. L’emploi qu’il en a fait répùgne au
bon fens & à la vraifemblance ; & cependant cette-
abfurdité e ft, au gré des y eux , le plus riche, le
plus bel ornement del’Architeâure.Les rouleaux, ou
volutes, de l’ordre Ionique ne font pas moins ridiculement
employés; & c’eft encore une beauté. L’art
même , depuis deux mille ans cherche en vain à
renchérir fur ces compofitions , rien n’eri -peut approcher;
les proportions de l’Architeâure grecque
relient encore inaltérables ; & fans avoir de modèle
dans la nature, elles .femblent dèftinées à être éternellement
elles-mêmes le modèle de l ’art. Pourquoi
cela? Ç’eft que le plaifir des yeux eft, comme celui
de l’oreille, attaché à de certaines impreffions, &que
ces impreffions' dépendent de certains rapports que
la nature a mis entre l’objet & l’organe. Mais faifir
ces rapports ce n’eft pas imiter , c’eft deviner la
nature.
Ainfi procédé l’Eloquence, elle n’imite rien : l’orateur
n’eft pas un mime ; il parle d’après lui, il tranf-
met fa penfée, il exprime fes fentimens. Mais dans
le deffein d’émouvoir, d’eclairer, de perfuader, de
faire paffer dans nos coeurs les mouvemens du fien
il choifit avec réflexion ce qu’il connoît de plus capable
de nous remuer à fon gré. C ’eft encore ici l’influence
de l’efprit fur l’efprit, l’aCtion de l’ame fur
l’ame, le rapport des objets avec l’organe du fentiment
, qu’il faut étudier ; & pour maîtrifer les ef-
prits, le loin de l’orateur eft de connoître ce qui les
touche & peut les mouvoir à fon gré,
Dans les arts même dont l’imitation femble être
le partage , comme la Poéfie, la Peinture, la Sculpture,
copier n’eft rien, choifir eft tout. Les détails
font dans la nature, mais l’enfemble eft dans le génie.
L’invention confifte à compofer des maffes qui ne
reffemblent à rien, & qui, fans avoir de modèle,
aient pourtant de la vérité : o r , quel eft dans la nature
le type & la réglé de ces compofitions? Il n’y en
a pas d’autre que la connoiffance de l’homme, l’étude
de fes affections, le réfultat dès impreffions que les
objets font fur l’organe. Cela eft évident pour le
choix, le mélange & l’harmonie des couleurs, la
beauté des contours, l’élégance des formes: l’oeil
en eft le juge fupirême ; & la même étude de la nature
qui a démêlé les fons qui plaifent à l’oreille,
nous a éclairé fur le choix des objets qui plaifent
aux yeux.
Même théorie à l’egard de la partie intelleâuelle
de la Peinture, & à l’égard de la Poéfie qui eft l’an
de peindre à l’efprit.
11 eft auffi impeffible d’expliquer les plaifirs de la
penfée & du fentiment que ceux de l’oreille & des
yeux. Mais une expérience habituelle nous fait connoître
que la faculté de fentir & d’imaginer a dans
l’homme une activité inquiété qui veut êfre exercée,
& de telle façon plutôt que de telle autre.
La nature nous préfente pêle-mêle, fi j’ofe le.dire,
ce qui flatte & ce qui bleffe notre fenfibilité : o r ,
l’imitation fe propofe non feulement l’illufion, mais
le plaifir , c’ell-à-dire , non feulement d’affeâer
l’ame en la trompant, mais de l’affeCter comme elle'
fe plaît à l’être. Cé choix eft le fecret de l’art, &.rien
dans la nature ne peut nous le révéler, que l’étude
même de l’homme & des impreffions de plaifir ou
de peine qu’il reçoit des objets dont il eft frappé. |
C’eft ce dîfcernement acquis par Fobfervation, qui
éclaire & conduit l’artifte ; mais il eft le guide du
parfumeur, comme celui du poète & du peintre;
&c que l’art imite ou n’imite pas , s’il eft de fon. ef-
Tence d’être un art d’agrément, fon principe eft le
choix de ce qui peut nous plaire. La différence eft
dans les organes qu’on fe propofe de flatter,, ou
plutôt dans les affeétions que chacun des arts peut
produire.
_Les arts d’agrément qui ne portent à Famé que des
fenfations, comme celui du parfumeur, ne feront
jamais comptés parmi les arts Libérauxi Ceux-ci ont
fpécialement pour organes l’oeil & l’oreille, les deux
fens qui portent à l’ame des fentimens & des pen-
lees ; & c’eft à quoi l’opinion femble avoir eu
égard, lorfqu’elle a marqué à chacun d’eux fa place
&C le rang .qu’il devoit tenir.
Ces arts s’accordent affez foüvent pour embellir
à frais communs le même objet, & produire un plaifir
compofé de leurs impreffions réunies : c’eft ainfi que
TArchiteftiire & la Sculpture, la Poéfie & la Mufique
travaillent de concert ; mais il ne faut pas croire
que ce foit dans la vue dé faire plus d’illufipn, en
imitant mieux leur objet. Un obfervateur .habile a
déjà remarqué que les deux arts dont l’alliance,
étoit le plus lenfiblement indiquée par leurs rapports
( la Sculpture & la Peinture) fe nuifent l’un-.à
l’autre en fe réunifiant. Une belle eftampe fait plus
de plaifir qu’une ftatue colorée : dans celle-ci l’excès
de reffemblance ôte à l’illufion fon mérite & fon
agrément. Voye^ B e l l e n a t u r e , I l l u s i o n , Im i t
a t i o n , &c. D i c l . raif. des Sciences, & c . , Suppl.
( .M . M a r m o n t e l . ')
B e a u x - A r t s . Celui qui le premier donna l’ér
pithete dè beaux, aux arts dont nous allons; parler,
s’étoit fans doute apperçu que leur effence eft d’allier
l’agréable à l’utile , ou d’embellir les objets que
l’art mécanique avoit inventés.
En effet, au lieu de faire confifter, comme on
l’a fi fouvent prétendu , F effence des beaux - arts,
dans une imitation de la nature, qui n’offre à l’efprit
que dés idées vagues, & très - peu fûres , il eft bien
plus naturel d’en chercher l’origine dans le penchant
qui nous porte à embellir tout ce qui nous environne
, & qui fert à nôs befoins les pîus fréquens.
On a été logé, on s’eft fait entendre, avant de.
fonger à embellir les logemens par l’ordre & la fym-
métrie, &• avant de recourir à l’harmonie pour
rendre. le langage plus àgréabfe.
Les âmes d’une heureufe trempe apportent en
fiaiffant un penchant décidé pour les impreffions,
douces, & c’eft ce penchant qui a produit les beaux-
Le berger,, qui le premier a effayé1 de donner
une forme plus élégante à fa coupe, ou à fa houlette
, & d’y ébaucher quelques petits reliefs, a été
l’inventeur de la Sculpture, Celui de l’Architeâure,
TortieL "
c’eft le premier fauvage qui ait eu le génie de mettra
de l’ordre dans la .conflruction de fa hutte , .& qui
ait fu obferver dans l’çnfemble une proportion Convenable.;
Sc l’on doit confidérer comme le pere de
1 Eloquence, chez une nation, celui qui eut la première
idée d introduire quelque forte d’arrangement
& d’agrément dans le récit qu’il avoïtà faire.
,C’elt de ces foibles germes que l’entendement humain,
par une culture réfléchie, a fu, peu à-peu,
faire éclore les beaux - ans : ces germes formés par
la nature font enfin devenus d’excellens arbres chargés
des fruits les plus délicieux.
Il en eft des beaux-arts comme de toutes les inventions
humaines: elles font, pour la plupart, l’ouvrage
du hazard, & très-chétives dans léui^origine ;
mais par une amélioration fucceffive elles deviennent
d’une utilité très - importante. La Géométrie
n’étoit d’abord qu’un arpentage fort groffier ; & c’eft
la fimple curiofité de quelques gens défoeuvrés qui
a fait naître FAilronomie : une application judicieufe
& foutenue a développé les premiers élémens de ces
deux fciences, & les ;a portées à ce haut dégré de
perfection où nous les voyons aujourd’hui, qui les
rend d’une utilité, ineftimable pour la fociété humaine.
Ainfi quand les beaux - arts n’auroient été
dans leur bérceau que de foibles effais uniquement
imaginés pour réjouir la vue, ou d’autres fens, il
faud.roit bien nous garder de refferrer dans des
bornes auffi étroites toute l’étendue de leurs avantages
réels & de leur vrai but. Pour apprécier ce
que vaut l’homme, il .faut confidérer, non ce qu’il
eft dans fa première enfance, mais.ee qu’il fer*
dans une ; âge mûr,
La première queftion qui fe préfente,ici c’eft donc
de rechercher quelle utilité Fhomme. peut fe promettre
des beaux-arts confédérés dans toute l’étendue
de leur effence, & dans l’état de perfeâioa
dont ils font fufceptibles.
Les efprits foibles ou frivoles répètent fans ceff©
que. les beaux-arts ne font deftinés qu’à nos amu-
femens ; que leur but ne va pas plus loin qu’à récréer
nos fens & notre imagination : examinons donc fl
la raifon n’y découvre rien de plus, important, 6c
voyons jufqu’où la fageffe peut tirer parti du penchant
induftrieux qui. porte les hommes à tout embellir
, & de leur difpofirion à être fenfibles au beau*
Nous n’aurons pas befoin de nous engager pour cela
dans des recherches longues & profondes; l’obfer-
vation de la nature nous offre une voie bien plus
abrégée. La nature eft le premier artifte , & fes
merveilleux arrangement nous indiquent tout ce qui
peut élever au plus haut point le prix & la perfeâioii
des arts.
Dans, les oeuvres de la création tout confpire à
procurer des impreffions agréables, à la vue, ou aux
autres fens. Chaque être deftiné à notre ufage, a un©
beauté qui eft indépendante de fon utilité :. les objets
mêmes qui n’ont aucun rapport immédiat avec nous ,
femblent n’aypir reçu, une figure gracieufe, & des
couleurs agréables que parce qu’ils allôient être
expofés à nos regards.
. La nature en travaillant ainfi de tout côté à faire
affluer., fur. nous ; les fenfations agréables, a , fans
doute, eu pour but d’excitèr tk de fortifier en nous
une douce fenfibilité , capable de tempérer la fougue
des paffions & la rudeffe de l’amour-propre.
Les beautés répandues fur les productions de la
nature font analogues à cette fenfibilité délicate qui,
cachée au fond de nos-coeurs,' y doit fans .ceffe être
excitée par l’impreffion que font fur. nous les couleurs,
les formes & les aceens qui frappent nos fens*
De-là réfulte un fentiment plus tendre, l’efprit & la
coeur en deviennent plus aétifs : nous ne fommes plus
bornés à des fenfations groffieres, communes à tous
£ E e e i j