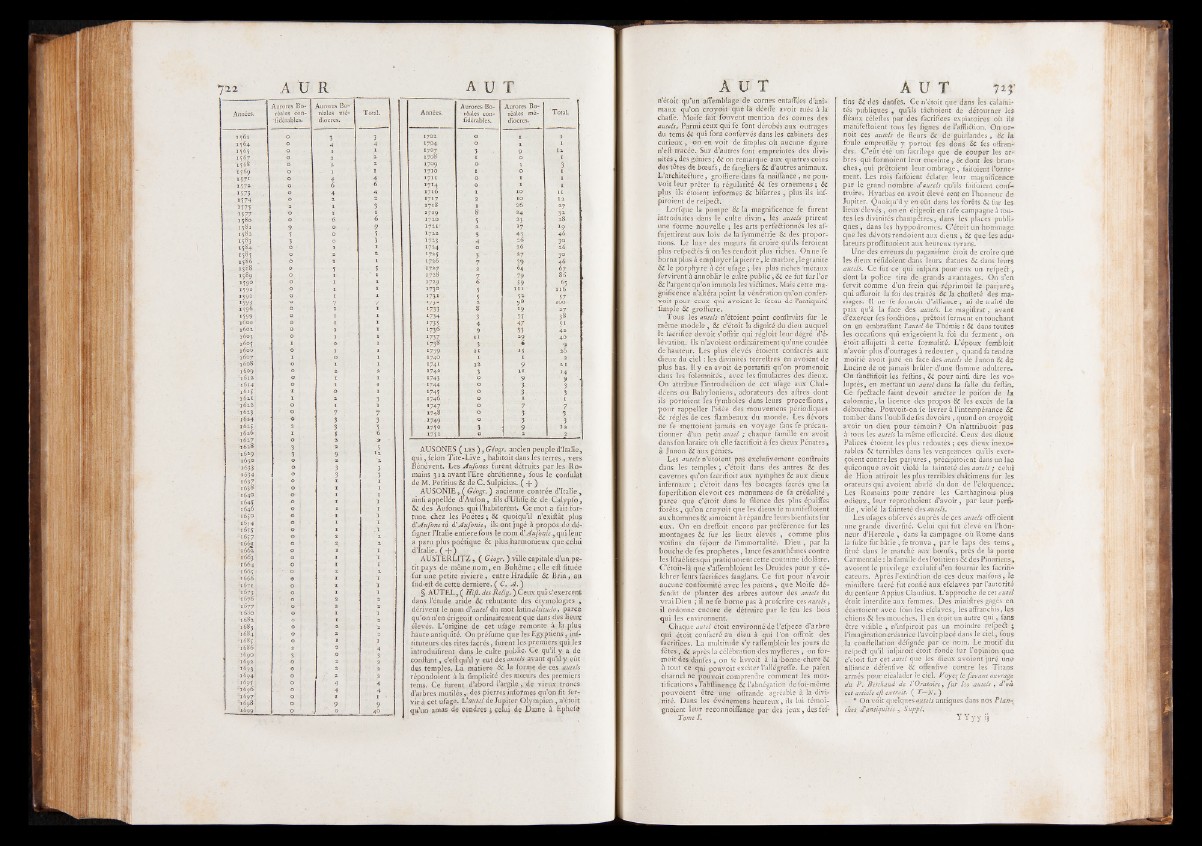
* JZ Z A Ü R A U T
Années.
Aurores Bo- :
réales con- ‘
•fidérables.
Aurores Boréales
mé- ;
diocréà.
Total.
1:^ 1 0 3
15 64. 0 4 4
0 1 I
1567 Ö 2
1568 b i 2
»5-69 0 1 I
U 7 1 0 4 4
1572 . ■ O; . ■ > 6
1573 V , O 4 4
J 5 74 0 2 2
U 75 1 ■ 1 3
ï 577 H 'ÏO • ; ï
1580 O 6
1581 9 0 9
.5 8 a . $ 0 S
I583 3 ■ . 0 .1 < 3
1584 0 • t 1
■ ï8! 0 2 2
IS86 1 ô 1 1
-4 .5 8 8 ■ . 0 | - .... ' 5 3
1 m 8s • H 0 z ' 1
1590 1
1591 | 1 1 1592 0 1 1
1593 • 1 b , | 7 7
ï 396 . à 1 1
1 5 9 9 , 0 1 x
lOOo ' 0 i 1
1602 0 1 1
1603 0 1 1
1605 1 0 1
1600 0 1 1
A607 1 0 1
1608 0 1 1
-1609 < 0 2 4 ' ï
-16x2 0 1 ï
-16 14 0 •1 1
h6is * 0 I
IÓ2X . 1 2 3
1622 0 ■ A 4
1623 0 . r * 7 ' . r ■•! 7
1624 Ó 3 3
IÓ2J • 2 '5
162O; 1 T 1 b
4 6 2 7 ; 0
•1628 3 2 3
-1629! 3 9 V
'1630 0
1633 0 3 •>• 3
-1634 0 \ 3 i • 3
1637; 0 ' •! 1
1638 : 0 j I 1
I64Ö- 0 I 1
I64-Î 0 1 i ï
Ï646 0 I | 1
‘ I^ O j 0 ; - ï 1 1
l 6 54. O, ! I 1
4 6 î-s 1 • O 1 • j .1
! iAS7 , O 4 -j 2
O T 4 i 2
iód® 1 O I 1
1663! O ; I 1
1664 o r I 1
1665 < — 0 j H Km 1 1 2
■ 1666. 0 Z i
4 6 7 1 • 0 % 1 1
r 0 I 1
h 676 • 0 ! 4 ‘2
1^77 H ■ 2 2
1680 0 I r
1682 ’ 0 ' I 2
4 6 8 3 1 o i 4 ■
1684 0 1 4 J 2
■ >«8S 1 0 1 I 1
4 6 8 6 : 2 2 f 4
■ 16901 | 3 . O 1 3
-1692 ' 0 1 2 j- 2 i
i 69 3 . 0 1 - A i , . 2 i
■ 1694! 0 1 2 •{ 1 2
« 6 9 ; ) à j 4 ' 4
’ -"1696' v£ r ' k H 1 4 4
TI 697- o i I I ' ■
A698 ; 0 1 1 9 9
* 09.9 0 0 ■■■'• 40
Années.
Aurores Boréales
con-
fidérables.
Aurores Boréales
médiocres:
Total.
1702 . 0 z 1
1704 à 1 1
1707 3 . 12
g 1708 1 ô ■ H 1
1709 0 î 3
1710 1 0 1
17 11 0 1 1
1714 0 X 1
17 1b 1 10 11
17 17 2 10 12
1718 1 26 27
1719 8 24 32
1720 5 23 28
17 2 1 ' *7 19
-1722 5 43 46
1723 4 i 1 à6’ 1 -, 39
1724 0 26 26
1725 3 ‘ 27 30
1726 . 7 3 9 1 46
1727 * . 67
1728 7 79 86
1729 0 . 39 65
173b - 3 i n 116
A 731 5 ‘ ® 37
173a 98 100
*733 8 *9 : 27
*734 3 1 33 1 38
*733 4 47 SI
1736 9 53 4 1
*737 IX ' 29
1738 3 6 9
, *739 i i 15 26
1740 ï 1 2
174* za 9 2 1
1742 3 11 *4
*743 0 9 9
1 1 74 4 0 3 3
*743’ 0 3 3
1740 0 1 1
*747 0 7 7
1748 0 3 3
'*749 0 3 .3
*739 3 9 12
173* 0 2 2
AUSONES ( les ) , Gêogr. ancien peuple d’Italie,
q u i, félon Tite-Live 9 habitoit dans les terres, vers
Bénévent. Les Aufones furent détruits par les Romains
312 avant l’Ére chrétienne, fous le çonfulat
de M. Petitius & de C . Sulpicius. ( + )
ÀUSONIE, ( Gêogr. ) ancienne contrée d’Italie,
ainfi appellée d’Aufon, fils d’Uliffe & de Calypfo,
& des Aufones qui l’habiterent. Ce mot a fait fortune,
chez les Poètes ; & quoiqu’il n’exiftât plus
d’Aufone ni d’Aufonie9 ils ont jugé à propos 'de.de-
figner l’Italie entière fous le nom d’Aufonie, qui leur
a paru plus poétique & plus harmonieux que celui
d’Italie. ( + )
AUSTERLITZ, ( Gêogr. ) ville capitale d’un petit
pays de même nom, en Bohême ; elle eft fituée
•fur une petite riviere, entre Hradiffe & Brin , au
fud-ell de cette derniere. (C . A.')
§ AUTEL, ( Hifl. des Relig. ) Ceux qui s’exercent
dans l’étude aride & rebutante des étymologies ,
dérivent le nom d’autel du mot latinalùtudo, parce
qu’on n’en érigeoit ordinairement que dans des lieux
élevés. L’origine de cet ufage .remonte à la plus
haute antiquité. On préfume que les Egyptiens, instituteurs
des rites facrés, furent les premiers qui les
introduifirent dans le culte publie. Ce qu’il y a de
confiant, c’eft qu’il y eut des autels avant qu’il y eût
des temples. La matière & la forme de ces autels
répondoient à la fimplicité des moeurs des premiers
rems. Ce furent d’abord l’argile, ;de vieux troncs
d’arbres mutilés,, des pierres informe? qu’on fit fer-
vir à cet ufage. L’autel de Jupiter Olympien , n’étoit;
qu’un amas de cendres ; celui de Diane à Ephefâ
A U T
n’étôit qu’un affemblage de cornes entaflees d’animaux
qu’on croyoit que la déeffe avoir tués à la
chaffe. Moïfe fait fôuvent mention des cornes des
autels. Parmi ceux qui fe font dérobés aux outrages
du tems & qui font eonfervés dans les cabinets des
curieux , on en voit de fimples oit aucune figure
n’eft tracée. Sur d’autres font empreintes des divinités
, des génies ; & on remarque aux.quatres coins.
des têtes de boeufs, de fangliers & d’autres animaux.
L ’architeôure, groffiere dans fa naiflance , ne pouvoir
leur prêter fa régularité .& fes ornemens ; &
plus ils étoient informes & bifarres , plus ils inf-
piroient de refpeét.
Lorfque la pompe & la magnificence fe furent
introduites dans le culte divin, les autels prirent
une forme nouvelle ; les arts perfectionnés les af-
fujettirent aux loix de la fymmétrie & des proportions.
Le luxe des moeurs fit croire qu’ils feraient
plus refpeétés fi on les rendoit plus riches. On ne fe
borna plus à employer la pierre, le marbre, le granité
& le porphyre à Cet ufage ; les plus riches ‘métaux
fervirent à annoblir le culte public, & ce fut fur l’or
& l’argent qu’on immola les vi&imes. Mais cette magnificence
n’àltéra point la vénération qu’on confer-
voit pour ceux qui avoient le fceau de l’antiquité
fimple & grofliere.
Tous les autels n’étoient point conftrùits fur le
même modèle , & c’étoit- la dignité du dieu auquel
le facrifice devoit s’offrir qui régloit leur dégré d’élévation.
Ils n’avoient ordinairement qu’une coudée
de hauteur. Les plus élevés étoient cônfacrés aux
dieux du ciel : les divinités terreftres en avoient de
plus bas. Il y en avoit de portatifs qu’on promenoit
dans les folemnités, avec les fimulacres des dieux.
On attribue l’introduâion de cet ufage aux Gh&l-
déens ou Babyloniens, adorateurs des aftres dont
ils portoient les fymboles dans leurs procédions
pour rappeller l’idée des mouvemens périodiques
& réglés de ces flambeaux du monde. Les dévots
ne fe mettoient jamais en voyage fans fe précautionner
d’un petit autel ; chaque famille en avoit
dans fon laraire oh elle facrifioit à fes dieux Pénates *
à Junon & aux génies.
Les autels n’étoient pas exclufivement conftrùits
dans les temples ; c’étoit dans des antres & des
Cavernes qu’on facrifioit aux nymphes & aux dieux
infernaux ; c’étoit dans les bocages facrés que la
fuperftition élevoit ces monumens de fa crédulité -,
parce que c’étoit dans le filence des plus épaifles
forêts, qu’on croyoit que les dieux fe manifeftoient
auxhommes & aimoient à répandre leurs bienfaits fur
eux. On en dreffoit encore par préférence fur les
montagnes & fur les lieux élevés , comme plus
voifins du féjour de l’immortalité. D ieu , par la
bouche de fes prophètes, lance fes anathèmes contre
les Ifraélites qui pratiquoient cette Coutume idolâtre.
C ’étoit-là que s’affembloient les Druides pour y célébrer
leurs faCrifices fanglans. Ce fut pour n’avoir
aucune conformité avec les païens , que Moïfe défendit
de planter des arbres autour des autels du
vrai Dieu ; il ne fe borne pas à profcrire ces autels -,
il ordonne encore de détruire par le feu les bois
qui les environnent.
.Chaque autel étoit environné'de l’efpece d’arbre
qui étoit confacré au dieu à qui l ’on offroit des
facrifices. La multitude s’y raffembloit les jours de
fêtes , & après la célébration des myfteres , on for-
moit des danfes , on fe livroit à la bonne-chere &
à tout ce qui pou voit exciter l’allégreffe. Le païen
charnel né pouvoit comprendre comment les mortifications
, l’abftinence & l’abnégation de foi-même
pouvoient être une offrande agréable à la divi-
. nité. Dans les1 événemens heureux, ils lui témoi-
gnoient leur reconnoiffance par des jeux, des fef-
Tomel.
A U T U f
fins & des danfes. Ce n’étoit que dans les cala mi*
tés publiques , qu’ils tâchoient de détourner les
fléaux céleftes par dés facrifices expiatoires oh ils
manifeftoient tous les lignes de l’affliftion. On or-
noit ces autels de fleurs & de guirlandes , & la
1 foule empreïfée y portoit fes dons & fes offrandes.
C ’eut été un facrilege que de couper les arbres
qui formoient leur enceinte, & dont les branches
, qui prêtoient leur ombrage, faifoient l’ornement.
Les rois faifoient éclater leur magnificence
par le grand nombre d’autels qu’ils faifoient conf-
truire. Hyarbas en avoit élevé cent en l’honneur de
Jupiter. Quoiqu’il y en eût dans les forêts & fur les
lieux élevés , on en érigeoit en rafe campagne à toutes
les divinités champêtres, dans les places publiques
, dans les hyppodromes. C ’ étoit un hommage
que les dévots rendoient aux dietix ; & que les adulateurs
proftituoient aux heureux tyrans.
Une des erreurs du paganifme étoit de croire quë
les dieux réfidoiénf dans leurs ftatues & dans leurs
autels. Ce fut ce qui infpira pour eux un refpeft,
dont la police tira de grands avantages. On s’en
fervit comme d’un frein qui réprimoit le parjure *
qui afluroit la foi des traités & fa chafteté des mariages.
Il ne fe formoit d’alliance , ni de traité de
paix qu’à la face des autels. Le magiftrat, avant
d’exercer fes fondions, prêtoit ferment en touchant
on en embraffant Y autel de Thémis : & dans toutes
les occafions qui exigeoient la foi du ferment, on
étoit affujetti à cette formalité. L’époux fembloit
n’avoir plus d’outrages à redouter , quand fa tendre
moitié avoit juré en face des autels de Junon & de
Lucine dé ne jamais brûler d’une flamme adultéré.
On fanéfifioit les feftins, & pour ainfi dire les vo*
luptés, en mettant un autel dans la falle du feftin.
Ce fpeftacle faint devoit arrêter le poifon de la
calomnie, la licence des propos & les excès de la
débauche. Pouvoit-on fe livrer à l’intempérance &c
tomber dans l’oubli de fes devoirs y quand on croyoit
ayoir un dieu pour témoin ?. On n’attribuoit pas
à tous les autels la même efficacité". Ceux des dieux
Palices étoient les plus redoutés ; ces dieux inexorables
& terribles dans les vengeances qu’ils exer-
çoient contre les parjures, précipitoient dans un lac
quiconque avoit violé la lainteté des autels ; celui
de Hion attiroit les plus terribles châtimens fur les
orateurs qui avoient abufé du don de l’éloquence^
Les Romains pour rendre les Carthaginois plus
odieux, leur réprochoient d’avoir, par leur perfî*
die , violé la fainteté des autels,
Les ufages obfervés auprès de ces autels offroient
une grande diverfité. Celui qui fut élevé en l’honneur
d’Hercule , dans la campagne oh Rome dans
la fuite fut bâtie , fe trouva , par le laps des tems *
fitué dans le marché aux boeufs, près de la porte
Carmentale : la famille des Potitiens & des Pinariens,
avoient le privilège exclufif d’en fournir les facrifi-
cateurs. Après l’extinéHon de ces deux maifons* le
miniftere facré fut confié aux efclaves par l’autorité
du Cenfeur Appius Claudius. L’approche de cet autel
étoit interdite aux femmes. Des miniftres gagés en
écartoient avec foin les efclaves, les affranchis, les
chiens & les mouches. Il en étoit un autre q ui, fans
être vifible , n’infpiroit pas un moindre refpeéi ;
l’imagination créatrice l’avoit placé dans le ciel, fous
la conftellation défignée par ce nom. Le motif du
refpeft qu’il infpiroit étoit fondé fur l’opinion que
c’étoit fur cet autel que les dieux avoient juré une
alliance défenfive & offenfive contré les Titans
armés pour efcalader le ciel. Voyelle/avant ouvrage
du P. Berthaud de l'Oratoire, fur Us autels , d’ou
'cet article ejl extrait. ( T—N. )
* On voit quelques autels antiques dans nos Plan-\
ckes cCAntiquités , Suppl,
1 Y Y y y i j ’