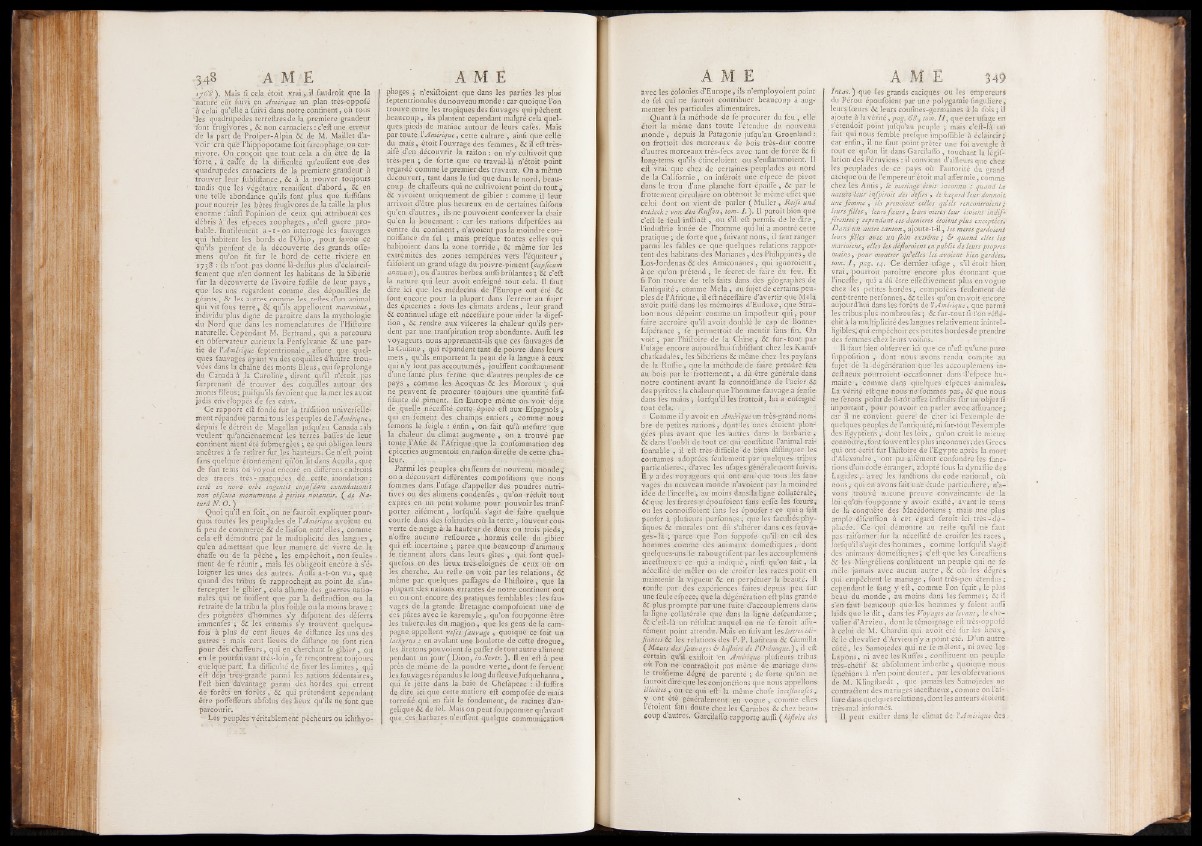
i j 68 ). Mais fi cela, étoit .vrai >, il faudrait, que la
'nature eut fuivi en Amérique .un plan très-'opp.ofé
'à celui qu’elle â fuivi dans notre continent, où tous
'les quadrupèdes terreftres de la première grandeur
"font frugivores, & non carnaciefs : c’eft une. erreur
de là part de Profper-Alpin & de M. Maillet d’a-
vdir'cru que'l’hippopotame foit fàyçophage. ou carnivore.
On conçoit que tout cela a dû être, de la
‘fo r te , à caiîfe de la difficulté qu’euffent eue^des
quadrupèdes‘ carnaciers de la première grandeur .à
trouver.leur fubfiftance, & à la trouver toujours
tandis que'les végétaux renaiffent. d’abord , & en
une telle abondance qu’ils fopt plus que fuffifans
pour nourrir les.. bêtes frugivores .de la taille la plus
énorme r ainfi l’opinion de ceux qui attribuent ces
débris-à :des efpeces zppphag.es, rieft guere probable.
Inutilement a - 1 - on interrogé les fauvagés
qui 'habitent lès bords de l’Ohio , pour favoir ce
qu’ils penfent de. la découverte des grands; ^oliemens
qu’on fit fur le bord d.e‘ cette. riviere en
1738 : ils n’ont pas, donné Tà-d.efius .plus d’éclaircif-
fement que n’en donnent les habitans de la Sibérie
fur la découverte de l’ivoire .foffile de leur pays,
que les uns' regardent comme, des dépouilles de
géants, & les autres comme les refies d’un animal
qui vit fous terre, & qu’ils appelloient mammout,
individu" plus digne de paraître. dans la mythologie
du Nord que dans les nomenclatures de l’Hifioire
naturelle. Cependant M. Bertrand, qui a parcouru
en obfervatêur curieux la- Penfy.lvanie & une partie
de YAmérique feptenfrionalé , affure que. quelques
fauvagés' ayant vu des coquilles d’huître trouvées
dans l ï chaîne"dés monts Bléus., qui fe prolonge
du Canada à la Caroline", dirent qu’il n’étoit pas
furprenant dé trouver des coquilles autour des
monts Bleus; puifqu’ils favoiènt que la.mer les avoit
jadis enveloppés de fe séaux . ,
Çe rapport eft fondé fur la tradition uniyerfellé-
ment répandue parmi tous les peuples de Y Arné};ique.,
depuis, le .détroit de Magellan ' jufqu’au Canada : ils
veulent qü’anciënnemerif les 'tèrr.ës baffes'de leur
continent aient été fubmergees ;. çé qui obligea.leurs
ancêtres à fe. retirer fur .les. hauteurs.; C?e a’.e;fi point
fans quelque ët'ôhnéméiVf'qu’dh'lft dans: Acpfta,-que
de fo.n tèms ôn vpyoit encore en différens endroits
des tracés, très - marquées. de._çette, inondation :
certe in novo . orbe ingentis cujitfdani . exundatiqnis
non' obfcura ■ monumenta a peritis nçtqntur. ( de Na-
turâ N. O. y \ '
Quoi qu’il en fóit, on në; faijroit ■ expliquer pourquoi.
toutes les peuplades de Y Amérique avofent eü
fi peu de commercé & de.liaifçn entr-elles, comme
cela eft démontré par la multiplicité des. Tangues,
qu’en admettant que leur maniéré, de’ vivre de la
chaffe ou de la pêché , les empêchoit, non feule.-?
ment de ■‘fe réunir., niais .les obligeoit encore à.s’é-r
loigner les unes des autres. Auffi a-t-on v u , que
quand des tribifs fe -rapprochent, au pbint. de s’intercepter
le’ gibier, cela allume des guerres nationales
qui ne finiffent que par la deftruction ou la
retraite de la tribu la plus foible o.u la moins brav.e :
des poignées d’hommes s’y difputent des deferts
immenfes ; &. les ennemis.’ s’y troùvént quelquefois?*^
plus de1 cent lieues .de diftance les .uns des
autres : mais cent lieues de diftance,ne,font rien
pour dés chaffeurs, qui en cherchant le gibier , ou
en le poùrfuivant très-loin , fe rencontrent toujours
quelque parti La difficulté q£, fixer les limites, qui
èft déjà très-grande parmi, le£ notions fédent-aires j
l’eft bierf davantage parmi dès hordes qui errent
de forêts en forêts , & qui prétendent .cependant
être poffëffeurs àbfolus des lieux’ qu’ils ne font.que
parcourir.
Les peuples véritablement pêcheurs ou iclithyophages
J n’exiftoient que dans les parties les plus'
leptentrionales du nouveau monde : car quoique l’on
trouve entre tes tropiques des fauvagés qui pêchent
b e a u c o u p i ls plantent cependant malgré cela quel-
que.s::P,ie.ds de manioc autour de leurs cafés. Mais
par toute Y Amérique, cette culture , ainfi que celle
du maïs, étoit l’ouvrage des femmes, & il eft très-,
aifé d’en découvrir la raifon : on n’y cùltivoit que
très-peu ; de forte que ce travail-là n’étoit point
regardé comme le premier des travaux. On a même
découvert, tant dans le fud que dans le nord, beau-,
coup de chaffeurs qui ne cultivoient point du tout
& vivoient uniquement de gibier : comme, il leur
arrivoit d’être plus heureux en de certaines faifona
qu’en d’autres, ils ne pouvoient conferver la chair
qu’en là boucanant : car les nations difperfées au
centre du continent, n’avoient pas la moindre con-
noiffance du fel ; mais prefque toutes celles qui
habitoient dans la zone torride, & même fur les
extrémités des zones tempérées vers l’équateur,
faifoient un grand ufage du poivre-piment ( capjîcurn
annuum) , ou d’autres herbes auffi brûlantes ; & c’eft
la nature qui leur avoit enfeigné tout cela. Il faut
dire ici que les médecins de l’Europe ont été Sc
font encore pour la plupart dans l’erreur au fujet
des épiceries : fous les climats ardens, leur grand
& continuel ufage eft néceffaire pour aider la digefi
tion, & rendre aux vifeeres la chaleur qu’ils perdent
par une tranfpiration trop abondante. Auffi les
voyageurs nous apprennent-ils que ces fauvagés de
la Guiane , qui répandent-tant de poivre dans leurs
mets , qu’ils .emportent; la peau de la langue à ceux
qui n’y font pas accoutumés , jouiffent conftatnment
d’une fanté plus fermeque..d’autres.peuples;de ce
pays ,. comme les, Acoqüas & les Moroux , qui
ne peuvent fe procurer toujours une quantité fuf-
fifante dé piment. En Europe’ même on-voit'déjà
de .quelle .néçeffité çettei-é-pice eft aux Efpagnols ,
qui en fempht des , champs entiers , comme', nous
femons le fieigle. : enfin , on. fait qu’à mefùre- ’que
la çhaleur du climat augmente. , 'pn a trouvé par
tpvrtç TÂfiè & f Afrique':que la çonfommation des
épiceries; .augmentait en.raifon dire&e de cette chaleur..
. , «vj 0 .
Parmi les peuples chaffeurs du nouveau, monde ','
on a découvert différentes compofitions que nous
femmes dans l’ufage d’appeller des poudres nutritives
ou des alimens .çon.dénfés , qu’on ‘réduit tout
exprès, en un petit volume pour pouvoir les tranf-
port.e.r aifément, lorfqu’iL s’agit de - faiVe quelque
eoui'fé dans des folitudes^ où .la terre ,vfouvent couverte
deneige à-la hauteur de deux ou trois pieds ,
n’offre aucune reffource , hormis celle, du gibier
qui ëft incertaine ; parce ;que- beaucoup d’animaux
fe. tiennent alors dans leurs-gîtes , qui. font quel-
quéfois en des lieux, très-élûignés : de ceux'oîi on
les .cherche. Au refte; on voit par les relations, &
mérite par.quelques,paffages de l’hiftoire^ que la
plupart.;des nations errantes de notre continent ont
eu ou ont encore des, pratiques femblables : les fau-
vag.es de la grande Bretagne compofoient une de
ces, pâtes aÿec le karemyle^ qu’on fôupçonne être
les tubercules du, magjon, que les gens de la campagne
appellent vefce'.fauvage , quoique ce foit un
Lathyrus : en avalant une boulette de cette drogue,
les.Bretons pouvoient fie paffer de tout autre aliment
pendant un jour ( Dion, inSevtr. ) . Il en eft à peu
près de même de la poudre verte, dont fe fervent
lesYfau,vages répandus le long du fleuve Jufquehanna,
qui le jette dans la baie de Chefapeac : il fuffira
de; dire ici que cette matière eft compofée de maïs
torréfié qui en fait le fondement, de racines d’an-
gelique & de fel. Mais on peut foupçonner qu’avant
que, ces barbares n’euffent quelque communication
âvec les Golonîes d’Europe, ils n’emploÿ'oierit point
de fel qui rie fauroit contribuer beaucoup à augmenter
les particules alimentaires.
Quant à la méthode de fe procurer du feu , elle
étoit la même dans toute l’étendue du nouveau-
monde , depuis la Patagonie jufqu’au Groenland:,
on frottoit des morceaux de bois très-dur contre
d’autres morceaux très-fecs avec tant de force & fi
long-tems qu’ils étinceloient- ou s’enflammoient. Il
eft vrai que chez de certaines peuplades au nord
de la Californie, on inféroit une efpece de pivot
dans le trou d’une planche fort épaiffe , & par; le
frottement circulaire on obtenoit le même effet que
celui dont on vient de parler ( Muller, Reife und
entdeck: von d&n Rujfen, lom. ƒ.). Il paroît bien que
c’eft le feul inftind, ou s?il eft permis de le dire,
l’induftrie innée de l’homme qui lui a montré.cette
pratique ; de forte que, fuivant nous , il faut ranger
parmi les fables ce que quelques relations rapportent
des habitans des Marianes, des Philippines.,. de
Los-Jordenas & des Amicouanes , qui ignoroient,
à ce qu’on prétend, le fecret de faire du feu. Et
fi l’on trouve de tels faits dans des géographes de
l’antiquité , comme Mêla , au fujet de certains.peu-
ples.de l’Afrique, il eft néceffaire d’avertir qiie Melà
avoit puifé dans les mémoires cl’Eudoxe, que Stra-
bon nous dépeint’ comme-un impofteur q ui, pour
faire accroire qu’il: avoit doublé le cap de.Bonnes
Efpérance , fe permettoit de irientir fans ■ fin. Qn
v o it , par l’hiftoiré de la Chine, .& fur-tout par
l ’ufage encore aujourd’hui fubfiftant 'chez les.Kamk
chatkadales, les Sibériens & même chez les payfans
de la Ruflie , que la méthode dé faire prendre feu
au bois par le:frottement, a dû être générale dans
notre c'ontinent avant la connôiffance de l’acier.&:
des pyrites : la chaleur, que l’homme fauvage_a fentie
dans fies maitis, lorfqu’il les frottoit, lui a enfeigné
tout cela. .
.' Comme il y avoit en Amérique un très-grand nom-i
bre de petites nations ,' dpnt "les unes-étoient pion-1
gééS 'plus avant que les autres dans' la barbarie-
& dans l’oubli de tout ce; qui-conftitue 'l’animal rai-I
fonnable , il eft très-difficile ’ de bièn diftinguer les
coutumes' adoptées feulement, par quelques-, tribus
particulières;, d’avec les ufages généralement fuivis;
Il y a des’ voyageurs qui onr 'cfirique tous »lés fau?
vages du nouveau monde n’avoient pas. la moindre
idée de l’incefte j .au moins dans-la ligne collatérale £
&;que les.fretesry.époufoi&nt fans: CeiTe les foeurs ;
ou les connoiffoient fans les épôùfer : ce qui a fait
penfer à plufieurs perfonnesy que les facultés phy-
fiqueS & morales- ont dû s’altérer .dans ces. fau va-
ges'-l'à ; ^parce .que l’on fuppofe- qu’il; en eft /des
hommes comme dès animaux donieftiques, dont
quelques-uns fie rabougriffent .par les accouplemens-
inceftueux : ce qui a indiqué , ainfi qu’on fa it , la
néçeffité de mêler ou de croifer les races poür en
maintenir là viguéur & en perpétuer la beaiité. Il
eonfte par des expériences faites • depuis peu fur
une feule efpece,-que la dégénération eft plus grande.
& plus prompte par une fuite d’accouplemens dans-
la ligne collatérale que dans la ligné defeendante ;
& c’eft-là un réfultat auquel on rie fe feroit affu-
rément point attendu. Mais en fuivant les lettres edi-,
fiâmes■ §£ les relations des P. P. Lafiteau & Gumillâ.
(Moeurs des fauvagés & hifioirè de l’Orénoque.'), il eft-
certain qu’il exiftoit en Amérique pllifieurs tribus;
oîi l’on né contraâoit pas même de mariage dans
le trqifieïne dégré de parenté ; de forte qu’on nel
fauroit dire que des conjonftions que nous appelions
illicites, ou ce qui eft la même chofe incejlueufes,
y ont ete généralement en vogue , comme elles-.
1 etoient fans doute chez les Caraïbes & chez beau-
eoup d’autres.- Garcilaffo rapporte au(fi (hjfioin des
ïnlas. ) que les grands caciques ou les êmpéreüfs
du Pérou époufoient par une polygamie finguliere*
leurs fceiïrs & leurs eoufines-germaines à la fois ; il
ajoute à lavérité, pag. '68',■ tom. I l , que cet ufage en
s’étendoit point jufqu’au peuple ; mais c’eft-là ■ uri
fait qui nous femble prefque impoffible à éclaircir y
car enfin, il ne faut;point prêter une foi aveuglé à-
tout ce qu’on lit dans Garcilaffo, touchant la législation
des Péruviens : il convient d’ailleurs que chez
les peuplades de? ce pays où l’autorité du grand
cacique Où dè l’empereur étoit mal affermie, Commé
chez lès Antis, /e màfiage étoit inconnu : quand là
nature 'leur infpiroit des defirs , le hasard'leur donnait
Une femme , ils prenoient celles qu'ils rencontraient ;
leurs filles, leurs foeurs, leurs meréslcur étoieht indijf
fèrentes ; cependant ces dernier es étoient plus exceptées
Dans un autre cantonajoute-t-il, les meres gardoienl
leurs filles- avec un foin extrême ; & quand elles les
marioient, elles les déjlofoient en public de leurs propres'
mains, pour montrer qui elles les av oient bien gardées*
tom: 1 , p.ag-. 74. Ce dernier-ufage , s’il étoit bien
vrai,'pourroit paroître encore plus étonnant que
l’incéfte, qui a du-être effeâivement plus en vogue
chez les petites hordes ", compofées feulement de
cent-trente perfonnes, & telle s qu’on en-voit eticore
aujourd’hui dans les-forêts de Y Amérique, que parmi
les tribus plus- nombreufes ; & fur-tout -fi î-dn réfléchit
à la multiplicité des langues relativement inintel-
ligiblesî qiii-empêchoit ces petites hordes de prendre
des femmes chez leurs voifins;
- Il .faut bien ob fer ver ici que'ce n’eft qufune pure
âippofition ,• dont nous’- /avons : rendu compte au
fujet dé là-dégéneratiori quelles accouplemens in-
ceftueux pOuïroient occanonner dans '1-èfpece humaine
, -comme dans quelques ëfpeces animales.
La vérité eft que nous ne-'fofflmes pas, ,& que nous-
ne ferons point de fi-'tdra'ffez inftriiits fur uri1 obj'et fi ’
important ,■ pour pouvoir eix parler avec-àffurance;
car il në convient, guere- de citer ici l’exemple de
quelques peuples de l’antiquitéj ni fur-tout l’exemple
des Egyptiens y dont les lo ix , qu’on croit le mieux-
coiinoîtré j-iontfioûventles pltis inconnue's ;:des Grecs
qui Ont écrit fur l’hiftoiré de l’Egypte après, la mort
d’Alexandre," ont pu aifément confondre les fanc-
tions dfun-'Code 'étranger j adopté fous la dynaftie des
Lagidep,2iayec les. faïïftions du code national, où
nous f qui en àéo'ns faitam'e étude particulière,’ n’a - 1
vons (mottvé aucune preuve convaincante-de la
loi; qu’oii- fioupGonne y avoir, exifté, - avant le teins ■
de - la conquête- des Macédoniens ; mais une plus
ample idîfcuffion -à cet' 'égard feroit ici. très - dé - '
placéev Ce qui démontre au refte qu!il ne faut
pas raifOrine'r fiur la néçeffité de- croifer les races,
Ibrfqu’il S’agit des hommes, comme lorfqu’il s’agit
des animaux' domeftiquës ; c’ eft que-les Circaffiens
& les-Mingréliens conftituent un peuple qui ne fe
mêle- jamais avec aucun autre, & où. les degrés
qui empêchent le mariage, font très-peu étendus ;
cependant le fang y e ft ,. comme l’on fçait., le plus
b'eau du monde , au moins dans les.femmes; & il
s’en faut beaucoup que-les hommes y fôient auffi
laids que le dit, dans fes Voyages au levant , le che- •
valier d’Arvieu, dont le témoignage eft très-oppofé
à'celui de M. Chardin qui avoit été fur les lieu x,
& le chevalier d’Arvieu n’y a point été. D ’un autre ■
côté, les Samojedes qui ne fe mêlent, ni avec les
Lapons, ni avec les Ruffes, conftituent un peuple
très-chétif & abfolument imberbe, quoique nous
fçaehions à rien point douter, par les obfervàtions
de M. Klingftaedt , que jamais les Samojedes ne
contrarient des mariages inceftueux, comme On l’af*
fure dans quelques relations, dont les auteurs étoient
très-maL informés., _ -■ # : _ -■ '?■
Il peut exifter dans le climat de Y Amérique des.