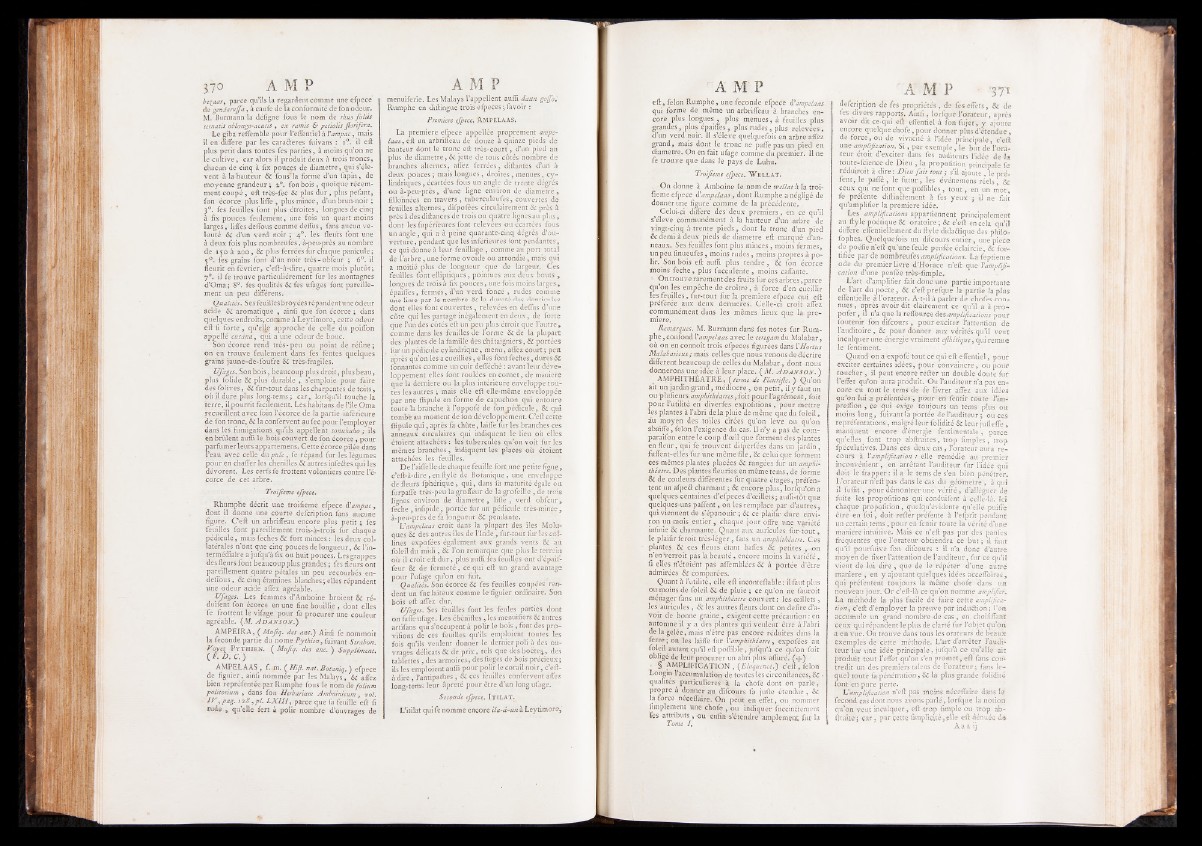
beçaar, parce qu’ils la regardent comme une efpece
de oendarujfa, à caufe de la conformité de fon odeur.
M. Bnrmann la défigne fous le nom de rhus foliis
ternatis oblongo-acutis , ex ramis & petiolis fiorifera.
Le giba reffemble pour l’eflentiel à l'ampac, mais
il en différé par les cara&eres fui vans : i?. il eft
plus petit dans toutes fes parties, à moins qu’on ne
le cultive, car alors il produit deux à trois troncs,
chacun de cinq à fix pouces de diamètre, qui s’élèvent
à la hauteur & fous*la forme d’un fapin, de
moyenne grandeur ; 2°. fon bois , quoique récemment
coupé, eft très-fec & plus dur , plus pefant,
fon écorce plus lifte , plus mince, d’un brun-noir ;
3°. fes feuilles font plus étroites, longues de cinq
à fix pouces feulement, une fois 'un quart moins
larges, liffes deffous comme defliis, fans aucun velouté
& d’un verd noir ; 40. les fleurs font une
à deux fois plus nombreufes, à-peu-près au nombre
de 150 à 200, & plus ferrées fur chaque panicule;
5 °. fes grains font d’un, noir très - obfcur ; 6°. il
fleurit en février, c’eft-à-dire, quatre mois plutôt;
70. il fe trouve particuliérement fur les montagnes
d’Ôma; 8°. fes qualités & fes ufages font pareillement
un peu différens..
Qualités. Ses feuilles broyées répandent une odeur
acide & aromatique , ainfi que fon écorce ; dans
quelques endroits, comme à Leytimore, cette odeur
eft fi forte, qu’eUe approche de celle du poiflbn
appellé cutàna, qui a une odeur de bouc.
Son écorce rend très-peu ou point de réfine;
on en trouve feulement dans fes fentes quelques
grains jaune-de-foufre & très-fragiles.
Ufages. Son bois, beaucoup plus droit, plus beau,
plus folidè & plus durable , s’emploie pour faire
des folives, & fur-tout dans les charpentes de toits,
où il dure plus long-tems ; car, lorfqu’il touche la
terre, il pourrit facilement. Lès habitans de l’île Orna
recueillent avec foin l’écorce de la partie inférieure
de fon tronc, & la confervent au fec pour l’employer
dans les fumigations qu’ils appellent tonuhuho ; ils
en brûlent aufli le bois couvert de fon écorce , pour
parfumer leurs appartemens. Cette écorce pilée dans
l’eau avec celle, du pule , fe répand fur les légumes
pour en chaffer les chenilles & autres infectes qui les
dévorent. Les cerfs fe frottent volontiers contre l’écorce
de cet arbre.
Troijieme efpece.
Rhumphe décrit une troifieme efpece d’ampac,
dont il donne une courte defcription fans.aucune
figure. C’eft un arbriffeau encore plus petit ; fes
feuilles font pareillement trois-à-trois fur chaque
pédicule, mais feches & fort minces : les deux collatérales
n’ont que cinq pouces de longueur, & l’intermédiaire
a jufqu’à fix ou huit pouces. Les grappes
des fleurs font beaucoup plus grandes ; fes fleurs ont
pareillement quatre pétales un peu récourbés en-
deffous, & cinq étamines blanches; elles répandent
une odeur acide a fiez agréable. .
Ufages. Les femmes d’Amboine broient & ré-
duifent fon écorce en une fine bouillie , dont elles
fe frottent le vifage pour fe procurer une couleur
agréable. (M. A d a n so n .')
AMPEIRA, ( Mujiq. des anc.) Ainfi fe nommoit
la fécondé partie du nome Pythien, fuivant Strabon.
Voye^ Pythien. ( Mujiq. des anc. ) Supplément.
{F . D .C . )
AMPELAAS , f. m. (^Hijl. nat. Botanlq. ^ efpece
de figuier, ainfi nommée par les Malays, & aflez
bien repréfentée,par. Rumphe fous le nom de folium
politorium , dans fon Herbarium Amboinicum, vol.
îy ^ pag. izS ,pl. L X I I I , parce que fà feuille eft fi
rude , qu’elle fert à polir nombre d’ouvrages de
menuiferie. Les Malays l’appellent Suffi daun goffo',
Rumphe en diftingue trois efpeces; favoir :
Première efpece. AMPELAAS.
La première efpece appellée proprement ampe-
laas,zH un arbriffeau de douze à quinze pieds de
hauteur dont le trortc eft très-court, d’un pied au
plus de diamètre, & jette de tous côtés nombre de
branches alternes, aflez ferrées, diftantes d’un à
deux pouces; mais longues, droites , menues, cylindriques
, écartées fous un angle de trente degrés
ou à-peu-près, d’une ligne environ de diamètre ,
fillohnées en travers , tuberculeufes, couvertes de
feuilles alternes, difpofées circiilairement & près à
près à des diftances de trois ou quatre lignes.au plus,
dont les fupérfèures font relevées ou écartées fous
un angle, qui a à peine quarante-cinq dégrés d’ouverture,
pendant que les inférieures font pendantes,
ce qui donne à leur feuillage , comme au port total
de l ’arbre, une,forme ovoïde ou arrondie, mais qui
a moitié plus de longueur que de largeur. Ces
feuilles font elliptiques, pointues aux deux bouts ,
longues de trois à fix pouces, une fois moins larges,
épaiffes, fermes, d’un verd foncé , rudes comme
une lime par le nombre & la dureté des denticules
dont elles font couvertes, relevées en deffus d’une
côte qui les partage inégalement en deux, de forte
que l’un des côtés eft un peu plus étroit que l’autre,
comme dans les feuilles de l’orme & de la plupart
des plantes de la famille des châtaigniers, & portées
fur un pédicule cylindrique, menu, aflez court ; peu
après qu’on les a cueillies, elles font feches, dures &
fonnantes comme un cuir defféché : avant leur développement
elles font roulées en cornet, de maniéré
que la derniere pu la plus intérieure enveloppe toutes
les autres ; mais elle eft elle-même enveloppée
par une ftipule en forme de capuchon qui entoure
toute la branche à l’oppofé de fon pédicule, & qui
tombe au moment de Ion développement. C’eft cette
ftipule qui, après fa chute, laifle fur les branches ces
anneaux circulaires qui indiquent le lieu où elles
étoient attachées : les tubercules qu’on voit fur les
mêmes branches, indiquent les places' où étoient
attachées les feuilles.-
De l’aiflelle de chaque feuille fort une petite figue
c’eft-à-dire, en ftyle de Botanique., une enveloppe
de fleurs fphérique, qui, dans fa maturité égale ou
furpaffe tr.ès-peu la groffeur de la grofeille , de trois
lignes environ de diamètre, lifl'e , verd obfcur,
feche , infipide, portée fur un pédicule très-mince ,
à-peu-près de fa longueur tte. pendante.
Uampelaas croît dans la plupart des îles Molu-
ques & des autres îles de l’Inde^, fur-tout fur les collines
expofées également aux grands vents & au
foleil du midi, & l’on remarque que plus le terrein
où il croît eft dur, plus aufli fes feuilles ont d’épaif-
feur & de fermeté, ce qui eft un grand avantage
pour l’ufage qit’on en fait.
Qualités. Son écorce & fes feuilles coupées rendent
un fuc laiteux comme le figuier ordinaire. Son
bois eft aflez dur.
Ufages. Ses feuilles font les feules parties dont
on faffe ufage. Les ébéniftes , les menuifiers & autres
artifans qui s’occupent à polir le bois , font des provisions
de ces feuilles qu’ils emploient toutes les
fois qu’ils veulent donner le dernier poli à des ou vrages
délicats & de prix, tels que des boëte$, des
tablettes , des armoires, des fieges de bois précieux;
ils les emploient aufli pour polir le corail noir, c’eft-
à dire, l’antipathes, & ces feuilles confervent aflez
long-tems leur âpreté pour être d’un long ufage.
Seconde efpece. I t i l a t .
L’itilat quife nomme encore ila-â-un à Leytimore,
eft, félon Rumphe, une fécondé efpece tfampelaas
qui forme de même un arbriffeau à branches encore
plus longues , plus menues, à feuilles plus
grandes, plus épaifles* plus rudes, plus relevées,
d’un verd noir. 11 s’élève quelquefois en arbre aflez
grand, mais dont le tronc ne paffe pas un pied en
diamètre. On en fait ufage comme du premier. 11 ne
fe trouve que dans le pays de Luhu.
Troijieme efpece.'W e l l a t .
. On donne à Amboine le nom de wellat à la troi-
ïieme efpece ftampelaas., dont Rumphe a négligé, de
donner une figure comme de la précédente. :
Celui-ci différé des‘ deiix premiers, èn- ce qu’il
s’élève communément à la hauteur d’un arbre de
vi'ngt-cinq à trente pieds, dont le tronc d’un pied
& demi à deux pieds de diamètre eft marqué d’anneaux.
Ses feuilles font plus minces, moins fermes,
un peu finueufes , moins rudes, moins propres à polir.
Son bois eft aufli plus tendre, & fon écorce
moins feche, plus fucculente, moins caffante.
On trouve rarement des fruits fur ces arbres, parce
qu’on les empêche de croître, à force d’en cueillir
les feuilles, fur-tout fur la première efpece qui eft
préférée aux deux dernieres. Celle-ci croît aflez
communément dans les mêmes lieux que la- première.
Remarques. M. Burmanndans fes notes fur Rumphe
,confond Vampelaas avec le teregamdu Malabar,
où on en connoît trois efpeces figurées dans l'Hortus
Malabaricus; mais celles que nous venons de décrire
different beaucoup de celles du Malabar, dont -nous
donnerons une idée à leur place. ( M . A d a n s o n . )
__ AMPHITHÉÂTRE, ( terme de Fleurijle. ) Qu’on
ait un jardin grand, médiocre , ou petit, il y faut un
oti'plufieurs amphithéâtres, foit pour l’agrément, foit
pour l’utilité, en diverfes exportions , pour mettre
les plantes à l’abri delà pluie de même que du foleil,
au moyen des toiles cirées qu’on leve ou qu’on
àbàiffe, félon l’exigence du cas. Il n’y a pas de com-
paraifon entre le coup d’oeil que forment des plantes
en fleur, qui fe trouvent difperfées dans un jardin,
fuffent-elles fur une même file, & celui que forment
ces mêmes plantes placées & rangées fur un amphithéâtre.
D es plantes fleuries en même tems, de forme
& de couleurs différentes fur quatre étages, préfen-
tent un afp eft charmant ; & encore plus, lorfqu’ona
quelques centaines.d’efpeces d’oeillets; aufîi-tôt que
quelques-uns paffent, on les remplace par d’autres,
qui viennent de s’épanouir ; & ce plaifir dure environ
un mois entier , chaque jour offre une variété
infinie & charmante. Quant aux auricules fur-tout,
le plaifir feroit très-léger., fans un amphithéâtre. Ces
plantes. & ces fleurs étant baffes Sc petites .,-ron
n’en Verroit pas la beauté, encore moins la variéfé,
fi elles n’étoie’nt pas affemblées & à portée d’être
admirées & comparées.
Quant à l’utilité, elle eft inconteftable : il faut plus
ou moins de foleil & de pluie ; ce qu’on ne fauroit
ménager fans un amphithéâtre couvert ,: les oeillets,
les ‘auricules, & les autres fleurs dont on defire d’avoir
de bonne graine,, .exigent cette précaution : en
automne il y a des plantes qui veulent être à l’abri
de la gelée, mais n’être pas encore réduites dans la
ferre ; on les laiffe fur \amphithéâtre, expofées au
foleil autant qu’il eft poflible, jufqu’à ce qu’on foit
Obligé de leur procurer un abri plus afîùré. (+ )
§ AMPLIFICATION , (EloquenceJ c’eft, félon
Longin l’accumulation de toutes les circonftances, & »
qualités particulières à la chofe dont on parle,
propre à donner a,u difeours fa jufte étendue, &
la force néeeffaire. On peut en effet, ou nommer
Amplement une chofe , ou indiquer fuccinfrement
fes attributs, ou enfin s’étendre amplement fur la
Tome I,
defcription de fes propriétés , de fes effets, & de
fes divers rapports. Ainfi , lorfque l’orateur, après
avoir dit ce-qui eft effentiel à fon fujet , y ajoute
encore quelque chofe, pour donner plus d’étendue,
de force, ou de vivacité à l’idée principale, c’eft
une amplification. S i , par exemple, le but de l’orateur
étoit d’exciter dans fes auditeurs l’idée de la
toute-fcience de Dieu , la propofition principale fe
réduiroit à dire : Dieu fait tout ; s’il ajoute , le pré-
fent, le paffé, le futur, les événemens réels,
ceux qui ne font que poflibles , tou t, en un mot
fe préfente diftinfrement à fes yeux ; il ne fait
qu’amplifier la première idée.
Les amplifications appartiennent principalement
au ftyle poétique & oratoire; & c’eft en cela qu’il
différé effentiellement du ftyle didaftiquê des philo-
fophes. Quelquefois un dilcours entier, une pièce
de poéfie n’eft qu’une feule penfée éclaircie, & fortifiée
par de nombreufes amplifications. La feptieme
ode du premier livre d’Horâce n’eft que l’amplification
d’une penfée très-fimple.
L’art d’amplifier fait donc une partie importante
de l’açt du poëte , & c’eft prefque la partie la plus
effentielle à l’orateur. A-t-il à parler de chofes connues,
après avoir dit clairement ce qu’il a à pro-
pofer, il n’a que la reffource des amplifications pour
foutenir fon difeours , pour exciter l’attention de
l'auditoire , & pour donner aux vérités qu’il veut
inculquer une énergie vraiment ejlhétiqpe, qui remue
le fentiment.
Quand on a expofé tout ce qui eft effentiel, pouf
exciter certaines idées, pour convaincre, ou pour
toucher, ii peut encore reftèr un double doute fur
l’effet qu’on aura produit. Ou l'auditeur n’a pas encore
eu tout le tems de fe livrer aflez aux idées
qu’on lui a préfentéës, pour en fentir toute Fim-
prèflion , ce qui exige toujours un tems plus ou
moins long, fuivant la portée de l’auditeur ; ou ces
repréfentations, malgré leur folidité & leur jufteffe ,
manquent encore d’énergie fentiment ale , parce
qu’ elles font trop abftraites, trop Amples, trop
fpécùlatives. Dans ces deux cas ,• l’orateur aura recours
à Vamplification : elle remédie au premier
inconvénient, ■ en arrêtant l’auditeur fur l’idée qui
doit- le frapper : il a le tems de s’en bien pénétrer.
I.’orateur n’eft pas dans lè cas du géomètre , à qui
il futfit , pour démontrer une vérité, d?al!éguer de
fuite les propôfitions qui conduifent à celle-là. Ici
chaque propofition , quelqu’évidente qu’elle, puifle
être en f o i , doit-refter préfente à l’e-fprit pendant-
un certain tems', pour en fentir toute la‘ vérité d’une
maniéré intuitive. Mais ce n’eft pas par des paufes
fréquentés que l’orateur obtiéndrâ ce but ; il faut
qu’il pourfuive fon difeours : il n’a donc d’autre
moyen de fixer l’attention de l’auditeur, fur ce qu’il
vient de -lui dire , que de Je répéter d’une autre
manière , en y ajoutant quelques idéès àcceffoires,
(jui préfentènt toujours la même chofe dans un
nouveau jour. Or c’eft-là ce qit’on nomme amplifier.
La méthode la plus facile de faire cette amplification,
c’eft d’employer la preuve par indufrion; l’on
accumule un grand nombre-de cas, en choififfant
ceitx qui répandent le plus de clarté fur l’objet qu’on
a en vue. On trouve dans tous les orateurs de beaux
exemples de cette méthode. L’art d’arrêter l’audi*
teur fur une idée principàle, jufqifà ce qu’elle ait
produit tout l’effet qu’on s’en promet , eft fans cou1
tredit un des premiers talens de l’orateur ; fans lequel
toute fa pénétration, & la plus grande folidité
font en pure perte.
L’amplification n’eft pas moins néeeffaire dans le'
fécond cas dont nous avons parlé, lorfque la notion
qu’on veut inculquer, eft trop fimple ou trop ab-
ftraite’; -car, par cette {implicite, elle eft dénuée de
A a a ij