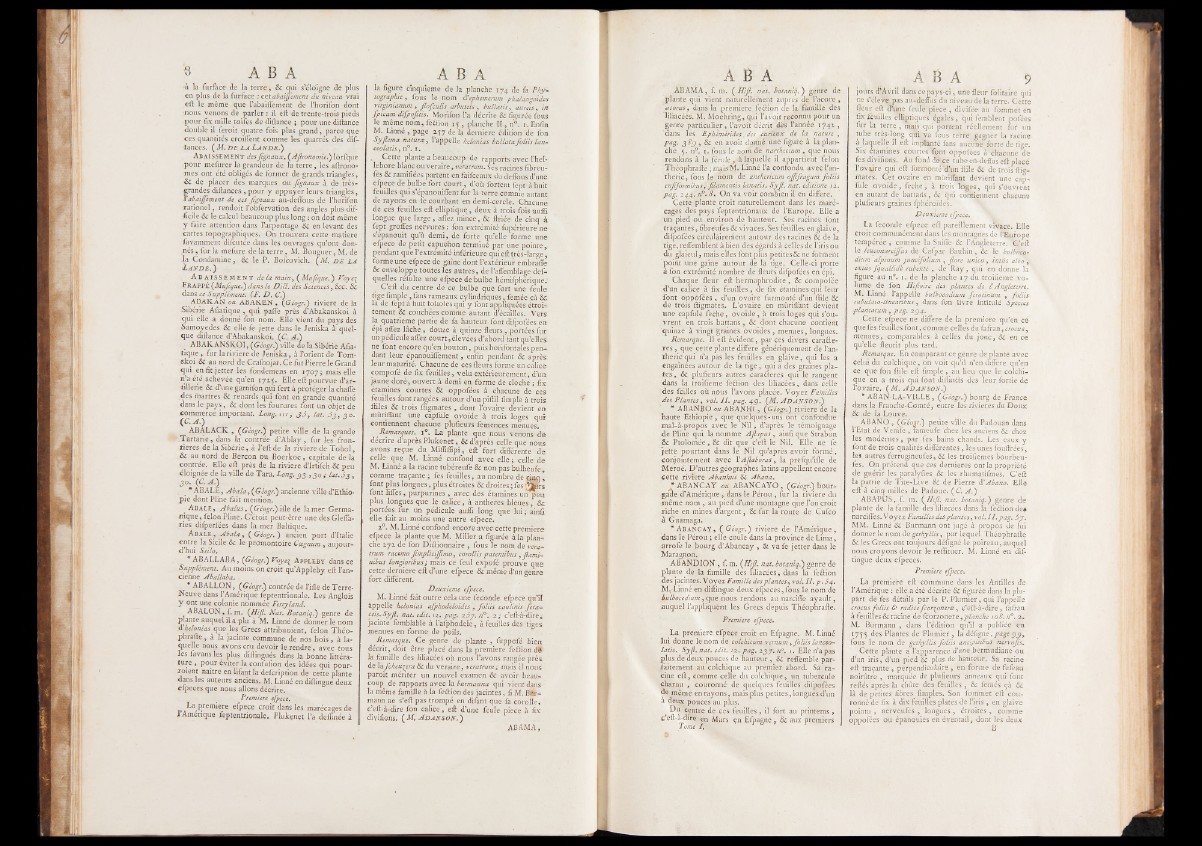
•à la furfhce de la terre, St qui s’éloigne de plus
en plus de la furface : cet abaijfement du niveau vrai
eft le même que l’abaifTemeot de Fhorifon dont
nous venons de parler : il eft de trente-trois pieds
pour fix mille toifes de diftance ; pour une diftance
double il feroit quatre fois plus grand, parce que
ces quantités croifl'ent comme les quarrés des dif-
'tances. ( M. d e l a L a n d e .')
Abaissement desfignaux, (Àfironomieî) lôrfque
pour mefurer la .grandeur de la terre, les.agronomes
ont été obligés de former de grands triangles,
& de placer des marques ou fignaux à de très-
grandes diftances , ppur y appuyer leurs triangles,
l’abaijfement de ces fignaux au-deffous de l’horifon
rationel, rendoit l’obfervation des angles plus difficile
& le calcul beaucoup plus long : on doit même
y faire attention dans l’arpentage St en levant des
cartes topographiques. On trouvera cette matière
favamment difeutée dans les ouvrages qu’ont donnés
, fur la mefure de là terre, M. Bouguer, M. de
la Condamine, St le P. Bofeovich. (M. d e l a
L a n d e . )
A b a i s s e m e n t de la main, ( Mufique. ) Voye%_
Frappe (Mufique.) dans le Dict. des Sciences, Stc. St
dans ce Supplément. (F. D . C.)
ABAKAN ou A BAKEN, (Géogr.) riviere de la
Sibérie Afiatique, qui paffe près aAbakanskoi à
qui elle a donné fon nom. Elle vient du pays des
Samoyedes St elle fe jette dans le Jeniska à quelque
diftance d’Abakanskoi. (C. A.)
ABAKANSKOI, (Géogr.) ville de la Sibérie Afiatique
, fur la riviere de Jeniska, à l’orient de Tomsk
?! & au nord de Crafnojar. Ce fut Pierre le Grand
qui en fit ,j etter les fondemens en 1707; mais elle
n’a ete,achevée qu’en 1725. Elle eft pourvue d’artillerie
St d’une garnifon qui fert à protéger la chaffe
des martres St renards.qui font en grande quantité
dans le pa ys, St dont les fourures font un objet de
commerce important. Long, m , j J , lai. 5 ? , o0. m® .. ■ ■ Il ABA LACK , (Geogr.) petite ville de la grande
Tartarie, dans la contrée d’A b la y , fur les frontières
de la Sibérie, à l’eft de la riviere de T o b o l,
.& au nord de Bërcon ou Boerkoc, capitale de la
contrée. Elle eft près de la riviere d’Irtifch St peu
éloignée de la ville de Tara. Long. $ 3 ,3 o; lat.53 5
j q . (C. A .)
_ * ABALE, Abala, (Géogr.) ancienne ville d’Ethiopie
dont Pline fait mention.
Abale, Abalus, (Géogr.) ifle de la mer Germa- !
nique, félon Pline. C ’étoit peut-être une desGleffa-
ries difperfées dans la mer Baltique.
Abale, Abala, (Géogr.) ancien port d’Italie
entre la Sicile St le promontoire Ccegnùm, aujourd'hui
Stilo.
* ABALLABA, (Géogr.) Voye^ Appleby dans ce
Supplément. Au moins on croit qu’Appleby eft l’ancienne
Aballaba. .
* ABALLON, (Géogr.) contrée de l’ifle de Terre-
Neuve dans l’Amérique feptentrionale. Les Anglois
y ont une colonie nommée Ferryland.
ABALON, f. m. (Hifi, Nat. Botaniq.) genre de
plante auquel il a plu à M. Linné de donner le nom
d'helonias que les Grecs attribuoient, félon Théo-
phrafte, à la jacinte commune de nos b o is, à laquelle
nous avons cru devoir le rendre, avec tous,
les favans les plus diftingués dans la bonne littérature
, pour éviter la confufion des idées qui pour-
xoient naître en lifant la defeription de cette plante
dans les auteurs anciens. M. Linné endiftingue deux
elpeces que nous allons décrire.
Premiere efpece,
La première efpece croît dans les marécages de
l ’Amérique feptentrionale. Plukenet l’a deffinée à
la figure cinquième de la planche 174 de fa Phy-
tographit, fous le nom d'epkemerum phalangoïdes
virginianum , fiofculls arbuteis | bullatis, aureis, in
fpicarn difpofius. Morifon l’a décrite St figurée fous
le même nom, fettion 15 , planche I I , n°. 1. Enfin
M. Linné , page 257 de la derniere édition de fon
Syfiema natures, l’appelle helonias bullata foliis lan-
ceolatis, n°. 1.
„ Cette plante a beaucoup de rapports avec l’hel-
lebore blanc ouveraite, veratrum. Ses racines fibreuses
St ramifiées partent en faifeeaux du deffous d’une
efpece de bulbe fort, court, d’où fortent fept à huit
feuilles qui s’épànouiffent fur la terre comme autant
de rayons en fe courbant en demi-cercle. Chacune
de ces feuilles eft elliptique, deux à trois fois aufli
longue que large, 'affez mince, St ftriée de cinq à
fept groffes nervures : fon extrémité fupérieure ne
s’épanouit qu’à demi, de forte qu’elle forme une
efpece de petit capuchon terminé par une pointe,
pendant que l’extrémité inférieure qui eft très-large ,
forme une efpece de gaîne dont l’extérieur embraffe
& enveloppe toutes les autres , de l’affemblage def-
quelles réfulte une efpece de bulbe hémifphérique.'
C’eft du centre de ce bulbe que fort une feule
tige fimple , fans rameaux cylindriques, femée çà Sc
là de fept à huit folioles qui y font appliquées étroitement
St couchées comme autant d’écailles. Vers
la quatrième partie de fa hauteur font difpofées en
epi affez lâche, douze à quinze fleurs , portées fur
un pédicule affez court, élevées d’abord tant qu’elles
ne font encore qu’en bouton, puis hofifontales pendant
leur épanouiffement, enfin pendant & après
leur maturité. Chacune de ces fleurs forme un calice
compofé de fix feuilles, velu extérieurement, d’un
jaune doré, ouvert à demi en forme de cloche ; fix
etamines courtes St Oppofées à chacune de ces
feuilles font rangées autour d’un piftil fimple à trois
ftiles St trois ftigmates , dont l’ovaire devient en
mûriffant une capfule ovoïde à trois loges qui
contiennent chacune plufieurs femences menues.
Remarques. i° . La plante que nous' venons dé
décrire d’après P lukenet, St d’après celle que nous
avons reçue du Mifliflïpi, eft fort différente de
celle que M. Linné confond avec elle; celle de
M. Linné a la racine tubéreufe St non pas bulbeufe,
comme traçante ; fes feuilles, au nombre de gînq ,
font plus longues, plus étroites St droites; fes ^feirs
font liffes, purpurines , avec des étamines unpeu
plus longues que le calice, à anthères, bleues, Se
portées fur un pédicule aufli long que lui ; ainû
elle fait au moins une autre efpece^
20. M. Linné confond encore avec cette première
efpece la plante que M. Miller a figurée à la planche
272 de fon Dictionnaire , fous le nom de veratrum
racemo fimplicïjfimo, corollis patentibus, fiattii-
nibus longioribusi mais ce feul expofé prouve que
cette derniere eft d’une efpece St même d’un genrè
fort différent.
Deuxieme efpece.
M. Linné fait outre cela une fécondé efpecè qu’il
àppelle helonias afphodeloïdes , foliis caulinis fêta~
ceis.Syfi. nat. edit. 12. pagi 25y. n°. 2 ; c’eft-à-dire*
jacinte femblable à l’afphodele, à feuilles des tiges
menues en forme de poils.
Remarque. Ce genre de plante > fuppofé bien
décrit, doit être placé dans la pfemiere feCtion d*é
la famille des liliacées où nous l’avons rangée près
de la fcheuçera & du veraire, veratrum; mais il nous
paroît mériter un nouvel examen & avoir beaucoup
de rapports avec la burmanna qui vient dans
la même famille à la feCtion des jacintes, fi M. Bfflr-
mànn ne s’eft pas trompé en difant que fa corolle,
c’eft-à-dire fon calice, eft d’une feule piece à fix
divifions. ( M, A d an so n . )
ABAiylA,
ÀBAMA, f. m. ( Hifi. nat. hotanïIj. ) genre de
plante qui vient naturellement auprès de l’acore ,
acorus, dans la première" fection de la famille des
liliacées. M. Moehrïng, qui l’ayoit reconnu pour un
genre particulier, l’avoït décrit/dès l’annéè 1742 ,
dans les Ephemérides. des curieux de la nature ,
pag, 38g , & en avoit donné ünë figure à là planche
5. n°. 1. fous le nom de harthecium, que nous
rendons à.la férule , à laquelle il appartient félon
Théôphraftè ; mais M. Linné l’a confondu avec l’an-
theric, fous le nom de anthericum ojfifraguni foliis
enfiformibus, filamentis lanatis. S y fi. nat. editione 12.
pag. 244, n°. 8. On va voir combien il en différé.
Cette plante croît naturellement dans lés marécages
des pays feptentrionaux de l’Europe. Elle a
un pied ou environ de hauteur. Ses racinés font
traçantes, fibreufès & vivaces. Ses feuilles en glaive,
difpofées circulàireifient autour des racines & de là
tige, reffemblent à bien des égards à celles de l’iris ou
du glaïeul, mais elles fönt plus petites & ne forment
poiiit une gaîne autour de la tige. Celle-ci porte
à fon extrémité nombre de fleurs difpofées en épi.
Chaque fleur eft hermaphrodite, & COmpofée
d’un calice à fix feuilles, de fix étamines qui leur
font oppôfées , d’un ovaire furmonté d’ùn ftile &
de trois ftigmàtes. L’ovaire en mûriflàht devient
line capfule feche, ovôïde, à trois loges qui s’ouvrent
en trois battans, & dont chacune contient
quinze à vingt ‘graines ôvo'ïdês , menues, longues.
Remarque. Il eft évident, par Ces divers caraéle-
t e s , que cette plante différé génériquement de l’an-
iheric qui n’a pas les feuilles en glaive, qui les a
engainées autour de la fig e , qui a des graines plates
, & plufieurs autres .caratter.es qui le rangent
dans la troifieme fettiön des liliacées, dans celle
des fcilles où nous l’avons placée. Voyez Familles
des Plantes, vol. II. pag. 4g. (M. A DAN SO N.)
* ABANBO ou ABANHI, (Géogr.) riviere de la
haute Ethiopie, que quelques-uns Ont Confondue
mal-à-propos avec le N il, d’après le témoignage
de Pline qui la nomme Afiapus, ainfi que Strabon
6c Ptolomée, & dit que c’eft le Nil. Elle ne fe
jette pourtant dans le Nil qu’après avoir formé,
conjointement avec VAfiaboras, la prefqu’ifle dè
Meroé. D ’autres géographes latins appellent encore
cette rivière Abanhus & Abana.
* ABANCAY ou ABANCA YO, (Géogr.) bourgade
d’Amérique, dans le Pérou, fur la riviere du
même nom , au pied d’une montagne que l’on croit
xiche en mines d’argent, & fur la route de Cufco
à Guamaga.
* Abanca y, (Géogr.) riviere de l’Amérique,
dans le Pérou ; elle coule dans la province de Lima,
arrofe le bourg d’Abancay , & va fe j etter dans le
Maragnon.
ABANDION , f. m. (Hifi. nat. botaniq.) genre de
plante de la famille des liliacées, dans la fettion
des jacintes. Voyez Famille des plantes, vol. II. p. 54.
M. Linné en diftingue deux efpeces, fous le nom de
bulbocedium., que nous rendons au narciffe ayault,
.auquel l’appliquent les Grecs depuis Théophrafte.
Premiere efpece.
La première efpece croît en Efpagne. M. Linné
lui donne le nom de colchicum vernum, foliis lanceo-
latis. Syfi. nat. edit. 12. pag. 23y. n°. / .- Elle n’a pas
plus de deux pouces de hauteur , & reffemble parfaitement
au colchique au premier abord. Sa racine
eft, comme celle du colchique, un tubercule
charnu , couronné de quelques feuilles difpofées
de même enrayons, mais plus petites, longues d’un
à deux pouces au plus.
Du centre de ces feuilles , il fort au printems ,
c’eft-à-dire en Mars çn Efpagne, & aux premiers
Tomé' I,
jours d’Àvrii dans ce pays-ci, une fleur folitairë qtti
ne s’élève pas au-deffus du niveau delà terre. Cette
fleur eft d’une feule piece , divifée au fommet en
fix feuilles elliptiques égales , qui femblent pofées
fur la terre , mais qui portent réellement fur un
tube très-long qui va fous terre gagner la racine
à laquelle il eft implanté fans aucune forte de tige.
Six etamines courtes font oppofées à chacune de
fes divifions. Au fond dé ce tube ert-deffus eft placé
l’ovaire qui eft furmonté d’un ftile & de trois ftigmates.
Cet ovaire én mûriffant devient une capfule
o voïde, feche, à trois lbges, qui s’ouvrent
en autant de battarts, &t qui contiennent chacune
plufieurs graines fphéroïdes.
Deuxieme efpece.
La fécondé efpece eft pareillement vivace. Elle
croît communément dans les montagnes de l’Europe
tempérée , comme la Suiffe & l’Angleterre. G’eft
le leuconarcijfus de Cafpar Bauhin, & le buLbâco-
dium alpinum juncifolium , flore unico , intus albo ,
ex tus fquaLLidc rubentè , de R à y , qui en donne la
figure au n°. 1. de la planche 17 du troifieme volume
de fon Hijloire des plantés de C Angleterre,
Mi Linné l’appelle bulbocodium ferôtinum , foliis
tubulato-linearibus, dans fon livre intitulé Spccies
plantarum, pag. 294.
Cette efpece ne différé de la première qu’en ce
que fes feuilles font, comme celles du fafran, crocus,
menues, .comparables-à celles du jonc, & en ce
qu’elle fleurit plus tard.
Remarque. En comparant ce genre de planté avec
celui du colchique, on voit qu’il n’en différé qu’en
ce que fon ftile eft fimple, au lieu que le colchique
en a trois qui font diftintts dès leur fortie de
l’ovaire, (M. A d a n son .)
* ABAN-LA-VILLE, (Géogr.) bourg de France
dans la Franche-Comté, entre les rivières du Doux
& de la Louve.
ABANO , (Géogr.) petite ville du Padouan dans
l’Etat de Venife , tameufe chez les anciens & chez
les modernes, par fes bains chauds. Les eaux y
font de trois qualités différentes , les unes fouffrées,
les autres ferrugineufes, & les troifiemes bourbeu-
fes. On prétend que ces dernieres ont la propriété
de guérir les paralyfies & les rhumatifmes. C ’eft
la patrie de Tite-Live &c de Pierre à’Abano. Elle
eft à cinq milles de Padoue» (C .A .)
A B AP US, f. m. (H f i. nat. botaniq.) genre de
plante de la famille des liliacées dans la fettion de#
narciffes. Voyez Familles des plantes, vol. I I . pag. 5 y *
MM. Linné & Burmann ont jugé à propos de lui
donner le nom de gethyllis, par lequel Tnéophrafte
&c les Grecs ont toujours défigné le poireau, auquel
nous croyons devoir le reftituer. M. Linné en diftingue
deux efpeces.
Première efpece-.
La première eft commune dans les. Antilles de
l’Amérique : elle.a été décrite Si figurée dans la plupart
de fes détails par le P. Plumier, qui l’appelle
crocus foliis & radice feor^onerce, c’eft-à-dire , fafran
à feuilles St racine de febrzoneré, planche 108-.11°. 2.
M. Bùrmann , dans l’ëditiOn qu’il a publiée en
1775 des Plàntës de Plumier , la défigne, page g g ,
fous le nom de gethyllis foliis ancipitibuS tiervofis.
Cette plante a l’apparence d’une, bermudiane ou
d’un iris, d’un pied & plus de hauteur. Sa racine
eft traçante , perpendiculaire , èn forme de fufeau
noirâtre , marquée de plufieurs anneaux qui font
reftés après la chute dès feuilles , St femés çà St
là de petites fibres {impies. Son fommet eft couronné
de fix à dix feuilles plâtês de l’iris , en glaive
pointu , nerveufes , longues , étroites , comme
oppofées ou épanouies en éventail, dont les deux