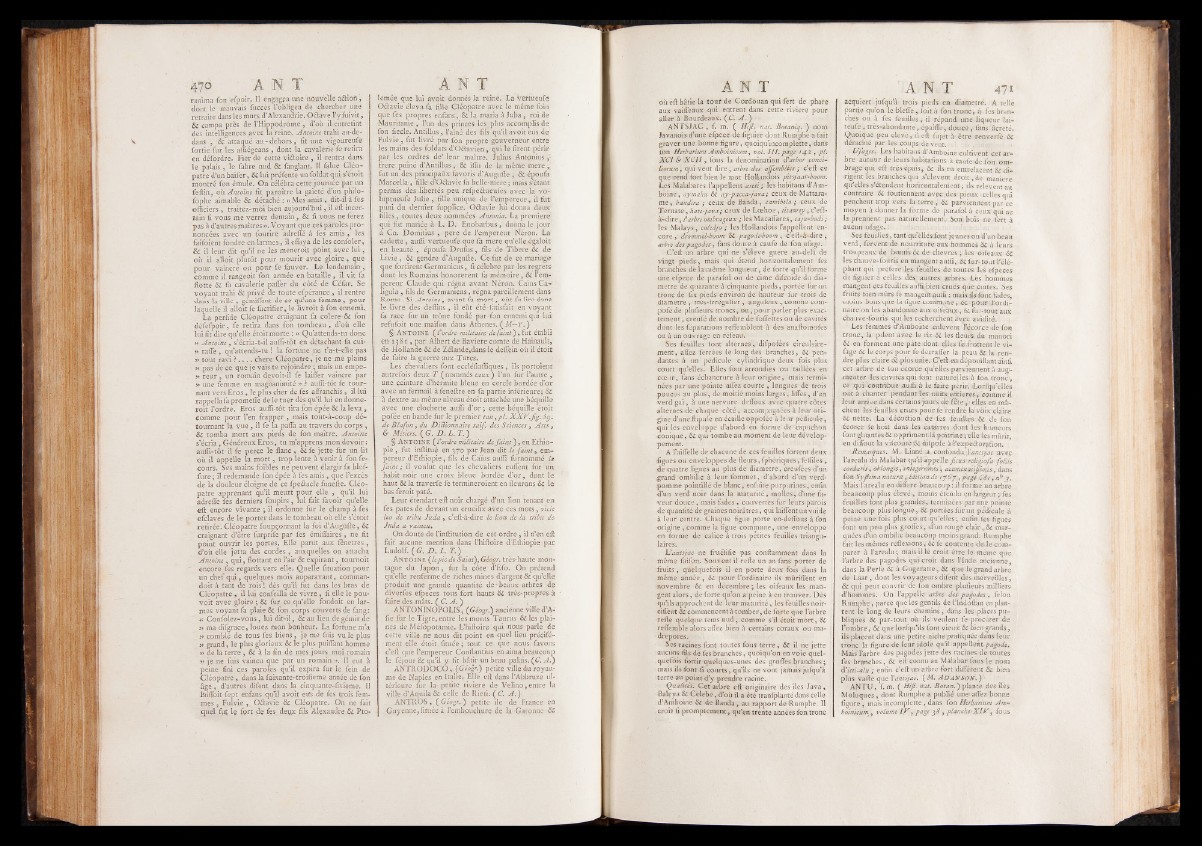
t-anima fon eljpoir,. Il engage aune ' nouvelle a.&toh,
dont le mauvais fuccès l’obligea de chercher une
retraite dans les murs, d’Alexandrie. O&ave l’yfuivit,
& campa près de l’Hippodrdme , d’où i l entretint
des intelligences avec la reine, Antoine trahi au-de-
dans , & attaqué au- dehors,■ fit une vigoureufe
fortie fur les affiégeans , dont la cavalerie fe retira
en défordre. Fier de cette vi&oire , il rentra dans
le palais , le fabre nud & fanglant. Ilfalue Cléo-
pâtre d’un baifer, & lui préfente un foldat qui s’étoit
montré fon émule. On célébra cette journée par un
feftin, où Antoine fit paroître la gaieté d’un philo-
fophe aimable &: détaché : « Mes amis , dit-il à fes ;
officiers , traitez-moi bien aujourd’hui, il eft incertain
fi vous me verrez demain, & ,fi vous ne ferez
pas à d’autres maîtres ». Voyant que ces paroles prononcées
avec un fourire adreffé à fes amis , les
faifoient fondre en larmes, il effaya de les confoler,
& il leur dit qu’il ne les meneroit point avec lu i,.
oii .il alloit plutôt pour mourir avec gloire, que
pour vaincre ou pour fe fauver. Le lendemain,
comme il rangeoit fon armée en bataille , il vit fa
flotte & fa cavalerie paffer du côté de Céfar. Se
voyant trahi & privé de toute efpérance , il rentre
dans la ville , gémiflant de ce qu’une femme, pour
laquelle il alloit fe facrifier, le livroit à fon ennemi.
La perfide Cléopâtre craignant fa colere ■ & fon
défefpoir, fe retira dans fon tombeau, d’où elle
lui fit dire qu’elle étoit morte. : « Qu’attends-tu donc
» Antoine, s’écria-t-il aufli-tôt en détachant fa cui-
» rafle, qu’attends-tu! la fortune ne t’a-t-elle pas
» tout ravi ? . . . » chere Cléopâtre, je ne me plains
» pas de ce que je vais te rejoindre ; mais un empe-
» reur , un romain devoit-il fe laiffer vaincre , par
» une femme en magnanimité » ? auffi-tôt fe tournant
vers Eros, le plus cher de fes affranchis, il.lui
rappella fa promeffe de le tuer dès qu’il lui endonne-
roit l’ordre. Eros auffi-tôt tira fon épée & la leva ,
comme pour l’en frapper , mais tout-à-coup détournant
la vu e , il fe la paffa au travers du corps ,
& tomba mort aux pieds de fon maître. Antoine
s’écria, Généreux Eros-, tu m’apprens mon devoir :
auffi-tôr il fe perce le flanc , & f e jette fur un lit
où il appelle la. mort, trop lente, à venir à fon fe-
cours. Ses mains foibles. ne peuvent élargir fa blef-
fure ; il redemande fon épée à fes amis, que l’excès
de la douleur éloigne de ce fpeâacle funefte. Cléopâtre
apprenant qu’il meurt pour elle , qu’il lui
adreffe fes derniers foupirs, lui fait favoir qu’elle
eft encore vivante ; il ordonne fur le champ à fes
efclavés de le porter dans le tombeau où elle s’étoit
retirée. Cléopâtre foupçonnant la foi d’Augùfte, &
craignant d’être furprife paf fes émiffaires, ne fit
point ouvrir les portes. Elle parut aux fênetres ;
d’où, elle jetta des cordes , auxquelles on attacha
Antoine , qui, flottant en l’air & expirant, tqurnoit
" encore fes regards vers elle. Quelle fituation pour,
un chef qui , quelques mois auparavant, commando!
t à tant de rois ! dès qu’il fut dans les bras de
Cléopâtre , il lui confeilla de vivre , fi elle le pouvoir,
avec gloire ; & fur ce qu’elle fondoit en larmes
voyant fa plaie & fon corps couverts de fang:
« Confolez-vous, lui dit-il, & au lieu de gémir de
» ma difgraCe, louez mon bonheur. La fortune m’a
» comblé de tous fes biens, je me fuis vu le plus
» grand, le plus glorieux & le plus puiffant homme
» de la terre, & à la fin de mes jours moi romain
» je ne fuis vaincu que par un romain, ». Il eut à
peine fini ces paroles qu’il expira fur le fein de
Cléopâtre , dans la foixante-troifieme année de fon
â g e , d’autres difent dans la cinquante-fixieme. Il
lhiffoit fept enfans qu’il avoit eifs.de fes trois femmes
, Fui vie ,. Octavie & , Cléopâtre. On ne fait
quel fut le fort de fes deux fils Alexandre, ôt Ptolemée
que lui avoit donnés la reiné. La vertueufo
Oftavie éleva-fa fille Cléopâtre avec le même foin
que fes propres enfans, & la maria à Juba , roi de
Mauritanie, l’un des princes les plus accomplis de
fon fiecle. Antillus f l’aîné des fils qu’il avoit eus de
Fulvie, fut livré par fon propre gouverneur entre
les mains des foldats d’Ottavien, qui le firent périr
par les ordres de' leur xmaître. Julius Antonius
frere puîné d’Antillus, & iflu de la même mere,
fut un des principaux favoris d’Augufte , & époufa
Marcelle, fille d’Oftavie fa belle-mere ; mais s’étant
permis des libertés peu refpé&ueufes avec'la'vo-,
luptueùfe Julie, fille unique de l’empereur, il fut
puni du dernier fupplice. Oftavie lui donna deux
filles, toutes'- deux nommées Antonia. La première
qui fut mariée à L. D. Enobarbùs , donna lé.qour
à Cn. Domitius , pere de l’empereur Néron. La
cadette, auffi vertueufe que fa mere qu’elle égaloit
en! beauté , époufa Drufus, fils de Tibère & de
Livie , & . gendre d’Augufte. Ce fu;t de ce mariage
quë fortirent Germanicus, fi célébré par les regrets
dont les Romains Honorèrent fa mémoire, & l’empereur
Claude, qui régna avant Néron. Çaïus 'Ca-
ligula , fils de Germanieus, régna pareillement dans
Rome. Sx Antoine , avant fa mort , eût fu lire dans
le livre des deftins, il eût été fatisfait en voyant
fa race fur un trône fondé par-fon ennemi qui lui
refufoit une maifon dans Athènes. ( M—y . )
§ A n t o in e ordre, militaire de faint ) , fut établi
en 13,81, par Albert de Bavière comte de Hainaùlt,
de Hollande & de Zélande,dans le deffein où il étoit
de faire la guerre aux Turcs.
Les chevaliers font eccléfiaftiques, ' ils p o r t o i e n t
autrefois deux T ( nommés taux') l’un fur l’autre .,
une ceinture d’hermite bleue en cercle bordée d’or
avec un fermail àfeneftre en fa partie inférieure; &
~a dextre au même niveau étoit attachée une béquille
avec une clochette auffi d’o r ; cette béquille étoit
pofée en bande fur le premier tau ; pi. XXV.fig. ip .
de Blafon, du Dictionnaire raif. des Sciences , Arts ,
& Métiers. ( G. D . L. T. )
§ A n t o in e ( L'ordre militaire de faint ) , en Ethiopie
, fut inftitué en 3 70 par Jean dit le faint, empereur
d’Ethiopie, fils de Caïus auffi furnommé l»
faint; il voulut que les chevaliers euffent fur un
habit noir une croix bleue bordée d’o r , d o n t le
haut & la traverfe fe termineroient en fleurons & le
bas feroit pâté.
Leur étendart eft noir chargé d’un lion tenant en
fes pâtes de devant un crucifix avec ces mots, vicie
leo de tribu Juda, c’eft-à-dire le lion de la tribu de
Jucla a vaincu.
On doute de l’inftitution de cet ordre, il ri’en eft
fait aucune mention dans l’hiftoire d’Ethiopie par
Ludolf. (G . D . L. T .)
A n t o i n e (lepic de Saint),Géogr. très-haute montagne
du Japon, fur la côte d’Efo. On prétend
qu’elle renferme de riches mines d’argent & qu’elle
produit une grande quantité de * beaux arbres :de
diverfes efpeces tous fort hauts & très-propres à
faire des mâts. ( C. A . )
ANTONINOPOLIS, (Géogr.) ancienne ville d’A-;
fie fur le Tigre, entre les monts Taurus & les plaines
de Méfopotamie. L’hiftoire qui nous parle dé
cette ville ne nous dit point en quel lieu précifé-
ment elle étoit fituée ; tout ce q u e nous, favons
• c’eft que, l’empereur Conftantius en aima beaucoup
le féjour& qu’il y fit bâtir unbeau palais.(C .A .)
ANTRODOCO, (Géogr.) petite ville du royaume
de Naples en Italie. Elle eft dans î’Abbruze ultérieure
fu r la petite rivière de Velino,entre la
vill’e d’Aquila & celle de Rieti. ( C. A .)
ÀNTROS, (Géogr.) petite île de France en
Guyenne, fituée à l’embouchure de la Garonne &
ôù eft bâtie là tour de Cordouan qui fert de phare
aux vaiflteaux qui entrent dans cette riviere pour
aller à Bourdieaux. (C. A . ) •. ,
ANTSJAC , f. m. ( Hifi. 'nat. Botaniq. ) nom
Javanois tfimeèfpecede figuier dont Rumphe a fait
graver une bonne figure, .quoiquincomplette, dans
■ fon Herbarium Ämboinioum, vol. III. page 14 2 , pi.
X C l & X C I l ,. fous la dénomination d’arbor çonoi-
iioru/n, qui veut dire ; arbre des affemblées ; c’eft ce
que :r.ehd fort bien le mot Holla®dois pitsjaar-boom.
Les Malatbares rappellent .ami ; les habitans d’Am-
boine , àymahu & ay-pacca-java; ceux de Mattara-
me, b an f ira ; ceux de Banda, camibtlo- ; ceux -de
Ternatei,hate-java; ceux de Loehoe, titawey , c’eft-
à-dirë', P arbre ombrageux ;;les Macaflares, caju~bodi;
les Malays:, càledjo ; les Hollandois l’appellent encore
, drommel-'boom & pag&dcdoom, c elb-à-dire ,
arbre des pagodes, fans doute à caufe de fon ufage: •
C’eft un arbre qui ne s’élève guere au-delà de
vingt pieds, mais qui étend horizontalement fes
branches de la même longueu r , de forte qu’il forme
une efpëCe de parafai ou de cime difeoïde du diamètre
de quarante à cinquante-pieds, portée fur un
tronc de : fix pieds ienviron de -hauteur lur trois de
diamètre ,itrès-irrégulier, 'anguleux, comme com-
pofé de plufieurs -troncs, ou , pour parler plus exactement
, creufé de nombre de follettes ou de cavités
dont les féparations reffemblent à des anaftoiaofes
ou à un ouvrage en réfeauv
'Ses.feuilles font alternes, difpofées circulaire-
jnent, affez ferrées le long des branches, & pendantes
à un pédicule cylindrique deux fois plus
court qu?elles. Elles font arrondies ou taillées en
coeur, fans-échancrure à leur origine, mais terminées
par une pointe affez courte , longues de trois
poncés, au plus, de-moitié moins larges, lilTes, d’un
verd gai, à une nervure deflotis avec quatre cotes
alternes de chaque côté, accom|>agnéêS.'à leur'origine
d’une ftipule en écailile oppofée à leur pédicule,
qui les enveloppe d’abord en forme de capuchon
conique, :& qui 'tombe au moment de leur développement.
A l’aiffelle de chacune de ces feuilles fortent deux
figues ou enveloppes de fleurs, fphériquèS', fe (files ,
de quatre lignes au plus de diamètre, oreùfées d’uh
grand ombilic à leurfommet, d’abord d ’un verd-
pomme pointillé de blanc, enfuite purpurines, enfin
d’un verd noir dans la maturité, molles; d’une faveur
douce, mais fades , couvertes fur leurs parois
de quantité de graines noirâtres, qui laifferit un vilide
à leur centre. Chaque figue porte en-defibus à fon
origine, comme la figue commune, une enveloppe
en forme de calice a trois petites feuilles triangulaires.
Vantsjac ne fructifie pas confiamment dans la
même faifoii. Souvent il refte un an fans porter de
fruits , quelquefois il en porte deux fois dans la
même année , & pour l’ordinaire ils mûriffent en
novembre & en décembre ; les oifeaux les mangent
alors, de forte qu’on a peine à en trouver. Dès
qu’ils approchent de leur maturité, les feuilles noir-
eiflent & commencent à tomber, de forte que l’arbre
refte quelque tems nud, comme s’il étoit mort, &
reflèmble alors affez bien à certains coraux ou ma-
- drepores.
Ses racines font toutes fous terre, & il ne jette
aucuns fils de fes branches, quoiqu’on en voie quelquefois
fortir quelques-unes des greffes branches;
mais ils font fi courts , qu’ils ne vont jamais jtifqu’à
terre au point d’y prendre racine.
Quatkés. ^ Cet arbre eft originaire dés îles Ja va ,
Baleya & Celebe, d’où il a été tranfplanté dans celle
d’Amboine de Banda, au rapport de Rumphe. Il
croît fi promptement, qufen trente années fon tronc
acquiert ’ jufqu’à: trois pieds en diatpetrë. A telle
partie qu’on le bleffe, (oit.à fon tronc, â fes br^n-
■ chés ou à fes feuilles, il répand'.une liqueuriai-
teufe , très-abondante » épaiffe1, douce, fans âcrêté.
Quoique peu élevé ,..il eft fujet à' être renverfé 6i
déraciné par les .coups de vent. .-L
Ufages'y Les habitans d ’Amboine cultivent cet arbre
autour de leurs habitations à caufeide fon ombrage1
qui eft . très-épais, Ôc ils.en entrelacent & dirigent
lès branchés qui s’élèvent droit, de maniéré
qu’elles s’étendent horizontalement.; ils relèvent au
contraire & foutiennent avpc (des pieux -celles qui
penchent, trop vers lai terre.; & parviennent par ce
moyen à donner la forme de parafol à ceux qui np
la prennent; pas: naturellement. Son- boïs ne fert à
aucun ufage. :
Ses feuilles, tant qu’è llésiqnt je unes o u id’un beau
verd, fervent.de nourriture-aux hommes & à leurs
troupeaux de boeufs de. ehevres les oifeaux: 6c
les ehauve-fouris en.mangent auffi, .& for-tout l’éléphant
qui préféré les feuilles de toutes les efpeces
de figuier à celles desNaiitrès arbres. Lés hommes
man.ge.nt ces feuilles auffi biert crués quefointes. bes
fruits bien mûrs fe mangertt-auffi : mais flsfont fades,
moins bons qiie la figue^communè,. ôC.pôur.'I’ordi-
naire o'n les abandonne'aux oifeàùx.,.& fuinout aux
ehauve-fouris qui les recherchent avvevc avidité, q
Les femmes d’Ambojne Enlèvent Fécorce de fon
tronc, la pilent avec le utzeôc les fleurs , du manori
& en forment -une^pàte.dont elles .feifcoûtent le vi~
fage & le corps pour fe décraffer la peau & la rendre
plus claire 6c.plus unie;: G’eftvend'épm'tillant ainfi
cet arbre- de fon écorpe .qu’elles.parviennent,à augw
•menter des .cavités qui font naturellesià fon- tronc1,
ce qulicontribue nuffi.à le;faire périri'iLorfqut’elles
ont à chanter pendant dés1 niiics entières-; - comme il
leur arrive dans certains j*aur's. dé fête ,'; elles en mâchent
les-feuilles cEiies;.p:ouc fe'rendkéla’vôix'clâire
6c nette. La décoâioni dei fes feuilles ’ de 400
iécocee fe bok dans.tes ëaearres dafït les.'fiumeups
fontgUiantès & op.primentilâ.pôitrine^*ellelesmûrii,
•en diffoutla vilcôfitésSc dïtpofe à l’expeiftor^fion-.
■ Reiftaùfues. M. Linné ;a.. confondu.fmtcfâc avep
l’a real u dû Malabar qu’il 'appelle ficus* relijti&fa ■ foliis
cordafis , ôblongis, in€eg&Ynèhiis\ acumuiatïjjimis, dans
fon Syfiema naturesédhio'n ds 1 y-Sy\, ‘p'agb .(fSm y «P J.
Mais l-'arealu en différé, b eauco up. : i l forme u n arbre
beaucoup plus élevé-,, moins étendu' en ‘large ur ;' fes
feuilles font plus grandes.; terminées' par w e pointé
beaucoup plus longue, & .portées fiir un pédicule -à
peine Une fois plus -court.qu’elles ; enfin fes figuqs
font un peu plus groflps, d’un raiigé clfir:,,8é marquées
d’un ombilic beaucoup moins-grand; Rumphe
fait les mêmes réflexions, & fe contente dede comparer
à l’arealu; mais il le croit être; leimëm-e qtte
l’arbre des pagodes qui croît dans l’tnd© ancienne,
dans la Perfe & à Gugeratte, & que le grand arbre
de Laar, dont les voyageurs difertt .dès-merveilles;
& qui peut couvrir de fon ombre, plufieurs-milliers
d’hommes. On l’appelle arbre des pagodes, félon
Rumphe, parce que les gentils de l’Indoftan en plantent
le long de leurs chemins, dàns^lës?places pu-
bliques & par-tout ©ù ils-1 iVeulent fe procurer -de
l’ombre, & que lorfqu’ils font vieux & bien grands,
ils placent dans une petite niche pratiquée-dans leur
tronc la figure de leur idole qu’il -appellent.pagode.
Mais Farbre des pagodes jette dès racines de toutes
fes branches, & eftcohnu au Malabarifôus le1 nom
d"uti-alu ; enfin e’eft un arbre -fort différent & bien
plus va fie que Ydhtsjac. (M . A d AN s o n . )
ANTH, f. m. ( Hiß. nat. Botan.) plante-;des îles
Moluques, dont Rumphe a publié une-1 âfièz'bonne
figure , mais incomplette, dans fon Herbarium Am*
hoînicum, volume- I f , page ^8-', planche-XIV, fous