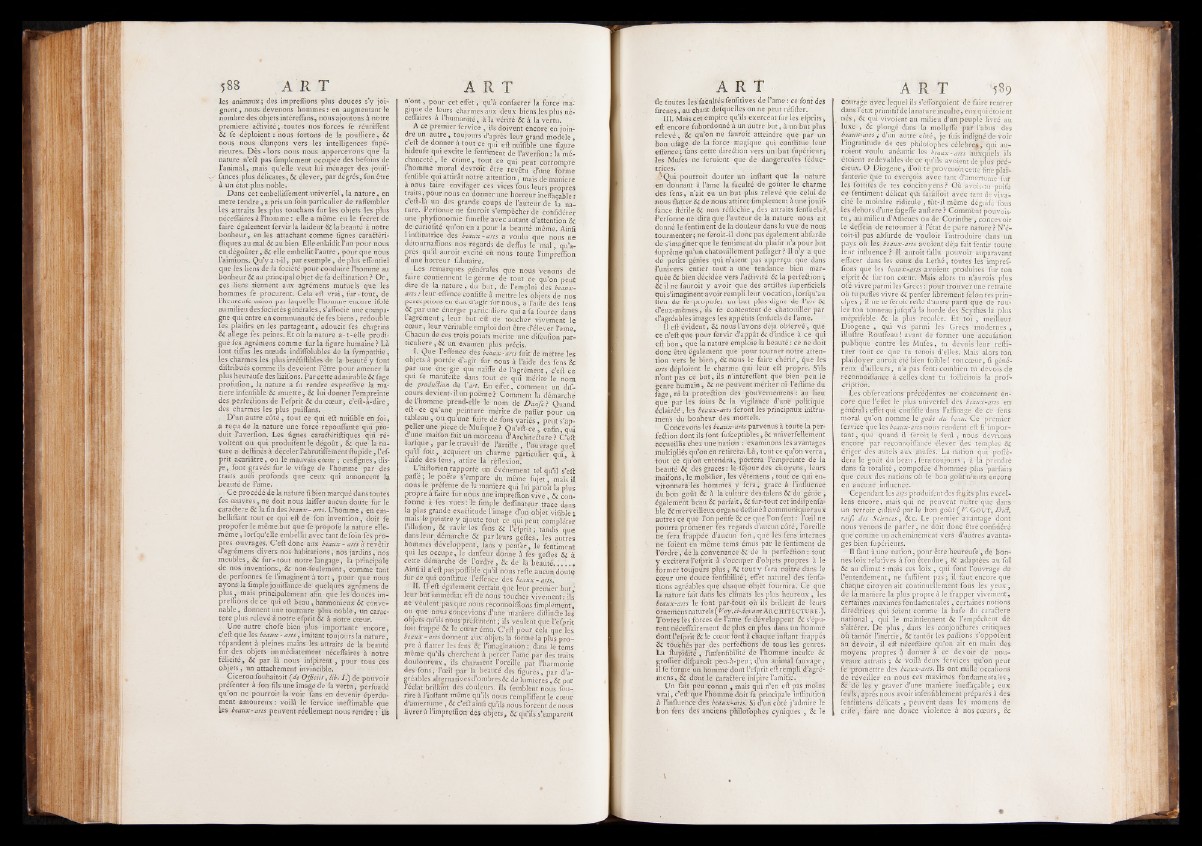
les animaux; des impreffions plus douces s’y joignent
, nous devenons hommes : en augmentant le
nombre des objets intéreffans, nous ajoutons à notre
première activité ; toutes nos forces fe réunifient
& fe déploient : nous fortons de la pôufliere, &
nous nous élançons vers les intelligences lupé-
rieures. Dès - lors nous nous appercevons que la
nature n’eft pas Amplement occupée des befoins de
l’animal., mais qu’elle veut lui ménager des jouif-
fances plus délicates, & élever, par dégrés, fon être
à un état plus noble *
Dans cet embelliffement univerfel, la nature, en
mere tendre , a pris un foin particulier de raffembler
les attraits les plus touchans fur les objets les plus
néceflaires à l’homme : elle a même eu le fecret de
faire également fervir la laideur & la beauté à notre
bonheur, en les attachant comme lignes cara&éri-
ftiques au mal & au bien Elle enlaidit l’un pour nous
en dégoûter, & elle embellit l’autre, pour que nous
l’aimions. Qu’y a-t-il, par exemple, de plus effentiel
que les liens de là foeiété pour conduire l’homme au
bonheur & au principal objet de fa deflination ? O r ,
ces liens tiennent aux agrémens mutuels que les
hommes fe procurent. Cela eft vrai, fur - tout , de
l’heureufe union par laquelle l’homme encore ifolé
au milieu desfociétés générales, s’aflbcie une compagne
qui entre en communauté de fes biens, redouble
les plaifirs en les partageant, adoucit fes chagrins
& allégé fes peines. Et oit la nature a-t-elle prodigué
fes -agrémens comme fur la figure humaine ? Là
font tifliis les noeuds indiflblubles de la fympathie,
les charmes les plus irréfiftibles de la beaute y font
diftribués comme ils dévoient l’être pour amener la
plus heureufe des liaifons. Par cette admirable & fage
profufion, la nature a fu rendre expreflive la matière
infenfible & muette, & lui donner l’empreinte
des perfections de l’efprit & du coeur, c’eft-à-dire,
des charmes les plus puiflans.
D ’un autre cô té, tout ce qui eft nuifible en foi,
,a reçu de la nature une force rèpouflante •qui'produit
l’averfion. Les fignes caraftériftiques qui révoltent
ou qui produifent le dégoût, & que la nature
a deftinés à déceler l’abrutiffement ftupide, l’efprit
acariâtre, ou le mauvais coeur ; ces fignes-, dis-
je , font .gravés fur le vifage dé l’homme par des
traits auffi profonds que ceux qui annoncent la
beauté de l’ame.
- Ce procédé de la nature fi bien marqué dans toutes
fes oeuyresne doit nous laiffer aucun doute fur le
cara&ere & la fin des beaux- arts. L’homme, en em-
belliflànt tout ce qui eft de fôn invention , doit fe
propofer le même but que fe propofe la nature elle-
même , lorfqu’elle embellit avec tant defoin fes propres
ouvrages. C’eft donc aux beaux - arts à revêtir
d’agrémens divérs nos habitations , nos jardins ,'nos
meubles, & fur-tout notre langage, la principale
de nos inventions, & non-fèulement, comme tant
de perfonnes fe l’imaginent à tort, pour que nous
ayons.la fimple jouiffance de quelques agremehs de
plus, mais principalement afin - que les douces im-
preflidns de ce qui eft beau, harmonieux & convenable,
donnent une tournure plus noble , un caractère
plus relevé à notre efprit & à notre cüeur.
. Une autre chofe bien plus-importante encore,
c’eft que les beaux - arts ^ imitant toujours la nature,
répandent à pleines mains les attraits de la beauté
fur des objets immédiatement néceflaires à notre
félicité, & par là nous infpirent , pour tous ces
objets, un attachement invincible.
Cicéron fouhaitoit (de Ojjiciis, lib. ƒ.) de pouvoir
préfenter à fon fils une image de la vertu , perfuâdé
qu’on ne pourroit la voir fans en devenir éperdument
amoureux : voilà le fervice ineftimable que
les beaux-arts peuvent réellement nous rendre : Us
tfont, pour cet effet, qu’à confacrer la force ma-'
gique de leurs charmes aux deux biens les plus né-
ceffaires à 1 humanité, à la vérité & à la vertu.
A ce premier fervice , ils doivent encore en joi'n-
» aUj af tre ’ touîoui‘s d’après leur grand modèle,
5. j ,.e donner à tout ce qui eft nurfible une figure
hideufe qui excite le fentiment de l’averfion : la méchanceté
, le crime, tout te qui peut corrompre
Ihomme moral devro’it être revêtu d’une forme
fenfible qui attirât notre attention , mais de manière
à nous faire envifager ces vices fous leurs propres
traits, pour nous en donner une horreur ineffaçable :
c’eft-là un des grands coups de l’auteur de la nature.
Perfonne ne fauroit s’empêcher de confidérer
une phyfionomie funefte avec autant d’attention Si
de curiofité qu’on en a pour la beauté même. Ainfi
Tinftitutrice des beaux- ans a voulu que nous ne
détournaflîons nos regards de deffusle mal , qu’apurés
qu’il auroit excité eh nous toute l’impreflion
d’une horreur falutaire.
Les remarques generales que nous Venons de
faire contiennent le germe de tout Ce qu’on peut
dire de la nature, du but, de l’emploi des beaux-
arts: leur effence confifte à mettre les objets de nos
perceptions en état d’agir fur nous, à l’aide des fens
& par une énergie particulière qui a fa foûrce dans
1 agrément ; leur but eft de tbucher vivement le
Coeur, leur véritable emploi doit être d’élever l’aine®
Chacun de ces trois points mérite une difcufion particulière
, Si un examen plus précis.
I. Que 1 effence des beaux-arts foit de mettre les
objets à portée d’agir fur nous à l’aide des fens &
par une énergie qui naiffe de l’agrément, c’eft ce
qui fe manifefte dans tout ce qui mérite le nom
de production de Vart. En effet, comment un dif-
cours devient-il un poème? Comment la démarche
de l’homme prend-elle le nom dé Danfe) Quand
eft-ce qu une peinture mérite de palier pour un
tableau , où qu’une fuite de fons variés , peut s’ap-
peller une piece de Mufique ? Qu’eft-ce, enfin, qui
d’une maifon fait un morceau d’Archite&ure ? C’eft
lorfque , par le travail de l’ârtifté , l’ouvrage quel
qu’il foit, acquiert un charme particulier qui, à
l’aide des fens, attire la :réflexion.
L’hiftorien rapporte un événement tel qu’il s’eft
paflé ; le poete s’empâte du même fujet, mais il
nous le préfente de 'là-manière qui lui pâfoît la plus
propre a faire fur nous Une impreflion v iv e , Si conforme
à fes vues : le fimple deffmâteVir tface dans
la plus grande exariitude l’imagé d’un objet vifible ;
mais'le peintre y ajoute tout ce qui peut Compléter
l’illufion, Si ravir les fèrts Si fefprit ; 'tandis que
dans leur, démarche & pa'r leurs gèftés, les autres
hommes développent, fans y pênfêf, le fentiment
qui les occupe, le danfeur donne à fès-geftes 8i à
cette démarche de l’ordïé , & de là bèiiité. . . „
Airtfi il n’eft pas pôfliblè qu’il' nous refte auCun dcmtq
fur ce qu.i conftitue l’effence des beaux - arts.
II. Il eft également'certarn^ae leur premier but;
leur büt immédiat eft dè' no US tOiichér viyêmënt : ils
ne veulent pasque nous rèconnoifljohs Amplement,
ou. què nOus Concevions d’une maniéré diftirtfte les
Objets qu’ils n’ôus'jiréftntént ; ils veulent que l’efprit
fôit frappé & fe ctèlir ému. C’eft pour cela que les
beaux-arts donnérit alix objets la forme la plus propre
à flatter les fens & l’iiriagiriàtiori * clans lè teins
même qu’ils cherchent à percer famé par dés traits,
douloureux, ils Charment l’oréiHé .pat l’harmonie
dès fons, l’oeil par la beauté dés figures, par d’agréables
alternatives d’ombres & de lumières , Si par
réclà't brillant des couleurs. Ils femblènt nous fou-
rire à l’inftant même qu’ils nous rempliffent le coeur
d’amertume, & c’eft ainfi qu’ils nous forcent de nous
livrer à l’impreflion des objets, Si qu’ils s’emparent
de foiites les facultés fenfitives de l’ame : ce font des
firenes, au chant defqüelles on ne peut réfifter.
III. Mais cet empire qu’ils exercent fur les efprits *
eft encore fubordonné à un autre but , à un but plus
relev é, & qu’on ne fauroit atteindre que par un
bon ufage de la force magique qui conftitue leur
effence; fans cette dire&ion vers un but ftipérieur;
les Mufes ne feroient que de dangeretffës féditc-
triceSé
{?Qui pourroit douter un inftant que la nature
en donnant à l’âme la faculté de goûter le charme
des fens, n’ait eu un but plus relevé que celui dé
ïious flatter & de nous attiféfimplément à une jouif-
fance ftérile &c non réfléchie, des attraits.fenfuels?,
Perfonne ne dira que l’auteuf de la nature nous ait
donné le fentiment dé la douleur dans la vue de nous
tourmenter ; ne ferôit-il donc pas également abfurde
de s’imaginer que le fentiment du plâifif n’a pour but
fuprêmé qu’un chatouillement paffager ? Il rt’y a que
de petits génies qui n’aient pas apperçu que dans
l’univers entier tout à une tendance bien marquée
& bien décidée Vers l’ââivifé & la perfection ;
éc il ne fauroit y avoir que des artiftes fuperficiels
qui s’imaginent avoir rempli leur vocation ,lorfqu’au
lieu de le propofer un but plus digne de Y art &
d’eux-mêmés, ils fe contentent de chatouiller par
d’agréables images' les appétits fenfuels de l’ame.
Il eft évident, nous l ’avons déjà ôbfervé, que
ce n’eft que pour fêrvir d’appât & d’indicé à cé qui
eft bon , que la nature emploie la beauté : ce rie doit
donc être également que pour tourner notre attention
vers le bien, & nous le faire chérir, que les
arts déploient le charme qui leur eft propre. S’ils
h’ont pas ce but , ils n’intéreffent que bien peu le
genre humain, & ne peuvent mériter ni l’ëftime du
fage, ni la prote&ion des gbuvernemens : au lieu
que par les foins & la yi^lânce d’une politique
ëclâiréë, les béaux-afts feront les principaux inftru-
irieris du bonheur dès môrtéls.
■ . Concevons les beaux-àrts parvenus à toute la per-
feÇlion dont .ils font fufceptibles, & univèrféUement
accueillis chez une nation : examinons les avantages
multipliés qu’on en rêtir'ëfa-. Là, tout ce qu’on verra,
tOUt. Cè qu’on entendra, portera l’empreinte de la
beauté & dès grâces : lè féjôur des citoyens, leurs
marions,le mobilier, leS Vêtèmens, tout ce qui èn-
vironhetà les hommes y fera, grâce à l’influence
du bon gbïït & à là culture des tâlens & du génie ,
également beau & parfait, & fur-tout cet indifpenfa^
blé Si merveilleux ôrgahe deftirié à communiquer aux
autres c.ë qviè l’on penfè & ce que l’on fent : l’oeil ne
pourra prÔmèner fès regards d’aucun côté, l’oreille
ne fefà frappée d’aucun fon , que les fens internes
he fôiènt en même tems émtis par le feiltiment de
l’ordre, de là çonvénancè & de la perfection: tout
y excitera l’efprit à s’occuper d’objets propres à le
former toujours plus, & tout y fera naître dans le
coeur unè douce fenfibilité;. effet naturel des fettfa-
tions agréables quç chaqu-è Objet fournira. Ce que
la nature fait dans les climats les plus heurèux , les
beaux-arts le font pat-îout oh ils brillent de leurs
ôrnemens naturels (V o y .ti-dey etm A r c h i t e c t u r e .) .
Toutes iès forces de l’âme "fe -développent & s’épurent
néceffairement de plus en plus dans Un homme
dont l’efprit & le coeur font à Chaque inftant frappés
& touchés par des peffeCtiOÀs dé tous les genres.
La ftup'idité , l’infenfibîllté dé l’homme inculte &
groflier difparoît pèu-à-peu ; d’un aiiiniâl fauvâge,
il fe forme un homme dont l’efprlt eft rempli d’agrémens
, & dont le Caractère infpite l’amitié.
Un fait peu connu , mais qui n’en eft pas moins
vrai, c’eft que l’homme doit fa principale itiftitutiori
à l’influehee des bedux'-arts. Si a’.uri côté j’admire le
bon fens des anciens philofophès Cyniques , & le
Courage avec lequel ils s’efforçoient de faire rentrer
dans l’état primitif de la na turé inculte, eux qui étoient
nés, & qui vivoient au milieu d’un peuple livré au
luxe , & plongé dans la molleffe par l’abus des
beaux-arts ; d’un autre côté, je fuis indigné de voir
•l’ingratitude de ces philofophès célébrés., qui au-
roient voulu anéantir les beaux-arts auxquels; ils
étoient redevables de ce qu’ils avoient de plus précieux.
O Diogene, d’où te provenoit cette fine plai-
fantèrie que tu exerçois avec tant d’amertume fut
les fottifés de tes cönèitóyéns ? Où avOis-fu puifé
ce fentiment délicat qûi faififfoit avec tant de vivacité
le moindre ridicule , fût-il même déguifé fous
les dehors d’une fageffe auftére ? Comment pou vois-
tu, au milieu d’Atheries ou de Corinthe , concevoir
le deflein de retourner à- l’état de pufe nature ? N’é-
toit-il pas abfurde de vouloir l’intrôduire dans un
pays ôh leS; beaux-arts avoient déjà fait fentir toute
leur influence? Il auroit fallu pouvoir auparavant
effacer dans les eaux du Lethé, toutes lés impreC-
fions que les beaux-arts avoient produites fur ton
èforit & fur ton coeur. Mais alors tu n’àurois plus
olé vivre parmi les Grecs : pour trouver une retraite
où fu puffes vivre & penfer librement félon tes principes
il ne te feroit refté d’autre parti que de rouler
ton tonneau jufqù’à là horde des Scythes la plus
méprifable & la plus reculée. Et toi , meilleur
Diogene , qui vis parmi lés Grecs modernes ,
illuftre Rouffeau ! avant de former une àeeufation
publiqiiè contre -lés Mufès, tu devois leur refti-
ttier t'Out ce que tu teriois d’elles. Mais alors ton
plaidoyer atiroit été bien foible ! tón coeur, fi généreux
d’ailleurs, n’a pas feriti combien tu deVôis dè
reçonhôiflànçe à cèlles dont tu follicitôis la prof-
Oriptiori.
Les obfervations précédentes ne concernent encore
que l’effet le plus univerfel des beaux-arts en
gérféràl ; effet qui confifte'dans l’affinage d'é ce fens
moral qu’on nomme le goût du beau: Gé premier
fervice que les beaux-arts nous rendent eft fi important,
qiië quand il fèrô’it le feul , nous devrions
encore par reconnoiffâhce élever des temples &
ériger dès autels aux mufes.. La nation qui poffé-
derà le gô.ût du beau ,fera toujours , à la prendre
dans fa totalité, cômpofée d’hommes plus parfaits
que ceux des nations oh le bón gôûfn’aura encore
eu aucune influence.
Cependant les arts produifent des fruits plus excelle
ns encore, mais qui ne, peUverit naître que dans •
un terroir cultivé parle bon goût (. V. G o û t , D ic î.
raif. des Sciences, &c. Le premièr àvântage dont
nous venons de parler, né doit'donc être confidéré
que comme un acheminement vers d’àutres avarita-
ges bien fiipérietirs.
Il faut à.uhe natiori, pour être heüréufe, de bonnes
lôix relatives à fori étendue , & adaptées au fol
& au climat : mais cés lô ix, qui font l’Ouvrage dé
l’ènfendement, ne fuffifent pas ; il faut encore que
chaque citoyen ait continuellement fous les yeux,
de Ja.maniere.la plus propre à le frapper vivement,
certaines maximes fondamentales , certaines notions
dirêébfices qui foient comme là bafe dit caraftere
ftâtionâl , qui le maintiennent & l’empêchent de
s’altérer. De plus, dans les cOnjOriâurès critiques
où tantôt l’inertie, & tantôt les paflïöhs s’Oppofent
âù devoir, il eft néceffaire qu’on ait en main des
moyens propres à donner à ce devoir dé nouveaux
attraits ; & voilà deux férvices qu’on peut
fe ■ promettre des beaux-arts. Ils ont mille occafions
de réveiller en noiis ces maximes fondamentales,
& 'dë lès y graver d’une maniefe ineffaçable ; eux
feüls, après nous avoir infenfiblémènt préparés à des
fepfiirieiîs délicats , peuvent dans les momens de
crifé, faire une douce violence à nos coeurs, ôc