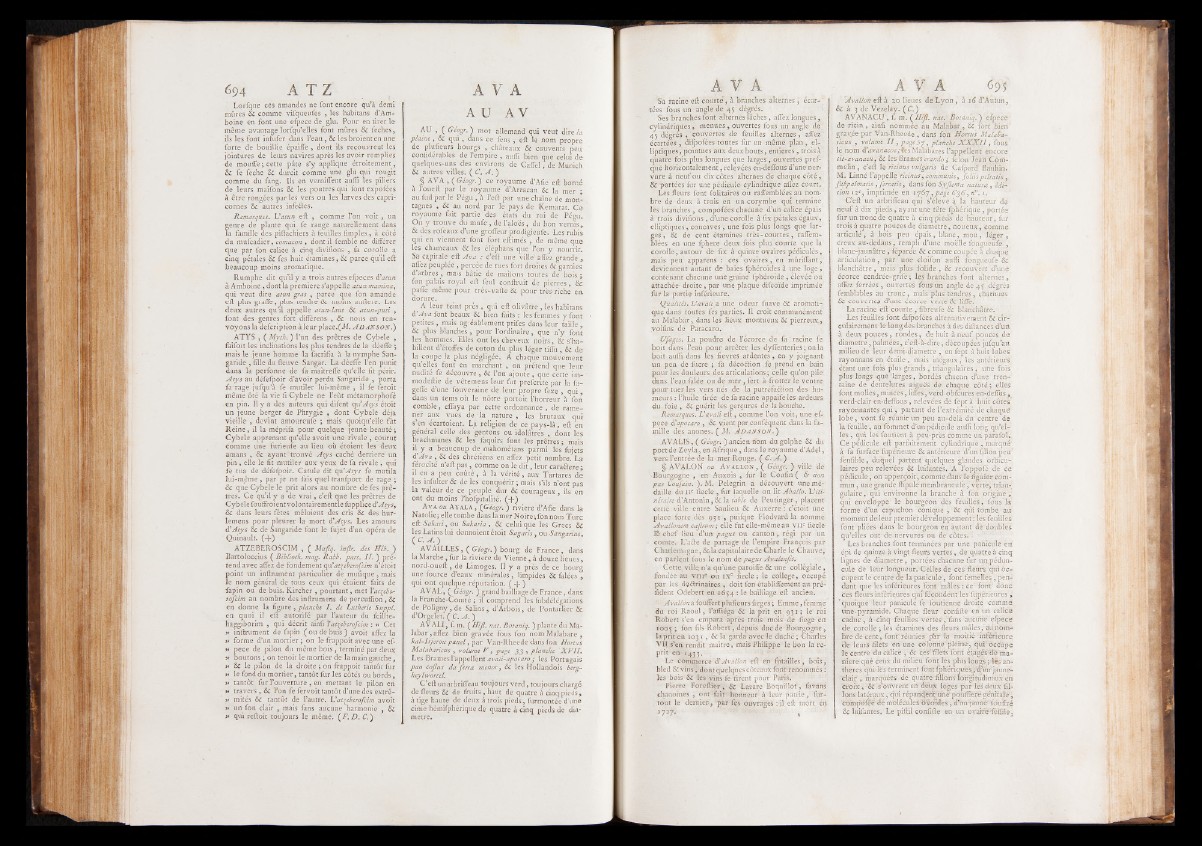
Lorfque ces amandes ne font encore qu’à demi
mûres & comme vifqueufes , les habitans d’Am-
boine en font une efpece de glu. Pour en tirer le
même avantage lorfqu’elles font mûres & feches,
ils les font infufer dans l’eau, & les broient en une
forte de bouillie épaifle , dont ils recouvrent les
jointures de leurs navires après les avoir remplies
de moufle ; cette pâte s’y applique étroitement,
& fe feche & durcit comme une glu qui rougit
comme du fang. Ils en verniffent aufli les piliers
de leurs maifons & les poutres qui font expofées
à être rongées parlés vers ou les larves des capricornes
& autres, infeftes.
Remarqués. Vatun eft , comme'l’on v o it , un
genre de plante qui fe range naturellement dans
la famille des piftachiers à feuilles Amples , à côté
du mufcadier, comacon , dont il femble ne différer
que par fon calice à cinq divifions , fa corolle a
cinq pétales & fes huit étamines, & parce qu'il eft
beaucoup moins aromatique.
Rumphe dit qu’il y a trois autres efpeces à'atun
à Amboine , dont la première s’appelle atun maminay
qui veut dire atun 'gras , parce que fon amande
eft plus graffe, plus tendre & moins auftere. Les
deux autres qu’il appelle atun-laut & atun-puti ,
font des genres fort différens , & nous en renvoyons
la defcription à leur place.(Af. A d a n so n .')
ATYS , ( Mytk. ) l’un des prêtres de Cybele ,
faifoit les inclinations les plus tendres de la déefle ;
mais le jeune homme la facrifïa à la nymphe San-
garide , fille du fleuve Sangar. La déefle l’en punit
dans la perfonne de fa maîtreffe qu’elle fit périr.
Atys au défefpoir d’avoir perdu Sangaride , porta
fa'rage jufqu’à fe mutiler lui-même , il fe feroit
même ôté la vie fi Cybele ne l’eût métamorphofé
en pin. Il y a des auteurs qui difent qu'Atys étoit
un jeune berger de Phrygie , dont Cybele déjà
vieille , devint amoureufe ; mais quoiqu’elle fût
Reine, il la méprifa pour quelque jeune beauté;
Cybele apprenant qu’elle avoit une rivale , courut
comme une furieule au lieu où étoient les deux
amans , & ayant trouvé Atys caché derrière' un
pin , elle le fit mutiler aux yeux de fa rivale , qui
fe tua de défefpoir. Catule dit qu 'Atys fe mutila
lui-même, par je ne fais quel tranfport de rage ;
& que Cybele le prit alors au nombre de fes prêtres.
Ce qu’il y a de v ra i, c’eft que les prêtres de
Cybele fouffroient volontairementle fupplice à*Atys,
& dans leurs fêtes mêloient des cris & des hur-
lemens pour pleurer la mort d’Atys. Les amours
d'Atys & de Sangaride font le fujet d’un opéra de
Quinault. (+ )
ATZEBEROSCIM , ( Mufiq. inftr. des Héb. )
Bartoloccius ( Biblioth. mag. Rabb. part. II. ) prétend
avec aflez de fondement qu’at^eberofcim n’étoit
point un inftrumènt particulier de mufique, mais
le nom général de tous ceux qui étoient faits de
Lapin ou de buis. Kircher , pourtant, met Yat^ebe-
rofcim au nombre des inftrumens de percuflion, &
en donne la figure, planche 1. de Lutherie Suppl.
en quoi il eft aùtorifé par l’auteur du fcillte-
Hâggiborim , qui décrit ainfi Y at\eberofcim : « Cet
» inftrumènt de fapin (ou de buis) avoit aflez la
» forme d’un mortier ; on le frappoit avec une ef-
» pece de pilon du même bois, terminé par deux
» boutons ; on tenoit le mortier de la main gauche,
» & le pilon de là droite ; on frappoit tantôt fur
» le fond du mortier, tantôt fur les côtés ou bords,
» tantôt fur l’ouverture, en mettant le pilon eh
» travers , & Fon fe fervoit tantôt d’une des extrê-
» mités & tantôt de l’autre. Uaiçeberofcirn avoit
» un fon clair , mais fans aucune harmonie , &
» qui reftoit toujours le même. (F . D . C.)
A U A V
AU , ( Géogr. ) mot allemand qui veut dire la
plaine, & q u i, dans ce fens , eft le nom propre
de plufieurs bourgs , châteaux & couvents peu
conliderables de 1 empire , aufli bien que celui de
quelques-uns des environs de Caflel, de Munich
& autres villes. ( C. A. )
§ A VA , {Géogr.) ce royaume d’Afie eft borné
à l’oueft par le royaume d’Arracan & la mer ;
au fud par le Pégu , à l’eft par une chaîne de montagnes
, & au nord par le pays de Kemarat. Ce
royaume fait partie ' des états du roi de Pégu.
On y trouve du mufe , de l’aloës , du bon vernis „
& dès rofeaux d’une groflèur prodigietife. -Les rubis
qui en viennent font fort eftimés , de même que
les chameaux & les éléphans que l’on y nourrit.
Sa capitale eft Ava : c’eft une ville'aflez grande,
aflez peuplée , percée de rues fort droites & garnies
d’arbres, mais bâtife de maifons toutes dé bois ;
fon palais royal eft feul conftruit de pierres, &:
pafîe même pour très-vafte & pour très-riche en
dorure.
A leur teint près , qui eft olivâtre , les habitans
d'Ava font beaux & bien faits : les femmes y font
petites, mais agréablement prifes dans leur taille ,
&: plus blanches, pour l’ordinaire, que n’y font
les hommes. Elles ont les cheveux noirs, & s’habillent
d’étoffes de coton du plus léger tiffu , & de
la coupe la plus négligée. A chaque mouvement
qu’elles font en marchant , on prétend que leur
nudité fe découvre, & l’on ajoute, que cette im-
modeftie de vêtemens leur fut prefcrite par la fa-
geffe d’une fo,uveraine de leur propre fexe , q u i,
dans un tems où le nôtre portoit l’horreur à fon
comble, effaya par cette ordonnance , de ramener
aux vues de,-la nature , les brutaux qui
s’en écartoient. Lp. religion de ce pays-là, eft en
général celle des gentons ou idolâtres , dont les
brachmanes & les faquirs font les prêtres ; mais
il y a beaucoup de mahométans parmi les fujets
d’\Ava , & des chrétiens en aflez petit nombre! La
férocité n’eft pas , comme on le d it , leur caraûere;
il en a peu coûte, à la vérité, aux Tartares de
les infulter & de les conquérir; mais s’ils n’ont pas
la valeur de ce peuple dur & courageux, ils en
ont du moins l’hofpitalité. (+ )
Ava ou A y al a , {Géogr. ) riviere d’Afie dans la
Natolie; elle tombe dans la mer Noire;fon nom Turc
eft Sakari, ou Sakaria , & celui que les Grecs &
les Latins lui donnoient étoit Sagaris, ou Sangarius.
{ c. a . \ ;
A\ AILLES, ( Géogr. ) bourg de France, dans
la Marche, fur la riviere de Vienne, à douze lieues,
nord-oueft, de Limoges. Il y a près de ce bourg
une fource d’eaux minérales , limpides & falées ,
qui ont quelque .réputation. ( + )
AVAL, ( Géogr. ) grand bailliage de France, dans
la Franche-Comté ; il comprend les fnbdélégations
de Pôligny, de Salins, d’Arbois, de Pontarlier &
d’Orgelet. ( C. A . )
AVALI, f. m. ( Hijl. nat. Botaniq. ) plante du Malabar
, aflez bien gravée fous fon nom Malabare ,
kal-lsjerou panel, par Van-Rheede dans fon Hortus
Malabaricus , volume V , page J J , planche 'XVII.
Les Brames l’appellent avali-apacaro ; les Portugais
pao cojius da ferra menor, & les Hollandois berg-
heylwortel.
C’eft un arbrifleau toujours verd, toujours chargé
de fleurs & de fruits, haut de quatre à cinq pieds,
à tige haute de deux à trois pieds, furmontée d’une
cime hémifphérique de quatre à cinq pieds de diamètre.
Sa racine eft courte, à branches alternes, éear-
tées fous un anglede 45' dégrés.
Ses branches font alternes lâches, aflez longues ,,
cylindriques, menues , ouvertes fouS un angle de
45 dégrés , couvertes de feuilles alternés, aflez "
écartées , difpofées toutes fur un même plan , el- ’
li p tiques, pointues aux deux bouts, entières , trois à
quatre fois plus longues que larges', ouvertes pref-
que horizontalement, relevées en-deffous d’une nervure
à rieüf ou dix côtés alternes de chaque côté ,
& portées fur une pédicule' cylindrique aflez court.
Les fleurs font folîtaires ou ràffembléés au nombre
de deux à trois en un corymbe qui termine
lès branches , compùfées chacune d’un Calice épais
à trois divifions , d’une corolle à fix pétales égaux,
elliptiques, concaves, une fois plus longs que larges
, & de cent étamines très - courtes,, raffem-
blées en une fphere deux fois plus courte que la
corolle1'; autour de fix à quinze ovaires pédiculés,
mais peu' apparens : ces ovaires,, en mûriffant,
deviennent autant de baies fphéroïdes à une loge,
contenant chacune une graine fphéroide , élevée ou
attachée- droite, par une plaqué difcoïde imprimée
furda partie inférieure.
Qualités. Uavàli. a .une odeur fuave & aromatique
dans foutes fes parties. Il croît communément
au Malabar, dans les lieux montueux & pierreux,,
voifins de Paracaro.
Ufages-, La poudre de l’écorce,de f a ’ racine fe
boit dans l’eau pour arrêter les dyflenteries ; on la
boit aufli dans les .fieyres ardentes , en y joignant
un peu de .lucre ; fa décoftion fe .prend en bain
pour les douleurs des articulations ; celle qu’on pilé’
dans l’eau falée ou de mer, fert à frotter le ventre
pour tuer les vers nés .de la putréfaftion des humeurs
: l’huile tirée de fa racine appaife les ardeurs
du foie , & güérit les gerçures de la bouche.
Remarques. UavalieQc, comme l’on voit, une ef-,
pece à’apocaro , & vient par conféqueilt dans la famille
des anones. ( M. A d an so n . )
AVALIS, ( Géogr.■ ) ancien nom du golphe & du
port de Zeyla , en Afrique, dans le royaume d’Adel,
vers l’entrée de la mer Rouge. ( C. A .')
§ .AVALON ou A v a l l o n , ( Géogr.') ville de
Bourgogne, en Auxois , fur le Coufin ( & non
pas Coufain. ). M. Pelegrin a découvert une médaille
du 11e fiede , fur laquelle , on lit Aballo. Uiti-
néraired’Antonm, & la table de Peutinger, placent
cette ville entre Saulieu & Auxerre : c’étoit une
place forte dès 9 3 1 , puifque Flodvard la nomme
Avallonem caflrum; elle fut elle-même au v i ie fiecle
lé chef lieu d’un pagus ou canton, régi par un
comte. L’a de de partage de l’empire François par
Charlemagne, 06.1a capitulaire de Charle le Chauve,
en parlent fous le nom de pagus Avalcnjis.
Cette, ville, n’a qu’une paroiffe.& une collégiale,
fondée au vm c ou ix e fiecle; le college, occupé
par les do&rinaires , doit fon établiffement au pré-
lident Odebert en 1654 : le bailliage eft ancien.
Avallon a fouffert plufieurs fieges ; Emme, femme
du roi Raoul, l’afliéga & la prit en 931; le roi
Robert s’en empara après- trois mois de fiegé fèn
1005 ; fon fils-Robert, depuis duc de Bourgogne,'
la prit en 10 3 1 , & la garda avec le duché ; Charles
VII s’en rendit maître, mais Philippe le bon la reprit
en 1433. . ;
Le commerce ôlAvallon eft."en fiYtâïlles, bois;
bled & vins5; dont quelques côtéaux forit renommés. i
les bois & les vins fe tirent pour Paris,
Pierre Foreftier, & Lazare Boquïllof, favâns
chanoines, ont’ fait-honneur à' leur patrie , ftir-
tout le dernier, - par fes ouvrages ; il eft mort en
»
rÀvaÜoh eft à 2,0 lieues de Lyon , à 16 d’Autun,
& à 3 de Vezelay. (C .)
ÂVANACÜ , f. m. tiàt. Botàniq. ) efpece
de ricin, ainfi nommée au Malabar, & fort bierf ’
gravée par Vàn-Rheede , dans fon Hortus Malafra-
ricus , volume I I , pagèb j , plahche X X X . l l , fous
le.nom d’avanacôe;4es Malabares l’appellent encore
cit-avanacü y & les Brames erandd'i félon Jean Cprii-
melin, c’eft le ricinus vulgatis de Cafpard Bauhin.
. M. Linné l’appelle ricinus, commuais y folïispeltatis,
fubpalmatis , ferratisy dans fôn Syjlenia naturà , édition
ixey imprimée; en 1^6.7, page 6'j6 , rù\ 1.
C’eft un arbrifleau qui s’élève à la hauteur dé
neuf à dix pieds, ayant une tête fphériqite, portée
fur un tronc de quatre à cinq pieds de hauteur, fuf
trois à quatre pôücesde diamètre, noueux , Comme
articulé, à bois peu épais, blanc, mou, léger ,
Creux au-dedans, rempli d’une moelle fOngueufe ,
blanc-jaunâtre, féparée & comme coupée à chaque
articulation, par une cloifon aufli fongueufe &
blanchâtre, mais plus fôlide, & recouvert d’une
écorce çendrée-grife; les branches font alternes,
aflez fèrrées , ouvertes foiis un angle de 45 dégrés
femblables au tronc, mais plus tendres, charnues
& couvertes d’une écorce verte & lifle.
La racine eft courte , fibreufe & blanchâtre.
Les feuilles font difpofées alternativement & cir-
eulairement le long des branches à des diftarices d’un
à deux pouces, rondes, de huit à neuf, pouces de
diamètre, palmées, c’eft-à-dire, découpées jufqu’au
1 milieu de leur démi-diametre , en fept à huit lobes
rayonnans en étoile , mais inégaux, les antérieurs
'• étant une .fois plus grands , triangulaires, une fois
plus longs qüe'latges, bordés chacun d’une trentaine
de dentelures aiguës de chaque côté. ; elles
. font molles, minces, lifl’es, verd-ôbfcures en-deflus ,
verd-clair en-deflbus , relevées de fept à huit côtes"
rayonnantes q ui, partant de l’extrémité de chaque.
; lobe, vont fe réunir un peu au-delà dit centre de
la feuille, au fômmet d’un pédicule aufli long qu’el-
les , qui les fôutiènt à peu-près comme un para fol.
Ce pédicule eft parfaitement cylindrique , marqué'
: à fa furface fupérieure & antérieure d’un fillon peuv
fenfible, duquel partent quelques glandes orbicu-
laires peu relevées & luifântés. A l’oppofé de ce
pédicule, on apperçoit, comme dans le figuier commun
, une grande ftipülé mèmbraneufe, verte, triangulaire,,
qui environne la branche à fon origine ,
qui enveloppe le bourgeon dès feuilles, fdus la
forme d’un capuchon conique , & qui tombe, au
moment de.leur premier développement: lès feuilles
font pliées dans le bourgeon en autant dé doubles
qu’elles ont de nervures ou de côtes. ■ ’
Les branches font terminées par une panicule en'
épi de quinze à vingt fleurs yertes, de quatre à cinq
lignes de diamètre, portées chacune fur umpédun-
cule de leur longueur.' Cèllés de cèS fleurs qui ocr
cupent le centre de la paniculé, font femelles , pendant
que les inférieures font mâles : ce font' dône
Ces fleurs inférieures qui féçôhdént les fiipérieurés ,
’ quoique leur paniculé fe foütiénne droité comme
Une-pyramide. Chaque fleür cônfifté en un calice
caduc, à cinq feuilles vertès',*fahs ;aucune efpëce
de corolle; les étamines des fleurs mâlesyaxinombre
de cent, font’ réunies par la moitié inférieure
de leurs filets en une co Ion lié’ pleine-, qui' occupe
le centré du calice , & ces-’filets font é{agés’ffë maniéré
qüè èèùJt dit milieu font les, plus longs ; lés an-
ïherés qùidë^ terminent font fpheriquè'sVd’irrf jaune-
-‘Clair , marquées de quatre- filions’ longitudinaux' en
croiix, - & S?Oüvrent en^ deux lôges ^ar lès deux filions
latéraux, qui répandent Une pOÙflîè'r'ê gâtitaïé’,
'Compôfée dé molécules b'vendes, d’nhjàunè' Lchiffré
& luifantes, Le piftil confifte en un ovatféfèSile3