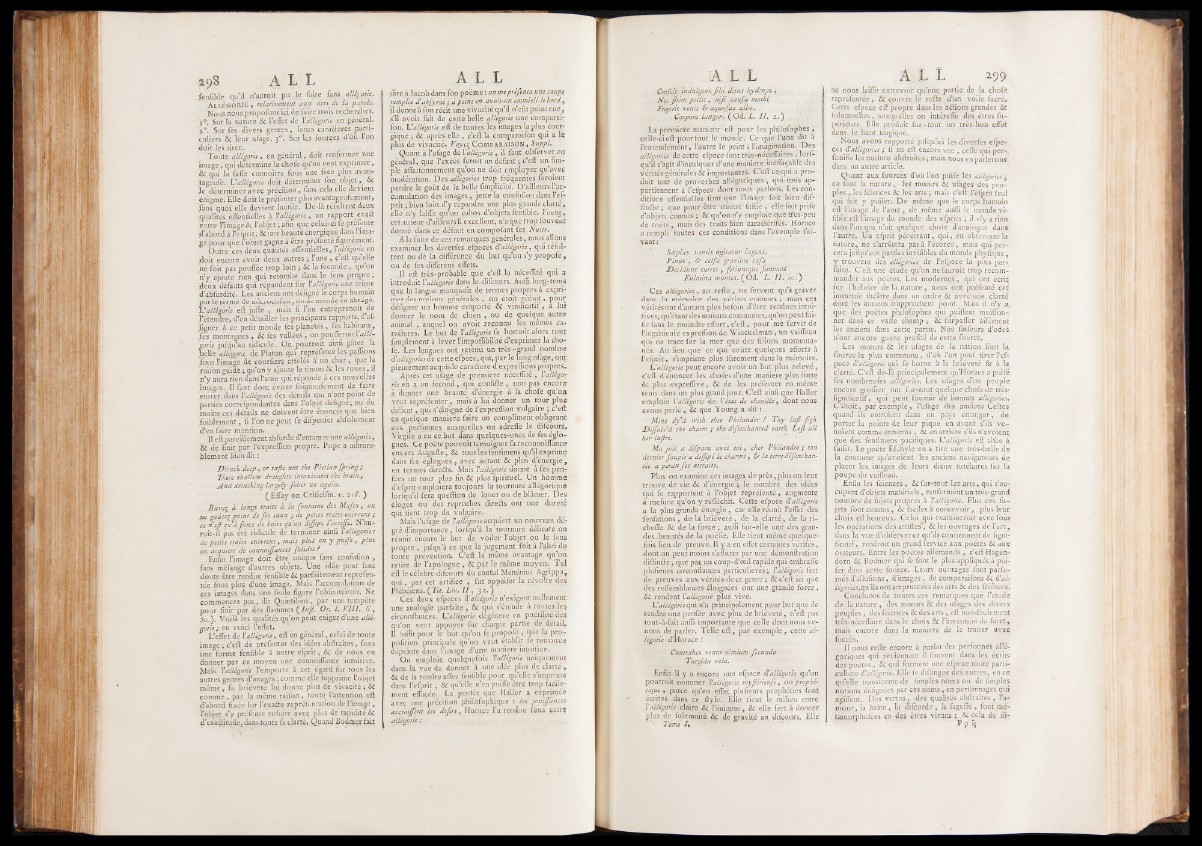
fenfible qu’il n’auroit pu .le faire fans, allégorie.
ALLÉGORIE, relativement aux arts de la parole.
Nous nous propofons ici de faire trois recherches.
ï° . Sur la nature & l’effet de Vallégorie, en général.
x°. Sur fes divers genres, leurs carafleres .particuliers
8c leur pa ge . 30. Sur les fources d’ôii l’on
doit les tiré r, _ r
Toute allégorie, en général, doit renfermer une
image, qui détermine la chofe qu’on veut exprimer,
& qui la faffe connaître fous une face plus ayan-
tagëufe. \J allégorie doit déterminer fon ,o bjet, &
le déterminer ave.c précifion, fans cela elle deÿient
énigme. Elle doit le préfenrer plus avantageufement,
fans quoi elle .devient inutile. De-là refultent deux
.qualités effentiellès à Y allégorie, un rapport exa&
entre l’image & l’objet ; afin que celui-ci le prefente
d’abord à i’efprit ; & une beauté énergique dans l’image
pour que l’objet gagne à être préfënté figurément.
’ Outre ces deux qualités effentielles, Y allégorie en
doit encore avoir deux autres ; l’une , c’eft qu’elle
ne foit pas pouffée trop loin ; Sc la fécondé , qu’on
n’y ajoute rien qui retombe dans le fens propre ;
deux défauts qui répandent fur Y allégorie une teinte
d’abfurdifé. Les anciens ont défigné le corps humain
par le terme de microcofme, o,u de monde en abrégé.
Vallégorie eft jufte , mais fi l’on entreprenoit de
l ’étendre, d’en détailler les principaux rapports, d’af-
ligner à ce. petit monde fes planètes , fes habitans,
fes montagnes, & fes vallées, onppu fier oit Y allégorie
jufqu’aii ridicule.. On ppurroit ainfi gâter la
belle allégorie de Platon qui repréfente les paflionç
fous l’image de courfiers attelés à un char , que la
raifon guide ; qu’on y ajoute le timon 8c les roues, il
n’y aura rien dans l’ame qui réponde à ces nouvelles
images. Il faut donc éviter foigneufement de^ faire
entrer dans Y allégorie des détails qui n’ont point de
parties corréfpondantes dans l’objet défigné; ou du
moins ces . détails ne doivent être énoncés que bien
foiblement, fi l’on ne peut fe difpenfer abfolument
d’en faire mention. ;
11 eft pareillement abfiirde d’entamer une allégorie,
& de finir par l’exprejfion propre. Pope a admirablement
bien dit :
D'rinck deep, or tajle not the Pierian fpring ;
There shallow draughtsintoxicates the brain,
And drincking Largely fober us again.
( Effay on Criticifm. v. 218. )
Buvei à longs traits a la fontaine des Mufes, ou
ne goîtte£ point de fes eaux j de petits traits enivrent j
ce riejiquaforce de boire qu on dijfipe Civreffe. N’auroit
il pas été ridicule de terminer ainfi Y allégorie:
de petits traits enivrent, mais plus on y puife , plus
on acquiert de connoiffances folides ?
Enfin l’image doit être unique fans^ confufion ,
fans mélange d’autres objets. Une idée peut fans
doute être rendue fenfible 8c parfaitement représentée
fous plus d’une image. Mais l’accumulation de
ces images dans une feule figure l’obfcurçiroit. Ne
commencez pas, dit Quintilien, par une tempête
pour finir par des flammes ( Injl. Or. L F 1II. G ,
So.). Voilà les qualités qu’on peut exiger d’une allégorie
; en voici l’effet.
L’effet de Y allégorie, eft en général, celui de toute
image ; c’eft de préfenter des idées abftraites, fous
une forme fenfible à notre efprit, 8c de nous en
donner par ce moyen une connoiffance intuitive.
Mais YaÛégo/ie l’emporte à cet égard fur tous les
autres genres d’images ; comme elle fupprime l’objet
même, fa brièveté lui donne plus de vivacité ; &
comme, par la même raifon, toute l’attention eft
d’abord fixée fur l’exa&e représentation de l’image ,
l’objet s’y préfente enfuite avec plus de rapidité 8c
d’exa&itude, dans toute fa clarté. Quand B0dîner fait
dire à Jacob dans fon poème : ontnepréfenta une coupe
remplie d'abfynte / à peine en avoit-on emmiele le bord,
il donne à fon récit une vivacité qu’il n’eût point eue ?
s’il avoit fait de gette belle allégorie une comparaison.
L’allégorie eft de toutes les images la plus énergique
; 8c après elle , c’eft la comparaison qui a le
plus de vivacité. Foye^ Comparaison , Suppl.
Quant à l’ufage de Yallégorie , il faut obferver en
général, que l’excès feroit un défaut ; c’ eft un fim-
ple affaifonnement qu’on ne doit emplqyer qu’avec
modération. Des allégories trop fréquentes feroient
perdre le goût de la belle fimplicité. D ’ailleurs l’accumulation
des images., jette la confufion dans l’ef-
prit ; bien loin d’y répandre une plus grande clarté,
elle n’y laiffe qu’un cahos d’objets fenfible. Young,
cet auteur d’ailleurs fi excellent, n’a que trop fouvent
donné dans ce défaut en compofant fes Nuits.
A la fuite de ces remarques générales, nous allons
examiner les diverfes efpeces $ allégorie, qui réful-
tent ou de la différence du but qu’on s’y propofe ,
ou de fes différens effets.
Il eft très-probable que c’ eft la né.ceflité qui a
introduit Y allégorie dans le difcours. Aufli long-tems
que la langue manquoit de termes propres à exprir
mer des notions générales , on étoit réduit, pour
défigner un homme emporté 8c vindicatif, à lui
donner le nom de chien , ou de quelque autre
animal , auquel on avoit reconnu lès memes ca?
ra&eres. Le but de Y allégorie fe bornoit alors tout
Amplement à lever l’impoflibilité d’exprimer la chbr
fe. Les langues ont retenu un très-grand nombre
d'allégories de cette efpeee, qui, par le lqng ufage, ont
pleinement acquis le caraâere d’exprefliqns propres.
Après cet ufage de première néceflite , Yallègç,<-
fie en a un fécond, qui çonfifte , non pas encore
à donner une beauté d’énergie à la chofe qu’on
yeiit repréfenter , mais à lui donner un tour plus
délicat, qui s’élqigne de l’expreflion vulgaire ; c’eft
en quelque maniéré faire un compliment obligeant
aux perfonnes auxquelles on adreffe le difcours.
Virgile a eu ce but dans quelques-unes de fes églo-
gues. Ce poète pouvoit témoigner fa reconnoiffance
envers Àugufte, 8c tous les fentimens qu’il exprime
dans fes églogues, avec autant 8c plus d’énergie ,
en termes directs. Mais Y allégorie donne, à fes peu?
fées un tour plus fin 8c plus fpirituel. Un homme
d’efprit emploiera toujours la tournure allégorique
lorfqu’Ù fera queftion de louer ou de blâmer. Des
éloges ou des reproches direfts ont une dureté
qui tient trop du vulgaire.
Mais l’ufage de Y allégorie acquiert un nouveau dér
gré d’importance, lorfqu’à la tournure délicate on
réunit encore le but de voiler l’objet ou le fens
propre , jufqu’à ce que le jugement foit à l’abri de
toute prévention. C ’eft lé même avantage qu’on
retire de l’apologue , 8c par le même moyem T e l
eft le célébré difcours du conful Ménenius Agrippa,
q u i, par cet artifice , fut appaifer la révolte dès
Plébéiens. {Tit. Liv. ƒ / , 32. )
Ces deux efpeces YYallégorie n’exigent nullement
une analogie parfaite, & qui s’étende à toutes les
circonftances. L’allégorie dégénéré en puérilité dès
au’on veut appuyer fu r . chaque partie de. détail.
Il fuffit pour le but qu’on fe propofe , que la pror
pofition principale qu’on vent établir le^ retrouve
dépeinte dans l’image d’une maniéré intuitive.
On emploie quelquefois Yallégorie uniquement
dans la yue de donner *à une idée plus de clarté ,
& de la rendre affez fenfible pour qu’elle s’imprime
dans l’efprit , & qu’elle n’en puiffe être trop facile^
ment effacée. La penlée que Haller a exprimée
avec une précifion philofophique : les jouiffances
accroiffent les defirs, Horace l’a rendue fous cette
allégorie ; , . >t. ^ ..
Crefcit indulgens fibi diras hydrops ,
Nec fitirn pellit, niji caufa morbi
Fugerit venis & aquofus albq.
Corpore langor. f Öd. L. II. 2, )
La première maniéré eft pour les philofophes ;
Celle-ci eft pour tout le monde. Ce que Tune dit à
l’entehdemènt, l’autre le peint à l’imagination. Des
allégories de cette efpete fônt tfès-néeeffaires ; 'lorf-
qu’il s’agit d’inculquer d’une maniéré ineffaçable des
vérités générales & importantes. C’eft Ce^qui-a produit
tant de proverbes âllé'goriquês, qui-foiis appartiennent
à l’efpeée dont nous parlons. Lés conditions
efferitielles font que l’image -foit bien dif-
finfté ; que pour être ttiiëux faifie , elle foit prife
d’objets1 connus ; & qu’on n’y emploie fuie1 très-peu
de traits', mais des traits bien caraâérilés. Horace
à rempli toutes ces conditions dans l’exemple' fui-
vant-:
Sapiûs ventis agitatur ingms.
P inus , & celfa graviore cafit ‘
JDèçidunt turres , feriuntque Jumfnôi
Fulmina montes. ( Öd. L. II. 10.')
Ces allégories, au rèfte , ne fervent qu’à graver
dans la mémoire des vérités connues ; mais ces
vérités ont d’autant plus befoin d’être rendues intuitives,
qu’étant des notions communes, qu’on peut fai-
fir fans le moindre effort, c’e ft , pour me fervir de
l’ingénieufé expreffion de Winckelmàn , un vaiffeau
qui ne trace fur la mer que des filions momentanés.
Au lieu que ce qui coûte quelques efforts à
l ’efprit-, s’imprime plus fûrement dans la mémoire.
Ùallégorie peut encore avoir un but plus relevé >
c’eft d’eiioncer les chofes d’une maniéré plus forte
& plus exprefiive, & de les préfenter en même
tems dans un plus grand jour. C’eft ainfi que Haller
emploie Yallégorie de Y état de chenille, dont nous
avons parlé , & que Young a dit :
Mine dy,d with thèe Philander ! Thy laß figh •
Dißolv’d the charm ; the difenchanted earth Lofi ail
her Ittßre.
Ma jo li a difparu avec toi, cher Philandre i ton
dernier foupir a dißipl le charme, & la terre défenchan-
léè a perdu fes attraits.
Plus on examine ces images de près, plus on leur
trouve de vie & d’énergie ; le nombre des idées
qui fe rapportent à l’objet repréfenté, augmente
à mefure qu’on y réfléchit. Cette efpeee G allégorie
a la plus grande énergie , car elle réunit l’effet des
fenfations , de la brièveté , de la clarté, de la ri-
cheffe & de la force ; aufli fait-elle une des grandes
.beautés de la poëfie. Elle tient même quelquefois
lieu de preuve. Il y a en effet certaines vérités,
dont on peut moins s’aflurer par une démonftration
. diftinfte, que pan un coup-d’oeil rapide qui embraffe
plufieurs circonftances particulières ; Yallégorie fert
de preuves aux vérités de ce genre ; & c’eft ici que
des reffemblanèes éloignées ont une grande force,
.& rendent Yallégorie plus vive.
L’allégorie qui n’a principalement pour but que de
rendre une penfée avec plus de brièveté, n’eft pas
îout-à-fait aufli importante que celle dont nous venons
de parler. Telle e f t , par exemple, cette allégorie
d’Horace :
Contrahes vento nimium fecundo
Turgida vêla.
Enfin il y a çncore une efpeee d’allégorie qu’on
pourroit nommer Yallégorie myférieufe, ou prophé-,
tique y parce qu’en effet plufieurs prophéties font
écrites dans ce ftylè. Elle tient le milieu entre
Yallégorie claire & l’énigme, & elle fert à donner
plus .de folemnité de de gravité au difcours, Elle
*•= Tome h
ne nous laiffe entrevoir qu’une partie de la çhofé
repréfentée, & couvre le refte d’un voile facréi
Cette efpeee eft propre dans les allions grandes ÔC
folemnelles, auxquelles on intéreffe des êtres fu-
périeurs. Elle produit. fur - tout un très-bon effet
dans. le haut tragique.
Nous avons rapporté jufqu’ici les diverfes eipe-
ces 8allégories ; il en eft encore une , celle qui per-.
Tonifie lésaiotions abftraites; mais nous en parlerons
dans un autre article, ‘
Quant aux fources d’oii l’on puife les allégories 1
çe font la nature, le S moeurs & ufages des peuples
, les fciences & les arts ; mais c’eft l’efprit feul
qui fait y puifer. De même que le corps humain
eft l’image de l’ame, de même aufli le monde vi-
fible.eft l’image du. monde des efprits ; il n’y a rien
dans l’un qui n’ait quelque chofe d’analogue dans
l’autré. Un efprit pénétrant , qui'/en oblervantla
nature, ne s’arrêtera pas à l’écorce, mais qui percera
jufqii’aùx parties invifibles du monde phyfique,
y trouvera des allégories de l’efpece la plus parfaite.
C’eft une étude qii’on nefauroit trop recommander
aux poètes. Les modernes, qui ont écrit
fur , l’hiftoire de là nature * nous ont préfënté cet
immenfe théâtre dans un ordre & avec, une clarté
dont les anciens n’approchent point. Mais il n’y a
que des poètes philofophes qui puiffent moiffon-
ner dans ce vafte champ ; & furpaffer aifément
les anciens dans cette, partie. Nos. faifeurs d’odes
n’ont encore guere profité de cetté fôurcè.
Les’ moeurs 8c les ufages de la nation fönt la
fource la plus commune, d’où l’on peut tirer l’efpece
G allégorie qui fe borne à la brièveté 8c à la
clarté. G’eft de-là principalement qu’Horace a puifé
fes nombreufes allégories. Les ufages d’un peuple
encore groflîer ont fur-tout quelque chofe de très-
fignificatif, qui peut fournir de bonnes allégories
C ’étoit, par exemple, l’ufage des anciens Celtes
quand ils entroient dans un pays étranger, de
porter la pointe de leur" pique eh avant s’ils v e -
noient comme ennemis , 8c en arriéré s’ils n’avoient
que des fentimens pacifiques. XIallégorie eft aifée à
faifir. Le poète Efchyle-en a tiré une très-belle de
la coutume qu’avoient les anciens navigateurs de
placer les images de leurs dieux tutélaires fur la
poupe du vaiffeaih ,
Enfin les fciences y 8c fur-tôut les arts, qui s’occupent
d’objets matériels , renferment un très-grand
nombre de fujets propres à Yallégorie. Plus ces fu-
jets font connus,. 8c faciles à concevoir, plus leur
choix eft heureux... Celui qui èxâmineroit avec foin
les Opérations des artiftes* 8c les ouvrages de l’art,
dans la vue d’obferver ce qu’ils contiennent de fignificatif,
rendroit un grand fervice aux poètes 8c aux
orateurs. Entre les poètes allemands , c’ëft Hagendorn
8c Bodmer qui fe font le plus appliqués à puifer
dans cette fource. Leurs ouvrages font parfe-
més d’allufions,- d’images , de comparaifons 8c d’al~
légories,qu’ils ont empruntées des arts 8c des fciences.
Concluons de toutes ces remarques que l’étude
de la nature , des moeurs 8c des ufages des divers
peuples, des fciences 8c des arts, eft non-fèulement
ttès-néceflaire dans le choix 8c l’invention du fujet,
mais encore dans la maniéré de le traiter avec
fùc'cès.. .
. II nous refte encore , à parler des perfonnés allégoriques
qui reviennent fi fouvent dans les écrits
des poètes , 8c qui forment une efpeee toute particulière
G allégorie. Elle fe diftingue des autres, en ce
quelle transforme de Amples noms ou de Amples
notions défignées par ces noms $ en pérfonnages qui
agiffent. Des vertus , des qualités abftraites, l’amour,
la haine , la difeorde , la fageffe , font me*
. tamorphofées en des êtres vivans ; 8c cela de di^