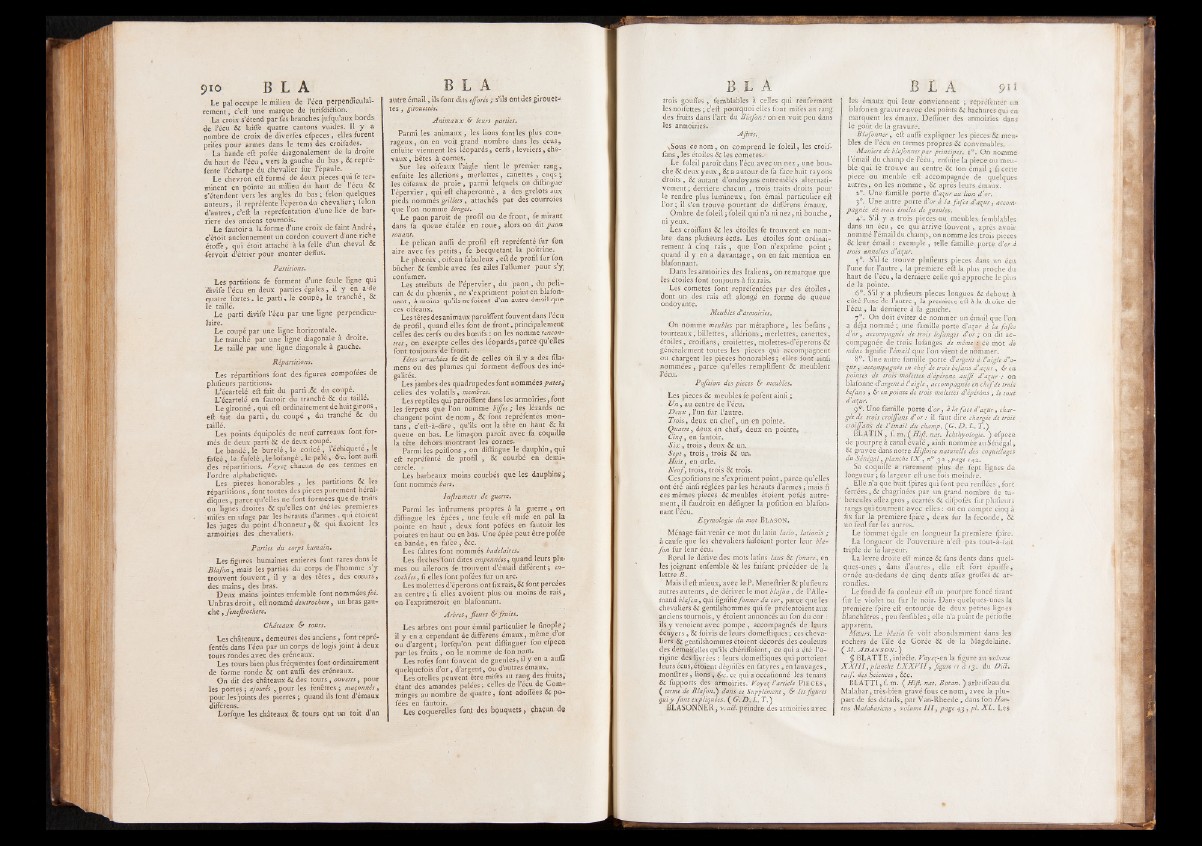
Le pal occupe le Milieu de l’ écu perpendiculairement,
c’eft: une marque de jurifdiftion.
La croix s’étend par fes branches jusqu'aux bords
de l’écu & laiffe quatre cantons vuides. Il y a
nombre de croix de diverfes efpeces, elles furent
prifes pour armes dans le tems des croifades. ^
La bande eft pofée diagonalement de la droite
du haut de l’écu , vers la gauche du bas, & repréfente
l’écharpe du chevalier fur l’épaule.
Le chevron eft formé de deux pièces qui fe terminent
en pointe au milieu du haut de l’écu &
s’étendent vers les angles du bas; félon quelques
auteurs, il repréfente l’éperon du chevalier; félon
d’autres, c’eft la repréfentation d’une lice de barrière
des anciens tournois.
Le fautoir a la forme d’une croix de faint André,
c’ëtoit anciennement un cordon couvert d une riche
étoffe, qui étoit attaché à la felle d’un cheval &
-fervoit d’étrier pour monter deffus.
Partitions.
Les partitions fe forment d’une feule ligne qui
'divife l’écu en deux parties égales, il y en a ‘de
quatre fortes, le parti, le coupé, le tranché, &
le taillé.
Le parti divife l’écu par une ligne perpendiculaire.
IL
Le coupé par une ligne horizontale.
Le tranché par une ligne diagonale à droite.
Le taillé par une ligne diagonale à gauche.
Répartitions.'
Les répartitions font des figures compofees de
plufieurs partitions. • ^ ,
L’écartelé eft fait du parti & . du coupe.
L’écartelé en fautoir du tranché & dn taillé.
Le gironné , qui eft ordinairement de huit girons,
eft fait du parti, du coupé , du tranche & du
taillé. .
Les points équipolés de neuf carreaux lont formés
de deux parti & de deux coupé. ^ .
Le bandé, le burelé, le codcé , l’échiquete , le
fafcé, le fufelé , le lofangé , le pale, &c. font aufli
jdes répartitions, yoye^ chacun de ces termes en
l’ordre alphabétique.
Les pièces honorables , les partitions & les
répartitions, font toutes des pièces purement héraldiques,
parce qu’elles ne font formées que de traits
ou lignes droites & qu’elles ont été les premières
mifes enufage par les hérauts d’armes , qui étoient
les juges du point d’honneur, & qui fixoient les
armoiries des .chevaliers.
Parties du corps humain.
Les figures humaines entières font rares dans le
Blafon, mais les parties du corps de l’homme s’y
trouvent fouvent, il y a des tetes, des coeurs,
des mains, des bras.
Deux mains jointes enfemble font nommées foi.
Unbras droit, eft nommé dextrochtre, un bras gauche
, fenefirochere.
Châteaux & tours.
Les châteaux, demeures des anciens, font repré-
fentés dans l’écu par un corps de logis joint à.deux
tours rondes avec des créneaux.
Les tours bien plus fréquentes font ordinairement
de forme ronde & ont aufli des créneaux.
On dit des châteaux &. des tours, ouverts, pour
les portes ; ajourés , pour les fenêtres ; maçonnés,
pour les joints des pierres ; quand ils font d’émaux
différens..
Lorfque les châteaux & tours ont un toit d’un
autre émail, ils font dits e(forés ; s’ils ont des giroueN
tes , girouettés.
Animaux & leurs parties.
Parmi les animaux, les lions font les plus courageux,
on en voi>$ grand nombre dans les écus,
énfuite viennent les léopards, cerfs, lévriers, chevaux
, bêtes à cornés.
Sur les oifeaux l’aigle tient le premier rang,
enfuite les aliénons, merlettes , canettes , coqs ;
lés oifeaux de proie, parmi lefquels on diftingue
l’cpervier , qui eft chaperonné ,, a des grelots aux
pieds nommés grillets, attachés par des courroies
que l’on nomme longes. ■
Le paon paroît de profil ou de front, fe mirant
dans fa qüeue étalée en roue, alors on dit paon
rouant.
Le pélican aufli de profil eft repréfenté fur fon
aire avec fes petits, fe becquetant la poitrine.
Le phoenix, oifeau fabuleux , eft de profil fur fon
bûcher & femble avec fes ailes l’allumer pour s’y
confirmer. ^ .
Les attributs de l’épervier, du paon, du pélican
& du phoenix, ne s’expriment point en blafon-
nant, à moins qu’ils ne foient d’un autre émail que
ces oifeaux.
Les têtes des animaux paroiffent fouvent dans l’écu
de profil, quand elles font de front, principalement
celles des cerfs ou des boeufs : on les nomme rencontres,
on excepte celles des léopards,parce qu’elles
font toujours de front. . '
Têtes arrachées fe dit de celles oh il y a des fila-
mens ou des plumes qui forment deffous des inégalités.
Les jambes des quadrupèdes font nommées pâtes}
celles des volatils ,• membres.
Les reptiles qui paroiffent dans les armoiries, font
les ferpens que l’on nomme biffes ; les lézards ne
changent point de nom , & font repréfentes mon-
tans , c’eft-à-dire , qu’ils ont la tête en haut & la
queue en bas. Le limaçon paroît avec fa coquille
la tête dehors montrant les cornes.
Parmi les poiflons , on diftingue le dauphin, qui
eft repréfenté de profil , & courbé en demi-
cercle. • . .. 935
Les barbeaux moins courbés que les dauphins^
font nommés bars.
Injlrumens de guerre.
Parmi les inftrumehs propres à la guerre , on
diftingue les épées , une feule eft mife en pal la
pointe en haut , deux font pofées en fautoir les
pointes en haut ou en bas. Une épée peut être pofée
en bande, en fafcé, &c.
Les fabres font nommés badelaires.
Les fleches ffont dites empennées, quand leurs plumes
ou ailerons fe trouvent d’émail différent ; en-
cochées, li elles font pofées fur un arc.
Les molettes d’éperons ont fix rais, & font percées
au centre; fi elles avoient plus ou moins de rais,
on-l’exprimeroit en blafonnant.
Arbres, fleurs & fruits.
Les arbres ont pour émail particulier le finople }
il y en a cependant de différens émaux, même d or
ou d’argent ; lorfqu’on peut diftinguer fon efpece
par' les fruits , on le nomme de fon nom.
Les rofes font fouvent de gueules, il y en a aufli
quelquefois d’o r , d’argent, ou d’autres émaux. |
Les otelles peuvent être mifes au rang des fruits,
étant des amandes pelées; celles de l’ecu de Com-
minges au nombre de quatre, font adoffees & pofées
en fautoir.
Les coquerelles fon,t des bçuquets, chacun de
B L A
trois gouffes , femblables à celles qui renferment
les noifettes ; c’eft pourquoi elles font mifes au rang
des fruits dans l’art du Blafon : on en voit peu dans
les armoiries. ~
AJlrisil
\Sous ce nom, on comprend le foleil, les croif-
fans, les étoiles & les cometes.*
Le foleil paroît dans l’éçu avec un nez, une bouche
& deux y eux, & a autour de fa face huit rayons
droits , & autant d’ondoyans entremêlés alternativement
; derrière chacun , trois traits droits pour
le rendre plus lumineux ; fon émail particulier eft
l’or ; il s’en trouve pourtant de différens émaux.
Ombre de foleil ; foleil qui n’a ni nez, ni bouche,
ni yeux.
Les croiffans & les étoiles fe trouvent en nombre
dans plufieurs éciïs. Les étoiles font ordinairement
à cinq rais , que l’on n’exprime point ;
quand il y en a davantage, on en fait mention en
blafonnant.
Dans les armoiries des Italiens, on remarque que
les étoiles font toujours à fix/ais.
Les cometes font repréfentées par des étoiles,
dont un des rais eft alongé en forme de queue
ondoyante»
Meubles d?armoiries.
On nomme meubles par niétaphoré, les befàns ,
tourteaux, billettes, allériohs, merlettes* canettes,
étoiles, croiffans, croifettes, molettes-d’éperons &
généralement toutes les pièces qui accompagnent
ou chargent les pièces honorables ; elles font ainfi
nommées, parce qu’elles rempliffent & meublent
l’écu.
Pojition des pièces & meubles,
Les pièces & meubles fe pofent ainfi ;
Un, centre de l’écu.
Deux , l’un fur l’autre»
Trois, deux en chef, un eft pointe.'
Quatre, deux en chef, deux en pointe.
Cinq, en fautoir.
S i x , trois , deux & un.
Sept, trois, trois & un»
Huit, en orle.
Neuf, trois, trois & trois.
Ces pofitions ne s’expriment point, parce qu’elles
ont été ainfi réglées par les hérauts d’armes ; mais fi
ces mêmes pièces & meubles étoient pofés autrement
, il faudroit en défigner la pofition en blafonnant
l’écu.
Etymologie du mot Blason.
Ménage fait venir ce mot du latin lado, lationis ;
à caufe que les chevaliers faifoient porter leur blafon
fur leur écu..
Borel le dérive des mots latins laus & fonare, en
les joignant enfemble & les faifant précéder de la
lettre B.
Mais il eft mieux, avec le P. Meneftrier & plufieurs
autres auteurs, de dériver le mot b la fo n , de l’Allemand
b la fcn , qui fignifie fonrier du cor, parce que les
chevaliers & gentilshommes qui fe préfentoientaux
anciens tournois, y étoient annoncés au fon du cor : i
ils y venoient avec pompe , accompagnés de leurs
écuyers , & fuivis de leurs domeftiques ; ces chevaliers
& gentilshommes étoient décorés des couleurs
des demoifelles qu’ils chériffoiënt, ce qui à été l’origine
des livrées : leurs domeftiques qui portoient
leurs écus, étoient déguifés en fatyres , en fauvages,
monftres, lions , &c. ce qui a occafionné les tenans
& fupports des armoiries. Voye^l'article P i è c e s ,
( terme de Blafon.') dans ce Supplément, 6* les figures
qui y font expliquées. ( G. D. L. T. )
BLASONNER , V. acl. peindre des armoiries avec
les émaux qui leur Conviennent ; repféfëfttèr un
blafon en gravure avec des points & hachures qui en
marquent les émaux. Defliner des armoiries dans
le goût de la gravure-.
Plafonner, eft aufli expliquer les pièces & meu*
blés de l’écu en termes propres & convenables.
Maniéré de blajonnerpar principes, i °. On nomme
l ’email du champ de l’écu, enfuite la pièce ou meuble
qui fe trouve au centre & fon émail ; fi cette
pieee ou meuble eft accompagnée de quelques
autres * on les nomme, & après leurs émaux.
2°. Une famille porte <da{ur au lion d'or.
3°. Une autre porte d'or à La fafcé da^ur, accompagnée
dè\ trois étoiles de gueules.
4°. S’il y a trois pièces ou meubles femblables
dans ,un écu, ce qui arrive fouvent, après avoir
nommé l’émail du champ, on nomme les trois pièces
& leur émail : exemple , telle famille porte d’or à
trois annelets d'azur.
5°. S’il fe trouve plufieurs pièces dans un écu
l’une für l’autre , la première eft la plus proche du
haut de l’éeu, la derniere celle qui approche le plus
de la pointe»
6°.. S’il y a plufieurs pièces longues & debout à
coté l’une de l’autre , la première eft à la droite de
l’écu , la dernière à la gauche.
7°. On doit éviter de nommer un émail que l’on
a déjà nommé ; une famille porte d'azur à la fafcé
d or, accompagnée de trois lof anges d'or ; on dit accompagnée
de trois lofanges de mêmet^kce mot de
même fignifie l’émail que l’on vient de nommer.
8°. Une autre famille porté d!argent à C aigle d'a-
£#r, accompagnée en chef de trois befahs d'azur , & en
pointes de trois molettes d'éperons aufli d'azur-: on
blafonne d! argent à P aigle, accompagnée en chefde trois
befans , G en pointe de trois molettes dépérôns , le tout
9°. Une famille porte dor, à la face d'azur, chargée
de trois croiffans d'or ; il faut dire chargée de trois
croiffans de l'émail dit champ. (G. D . L. T.)
BLÀTIN , f. m. ( ilifi. nat. Ichthyologie» ) efpecë
de pourpre à canal évalé, ainfi nommée au Sénégal*
& gravée dans notre Hifioire naturelle des coquillages
du Sénégal, planche IX , n° 32 ,page 142.
. Sa coquille a rarement plus de fept lignes de
longueur ; fa largeur eft une fois moindre.
Elle n’a que huit fpires qui font peu renflées , fort
ferrées, & chagrinées par un grand nombre de tu-
' hercules affez gros , écartés & difpofés fur plufieurs
rangs qui tournent avec elles : on en compte cinq à
nx fur la première fpire , deux fur la fécondé, ôt
tin feul fur les autres.
Le fommet égale en longueur la première fpire.'
La longueur de l’ouvertürè n’eft pas toiit-à- fait
triple de fa largeur.
La levre droite eft mince & fans dents dans quelques
unes ; dahs d’autres, elle eft fort épaiffe *
Ornée au-dedans de cinq dents affez groffes & arrondies.
Le fond de fa couleur éft un pourpre foncé tirant
fur le violet ou fur le noir. Dahs quelques-iines la
première fpire eft entourée de deux petites lignes
blanchâtres, peu feniibles ; elle n’a point de péri'ofte
apparent.
Mceitrs. Le bldùn fe voit abondamment dans les
rochers de l’îlé de Corée & de la Mâgdelaine.
( M. A d AN s o n . )
§ BLATTE,infefte. Foye^-en la figure au volume
X X I I I , planche LX X V I I , figure 11 à 13. du Dicl.
raif. des Sciences, &c.
BLATTI, f. m. ( Hiß. nat. Botan. ) arbriffeau du
Malabar,.très-bièn gravé fous ce nom* avec la plupart
de fes détails, par Van-Rheede, dans fon Hor-
tus Malabaricus , volume I I I , page 43 , pl. XL, Les