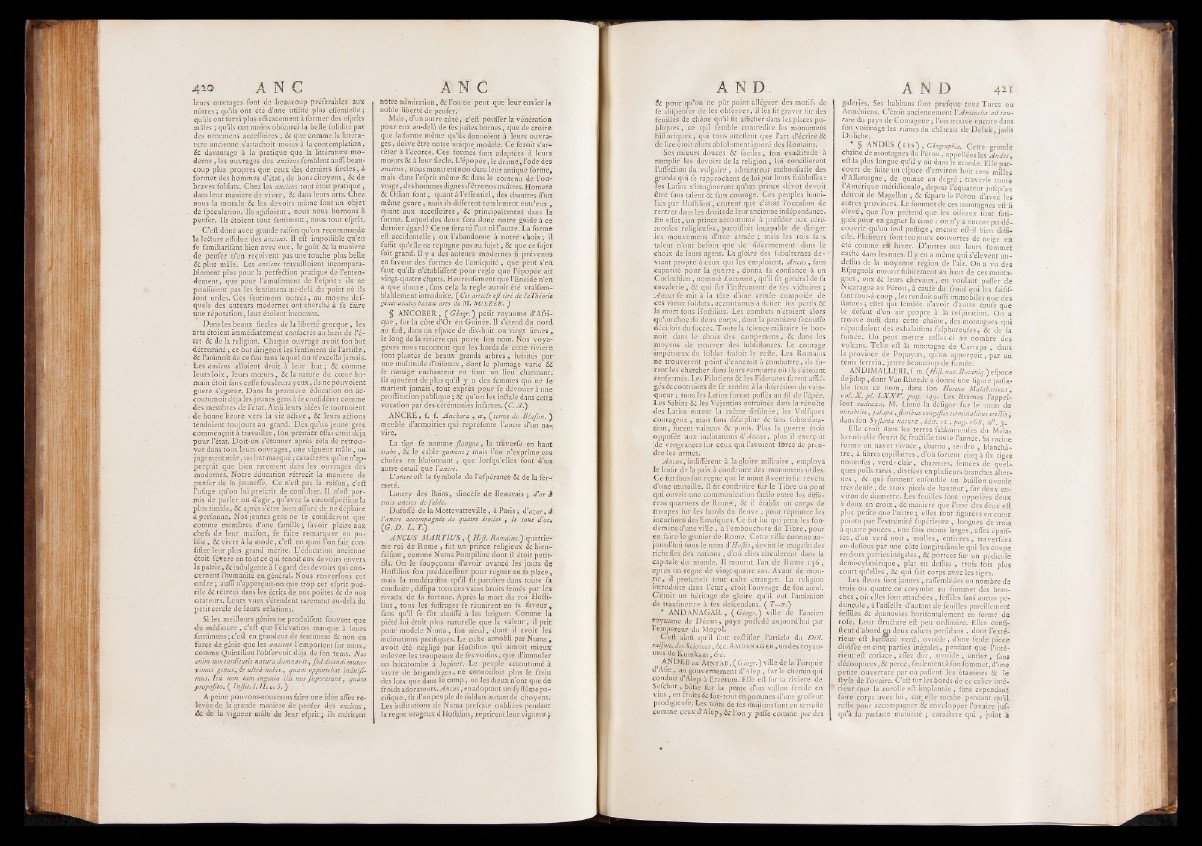
leurs ouvrages font de beaucoup préférables aux
nôtres ; qu’ils o n t été d’une utilité plus effentielle ;
qu’ils ont fervi plus efficacement à former des efprits
mâles ; qu’ils ont moins obfcurci la belle folidité par
des ornemens acceffoires ; & que comme la littérature
ancienne s’attachoit moins à la contemplation,
& davantage à la pratique que la littérature moderne
, les ouvrages des anciens femblent auffi beaucoup
plus propres que ceux des derniers fiecles, à
former des hommes d’é ta t, de bons citoyens, & de
braves foldats. Chez les anciens tout étoit p ra tiq u e ,
dans leur maniéré de v iv re , & dans leurs arts. Chez
nous la morale & les devoirs même font Un objet
de fpéculation. Ils a g ira ie n t, nous nous bornons à
penfer. Ils étoient tout fentiment, nous to u t efprit,
C’eft donc avec grande raifon qu’on recommande
laîe&ure affidue des anciens. Il eft impoffible qu’en
fe familiarifant bien avec e u x , le goût & la maniéré
de penfer n’en reçoivent pas une touche plus belle
& plus mâle. Les anciens travailloient incomparablement
plus pour la perfe&ion pratique de l’entendement,
que pour l’amufement de Pefprit : ils ne
pouffoient pas les fentimens au-delà du point où ils
fo n t utiles. Ces fentimens 'outras, au moyen def-
quels des auteurs modernes ont cherché à fe faire
une réputa tion, leur étoient inconnus.
Dans les beaux fiecles de la liberté g re cq u e , les
arts étoient immédiatement confacrés au bien de l’éta
t & de la religion. Chaque ouvrage avoit fon but
déterminé ; ce but dirigeoit les fentimens de l’artifte',
& l’animoit de ce feu fans lequel on n’excella jamais.
Les anciens alloient droit à leur b u t ; & comme
le u rs lo ix , leu rs moeurs, & la nature du coeur humain
étoit fans ceffe foüs leurs y e u x , ils nepouvoient
guère s ’égarer. Dans la première éducation on ac-
coutumoitdéjaleS jeunes gens à fe confidérer comme
des m embres de l’état. Ainfi leurs idées fe tournoient
d e bonne heure vers la vie aftive , & leurs actions
tendoient toujours au grand. Dès qu’un jeune grec
■commençoit à trav a ille r, fon premier effai étoit déjà
p o u r l’état. D oit-on s’étonner après cela de re tro u v
e r dans tous leurs ouvrages, une vigueur mâle , un
jugement m û r, un b ut marqué ; caractères qu’on n’ap-
p e rçq it que bien rarement dans les ouvrages des
modernes. Notre éducation rétrécit la maniéré de
enfer de la jeuneffe. Ce n’eft pas la raifon, c’eft
. ufage qu’on lui prefcrit de conlulter. Il n’eft p e rmis
de.pa rler ou d’a g ir, qu’avec la circonfpeétion la
plus timide, & après s’être bien affuré de ne déplaire
ap e rfo n n e . Nos jeunes gens, ne fe cônfiderent que
comme membres d’une famille ; favoir plaire aux
chefs de leur maifon, fe faire remarquer en public
, & vivre à la m o d e, c’eft en quoi l’on fait çon-
fifter leur plus grand mérite. L’éducation ancienne
étoit fèvere en to u t ce qui tenOit aux devoirs envers
la p atrie , Scindulgente à Fégard des devoirs qui conce
rn en t l’humanité en général. Nous renverfons Cet
o rd re ; auffi n’apperçoit-on que trop cet efprit puérile
& rétréci dans les écrits de nos poètes & de nos
ora teurs. Leurs vues s’étendent rarement au-delà du
p e tit cercle de leurs -relations.
Si les meilleurs génies ne produifent foiivent que
•du médiocre , c’eft que l’élévation manque à leurs
fentimens : c’eft en grandeur de fentiment & non en
force de génie que les anciens .l’emportent fur nous,-
comme Quintilien l’obfervoit déjà de fon tems. Hec
enirn nos tarditatis natura damnavit-, fea dicendlmuta-
vimus genus, & ultra nobis , quam opportebat indulji-
mus. h à non tam ingenio illi nos fuperarunt, quàm
propofito. ( Injlit. I. I I. c. 5 . )
A peine pou vons-nous nous faire une idée affez r e levée
de la grande maniéré de penfer dès anciens,
& de la vigueur mâle de leur efprit ; ils méritent
hotre admiration, Si l’on ne peut que leur envier la
noble liberté de penfer.
Mais, d’un autre c ô té , 1 c’eft pouffer la vénération
po u r eux au-delà de fes juftes bornes, que de croire
que la forme même qu’ils donnoient à leurs ouvrages
, doive être notre unique modèle. Ce feroit s’arrê
te r à l’ecorce-. Ces formes font adaptées à leurs
moeurs & à leur fieclé. L’épopé e, le drame, l’ode des
anciens, nous montrent non dans leur antique forme,
mais dans l’efpïit même & dans le contenu de l’ouvrage
, des hommes dignes d’être-nos maîtres. Homere
& Offian fo n t, quant à l’effentiel, des chantres d’un
même genre , mais ils different totalement entr’eux ,
quant aux acceffoires, & principalement dans la
forme. Lequel des deux fera donc notre guide à ce
dernier égard ? Ce ne fera ni l’un ni l’autre. La forme
eft accidentelle ; on l’abandonne à notre choix ; il
fuffit qu’elle ne répugne pas au Tu j e t , & que ce fujet
foit grand. 11 y à des auteurs modernes fi prévenus
en faveur des formes de l’antiquité , que petit s’e a
faut qu’ils n’établiffent po u r regle que l’épopée ait
vingt-quatre chants. H eureufement que l’Enéïde n’en
a que douze , fans cela la regle auroit été vraifem-
blablement introduite. ( Cet article eß tiré de laThéori*
gêneraledes beaux arts de M. SuLZER. )
§ ANCOBER, ( Géogr. ) petit royaume d’Afrique
, fur la côte d’O r en Guinée. Il s’étend du nord
au fud, dans un efpace de dix-huit ou vingt lieues ,
le long de la riviere qui porte fon nom. Nos voyageurs
nous racontent que les bords de cette riviere
font plantés de béaux grands a rb re s , habités par
une multitude d’oifeaüx, dont le plumage varié &C
le ramage enchanteur en font un lieu charmant.
Ils ajoutent d éplus qu’il y a des femmes qui ne fe
marient jamais, to u t exprès po u r fe dévouer à une
proftitution publique ; & qu’on les inftale dans ce tte
vocation par des cérémonies infames. (C. A Y).
A N C R E , f. f. Anchora , <e, ( terme de B lafon. )
meuble d’armoiries qui repréfente Y ancre d’un navire.
. La tige fe nomme fiangue, la tràverfe en haut;
trabe , & le cable gumene ; mais l’on n’exprime ces
chofes en blafonnant , que lorfqu’elles font d’un
autre émail'que Y ancre.
U ancre eft le fymbole de Pefpérance & de la fer-<
meté.
Lancrÿ des Bains, diocèfe de Beauvais ; d’or à
trois ancres de fable.
Dufoffé de la Mottevatteville , à Paris ; d'azur, à
l ’ancre accompagnée de quatre étoiles , le tout d’or,
{G . D . L . T.)
A N C U S M A R T IU S , ( Hiß'. Romaine.) quatrième
roi de Rome , fut un prince religieux & bien-
faifant, comme NumaPompilius dont il étoit petit-
fils. On le foupçonna d’avoir avancé les; jours de
Hoftilius fon prédéceffeur pour régner en la p la c e ,
mais la modération qu’il fitp a ro ître dans toute fa
conduite, diffipa tous ces vains bruits fernes par les
rivaux de fa fortune. Après la mort du roi Hofti-
lius , tous les fuffrages fe réunirent en fa faveur ,
fans qu’il fe fut abaiffé à les briguer.- Comme la
piété lui étoit plus naturelle que la v a le u r, il prit
p o u r modele N um a , fon a ïe u l, dont il avoit les
inclinations pacifiques. Le culte annobli par Numa ,
avoit été négligé par Hoftilius qui aimoit mieux
enlever les troupeaux de fes voifins, que d’immoler
un hécatombe à Jupiter. Le peuple accoutumé à
vivre' de brigandages, ne eonnoiffoit plus le frein
des loix que dans le camp., oïi.Ies dieux n’ont que de
froids adorateurs. Ancus, en adoptant un fyftême pacifique
, fit d’un peuple de foldats autant de citoyens;
Les inftitutions de Numa prefque oubliées pendant
le regne orageux d’Hoftifiiis, reprirent leu r vigueur j
& pour qu’on ne pût point alléguer des motifs de
fe difpenfer de les obferver, il les fit graver fur des
feuilles de chêne qu’il fit afficher dans les places publiques
, ce qui femble contredire les monumens
hiftoriqties., qui tous atteftent que l’art d’écrire &
de lire étoit alors abfolumçnt ignoré des Romains.
Ses moeurs douces & faciles, fon exactitude à
remplir les devoirs de la religion, lui concilièrent
l’affeCtion du vulgaire, admirateur enthoufiafte des
grands qui fe rapprochent de lui par leurs foibleffes :
les Latins S’imaginèrent qu’un prince dévot devoit
être fans talent & fans courage. Ces peuples humiliés
par Hoftilius', crurent que c’étoit l’occafion de
rentrer dans les droits de leur ancienne indépendance.
En effet, un prince accoutumé à préfider aux cérémonies
religieufes, paroiffoit incapable de diriger
les mouvemerîs d’une armée ; mais les rois fans
talent n’ont befoin que de difcernement dans le
choix de leurs àgens. La gloire des fubalternes de- ■
vient propre à ceux qui les emploient. Ancus, fans
capacité pour la guerre, donna fa confiance à un
Corinthien , nommé Lucümon, qu’il fit général de fa
cavalerie , & qui fut l’inftrument de fes .victoires ;
Ancus fe mit à la tête d’une armée compofée de
ces vieux foldats, accoutumés à défier les périls &
la mort fous Hoftilius. Les combats n’étoient alors
<ju’un choc de deux corps, dont la première fecouffe
décidoit du fuccès. Toute la (cience militaire fe bor-
xioit dans le choix des campemens, & dans les
moyens de trouver des fubfiftances. Le courage
impétueux du foldat faifoit le refte. Les Romains
ne trouvèrent point d’ennemis à combattre, ils furent
les chercher dans leurs remparts où ils s’étoient
renfermés. Les Piloriens & les Fidenates furent affié-
gés & contraints de fe rendre à la difcrétion du vainqueur
; tous les Latins furent paffés au fil de l’épée.
Les Sabins & les Véjentins entraînés dans la-revolte
ides Latins eurent la même deftinée; les Volfques
•courageux , mais fans difeipline & fans fubordina-
•lion, furent vaincus & punis. Plus la guerre étoit
•oppofée aux inclinations d’ Ancus, plus il exerçoit
{de vengeances fur ceux qui l’avoient forcé de prendre
les armes.
Ancus, indifférent à la gloire militaire , employa
le loifir de la paix à conftruire des monumens utiles.
C e fut fous fon régné que le mont Aventinfui revêtu
•d’une muraille. II fit conftruiré fur le Tibre un pont
qui ouvrit une communication facile entre les diffé-
rens quartiers de Rome, & il établit un corps dé
troupes fur les bords du fleuve , pour réprimer les
incurfions des Etrufques. Ce fut lui qui jetta les fon-
demens d’une ville , à l’embouchure du Tibre, pour
en faire le grenier de Rome. Cette ville connue aujourd’hui
fous le nom à'HoJlie, devint le magalin des'
richeflès des nations , d’où elles circulèrent dans la
capitale du monde. Il mourut l’an de Rome 156 ,
après Un régné de vingt quatre ans. Avant de mourir
, -il proferivit tout culte étranger. La ■ religion
introduite dans -l’état, étoit l’ouvrage de fon aïeul.
C’étoit un héritage de gloire qu’il eut l’ambition
de tranfmettre à les defeendans. ( T— jv.)
* ANDANAGAR , ( Géogr. ) ville de l’ancien
royaume de Décan, pays poffédé aujourd’hui par
l ’empereur du Mogol.
C’eft ainfi qu’il faut reéfifier l’article du D i cl.
raifon. des Sciences, &c. A m d e n a g e r , un des royaumes
de Kumkam, &c.
? AN DEB ou A i n t à b , ( Géogr. ) ville de la T urquie
d’Afie, au gouvernement d’ Alep , fur le chemin qui
conduit d’Alep à Erzecum. Elle eft fur la rivière de
Sefchur, bâtie fur la pente d’un vallon fertile en
vins , en fruits & fur.-tout en-pommes d’une groffeur;
prodigieufe. Les toits de fes maifons font en terraffe
comme ceuxd’Alep,-& l’on y paffe comme par des
galeries. Ses habitans font prefque tous Turcs ou
Arméniens. C’étoit anciennement YAntiocha ad tau-
rum du pays de Comagene ; l’on trouve encore dans
fon^voifinage les ruines du château de D e lu k , jadis
Doliche. V
§ ANDES ( l e s ) , Géographie. Cette grande
chaîne de montagnes du P é ro u , appellées les Andes,
eft la plus longue qu’il y ait dans le monde. Elle parcourt
de fuite un efpace d’environ huit cens milles
d’Allemagne, de quinze au dégré ; tràverfe toute
l’Amérique méridionale, depuis l’équateur jufqu’au
détroit de Magellan , & fépare le Pérou d’avec les
autres provinces. Le fommet de ces montagnes eft fi
é le v é , que l’on prétend que les oifeaux Font fatiguéspour
en gagner la cime : on n ’y a encore pu découvrir
qu’un feul pafl’ag e , encore eft-il bien diffi-
cilei Plufieurs font toujours couvertes de neige en
été comme eft hiver. D ’autres ont leurs fommet
cache dans lès nues. Il y en a même qui s’élèvent au-
-deffus de la moyenne région de l’air. On a vu des
Efpagnols mourir fubitement au haut dé ces montagnes,
eux & leurs chevaux, en voulant paffer de
Nicaragua au P éro u , à caufe du froid qui les faifif-
fant touc-à-coup, les rendoit auffi immobiles que des
ftatues ; effet qui femble n’avoir d’autre caufe que
le défaut d’un air propre à la refpiration. On a
trouvéS uffi dans cette chaîne, des montagnes qui
repandoient des exhalaifons fu lp h u r e u f e s& de la
fumée. On peut mettre celles-ci au nombre des
volcans. Telle eft. la montagne de Carrapà , dans
la province de Popayan, qu’on apperÇoit, par un
tenis fe rre in, jetter beaucoup de fumée;
ANDIMALLERI,f m . nat.BotaniqY)efpece
de ja la p , dont Van-Rheede à donné une figure paffa-
ble fous ce nom , dans fon Hortus MaLabaricus,
vol._X.pl. L X X X , pag. tqc). Les Brames Yappellent
eudraxa. M; Linné la défigne fur le nom de
mirabilis, jalap a , fioribus congejlis terminalibüs ertclis ,
dans fon Syjlema natura, édit. 12 , pag. 16"8, n°. ? .
Elle croit dans les terres fablonneufes du Malabar
où elle fleurit & fru&ifie toute l’année. Sa racine
formé un navet vivace , charnu , tendre , blanchâtre
, à fibres capillaires , d’où fortent cinq à fix tiges
nouéufes, v e rd -c la ir, charnues, femées de quelques
poils ra re s , divifées en plufieurs branches alternes
, & qui forment enfemble un buiffon ovoïde
très denfe , de trois pieds de h au te u r, fur deux environ
de diamètre. Les feuilles font oppofées deux
à deux en c ro ix , de m aniéré que l’une des deux eft
plus petite que l’autre ; elles font figuréès en coeur
pointu par l’extrémité fupérieure , longues de trois
à quatre pouces , une fois moins larges, affez épaif-
f e s ,d ’un v,erd n o ir , molles, en tières, traverfées
en-deffous par une côte longitudinale qui les coupe
en deux parties inégales, & portées fur un pédicule
demi-cylindrique, plat en deffus , trois fois plus
court qu’elles , & qui fait corps avec les tiges.
Les fleurs font jaunes’, raffemblées au nombre de
trois ou quatre en corymbe au fommet des branches
, où elles font attachées , feffiles fans' aucun pé-
d uncule, à l’aiffelle d ’autant de feuilles pareillement
feffiles & épanouies horifontalement en forme de
rofe. Leur ftru&ure eft peu ordinaire. Elles confi-
ftent d ’abord gn deux calices perfiftans , dont l’extérieur
eft beroacé v e rd , o v o ïd e , d’une feule piece
divifée en cinq parties inégales, pendant que l’intérieu
r eft coriace , affez d u r , ovoïde , entier , fans
découpures, & p ercé, feulement à fon fommet, d’une
petite ouverture par où paffent les étamines & le
ftyle de l’ovaire. C’eft fur les bords de ce calice intérieur
que la corolle eft implantée, fans cependant
faire corps avec lu i, carpelle tombe pendant qu’il
refte pour accompagner & envelopper l’ovaire juf:
qu’à fa parfaite maturité ; caractère qui , joint à