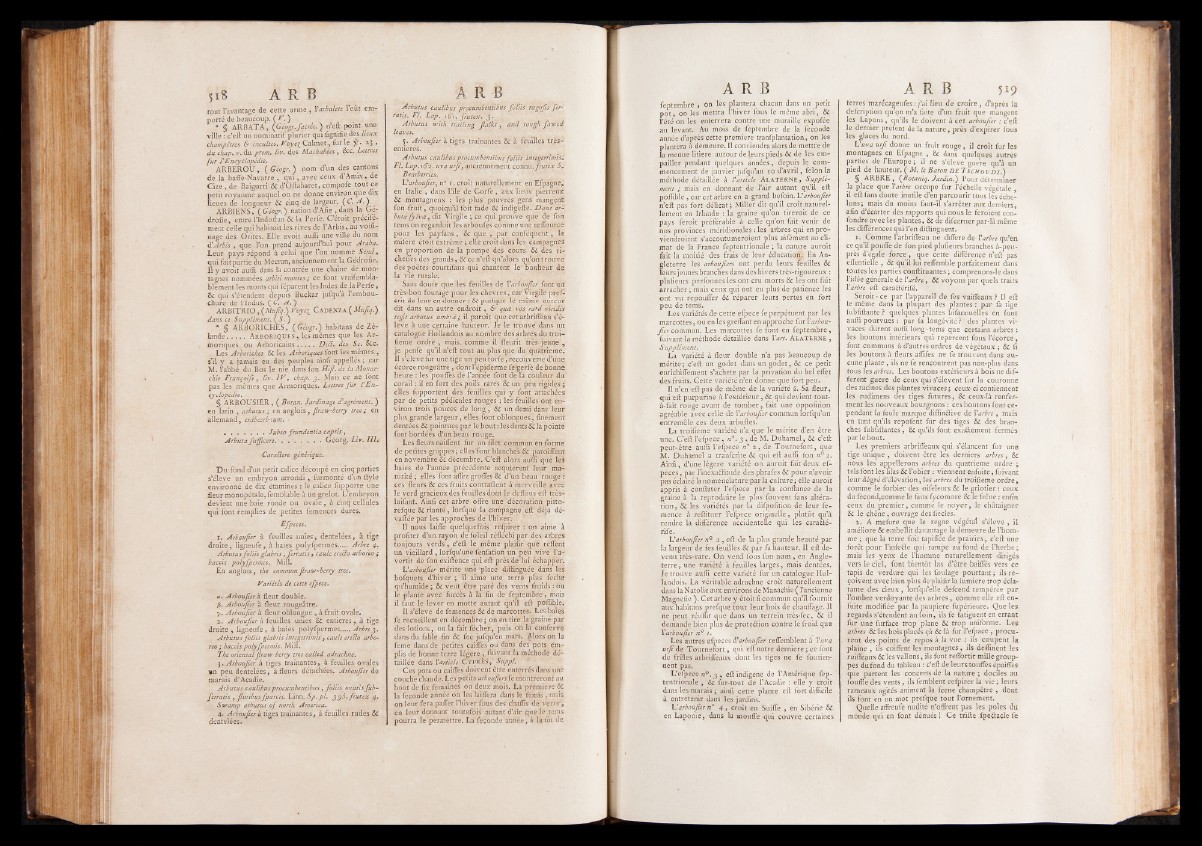
fout l’avantage de cette arme , Y arbalète l’eut emporté
de beaucoup. ( V. )
* § ARBATA, (Géogr.facrée. ) n’eft point une
ville : c’eft un nominatif plurier qui lignifie des lieux
champêtres & incultes. Voye^ Calmet, furie 2.3 ,
du chap. v. du prem, liv. des Machabées, êcc. Lettres
fur P Encyclopédie.
ARBEROU , ( Géogr. ) nom d’un des Cantons
de la baffe-Navarre , q u i, avec ceux d’Amix, de
C iz e , de Baigorri Sc d’Oftabaret, compofe tout ce
petit royaume auquel on ne donne environ que dix
neues de longueur 8c cinq de largeur. (C. A. ) |
ARBIENS, ( Géogr.) nation d’A fie , dans la Gé-
drolie, entre l’Indoftan & la Perfe. C’etoit précisément
celle qui habitoit les rives de l’Arbis, au voifi-
nage des Orites. Elle avoit aufli une ville du nom
d'Arbis , que l’on prend aujourd’hui pour Araba.
Leur pays répond à celui que l’on nomme Send9
qui fait partie du Mecran, anciennement la Gedröfie.
Il y avoit aufli dans la contrée une chaîne de montagnes
nommées, arbiti montes; ce font vraisemblablement
les monts qui féparent les Indes de la Perfe,
8c qui s’étendent depuis Buckar jufqu’à l’embouchure
de rindus. (C. A. )
ARBITRIO, (Mußq.) Voyei C a d e n z a ( Mufiq.)
dans ce Supplément. (S . )
* § ARBORICHES, (Géogr.) habitans de Zélande.........
ArboriQü e s , les mêmes que les Armoriques
ou Arboricains.........Dict. des Sc. 8cc.
Les Arboriches 8c les Arboriqùes font les mêmes ,
s’il y a jamais eu des peuples ainfi appellés ; car
M. l’abbé du B os le nie dans fon Hifi. de la Monarchie
Françoife, liv. IV , chap. g. Mais ce ne font
pas les mêmes que Armoriques. Lettres fur lé Encyclopédie.
§ ARBOUSIER, ( Botan. Jardinage déagrément. )
en latin , arbutus ; en anglois , firaw-berry tree; en
allemand, erdbeerbaum. •
. . . . . . . Jubeo frundentia capris,
Arbuta fujficere.........................Géorg. Liv. III.
Caractère générique.
D u fond d’un petit calice découpé en cinq parties
s’élève un embryon arrondi, furmonté d’un ftyle
environné de dix étamines : le calice fupporte une
fleur monopétale, femblable à un grelot. L’embryon
devient une baie ronde ou ovale, à cinq cellules
qui font remplies de petites femences dures.
Efpeces.
1. Arboufier à feuilles unies, dentelées, à tige
droite, ligneufe, à baies polyfpermes..... Arbre 4.
Arbutus foliis glabris, ferratis , caule ereBo arboréo ;
baccis polyfpermts. Mill.
En anglois, the common ßraw-berry tree.
Variétés de cette efpece.
a. Arboufier à fleur double,
ß. Arboufier à fleur rougeâtre.
y. Arboufier à fleur oblongue , à fruit ovale.'
2. Arboufier à feuilles unies 8c entières, à tige
droite , ligneufe, à baies polyfpermes..... Arbre g.
Arbutus foliis glabris integerrimis , caule ereBo arbo-
reo ; baccis polyfperrnis. Mill,
The oriental firaw berry tree called adrachne.
3. Arboufier à tiges traînantes, à feuilles ovales
vn peu dentelées ', à fleurs détachées. Arboufier de
marais d’Acadie.
Arbutus caulibus procumbentibus, foliis ovatis fub-
ferratis , floribus fparcis. Linn. Sp.pl. 39b. frutex 4.
Swamp arbutus o f north America.
4. Arboufier à tiges traînantes, à feuilles rudes 8c
dentelées.
Arbutus caulibus procumbentibus foliis rugojis fer»
ratis. Fl. Lap. fS ). frutex. 3.
Arbutus with traïling fialks , and rough frwed
leaves.
5. Arboufier à tiges traînantes Sc à feuilles très-
entières.
Arbutus caulibus procumbentibus foliis integerrimisl
Fl. Lap. /(Ta. uva urfi, anciennement connu, frutex 5.
Bearberries.
L’arboufier, n° 1. croît naturellement en Efpagne,
en Italie , dans l’île de Corfe, aux lieux pierreux
8c montagneux : les plus pauvres, gens mangent
fon fruit, quoiqu’il foit fade 8c indigefte. Dant arbuta
fylvce, dit Virgile ; ce qui prouve que de fora
tems on regardoit les arboufes comme une reffource
pour les payfans, 8c que , par çonféquent, la
mifere étoit extrême ; elle croît dans les campagnes
en proportion de la pompe des cours 8c des ri-
cheflès des grands, 8c ce n’eft qu’alors qu’on trouvé
des poëtes-courtifans qui chantent le bonheur de
la vie rûrale.
Sans doute quedes feuillesde Y arboufier font un'
très-bon fourage pour les chevres, car Virgile pref-
crit de leur en donner : Sc-puifque lé même auteur
dit dans un autre endroit , & quai- vos rarâ viridis
te fit arbutus umbrâ; il paroît que cet arbriffeaü s’élève
à une certaine hauteur. Je le trouve dans un
catalogue Hollandois au nombre des arbres dit,troifieme
ordre , mais .-comme il fleurit très-jeune ,
je penfè qu’il n’eft tout au plus' que du quatrième.
Il s’élève fur une tige un peu torfe, recouverte d’une
écorce rougeâtre, dont l’épiderme fe^gerfe de bonne
heure : les pouffes de l’année font de la couleur du
cçrail : il en fort des poils rares 8c un peu rigides ;
elles fupportent des feuilles qui y font attachées
par de petits pédicules rouges : les feuilles ont environ
trois pouces de long, 8c un demi dans leur
plusvgrandë largeur, elles font oblongues, fînément
dentées 8c pointues par le bout: les dents Scia pointe
font bordées d’tin beau'rouge,
Les fleurs naiffent fur un filet commun en forme
de petites grappes ; elles'font blanche! 8c pardiffent
en novembre 8c décembre. C’eft alors, aüm qûè les
baies de l ’année précédente acquièrent leur maturité;
elles font affez groffes 8c d’un beau rouge :
ces fleurs 8c ces fruits contraftent à merveille aVec
le verd gracieux des feuilles dont le déffous êff très-
luifant. Ainfi cet arbre offre une décoration pitto-
refque 8c riante, Ibrfquë la campagne eft déjà dé-
vaftée par les approches de l’hiver.
Il nous laiffe quelquefois réfpirer : on. aime à
profiter d’un rayon de foleil réfléchi par des arbres
toujours verds, c’eft le même plaifir que reflent
un vieillard , Iorfqu’une fenfation un peu vive l’avertit
de fon exiftènce qui èft près de lui' échapper.
\éarboufier mérite une ‘placé distinguée dans les
bofquèts d’hiver ; il aime une terre pl,us feche
qu’humide; 8c veut être paré des vents frcfidsrôa
le plante avec fuccès à la fin de feptehïbre, mais
il faut le lever en motte autant qu’il eft poflible.
Il s’élève de femences 8c de marcottés. Les bâi'es
fe recueillent en décembre; on en tire la graine par
des lotions, onia fait fécher, puis o'n la conferve
dans du fable fin 8c fec jufqu’en mars, ^lors on la
feme dans de petites cailles ou dans des pots emplis
de boniîe terre légère »fuivant la méthode détaillée
dans Y article C yprès,' Suppl. *
Ces pots ou caiffes doivent être enterrés dans unè
couche chaude. Les petits arboufiers fe montreront au
bout de fix femairies ou deux mois. La première 8c
là fécondé année on les laifl’era dans le femis, mais
on leur fera paffer l’hiver fous des chaflis de verre,
en leur donnant toutefois1 autant d’air que le tems
pourra le permettre. La féconde année, à' la fin de
feptembre , on les plantera chacun dans un petit
pot, on les mettra l’hiver fous le même abri, 8c
l’été on les enterrera contre une muraille' expofée
au levant. Au mois de feptembre de la feeonde_
année d’après cette première tranfplantation, on les
plantera a demeure. Il conviendra alors de mettre de
la menue litiere autour de leu rs pieds 8c de les empailler
pendant quelques années, depuis le commencement
de janvier jufqu’au 10 d’avril, félon la
méthode détaillée à !éarticle A l a t e r n e , Supplément
; mais en donnant de l’air autant qu’il eft
poflible , car cet arbre en a grand befoin. Varboufier
n’eft pas fort délicat ; Miller dit qu’il croît naturellement
en Irlande : la graine qu’on tireroit de ce
pays feroit préférable à celle qu’on fait venir de
nos provinces méridionales : les arbres qui en pro-
viendroient s’accoutumeroient plus aifément au climat
de la France feptentrionale ; la nature auroit
fait la moitié des frais de leur éducatioq. En Angleterre
les arboufiers ont perdu leurs fe u ille s 8c
leurs jeunes branches dans des hivers très-rigoureux :
plufieurs perfonnes les ont cru morts 8c les ont fait
arracher ; mais ceux qui ont eu plus de patience les
ont vu repouffer 8c réparer leurs pertes en fort
peu de tems.
Les variétés de cette efpece fe perpétuent par les
marcottes, ou en les greffant en approche fur Y arboufier
commun. Les marcottes fe font en feptembre,
fuivant la méthode détaillée dans Y art. A l a t e r n e ,
Supplément.
Là variété à fleur double n’a pas beaucoup de
mérite ; c’eft un godet dans un godet, 8c ce petit
enrichiffement s’achete par la privation du bel effet
•des fruits. Cette variété n’en donne que fort peu.
Il n’en eft pas de même de la variété j8. Sa fleur,
qui eft purpurine à l’extérieur, 8c qui devient tout-
à-fait rouge avant de tomber, fait une oppofition
agréable avec celle de Y arboufier commun lorfqu’on
entremêle ces deux arbuftes.
La troifieme variété n’a que le mérite d’en être
une. C’eft l’efpece, n°. 3 ,de M. Duhamel, 8c c’eft
peut-être aufli l’efpece n° 2 , de Tournefort, que
M. Duhamel a tranfcrite 8c qui eft aufli fon n° 2.
Ainfi, d’une légère variété on auroit fait deux efpeces
, par l’inexaftitude des phrafes 8c pour n’avoir
pas éclairé la nomenclature parla culture; elle auroit
appris à conftater l’efpece par la confiance de la
.graine à la reproduire le plus fouvènt fans altération,
8c les variétés par la difpofition de leur fe-
mence à reftituer l’efpece originelle, plutôt qu’à
rendre la différence accidentelle qui les cara&é-
rife.
L’arboufier nQ 2 , eft de la plus grande beauté par
la largeur de fes feuilles 8c par fa hauteur. Il eft devenu
très-rare. On vend fous fon nom , en Angleterre
, une variété à feuilles larges, mais dentées.
Je trouve aufli cette variété fur un catalogue Hollandois*
La véritable adrachne croît naturellement
dans laNatolie aux environs de Manachie ( l’ancienne
Magnefie ). Cet arbre y étoit fi commun qu’il fournit
aux habitans prefque tout leur bois de chauffage. Il
ne peut réuffir que dans un terrein très-fec, 8c il
demande bien plus de p ro te c t io n contre le froid que
Y arboufier 1.
Les autres efpeces d1arboufier reffemblent à Y uva
urfi de T o u r n e f o r t , qui eft notre derniere ; ce font
de frêles arbriffeaux dont les tiges ne fe foutien-
nent pas.
L’efpece n®. g , eft indigène de l’Amérique feptentrionale
, 8c fur-tout de l’Acadie : elle y croît
dans les marais ; ainfi cette plante eft fort difficile
à entretenir dans les jardins.
L'arboufier n° 4 , croît en Suiffe , en Sibérie 8c
en Laponie, dans la moufle qui couvre certaines
terres 'marécageufes : j’ai lieu d e croire, d’après la
defcription qu’on m’a faite d’un fruit que mangent
les Lapons , qu’ils le doivent à cet arboufier ; c’eft:
,1e dernier prêtent de la nature, près d’expirer fous
les glaces du nord.
h ’uva urfi donne un fruit rouge, il croît fur les
montagnes eh Efpagne , 8c dans quelques autres
parties1 de l’Europe ; il ne s’élève guere qu’à un
pied de hauteur. ( M . le Baron d e T s c h o v d /.) •
§ ARBRE, (Botaniq. Jardiné) Pour déterminer
la place que Y arbre occupe fur l’échelle végétale ,
il eft fans doute inutile d’en parcourir tous les échelons;
mais du moins faut-îl s’arrêter aux derniers
afin d’écarter des rapports qui nous le feroient confondre
avec les plantes, 8c de difcerner par-là même
les différences qui l’en diflinguent.
1. Gomme l’arbriffeau ne différé de Y arbre qu’en
ce qu’il pouffe de fon pied plufieurs branches à-peu-
près d’égale forc e , que cette différence n’eft pas
effentielle , 8c qu’il lui reffemble parfaitement dans
toutes les parties conftituantes ; comprenons»le dans
l’idée générale de Y arbre, 8c voyons par quels traits
Y arbre eft caraéférifé. ’
Seroit - ce par Pappareil de fes vaiffeaux ? Il eft
le même dans la plupart des plantes : par fa tige
fubfiftante ? quelques plantes bifannuelles en font
aufli pourvues : par fa longévité ? des plantes vivaces
durent aufli long-tems que certains arbres:
les boutons intérieurs qui repercent fous l’écorce,
font communs à d’autres ordres de végétaux ; 8c fi
les boutons à fleurs aflîfes ne fe trouvent dans aucune
plante, ils ne fe rencontrent pas non-plus dans
tous les arbres. Les boutons extérieurs à bois ne different
guere de ceux qui s’élèvent fur la couronne
des racines des plantes vivaces ; ceux-ci contiennent
les rudimens des tiges futures, 8c ceux-là renferment
les nouveaux bourgeons : ces boutons font cependant
la feule marque diftinétive de Y arbre , mais
en tant qu’ils repofent fur des tiges- 8c des branches
fubfiftantes, 8c qu’ils font exactement fermés
par le bout.
Les premiers arbriffeaux qui s’élancent fur une
tige unique , doivent être les derniers arbres, 8c
nous les appellerons arbres du quatrième ordre ;
tels font les lilas 8c l’obier : viennent enfuite, fuivant
leur dégré d’élévation, les arbres du troifieme ordre,
comme le forbier des oifeleurs 8c le griotier ceux
du fécond,comme le faux fycomoré 8c le frêne : enfin
ceux du premier, comme le noyer, le châtaigner
8c le chêne, ouvrage des fiecles.
2. A mefure que le régne végétal s’élève , il
améliore & embellit davantage la demeure de l’homme
; que là terre foit tapiffée de prairies; c’eft une
forêt pour l’infeCte qui rampe au fond de l’herbe ;
mais les yeux de l’homme naturellement dirigés
vers le ciel, font bientôt las d’être baiffés vers ce
tapis de verdure qui les foulage pourtant ; ils reçoivent
avec bien plus de plaifir la lumière trop éclatante
des cieux, lorfqu’elle defcend tempéree par
l’ombre verdoyante des arbres, comme elle eft en-
fuite modifiée par la paupière fupérieure. Que les
regards s’étendent au loin, ils fe fatiguent en errant
fur une furface trop plane 8c trop uniforme. Les
arbres 8c les bois placés çà 8c là furl’efpace , procurent
des points de repos à la vue : ils coupent la
plàine , ils coiffent les montagnes, ils deflinent les
ruiffeaux 8c les vallons, ils font reffortir mille group-
pes du fond du tableau : c’eft de leurs touffes épaiffes
que partent les concerts de la nature ; dociles au
fouffle des vents, ils femblent refpirer la vie ; leurs
rameaux agités animent la fcene champêtre , dont
ils font en un mot prefque tout l’ornement.
Quelle affreufe nudité n’offrent pas les pôles du
monde qui en font dénués 1 Ce trifte fpeftacle fe