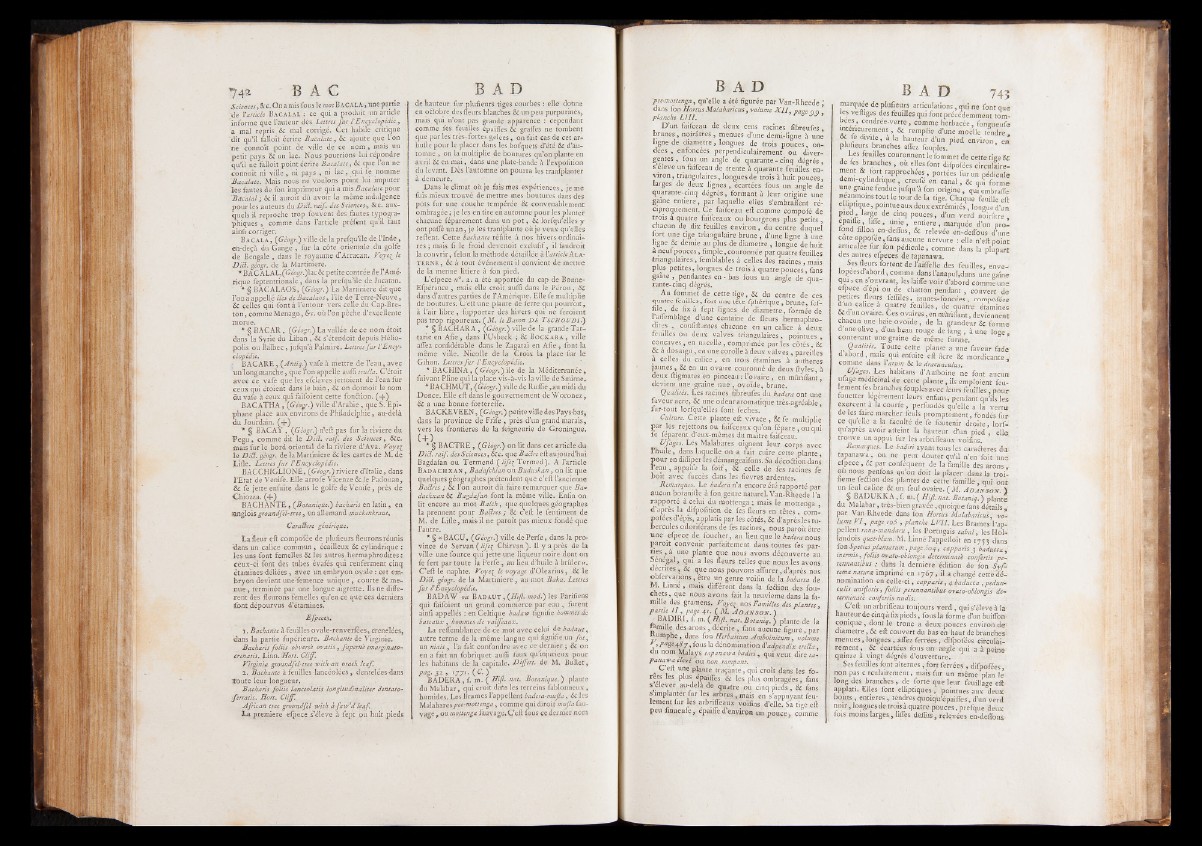
7 4 5 B A C
Sciences, Sic. On a mis fous le mot B AÇALA, une partie
"de l’article Ba c a l a l : ce qui a produit un article
informe que l’auteur des Lettres fur l'Encyclopédie.,
a mal repris & mal corrigé. Cet habile critique
'dit qu’il falloit écrire Bacalàte, Sç ajoute que l’on
ne connoît point de ville de ce nom, mais un
petit pays & un lac. Nous pourrions lui répondre
qu’il ne falloit point écrire Bacalate, & que l’on ne
connoît ni ville , ni pays , ni lac, qui le 'nomme
Bacalate. Mais nous né voulons point lui imputer
les fautes de Ton imprimeur qui a mis Bacalate pour
"Bàcalal ; Sc il auroit du avoir la même indulgence
pour les auteurs du Dicl. raij. des Sciences* &c. auxquels
il reproche trop fouvent des fautes typographiques
, comme dans l’article préfent qu’il faut
ainfi corriger.
B a c a l a , (Géogr._) ville de la prefqu’île de l’Inde,
eh-deçà du Gange , fur la côte orientale du golfe
de Bengale , dans le royaume d’Arracan. Voye^ le
JDicl. géogr. de la Martiniere.
* B AC ALAL,(&éo;gr.)lac & petite contrée de l’Amérique
feptentrionale, dans la prefqu’île de Jucatan.
* § BACALAOS, (Géogr.) La Martiniere dit que
l’on a appellé îles de Bacalaos, l’île de Terre-Neuve,
& celles qui -font à l’entour vers celle du Cap-Bre-?
ton , comme Menago, &c. où l’on pêche d’excellente
morue.
* § BACAR, (Géogr.") Là vallée de ce nom étoit
dans la Syrie du Liban , Sc s’étecdoit depuis Héliopolis
ou Bâlbec, jufqu’à Palmire. Lettres fur £ Encyclopédie.
( BAC ARE, (Antiq.) vafe à mettre de l’eau, avec
iinlong;manche, que l’on appelle aufli trulla. C ’étoit
avec ce vafe que les efclaves jetroient de l’eau fur
ceux qui étoient dans le bain, ■ & on donnoit le nom
du vafe à ceux qui faifoient cette fon&ion. (d-)
BACATHA, (Géogr.) ville d’A rabie, que S. Epî-
phane place aux environs de Philadelphie, au-delà
du Jourdain. (+ )
'* § BÂCAY , (Géogr.)-n’eft pas fur la rivière du
Pègu , comme dit le Dicl. <raif. des Sciences, Sec.
mais fur le ,bord oriental de la riviere d’Ava. Voye^
le Dicl. géogr. de la Martiniere Sc les cartes de M. de
Lille. Lettres fur £ Encyclopédie.
BACCHIGLIONE, (Géogr.)i riviere d’Italie, dans
l ’Etat de Venife. Elle arrofe Vicenze &Je Padouan,
& fe jette enfuite dans le golfe de Venife, près de
Chiozza. (+)
BÂCHANTE, (Botanique?) bacharis en latin, en
janglois groundfêl-tree, ?en allemand muckenkraut,
CaraSere générique.
La fleur eft cômpôfée de plufieurs fleurons réunis
dans un calice commun , écailleux & cylindrique :
les uns font femelles Sc les autres hermaphrodites c
ceux-ci font des tubes évafés qui renferment cinq
étamines déliées , àvec un embryon oyale : qet embryon
devient une-femence unique, courte & menue
, terminée par une longue aigrette. Ils ne different
des fleurons femelles qu’en ce que ces, derniers
font dépourvus d’étamines.
Efptces'.
ï . Bacharite à feuilles ovale-renveriees, crénelées,,
dans la partie fupérieure. Bâchante de Virginie.
Bacharis foins obversé ovatis., fuperrû emarginato-
crenatis, Linn. 'Sort. Cliff.
Virginia groundfel-tr.ee with an Orach leaf. ,
a. Bâchante à feuilles -lancéolées , dentelées dans
ïoute leur longueur.
Bacharis foliis la-nceo lotis longltudinalittr dentato-
■ ferratis.. Soft. Cliff.
A fric an t'ree groundfel with àfavPd leaf.
La première -ëfpece s’élève à fept ou huit pieds
B A D
de hauteur fur plufieurs tiges courbes : elle donne
en o r io b r e des fleurs blanches & un peu purpurines,
mais qui n’ont pas grande apparence : cependant
comme fes feuilles épaiffes & grades ne tombent
que par les très-fortes gelées, on fait cas de cet ar-
buffe pour le placer dans les bofquets d’été Sc d’automne
, on la multiplie de boutures qu’on plante en
avril & en mai, dans une plate-bande à l’expofition
du levant. Dès l’automne on pourra les tranfplanter
à demeure.
Dans le climat où je fais rites expériences§ je me
fuis mieux trouvé de mettre mes boutures dans des
pots fur une couche tempérée Sc convenablement
ombragée ; je les en tire en automne pour les planter
chacune féparement dans un pot, Si. lorfqu’elles y -
ont paffé un an, je les tranfplante où je veux qu’elles
reftent. Cette bâchante réfifte à nos hivers ordinaires
; mais fi le froid devenoit exclufif, il faudroit
la couvrir, félon la méthode détaillée à Xarticle A l a -
t e r n e , Sc à tout événement il convient de mettre
de la menue litiere à fon pied.
•L’efpece n°. z . a été apportée du cap de Bonne-
Efpérance , mais elle croît aufli dans le Pérou, Sc
dans d’autres parties de l’Amérique. Elle fe multiplie
de boutures. C’eft une plante de ferre qui pourroit,
à l’air libre, fupporter des hivers qui ne feroient
pas trop rigoureux. (M. le Baron d e T s c h o v d i .)
* § BAÇHARA, (Géogr.) ville de la grande Tar-
tarie en Afie, dans L’Usbeck ; & B o c k a r a * ville
affez conlidérablë dans le Zagatai en Afie j font la,
même ville. Nicolle de la Croix la place-fur le
Gihon. Lettres fur £ Encyclopédie.
* BACHINA, (Géogr.) île de la Méditerranée,
fuivant Pline qui la place vis-à-vis-la ville de Smirne.
* B ACHMUT, (Géogr.) ville de Rufîie ,-àu midi du
JDonce. Elle eft dans le gouvernement deWoronez,
Sc a une bonne fortereffe.
BACKEVÉEN, (Géogr.) petite ville des Pays-bas,
dans la province de Frife , près d’un grand marais,
vers les frontières de la feigneürie de Groningue.
( + ) B .
* § BACTRE, (Géogr.) on lit dans cet article du
Dicl. raif. des Sciences, Sic. que Baclre eft aujourd’hui
Bagdafan ou Termend ( life^ Termed). A l’article
Ba d a cHXAN , Badafchtan ou Buauskan, on lit que
quelques géographes prétendent que c ’eft l’ancienne
Baüres ; Sc l’on auroit du faire remarquer que B a-
dachxan Sc Bagdafan font la même ville. Enfin on
lit encore au mot Balch, que quelques géographes
la prennent pour Bactres ; Sc c’eft le fentiment de
M. de Lifle, mais-il ne paroît pas mieux fondé que
l’ autre.
* § « BACU, (Géogr.) ville de Perfe, dans la province
de Servan (Hfe{ Chirvan). Il y a près de la
ville une fource qui jette une liqueur noire dont on
fe fert par toute la Perfe, au lieu d’huile à brûler».
C’ eft le naphte. Voyc{ le voyage d’Oleàrius, Sc le
Dicl. géogr. de la Martiniere, au mot Baku. Lettres
fur £ Encyclopédie.
BA D A V où Ba d au t , (Hifi.rnod.) les Parifiens
qui faifoient un grand commerce par eau , furent
ainfi appellés : en Celtique badaw fignifie hommes de
bateaux , hommes de vaiffeaux.
La reffemblance de ce mot avec celui de badaut,
autre terme de la même Tangue qui fignifie un fo t,
un niais, l’a fait confondre avec ce dernier ; & on
en a fait un fobriquet auffi faux qu’injurieux pour
les habitans de la capitale. Difftrt. de M. Bullet,
pag. 32 , 1 y y.1. ( C. )
BADERA, f. m. ( Hifi. nat. Botanique. ) plante
du Malabar, qui croit dans les terreins fablonneux ,
humides. Les Brames l’appellent badera-mufta, & les
Malabarespee-mottenga, comme qui diroit r/mfia fau-
yage, ou mottenga fauyage, Ç’eft fous ce d e rn ie r nom
B A D
'pte-mottenga, qu’elle a été figurée par Van-Rheede,
dans fon Hortus Malabaricus, volume X I 1 page 00
planche LUI. . r 6 9
D’un faifceau de deux cens racines fibreufes
brunes, noirâtres, menues d’une demi-ligne à une
ligne de diamètre » longues de trois pouces, ondées
, enfoncées perpendiculairement ou divergentes,
fous un angle de quarante - cinq dégrés ,
s eleve un faifceau de trente à quarante feuilles environ,
triangulaires, longues de trois à huit pouces,
larges de deux lignes, écartées fous un angle de
quarante-cinq dégrés, formant à leur origine une
gaîne entière , par laquelle elies s’embraffent réciproquement.
Ce faifceau eft comme compofé de
trois à quatre faifceaux ou bourgeons plus petits ,
chacun de dix feuilles environ , du centre duquel
fort une tige triangulaire brune, d’une ligne à une
ligne & demie au plus de diamètre , longue de huit
à neuf pouces, fimple, couronnée par quatre feuilles
triangulaires, femblables à celles des racines , mais
plus petites, longues de trois à quatre pouces, fans
game , pendantes e n b a s fous un angle de quarante
cinq dégrés.
Au fommet de cette tige, & du centre de ces
quatre feuilles, fort une tête fphérique, brune, fèf-
de fix à fept lignes de diamètre, formée de
l’aflemblage d’une centaine de fleurs hermaphrodites
, confiftantes chacune en un calice à deux
feuilles ou deux valves triangulaires, pointues ,
concaves, en nacelle,,comprimée parles côtés, &
& à dos aigu, en une corolle à deux valves , pareilles
à celles du calice, en trois étamines à ‘anthères
----- - — Ö ——- • * w » a u t , eu U iunua iu ,
devient une-graine nue , ovoïde, brune.
Qualités. Les racines fibreufes du badera ont, une
faveur acre, & une odeur aromatique très-agréable,
, fur-tout lorfqu’elles font feches.
Culture. Cette plante eft vivace , & f e multiplie
par les rejettons ou faifceaux qu’on fépare , ou qui
fe féparent d’eux-mêmes du maître faifceau.
Ufages. Les Malabares oignent leur corps avec
l’huile, dans laquelle on a fait cuire cette plante,
pour en difliper les démangeaifons. Sa déco&ion dans
l’eau , appaife la foif, & celle de fes racines fe
boit avec fuccès dans les fievres ardentes.
Remarques. Le badera n’a encore été rapporté par
aucun botanifte à fon genre naturel. Van-Rheede l ’a
rapporté à celui du mottenga ; mais le mottenga ,
d’après la difpofition de. fes fleurs en têtes , com-
pofées d’épis, applatis par les côtés, & d’après les tubercules
odoriférans de fes racines, nous paroît être
efpece de. fouchet, au lieu que le badera nous
paroît convenir parfaitement dans toutes fes parties
, à une plante que nous avons découverte au
Senegal, qui a les fleurs telles que nous.les avons,
décrites , & que nous pouvons affurer, d’après nos
oblervarions, être un genre voifin de là bobarta de,
M. Linné , mais différent dans la feéiion des fou-,
chets, que nous avons fait la neuvième dans la famille
des gramens. Voye{ nos Familles des plantes,
partie I I , page 41. ( M. A d a n SON. )
BADIRI, f. m. ( Hiß. nat. Botaniq. ) plante de la
»mille des arons »décrite, fans aucune figure, par
umphe , dans fon Herbarium Amboinicum , volume
> PaSe4871 f°us la dénomination d’adpendix erecla,
du nom Malays tapanawa badiri, qui veut dire ta-
panawa elévé ou non rampant. . -,, „
A u" e plante traçante, qui croît dans les fo-
rets les plus épaiffes Si les plus ombragées, fans
v e\ 6r ^Ù'delà de quatre, ou cinq pieds , Si fans
s implanter fur les arbres » mais en s’appuyant feulement
fur les arbriffeaux yoifins d’elle. Sa tige eft
peu finueufe, épaiffe d environ un pouce, comme
B A D 743
«arquée de plufieurs articulations, qui ne font que
. les veftiges des feuilles qui font précédemment tom-
; ,s .’ cendrée-verte, comme herbacée, fongueufe
mténeurement, & remplie d’une moelle téndre .
oc le divife, à la hauteur d’un pied environ, en
plufieurs branches affez fouples.
Les feuilles couronnent le fommet de cette tiee &
de les branches , où elles font difpofées circulaire-
;ment & fort rapprochées , portées fur un pédicule
demi-cylindrique , creufé en canal , & qui forme
une graine fendue jufqu’à fon origine, qui embraffe
neanmoins tout le tour de la tige. Chaque feuille eft
elliptique, pointue aux deux extrémités, longue d’un
M i de cinT pouces, d’un verd noirâtre ,
épaiiie liffe, unie, entière, marquée d’un pro-
fond fillon en-deffus, & relevée en-deffous d’une
cote oppofee, fans aucune nervure : elle n’eft point
articulée fur fon pédicule, comme dans la plupart
des autres efpeces de tapanawa.
Ses fleurs fortent de l’aiffelle des feuilles, enve-
lopeesd abord, comme dans l’anapul,dans une gaîne
qui, en s ouvrant, leslaiffe voir d’abord comme une
efpece d’épi ou de chatton pendant, couvert de
petites fleurs felliles, jaunes^foncées, compofées
d un calice a quatre feuilles, de quatre étamines
Sc d un ovaire. Ces ovaires, en mûriffant, deviennent
chacun une baie ovoïde, de la grandeur Sc forme
d’une olive, d’un beau rouge de fang , à une loge
contenant une graine de même forme.
Qualités. Toute cette plante a une faveur fade
d abord, mais qui enfuite eft âcre & mordicante ,
comme dans 1 arum Sc le dracunculus.
Ufages. Les habitans d’Anfboine ne font aucun
ulage médicinal de cette plante, ils emploient feulement
fes branches fouplesavec leurs feuilles, pour
fouetter legerement leurs enfans, pendant qu’ils les
exercent à la courfe , perfuadés qu’elle a la vert»
de les faire marcher feuls promptement, fondés fur
ce qu elle a la faculté de fe foutenir droite, lorf»
qu après avoir atteint la hauteur d’un pied , elle
trouve un appui fur les arbriffeaux voifins.
Remarques. Le badiri ayant tous les caractères dutapanawa,
on ne peut douter qu’il n’en foitune
efpece , Sc par conféquent de la famille des arons
ou nous penfons. qu’on doit la placer , dans la troi-
fieme feéhon des plantes de cette famille , qui ont
un feul calice & un feul ovaire. ( M . A d a n son . )
§ BADUK.KA, f, m. ( Hiff nat. Botaniq. ) plante
du Malabar , très-bien gravée, quoique fans détails ,
par Van-Rheede dans fon Hortus Malabaricus, volume
VL, page toS , planche LV1I. Les Brames l'appellent
rana-mandaru , les Portugais tabal, les Hol-
landois quet-blam. M. LinnéT’appelloit en 1 7 0 dans
fon Sptcies plantarum, page 5oq, cap paris 3 baducca
inermis, foliis ovato-oblongis determinatï confettis pe—
rennanttbus ; dans la derniere édition de fon Syf-
tema natures imprimé en 1767, .il a changé cette dénomination
en celle-ci, capparis, 4 baducca ,pedun-
çulis unifions, foliis perennantibus ovato-oblongis dc-
terminat'e confettis nudis.
G eft un arbriflèau toujours v erd, qui s’élève à la
hauteur de cinq.a fix pieds, fous la forme d’un buiffon
conique , dont le tronc a deux pouces environ de:
diamètre, Sc eft couvert du bas en haut de branches
menues, longues , affez ferrées, difpofées circulai-
rement, & écartées fous un angle qui a à peine
quinze à vingt dégrés d’ouverture. ;-,
Ses feuilles font alternes , fort ferrées , difpofées,'
non pas c rculairement, mais fur un même plan le
long des branches , de forte que leur feuillage eft
applati. Elles font elliptiques, pointues aux deux
bo.uts , entières, téndres quoiqïi,’épaiffes, d’un verd
npir, longues de trois à quatre pouces, prefque deux
fois moins larges, liffes deffus, relevées en-deffous