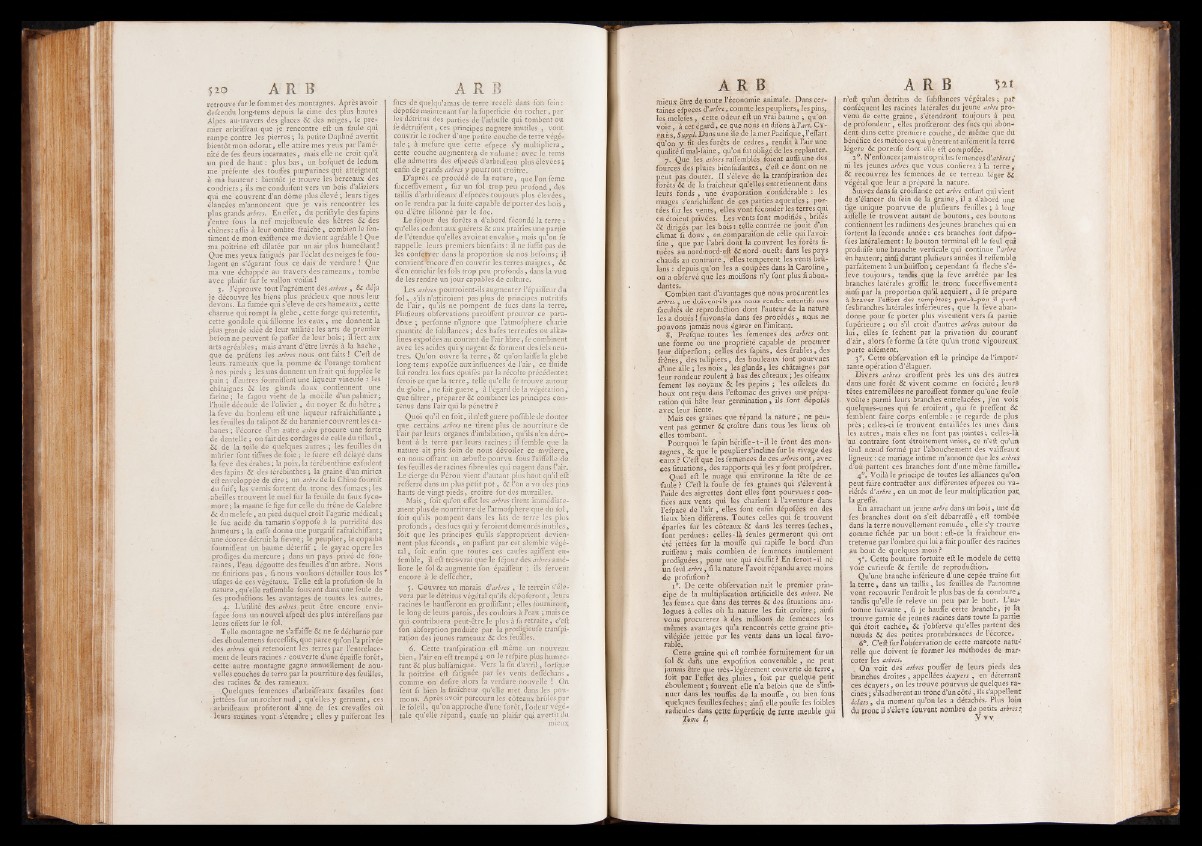
rçtrouve furie fommet des montagnes. Après avoir
defcendu long-tems depuis la cime- des plus hautes
Alpes au-travers -des glaces 8c des neiges, le premier
arbriffeau que, je rencontre eft un faule qui
rampe contre les pierres ; la petite Daphné avertit
bientôt mon o d o r a t , elle attire mes yeux par l’aménité
de fes fleurs incarnates, mais elle ne croît qu’à
un pied de haut : plus bas, un bofquet de ledum
me préfente des touffes purpurines qui atteignent
à ma hauteur : bientôt je trouve les berceaux des
coudriers ; ils me conduifent vers un bois d’aliziers
qui me couvrent d’un dôme plus élevé ; leurs tiges
élancées m’annoncent que je vais rencontrer les
plus grands arbres. En effet, du periftyle des fapins
j’entre fous la nef majeftueufe des hêtres & des
chênes : aflïs à leur ombre fraîche, combien le fen-
timent de mon exiftence me devient agréable !. Que
ma poitrine eft dilatée par un air plus humeûant!
Que mes yeux fatigués par l’éclat des neiges fe fou-
lagent en s’égarant fous ce dais’ de verdure ! Que
ma vue échappée au travers des rameaux, tombe
avec plaifir fur le vallon voifin !
3. J’éprouve tout l ’a g rém en t des arbres , & déjà
je découvre les biens plus précieux que nous leur
devons. La fumée qui s’élève de ces hameaux, cette
charrue qui rompt la glebe, cette forge qui retentit,
cette gondole quifïllonne les eaux, me donnent la
plus grande idée de leur utilité : les arts de premier
befoin ne peuvent fe paffer de leur bois; iffert aux
•arts agréables ; mais avant d’être livrés à la hache ,
que de préfens les arbres nous ont faits ! C ’eft de
leurs rameaux que la pomme & l’orange tombent
à nos pieds ; les uns donnent un fruit qui fupplée le
-pain ; d’autres fourniffent une liqueur vineufe : les
châtaignes & les glands doux contiennent une
farine; le fagou vient de la moelle d’un palmier.;,
l’huile découle de l’olivier , du noyer & du hêtre,;
la feve du. bouleau eft une liqueur rafraîchiffantè ;
les feuilles du talipot & du bananier couvrent les cabanes
; l’écorce d’un autre arbre procure une fo r t e
de dentelle ; on fait des cordages de celle du tilleul,
& de la toile de quelques autres ; les feuilles du
mûrier font tiffues de foie ; lefucre eft délayé dans
la feve des érabes ; la poix, la térébenthine exfudent
des fapins & des térébinthes ; la graine d’un mirica
eft enveloppée de cire ; un arbre delà Chine fournit
- du fuif ; les vernis fo r t e n t du tronc des fumacs ; les
abeilles trouvent le miel fur la feuille du faux fyco-
more ; la manne fe fige fur celle du frêne de Calabre
8c dumelèfe, au pied duquel croît l’agaric médical ;
le fuc acidé du tamarin s’oppofe à la putridité des
humeurs ; la cafte donne une purgatif rafraîchiffant;
une écorce détruit la fievre; le peuplier, lecOpàïba
fourniffent un baume déterfif ; le gayac opéré les
prodiges du mercure ; dans un pays privé de fo'n^
t a in e s , l’eau dégoutte des feuilles d’un arbre. Nous
ne finirions pas , fi nous voulions détailler tous les *
. u fa g e s de ces végétaux. Telle eft laprofufion de la
- nature, qu’elle raffemble. fouvent dans une feule de
fes productions les avantages de' tputes les autres.
4.- L ’utilité des arbres peut être encore, envisagée
fous un nouvel afpeCt des plus intéreffans par
leurs effets fur le' fol.
Telle montagne ne s’affaiffe &: ne fe décharrie par
des éboulemens fucceflifs, que parce qu’on l’a privée
des arbres qui retenoient les. terres par l’entrelace-
ment de leurs racines : couverte d’une épaiffe forêt,
cette autre montagne gagne annuellement de nouvelles
couches de terre par la pourriture des feuilles,
- des racines & des rameaux.
.Quelques femences d’arbriffeaux faxatiles font
jettées fu r un rocher nud ; qu’elles y germent, ces
- arbrifleaux profiteront d’une de fes. crevaffes o ii
leurs racines vont s’étendre ; elles y puiferont les
fîtes de quelqu’amas de terre recelé dans fon fein:
dépofés-maintenant fur lafuperficie du rocher, par
les détritus des parties de l’arbufte qui tombent ou
fe détruifent, ces principes naguère inutiles. , vont
couvrir le rocher d’une petite couche de terre végétale
; à mefure que cette efpece s’y multipliera,
cette couche augmentera de volume : avec le tems
elle admettra des efpeces d’arbriffeau plus élevées ;
enfin de grands arbres y pourront croître.
D’après ce procédé dè la nature, que l’on feme
fucceffivement, fur un fol trop p,eu profond , des
taillis d’arbriffeaux d’efpeçes toujours plus élevées,
on le rendra par la fuite capable de porter d.es bois,
pu d’être fillonné par le foc. - .
Le féjour des forêts a d’abord fécondé la terre :
qu’elles cedent aux guérets 8c aux prairies une partie
ae l’étendue qu’elles avoient envahie-, mais qu’on fe
rappelle leurs premiers bienfaits : il ne fuffit pas de
les conferyer dans la proportion de nos befoins; il
convient encore d’en couvrir les terres maigres, 8c
d’en enrichir les fols trop peu profonds , dans la vue
de les rendre un jour capables de culture.
Les arbres pourroient-ils augmenter l’épaiffeur du
fol , s’ils n’attiroient pas plus de principes nutritifs
de l’air, qu’ils ne pompent de fucs dans la terre,
Plufieurs obfervations paroiflent prouver ce paradoxe
; perfonne n’ignore que l’atmofphere charie
quantité de fubftances ; des bafes terreufes ou alka-r
fines expofées au courant de l’air fibre, fe combinent
avec les acides qui y nagent 8c forment des fels neutres.
Qu’on ouvre la terre, 8c qu’on laiffe la glebe
long-tems expofée aux influences de l’air, ce fluide
lui rendra les fucs.épuifés par la récolte précédente-:
feroit-ce que la terre, telle qu’elle fe trouve autour
du globe , ne fait guère., à.l’égard de la végétation,
que filtrer, préparer & combiner les principes contenus
dans l’air q,ui la pénétré ?
Quoi qu’il en foit, il n’eft guere poffible de douter
que certains arbres ne tirent plus de nourriture de
l ’air par leurs organes d’imbibition, qu’ils n’en dérobent
à la terre par leurs racines ; il femble que la
nature ait pris foin de nous dévoiler ce myftere,
en nous offrant un àrbufte pourvu fous l’aiffelie de
fes feuilles de racines fibreufes qui nagent dans l’air.
Le cierge du Pérou vient d’autant plus haut qu’il eft
refferre dans un plus petit p o t , 8c l’on a vu des pins
hauts de vingt pieds, croître fur des murailles.
Mais ,;foit qü’en effet les arbres tirent immédiatement
plus de nourriture de l’atmofphere qué du fol,
foit qu’ils pompent dans les lits de terre les plus
profonds , des fucs qui y feroient demeurés inutiles,
fôit que les principes qu’ils s’approprient de viennent
plus féconds, en paflant par cet alembic végétal
, foit enfin - que toutes ces caufes agiffent en-
femble, il eft très-vrai que le féjour des arbres améliore
le fol & augmente fon épaiffeur : ils fervent
encore à le deffécher.
5. Couvrez un marais 8 arbres , le terrein s’élèvera
par le détritus végétal qu’ils dépoferont, leurs
racines le haufferont en grofliflant ; elles fourniront,
le long dé leurs parois, des couloirs à l’eau ; mais ce
qui contribuera peut-être le plus à fa retraite, c’eft
Ion abforption produite1 par la prodigièufe tranfpiration
des jeunes rameaux 8c des feuilles.
6. Cette tranfpiration eft même un nouveau
! bien, l ’air en eft trempé ; on le refpire plus humectant
8c plus balfamique. Vers la fin d’avril, lorfque1
la poitrine éft fatiguée par les vents defféchans ,
comm'e on defire alors la verdure nouvelle ! On
fent fi bien la fraîcheur qu’elle met, dans les poumons.
Après avoir parcouru les coteaux bridés par
, le foleil, qu’on approche d’une forêt, l’odeur végétale
qu’elle répand, caufe. un plaifir qui avertit du
• V- ' . ' ' • - piteux
mieux être de. toute l’économie animale. Dans certaines
efpeces d* arbre, comme les peupliers, les pins,
les melefes , cette odeur eft un vrai baume ; qu’on
vo ie , à cet égard, ce que nous en difons à l’art. Cy près,
Suppl. Dans une île de la mer Pacifique, l’eflart
qu’on y fit des forêts de cedres , rendit à l’air une
qualité fi mal-faine, qu’on fut obligé de les replanter.
7. Que les arbres raffemblés foient auffi une des
fôurces des pluies bienfaifantes, c’ eft ce dont on ne
peut pas douter. Il s’élève de la tranfpiration des
forêts 8c de la fraîcheur qu’elles entretiennent dans
leurs fonds , une évaporation confiderable : les
nuages s’enrichiflent de ces parties aqueuses ; portées
fur les vents, elles Vont féconder les terres qui
en étoient privées. Les vents font modifies , briies
& dirigés par les bois: telle contrée ne jouit d’un
climat fi doux , en comparaifon de celle quil’avoi-
fine , que par l’abri dont la couvrent les.,forêts fi-
tuées au nord-nord-eft &nord-oueft: dans les pays
chauds au contraire, elles temperent les vents brû-
lans : depuis qu’on les a~ coupees dans la Caroline,
on a obfervé que les moiffons n’y font plus fi abondantes.
Combien tant d’avantages que nous procurent les
arbres, ne doivent-ils pas nous rendre attentifs aux
facultés de reproduction dont l’auteur de la nature
les a doués ! fuivons-la dans fes procédés, nous ne
pouvoris jamais nous égarer en l’imitant.
8. Prefque toutes les femences des arbres ont
une forme ou une propriété capable de procurer
leur difperfion ; celles des fapins, des érables, des
frênes, dès tulipiers, des bouleaux font pourvues
d’une aîle ; les noix, les glands, les châtaignes par
leur rondeur roulent à bas des côteaux ; les oifeaux
fement les noyaux 8c les pépins ; les offelets du
houx ont reçu dans l’eftomac des grives une préparation
qui hâte leur germination, ils font dépofés
avec leur fiente.
Mais ces graines que répand la nature ; ne peuvent
pas germer 8c croître dans tous les lieux où
elles tombent.
Pourquoi le fapin hériffe-t-il le front des montagnes
, 8c que le peuplier s’incline fur le rivage des
eaux ? C’eft que les femences de ces arbres ont* avec
ces fituations, des rapports qui les y font profpérer.
Quel eft le nuage qui environne la tête de ce
faule? C’eft la foule de fes graines qui s’élèvent à
l’aide des aigrettes dont elles font pourvues : confiées
aux vents qui les charient à l’aventure dans
l’efpace de l’a i r , elles font enfin dépofées en des
lieux bien différens. Toutes celles qui fe trouvent
éparfes fur les coteaux 8c dans les terres feches,
font perdues: celles-là feules germeront qui ont
été jettées fur la moufle qui tapiffe le bord d’un
ruiffeau ; mais combien de femences inutilement
prodiguées, pour une qui réuflit? En feroit-il né
un feul arbre, fi la nature l’aYoit répandu avec moins
de profufion ?
i°. De cette obfervation naît le premier principe
de la multiplication artificielle des arbres. Ne
les femez que dans des terres 8c des fituations analogues
à celles où la nature les fait croître ; ainfi
vous procurerez à des millions de femences les
mêmes avantages qu’a rencontrés cette graine^ privilégiée
jettée par les vents dans un local favorable.
Cette graine qui eft tombée fortuitement fur un
fol 8c dafls une expofition convenable , ne peut
jamais être que très-légèrement couverte de terre ,
foit par l’effet des pluies, foit par quelque petit
éboulement ; fouvent elle n’a befoin que de s’ infi-
nuer dans les. touffes de la moufle, ou bien fous
quelques feuilles feches : ainfi elle pouffe fes foibles
radicules dans çgttp fupçrficie. dç terre meuble qui
Tern e /,
n’eft qu’un détritus de fubftances végétales ; pat
conféqiient les racines latérales' du jeune arbre provenu
de cette graine, s’étendront toujours à peu
de profondeur, elles profiteront des fuCs qui abondent
dans cette première couche, de même que du
bénéfice des météores qui pénètrent aifémertt la terre
légère 8c poreufe dont elle eft eompofée.
z°. N’enfôneez jamais trop ni les (ertiencesd’arbresj
ni les jeunes arbres que vous confierez à la terre ,
8c rècouvrez les femences,de ce terreau léger 8c
végétal que leur a préparé la nature.
Suivez dans fa eroiffarice cet arbre enfant qui vient
de s’élancer du fein de la graine, il a d’abord une
tige unique pourvue de plufieurs feuilles ; à leur
aiflelle fe trouvent autant de boutons, ces boutons
contiennent les rudimeiis des jeunes branches qui enr
fortent la fécondé année : ces branches font difpo-
fées latéralement : le bouton terminal eft le feul qui
produife une branche verticale qui continue l'àrbrt
en hauteur; ainfi durant plufieurs années il reffemble
parfaitement à un buiffon ; cependant fa fléché s’élève
toujours, tandis que la feve arrêtée par les
branches latérales groflit le tronc fucceffivement s
ainfi par la proportion qu’il acquiert, ilfe prépare
à braver l’effort des tempêtes; peu-à-peu il perd
fes branches latérales inférieures, que la feve abandonne
pour fe porter plus vivement vers fa partie
fupérieure ; ou s’il croît d’autres arbres autour de
lui, elles fe fechent par la privation du courant
d’air, alors fe forme fa tete qu’un tronc vigoureux
porte aifément.
30. Cette obfervation eft le principe de l’importante
opération d’élaguer.
Divers arbres croiffent près les uns des autres
dans une forêt 8c vivent comme en fociété ; leurs
têtes ’entremêlées ne paroiflent former qu’une feule
voûte: parmi leurs branches entrelacées, j’èri vois
quelques-unes qui fe éroiferit, qui fe preffent 8C
femblent faire corps erifemble: je regarde de plus
près ; celles-ci fe trouvent entaillées les unes dans
les autres, mais elles ne font pas jointes ; celles-là
'au contraire font étroitement unies, ce n’eft qu’urt.
feul noeud formé par l’abouchement des vaiffeauxi
ligneux : ce mariage intime m’annonce que les arbres
■ d’où partent ces branches font d’une même famille«'
40. Voilà le principe de toutes les alliances qu’on
peut faire contracter aux différentes efpeces ou variétés
d'arbre, en un mot de leur multiplication paÉ;
la greffe.
En arrachant uti jeune arbre dans un bois, une do
j fes branches dont on s’eft débarraffé, eft tombée
dans’ ia terre nouvellement remuée, elle s’y trouve
comme fichée par un bout : eft-ce la fraîcheur entretenue
par l’ombre qui lui a fait pouffer des racines
au bout de quelques mois ?
<6. Cette bouture fortuite eft le modèle de Cette
VOie curieufe 8c fertile de reproduction.
Qu’une branche inférieure d’une Cepée traîne fur
la terre, dans un taillis, les feuilles de l’autoiUrte
vont recouvrir l’endroit le plus bas de fa courbure *
tandis qu’elle fe releve un peu par le bout. L’automne
fuivante , fi je hauffe cette branche, je la
trouve garnie de jeunes racines dans toute la partie
qui étoit cachée, & j’obferve qu’elles partent deS
noeuds 8c des petites protubérances de l’ecorce.
6°. C’eft fur l’obfervation de cette marcote naturelle
que doivent fe former les méthodes de mar-
coter les arbres.
.O n voit des- arbres pouffer de leurs pieds des
branches droites, appellées écuyers , en déterrant
ces écuyers, on les trouve pourvus de quelques racines
; s’ils adhèrent au tronc d’ùn côté, ils s'appellent"
éclats, du moment qu’on les a détâchés. Plus loin
du tronc U s’élève fouvent nombre de petits arbres