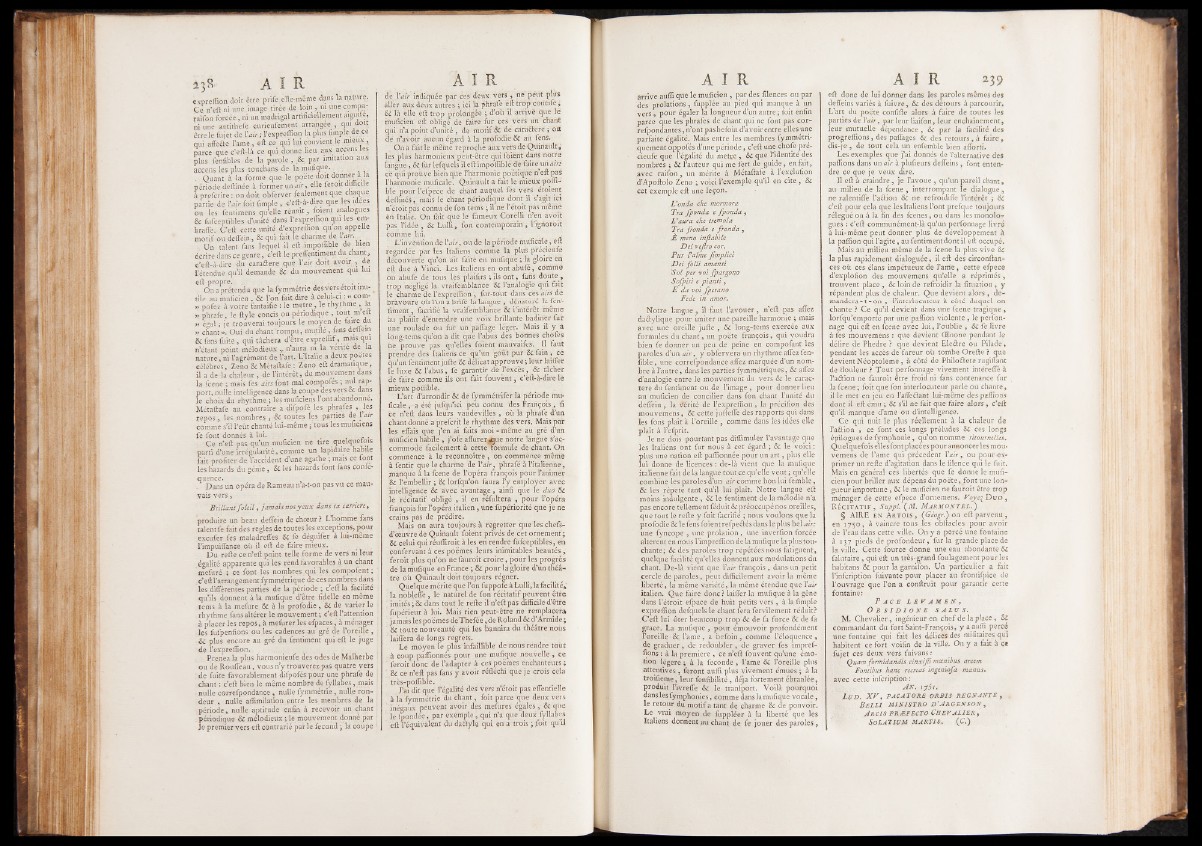
expreflion doit être prife. elle-même dans la nature.
Ge n’ eft ni une image tirée de loin ,- ni une compa-
raifon forcée., ni un madrigal artificiellement aiguiie,
ni une antithefe curieufoment arrangée,, qui doit
être le fu jet de Y air; l’expreflion la plus fimple de ce
qui affe&e l’ame, eft ce qui lui convient le mieux ,
parce que c’eft-là ce qui donne lieu aiix accens les.
plus fenfibles de la parole , & par imitation aux
accens les plus touçhans de la mufique. -,
. Quant à la forme que le poète doit donner a la
période deftinée. à former un air ,- elle feroit difficile
à prefcrire : on doit obferver feulement que .aJcl,u^
partie de Y air foit fimple , c’eft-à-dire que les idées
ou les fentimens qu’elle réunit, foient analogues
& fufceptibles d’unité dans l’expreflion qui les em-
braffe. C’eft cette unité d’exprefîion qu on appelle
motif oudeflein, & qui fait le charme de Yair.
■ Un talent fans lequel il eft .impoflible de bien
écrire dans ce genre, c’eft le preffentiment du chant,
e’eft-à-dire du cara&ere que Y air d o i ta y o ir , de
L’étendue quil demande & du mouvement qui lui
eft propre, . . . . .
. On a prétendu que la fymmétrie des vers etoit mu- -
tile au muiicien , & l’on fait dire à celui-ci : « com-
>> pofez à votre fantaifie : le métré, le rhythme s la
» phrafe, le ftyle concis ou périodique , tout meft
» égal ; je trouverai toujours le moyen de faire du
» chant ». Oui du chant rompu, mutilé , fans deüein
& fans fuite , qui tâchera d’être expreflif, mais qui
n’étant point mélodieux ,, n’aura ni la vente -de la
nature, ni l’agrément de l’art. L’Italie a deux poetes
célébrés, Zeno & Métaftafe : Zeno eft dramatique,
il a de la chaleur , de l’intérêt, du mouvement dans
la fcene ; mais fes airs font- mal compofes ; nul rapport,
nulle intelligence dans la coupe des vers & dans
le choix du rhy thme ; les muficiens l’ont abandonne.
Métaftafe au contraire a difpofe les'phrafes , les
repos,, les nombres , & toutes les parties de 1 air
comme s’il l’eût chanté lui-même ; tous les muficiens
fe font donnés.à lui. , .
Ce n’eft pas qu’un muficien ne tire quelquefois
parti d’une irrégularité, comme un lapidaire habile
fait profiter de l’accident d’une agathe ; mais ce font
les hazards du génie, & les hazards font fans confé-
quence.
Dans un opéra de Rameau n’a-t-on pas vu ce mauvais
v e r s ,
Brillant fo le il, jamais nos yeux dans ta carrure,
produire un beau deflein de choeur ? L’homme fans
talent fe fait des réglés de toutes les exceptions, pour
excufer fes maladreffes & fe déguifer à lui-meme
l’itnpuiflançe où il eft de faire mieux.
Du refte ce n’eft pqint telle forme de vers ni leur
.égalité apparente qui les rend.favorables à un chant
mefuré ; ce font les nombres qui les cpmpofent;
.c’eftl’arrangement fymmétrique de ces nombres dans
les différentes parties de la période ; c’eft la facilite
qu’ils donnent à la mufique d’être fidelle en même
tems à la mefure & à la profodie, & de varier le
rhythme, fans altérer le mouvement ; c’eft l’attention à placer les repos, à mefurer les efpaces , à ménager
les fufpenfions ou les cadences au gré de l’oreille ,
& plus encore au gré du fontiment qui eft le juge
de l’expreflion. , •
Prenez la plus harmonieufe des odes de Malherbe
ou de Roufleau, vous n’y trouverez pas quatre vers
de fuite favorablement difpofés pour une phrafe de
chant : c’eft bien le même nombre de fyllabes, mais
nulle correfpondance , nulle fymmétrie, nulle rondeur.,
nulle aflimilation entre les membres de la
.période, nulle aptitude enfin à recevoir un chant
périodique & mélodieux ; le mouvement donné par
le premier vers eft contrarié par le fécond ; la coupe '
de Vair indiquée par des deux vers , ne peut plus
aller aux deux autres ; ici là phrafe eft trop concife >
êé la elle èft trop proldrigèe ; d’où il arrive que le
muficien eft obligé dé faire fuir ceS vers un chant
qui n’à point d’unité , de motif & de carâ&'ere ; ou
dé ri’avoir aucun égard à la profodie & aù fens.
Ôna fait le même reproche aux vers-de Qiiinaultj'
les plus harmonieux peut-être qui foient dans notre
langue, & fur lefquels il eft impofliblé de faire un air;
ce qui prouve bien que l’harmonie poétique n’eft pas
l’harmonie muficale. Quinault a fait le mieux pofli-
ble pour l’elpece de chant auquel fes vers étoient
deftinéS, mais le chant périodique dont il s’agit ici
n’étôit pas connu de fort tems ; il ne l’étoit pas même
ên Italie! On fait que le fameux Corèlli n’en avoit
pas l’idée , & Lulli, fon contemporain , l’ignoroit
comme lui. ' _
L ’in v èn t i'o n de Y air, ou de la période muficale, eft
regardée par les Italiens comme la plus p r e c iè u fé
découverte qu’on ait faite en mufique ; là gloire en
eft due à Vinci. Les Italiens en ontabufé, comme
on a b u fe de tous les plaifirs ; ils ont, fans doute ,
trop négligé la. vraifomblance & l’analogie qui fait
ie charme de l’ e x p r e flio n , fur-tout dans ces airs dé
bravoure où l’on à brifé la langue , dénature le fon-
timent, facrifié la vraifemblance & l ’in té r ê t même
au plaifir d’entendre une voix brillante badiner fur
une roulade ou fur un pàflage léger. Mais il y à
long-tems qu’ort a dit que l’abus des bonnes chofes
ne prouve pas qu’elles foient mauvàifes. Il faut
prendre des Italiens ce qu’un goût pur & fain , cè
qu’un fentiment jufte & délicat approu ve ; leur laifler
le luxe & l’abus, fe garantir de l’excès , .& tâcher
de faire comme ils ont fait fouvènt, c’ëft-à-dire le
mieux poflible.
L’art d’arrondir & de fymmétrifer là période muficale
, a été jûfqu’ici peu connu des François., fi
ce n’eft dans leurs vaudevilles , où la phrafe d’un
chant donné a prefcrit le rhythme des vers, Mais par
les eflais que j’en ai faits moi - même au gre d’un
muficien habile , j’ôfe affurer«que notre langue s’accommode
facilement à cetteTformule de chant. On
commence à le reçonnoître , on commence même
à fentir que le charme de Y air, phrafé à l’italienne,
manque à la fcene de l’opéra françois pour l’animer
& l’embellir ; & lorsqu'on faura l’y employer avec
intelligence & avec avantage, ainfi qué le duo &
le récitatif obligé , il en réfultera , pour l’opéra
françois fur l’opéra italien, une fupérioritë que jë ne
crains pas de prédire.
Mais on aura toujours à regretter que les chefs-
d’oeuvre de Quiriault foient privés de cet ornement ;
& celui qui réufliroit à les en rendre fufceptibles, en
confervant à cés poëmes leurs inimitables beautés ,
feroit plus qu’on ne fauroit croire, pour les progrès
de la mufique en France ; & pour là gloire d’un théâtre
où Quiriault doit toujours régner.
Quelque mérite que l’on fuppofe à Lulli, la facilité*
la noblefle , le naturel de fon récitatif peuvent être
imités ; & dans tout le refte il n’eft pas difficile d’être
fupérieur à lui. Mais rien peut-être ne remplacera
jamais les poëmés de Thefée, de Roland & d’Armide ;
& toute nouveauté qui les bannira du théâtre noüs
' laiflera de longs regrets.
Le moyen le plùs infaillible de noüs rendre tout
. à coup-paflionnés pour une mufique nouvelle , ce
feroit donc de l’adapter à ces poëmes enchanteurs;
& ce n’eft pas fans y avoir réfléchi que je crois cela
très-poflible.
J’ai dit que Légalité dès vers n’étoit pas eflentielle
à la fymmétrie du chant, foit parce que deux vers
inégaux peuvent avoir des mefures égales, & que
le foondée, par exemple, qui n’a que deux fyllabes
eft l’équivalent du daâyle qui en’ a trois ; foit qu’il
arrive aufîi que le muficien, par des filences ou par
des prolations, fupplée au pied qui manque à un
v e r s , pour égaler la longueur d’un autre ; foit enfin
parce que les phrafes de chant qui ne font pas cor-
refpondantes, n’ont pas befoin d’avoir entre elles une
parfaite égalité. Mais entre les membres fymmetn-
quement oppofés d’une période, c’eft une chofe pre-
cieufe que l’égalité du mette , & que l’identite des
nombres ; & l’auteur qui me fort de guide, en fait,
avec raifon, un mérite à Métaftafe à l’exclufion
d’Apoftolo Zeno ; voici l’exemple qu’il en c ite , &
cet exemple eft une leçon.
Vonda che rriormora
Tra fponda e fponda ,
L ’dura che tremola
Tra fronda e fronda ,
È meno injlabile
Delvejlro cor.
Pur Palme Jimplici .
Dci folli amanti
Sol per voi fpargono
Sofpirï e pianti,
E du voi fperano
Fede in amor.
Notre langue, il faut l’avouer, n’eft pas allez
daâylique pour imiter une pareille harmonie ; mais
avec une oreille jufte , & long-tems exercée aux
formules du chant, un poëte françois, qui voudra
bien fe doriner un peu de peine en compofant les
paroles d’un air, y obforvera un rhythme allez fen-
fible, une correfpondance aflez marquée d’un nombre
à l’autre, dans les parties fym métriques, & aflez
d’analogie entre le mouvement du vers & le caractère
du fentiment ou de l’image , pour donner lieu
au muficien de concilier dans fon chant l’unité du
deflein , la Mérité de l’expreflion , la précifion des
mouvemens, & cette juftefîe des rapports qui dans
les fons plaît à l’oreille , comme dans les idées elle
plaît à l’efprit.
Je ne dois pourtant pas diflimuler l’avantage que
les Italiens ont fur nous à cet' égard ; & le voici :
plus une nation eft paflïonnée pour un a r t , plus elle
lui donne de licences : de-là vient que la mufique
italienne fait de la langue tout ce qu’elle veut ; qu’elle
combine les paroles d’un air comme bon lui femble,
&c les répété tant qu’il lui plaît. Notre langue eft
moins indulgente , & le fontiment de la mélodie n’a
pas encore tellement féduit & préoccupé nos oreilles,
que tout le refte y foit facrifié ; nous voulons que la
profodie & le fens foientrefpeftés dans le plus bel air:
une fyncope , une prolation, une inverfion forcée
altèrent en nous l’impreflion de la mufique la plus touchante;
& des paroles trop répétées nous fatiguent,
quelque facilité qu’elles donnent aux modulations du
chant. De-dà vient que Yair françois , dans un petit
cercle de pâroles, peut difficilement avoir la même
liberté, la même variété, la même étendue que Yair
italien. Que faire donc ? laifler la mufique à la gêne
dans l’étroit efpace de huit petits vers , à la fimple
expreflion defquels le chant fera fervilement réduit?
.C’eft lui ôter beaucoup trop & de fa force & de fa
grâce. La mufique , pour émouvoir profondément
l’oreille & l’ame , a befoin, comme l’éloquence,
de graduer, de redoubler, de graver fes impref-
fions : à la première , ce n’eft fouvent qu’une émotion
légère ; à la fécondé , l’ame & l’oreille plus
attentives , feront aufîi plus vivement émues ; à la
troifieme, leur fenfibilite, déjà fortement ébranlée ,
produit l’ivrefle & le tranfport. Voilà pourquoi
dans les fymphonies, comme dans la mufique vocale,
le retour du motif a tant de charme &c de pouvoir.
Le vrai moyen de fuppléer à la liberté que les
Italiens donnent pu chant de fe jouer des paroles ,
eft donc de lui donner dans les paroles mêmes des
defleins variés à fuivre, & des détours à parcourir»
L’art du poëte confifte alors à faire de toutes les
parties de l’air, parleur liaifon, leur enchaînement,
leur mutuelle dépendance , & par la facilité des
progreflions, des paffages & des retours, à faire,
dis-je , de tout cela un enfomble bien aflorti.
Les exemples que j’ai donnés de l’alternative des
pallions dans un air à plufieurs defleins, font entendre
ce que je- veux dire.
Il eft à craindre, je l’avoue , qu’un pareil chant,
au milieu de la fcene , interrompant le dialogue,
ne ralentifle l’a&ion & ne refroidiffe l’intérêt ; &C
c’eft pour cela que les Italiens l’ont prefque toujours
rélegué ou à la fin des fcenes, ou dans les monologues
: c’eft communément-là qu’un perfonnage livré
à lui-même peut donner plus de développement à
la paflion qui l’agite, au fentiment dont il eft occupé.
Mais au milieu même de la fcene la plus vive &
la plus rapidement dialoguée, il eft des circonftan-
ces où ces élans impétueux de l’anîe, cette efpece
d’explofion des mouvemens qu’elle a réprimés,
trouvent place , & loin de refroidir la fituation , y
répandent plus de chaleur. Que devient alors , demandera
t-on , l’interlocuteur à côté duquel on
chante ? Ce qu’il devient dans une fcene tragique ,
lorfqu’emporté par une paflion violente , le perfonnage
qui eft en fcene avec lui, l’oublie , & fo livre
à fes mouvemens : que devient QEnone pendant le
délire de Phedre ? que devient Ele&re ou Pilade,
pendant les accès de fureur où tombe Orefte ? que
devient Ncoptoleme , à côté de Philo&ete rugiflant
de douleur ? Tout perfonnage vivement intérefle à
l’acfion ne fauroit être froid ni fans contenance fur
la fcene; foit que fon interlocuteur parle ou chante,
il le met en jeu en l’affeclant lui-même des pallions
dont il eft ému ; & s’il ne fait que faire alors , c’eft
qu’il manque d’ame ou d’intelligence.
Ce qui nuit le plus réellement à la chaleur de
l’aftion , ce font ces longs préludes &c ces longs
épilogues de fymphonie, qu’on nomme ritournelles.
Quelquefois elles font placées pour annoncer les mouvemens
de l’ame qui precedent Yair, ou pour exprimer
un re.fte d’agitation dans le filence qui le fuit.
Mais en général ces libertés que fe donne le muficien
pour briller aux dépens du poëte, font une longueur
importune , & le muficien ne fauroit être trop
ménager de cette efpece d’ornemens. F o y e^ D u o ,
Ré c ita t if , Suppl. (M. M a r m o n t e l .')
§ AIRE en A r t o i s , (Géogr.) on eft parvenu,
en 17^0, à Vaincre tous les obftacles pour avoir
de l’eau dans cette ville. On y a percé une fontaine
à 137 pieds de profondeur, fur la grande place de
la ville. Cette fource donne une eau abondante Sc
falutaire , qui eft un très-grand foulagement pour les
habitans ôt pour la garnifon. Un particulier a fait
l’infcription fuivante pour placer au frontifpice de
l’ouvrage que l’on a conftruit pour garantir cette
fontaine:
P A C E L E V A M E S ,
O b s i d ï o n e $ A L U S.
M. Chevalier, ingénieur en chef de la place, &
commandant du fort Saint-François, y a auffi percé
une fontaine qui fait les délices des militaires qui
habitent ce fort voifin de la ville. On y a fait à ce
fujet ces deux vers fuivans :
Quant formidandis cinxifti mccnibus arcem
Fontibus liane récréas ingeniofa manus.
j avec cette infcription :
A n . [ y S i .
L ü D . X V , PACATORE ORRIS REGNANTE , .
B e LLI. M1N I S TR O D 'A R G E N S O N ,
A r c i s p r à f e c t o Ch e v a l i e r ,
S o L A T IU M M AR T LS. ( C . )