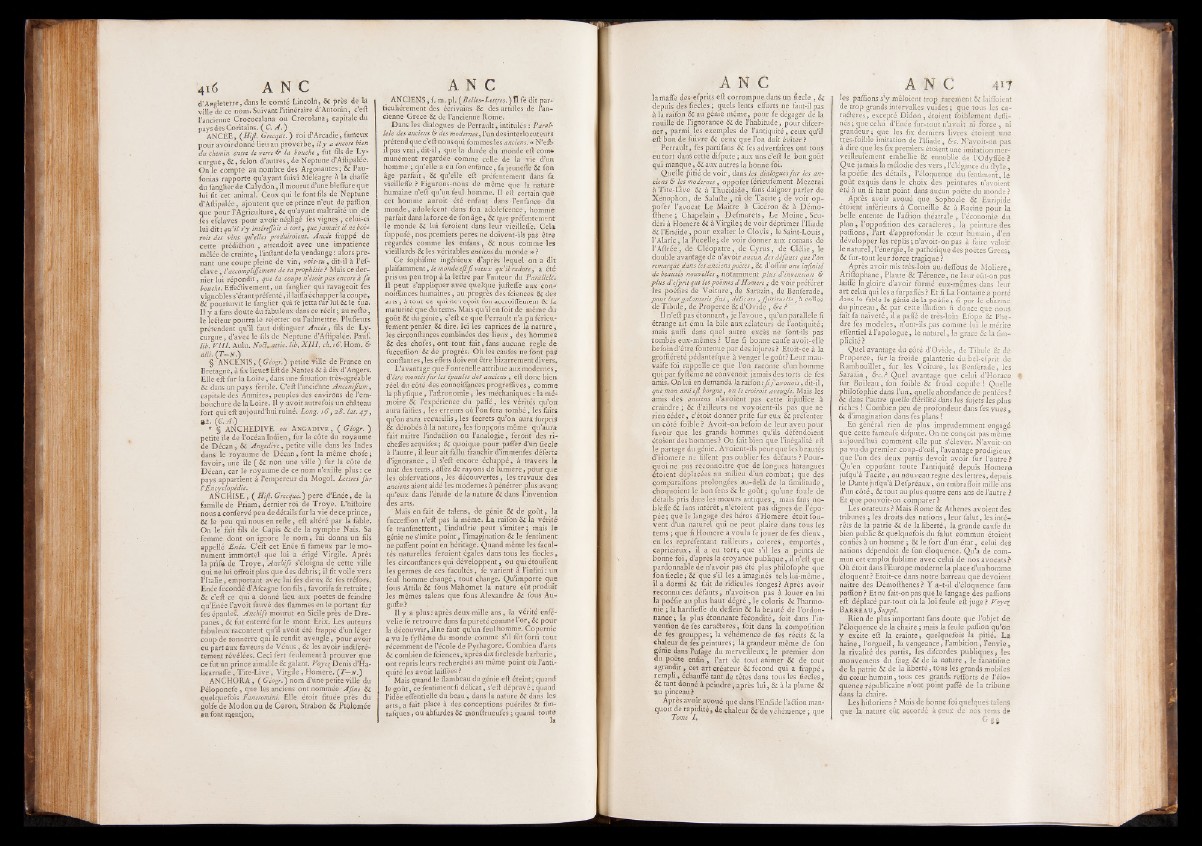
d’Angleterre, dans le comté Lincoln, & près de là
ville de ce nom. Suivant l’itinéraire d’Antonin, c’eft
l’ancienne Crococalana ou Crorolana , capitale du
pays des Coritains. (C i A .)
ANCÉE, {Hiß. Grecque.) foid*Arcadie, fameux
pour avoir donné lieu au proverbe, il y a encore bien
du chemin e'ntre le verre & la bouche , fut fils de Ly*
curgue, & , félon d’autres , de Neptune d’Aftipàléei
On le compte au nombre des Argonautes ; & Pau-
fonias rapporte qu’ayant fuivi Méléagre à la chaffe
du fanglier de Calydon, il mourut d’une bleffure que
lui fit cet animal. Ceux qui le font fils de Neptune
d’Aftipalée, ajoutent que ce prince n’eut de paflïon,
que pour l’Agriculture, & qu’ayant maltraite un de
les efclaves pour avoir négligé fes vignes , celui-ci
lui dit :q u il s'y intéreffoit d tort, que jamais il ne boi-
roit des vins qu'elles produiraient. Ancée frappé de
cette prédiétion , attendoit avec une impatience
mêlée de crainte, l’inftant de la vendange : alors prenant
une coupe pleine de vin, vois-tu, dit-il à l’ef-
clave V accompliffement de ta prophétie ? Mais ce dernier
lui répondit, que la coupe n étoit pas encore^ cl fa
bouche. Effectivement, un fanglier qui l'avageoit fes
vignobles s’étant préfenté, il laiffa échapper la coupe,
& pourfuivit le fanglier qui fe jetta fur lui & le tua.
Il y a fans doute du fabuleux dans ce récit ; au reite,
le leéteur pourra le rejetter ou l’admettre. Plufieurs
prétendent qu’il faut diftiriguer Ancée, fils de Lycurgue
, d’avec le fils de Neptune d’Altipalée. Pauf.
lïb. F 1II. Aulu. Nocl, attic. lib, X III. ch. iG. Hom. 6*
alii. (T—N.)
§ ANCENIS, ( Géogr.) petite ville de France en
Bretagne, à fix lieues-Eft de Nantes & à dix d’Angers.
Elle ell fur la Loire, dans une fituation très-agréable
& dans un pays fertile. C’ell l’ancienne Ancenifiüm,
capitale des Anmites, peuples des environs de l’embouchure
de la Loire. Il y avoit autrefois un château
fort qui ell aujourd’hui ruiné. Long. /<?, 28. lat. qy9
»2. (G .A f
* § ANCHEDIVE ou Angadive, {Géogr. )
petite île de l’océan Indien, fur la côte du royaume
de Décan, & Angedive, petite ville dans les Indes
dans le royaume de Décan,font la même chofe;
favoir, une île ( & non une ville ) fur la côte de
Décan, car le royaume de ce nom n’exifte plus: ce
pays appartient à l’empereur du Mogol. Lettres fur
VEncyclopédie.
ANCHISE , ( Hiß. Grecque.) pere d’Enée, de la
famille de Priam, dernier roi ae Troye. L’hiftoire
nous a confervé peu de détails fur la vie de ce prince ,
& le peu qui nous en refte , eft altéré par la fable.
On le fait fils de Capis & de la nymphe Nais. Sa
femme dont on ignore le nom, lui donna un fils
appellé Enée. C’eft cet Enée fi fameux par le monument
immortel que lui a érige Virgile. Après
la prife. de T ro y e , Anchife s’éloigna de cette ville
qui ne lui offroit plus que des débris; il fit voile vers
l’Italie, emportant avec lui fes dieux & fes tréfors.
Enée fécondé d’Afcagne fön fils, favorifa fa retraite ;
& c’eft ce qui a donné lieu aux poètes de feindre
qu’Enée l’avoit fauvé des flammes en le portant fur
les épaules. Anchife mourut en Sicile près de Dre-
panes, & fut enterré fur le mônt Erix. Les auteurs
fabuleux racontent qu’il avoit été frappé d’un léger
coup de tonnerre qui le rendit aveugle, pour avoir
eu part aux faveurs de Vénus, & les avoir indifcré-
tement révélées. Ceci fert feulement à prouver que
ce fut un prince aimable & galant. Foye[ Denis d’Ha-
licarnaffe , T ite-Live, Virgile , Homere. {T— n .)
ANCHORA, ( Géogr. ) nom d’une petite ville du
Péloponefe, que les anciens ont nommée Afine &
quelquefois Fdneromini. Elle étoit fituée près du
golfe de Modon ou de Coron, Strabon & Ptolomée
#n font mention.
ANCIENS ,'f. m. pl. { B elles-Lettres. ) t t fë dit par*
ticuliérement des écrivains & des artiftes de l’ancienne
Grece & de l’ancienne Rome;
Dans les dialogues de Perrault, intitulés : Parafa
lele des anciens & des modernes, l’un des interlocuteurs
prétend que c’eft nous qui femmes les anciens. « N’eft-
il pas v ra i, dit-il , que la durée du monde eft communément
regardée comme celle de là vie d’un
homme1; qu’elle a eu fon enfance, fa jeuneffe & fon
âge p a rfa it, & qu’elle eft présentement dans fa
vieilleffe ? Figurons-nous de même que la nature
humaine n’eft qu’un feuLhomme. Il eft certain que
cet homme auroit été enfant dans l’erifancè dit
monde, adolefcent dans fon adolefcence; homme
parfait dans la force de fon âg e, & que préfentemertt
le monde & lui feroient dans leur vieilleffe; Cela
fuppofé, nos premiers peres ne doivent-ils pas ê tre
regardés comme les enfans, & nous comme les
vieillards & les véritables anciens du monde >> ?
Ce fophifme ingénieux d’après lequel on a dit
plaifamment, le monde eflji vieux qu 'il radote, a été
pris un peu tro p à la lettré par l’auteur du Parâlleléi
11 peut s’appliquer avec quelque jufteffe aux cori-*
noiffances humaines, au progrès des fciences & des
a r ts , à to u t ce qui rie reçoit fon accroiffement & fa
maturité que du tems. Mais qu’il en foit de même du
goût & du g énie, c’eft ce que Perrault n’a pu férleti-*
fement penfer ôc dire. Ici les caprices de la n a tu re ,
les cirçonftançes combinées des lieu x , des hommes
& des chofes, ont to u t fa it, fans aucune réglé de
fucceffion & de progrès. Où les caufes ne font paS
confiantes, les effets doivent être bizarrement divers,
L’avantage que Fonterielle attribue aux modernes,
d'être montésfuries épaules des anciens , eft donc bien
réel du côté des connoiflanees progi'eflives, comme
la phyfique,- l’aftronomie, les méehaniques : la mé*
moire & l’expérience du paffé, les vérités qu’on
aura faifies, les erreurs o ù l’on fera tom b é , les faits
qu’on aura recueillis, les fecrets qu’on aura furpris
& dérobés à la nature, les foupçoris même qu’aura
fait naître l’induûion ou l’analogie, feront des ri-»
cheffes acquifes ; & quoique pour paffer d’un fiecle
à l’au tre , il leur ait fallu franchir d’immenfes déferts
d’ignorance, il s’eft encore échappé, à travers la
nuit des tem s, affez de rayons de lumière, pOuf que
les obfervations, les découverte s, les travaux des
anciens aient aidé les modernes à pénétrer plus avant
qu’eux dafis’ l’étude de la nature & dans l’invention
des arts.
Mais en fait de talens, de génie & de g o û t, la
fucceffion n’eft pas la même. La raifon & la vérité
fe trànfmettent, l’induftrie peut s’imiter ; mais le
génie ne s’imite p o in t, l’imagination & le fëntiment
ne paffent point en héritage. Quand m ême les facultés
naturelles feroient égales dans tous les fiecles,
les cifConftànces qui développent, ou qui étouffent
les germes de ces facultés, fe varient à l’infini : un
feul homme changé, tout change. Qu’importe que
fous Attila & fous Mahomet la nature eû t produit
les mêmes talens que fous Alexandre & fous Au-
gufte.?
Il y a plus: après deux mille a n s, la vérité enfé-
velie fe re trouve dans fa pureté comme l’o r, & pour
la découvrir, il ne faut qu’un feul homme. Copernic
a vu le fyftême du monde comme s’il fût forti tout
récemment de l’école de Pythagore. Combien d’arts
& combien de fciences, après dix fiecles de barbarie,
ont repris leurs recherches au même point où l’antiquité
les avoit laiffées ?
Mais quand le flambeau du génie eft éteint; quand
le go û t, ce fentimentfi délicat, s’eft dépravé ; quand
l’idée effentielle du b e a u , dans la nature & dans les.
arts, a fait place à des conceptions puériles & fari-
tafque s, ou abfurdes & tnonftrueufes ; quand toute
la
la maffe des efprits eft corrompue, dans un fiecle , &
depuis des fiecies ; quels lents efforts ne faut-il pas
à la raifon & au génie même, pouf fe dégager de la
rouille de l’ignorance & de l’habitude, pouf difcer-
ner, parmi lès exemples de l’antiquité, ceux qu’il
eft bon de fuivre & ceux que l’on doit éviter ?
Perrault, fes partifans & fes-ad verfaires ont tous
eu tort dans cette difpute ; aux uns c’eft le bon goût
qui manque, & aux autres la bonne foi.
Quelle pitié de voir, dans les dialogues fur les an-
tiens & Les modernes, oppofer férieufement Mezerai
à T i t e - L i v e & à Thueidide, fans daigner parler de
Xénophon, de Salufte , ni de Tacite ; de voir oppofer
l’avocat Le Maitre à Cicéron Si à Démo-
fthene ; Chapelain, Defmarets, Le Moine, Sèu-
déri à Homere & à Virgile; de voir déprimer l’Iliade
& l ’Enéide, pouf exalter le Clovis, le Saint-Louis,
l’Alaric, la Pucelle; de voir donner aux romans de
l’Aftrëe , dé Cléopâtre, de Cyrus, de Clélie, le
double avantage de n’avoir aucun des défauts que Von
remarque dans les anciens poètes, & d’offrir une infinité
de beautés nouvelles, notamment plus dinvention &
plus d'efprit que les poèmes d'Homere ; de voir préférer
les poéfies de Voiture, de Sarazin, de Benferade,
pour leur galanterie fine, délicate , fpitituelle, à celles
de Tibule, de Properce & d’Ovide , &c ?
Il n’eft pas étonnant, je l’avoue, qu’un parallèle fi
étrange ait ému la bile aux zélateurs de l’antiquité;
mais auffi dans quel autre excès né font-ils pas
tombés eux-mêmes ? Une fi bonne caufe avoit-elle
befoin d’être foütenue par des injures ? Etoit-ce à la
groffiéreté pédantefque à venger le goût? Leur, mau-
vaife foi rappelle ce que l’on raconte d’un homme
qui par fyftême ne convenoit jamais des torts de fes
amis. On lui en demanda la raifon :f i favouois, dit-il,
que mon ami efi borgne, on le croirait aveugle. Mais les
amis des anciens n’avoient pas cette injùftice à
craindre ; & d’ailleurs ne voyoient-ils pas que ne
rien céder, ç’étoit donner prife fur eux & préfenter
un côté foible ? Avoit-on befoin de leur aveu pour
favoir que les grands hommes qu’ils défendoient
étoient des hommes? On fait bien que l’inégalité eft
le partage du génie. Avoient-ils peur que les beautés
d’Homere ne fiffent pas oublier fes défauts ? Pourquoi
ne pas reconnoître que de longues harangues
étoient déplacées au milieu d’un combat; que des
comparaifons prolongées au-delà de la fimilitude,
choquoient le bon fens & le goût ; qu’une foule de
détails pris dans les moeurs antiques, mais fans no-
bleffe & fans intérêt, n’étoient pas dignes de l’épopée;
que le langage des héros d’Homere étoit fou-
vent d’un naturel qui ne peut plaire dans tous les
tems ; que fi Homere a voulu fe jouer de fes dieux,
en les repréfentant railleurs , coleres, emportés ,
capricieux, il a eu tort; que s’il les a peints de
bonne foi, d’après la croyance publique, il n’eft que
pardonnable de n’avoir pas été plus philofophe que
îonfiecle; & que s’il les a imaginés tels lui-même,
il a dormi & fait de ridicules fonges? Après avoir
reconnu ces défauts, n’avoit-on pas à louer en lui
la poéfie au plus haut dégré , le coloris & l’harmonie
; lahardieffe du deffein & la beauté de l’ordonnance;
la plus étonnante fécondité, foit dans l’invention
de fes caraèleres, foit dans la compofition
de fes grouppes ; la véhémence de fes récits & la
chaleur de fes peintures ; la grandeur même de fon
génie dans l’ufage du merveilleux ; le premier don
du poète enfin, l’art de tout animer & de tout
agrandir, cet art créateur & fécond qui a frappé,
rempli, échauffé tant de têtes dans tous les fiecles,
& tant donné à peindre, après lu i, & à la plume &
au pinceau?
Après avoir avoué que dans l’Enéide l’a&ion man-
quoit de rapidité, de-chaleur & de véhémence ; que
. Tome /. ,
les pâflîons s’y mêloient trop rarenient & laiffoient
de trop grands intervalles vuides; que tous les ca-
radreres, excepté Didori, étoient foiblement defîi-
n^syi. que celui d’Enée fur-tout n’avoit ni force , ni
grandeur; que les fix derniers livres étoient une
tçès-foible imitation de l’Iliade, &c. N’avoit-ôn pas
à dire que les fix premiers etoient une imitation mer-
veilleufement embellie & ennoblie de l’Odyffée ?
Que jamais la mélodie des vers, l’élégànee du ftyle ,
la poéfie des détails, l’éloquence du fentiment, lé
goût exquis dans le choix des peintures n’avoient
été à un fi haut point dans aucun poète du monde ?
Après avoir avoué que Sophocle & Èuripidé
étoient inférieurs à Corneille & à Racine pour la
belle entente de l’afHon théâtrale , l’économie du
plan, l’oppofition des caractères, la peinture des
pallions, l’art d’approfondir le coeur humain, d’en,
développer les replis; n’avoit-on pas à faire valoir
le naturel, l’énergie, le pathétique des poètes Grecs $
& fur-tout leur force tragique ?
Après avoir mis très-loin au-deffoüs de Moliere,
Àriftophane, Plaute & Térence, ne leur eût*on pas
laiffé la gloire d’avoir formé eux-mêmes dans leur
art celui qui les a furpaffés ? Et fi La Fontaine a porté
dans la fable le génie de la poéfie; fi par le charmé
du pinceau, & par cette illufion fi douce que nous
fait fa naïveté, il a paffé de très-lôin Efope & Phèdre
fes modèles, n’ont-ils pas comme lui le mérité
effentiel à l’apologue, le naturel, la grâce & la fim-
plicité ?
Quel avantage du côté d’Ovide, de Tibule & dé
Properce, fur la froide galanterie du bel-efprit dé
Rambouillet, fur les Voiture, les Benferade, les
Sarazin, &c.? Quel avantagé que celui d’Horace
fur Boileau, fon foible &t froid copifte ! Quelle
philofôphie dans l’un,. quelle abondance de penfées l
& dans l’autre quelle ftérilité dans les In jets les plus
riches ! Combien peu de profondeur dans fes vues,
& d’imagination dans fes pians !
En général rien de plus imprudemment erigagé
que Cette fameufe difpute. On ne conçoit pas même
aujourd’hui comment elle put s’élever. N’avoit-on
pa vu du premier cOup-d’oeil, l’avantage prodigieux
que l’un des deux partis devoit avoir fur l’autre ?
Qu’en oppofant toute l’antiquité depuis Homere
jufqu’à Tacite, au nouveau régné des lettres, depuis
le Dante jufqu’à D efpréaux, on eiribraffoit mille ans
d’un côté, & tout au plus quatre cens ans de l’autre ?
Et que pouvôit-on comparer?
Les orateurs ? Mais Rome & Athènes avoient des
tribunes ; les droits des nations, leur faîut, les intérêts
de la patrie & de la liberté, la grande caufe dit
bien public & quelquefois du falut commun étoient
confiés à un homme ; & le fort d’un état, celui des
nations dépendoit de fort éloquence. Qu’a de commun
cet emploi fublime avec celui de nos avocats ?
Où étoit dans l’Europe moderne la place d’un homme
éloquent ? Etoit-ce dans notre barreau que dévoient
naître des Démoftheries? Y a-t-il d’éloquence fans
paflïon ? Et ne fait-on pas que le langage des pallions
eft déplacé par-tout où la loi feule eft juge ? Foyeç
Ba r r e a u , Suppl.
Rien de plus important fans doute que l’objet de
l’éloquence de la chaire ; mais la feule paflïon qu’on
y excite eft la crainte, quelquefois la pitié. Là
haine, l’orgueil, la vengeance, l’ambitiori, l’envie ,
la rivalité des partis, les difcordes publiques# les
moüvemens du faog & de la nature , ie fanatifine
de la patrie & de la liberté, tous ies grands mobiles
du coeur humain, tous ces grands refforts de l’éloquence
républicaine n’ont point paffé dé la tribuné
dans la Chaire.
Les hiftoriens ? Mais de bonne foi quelques talenâ
que la nature eût accordé à ceux de nos tems de
G g ü