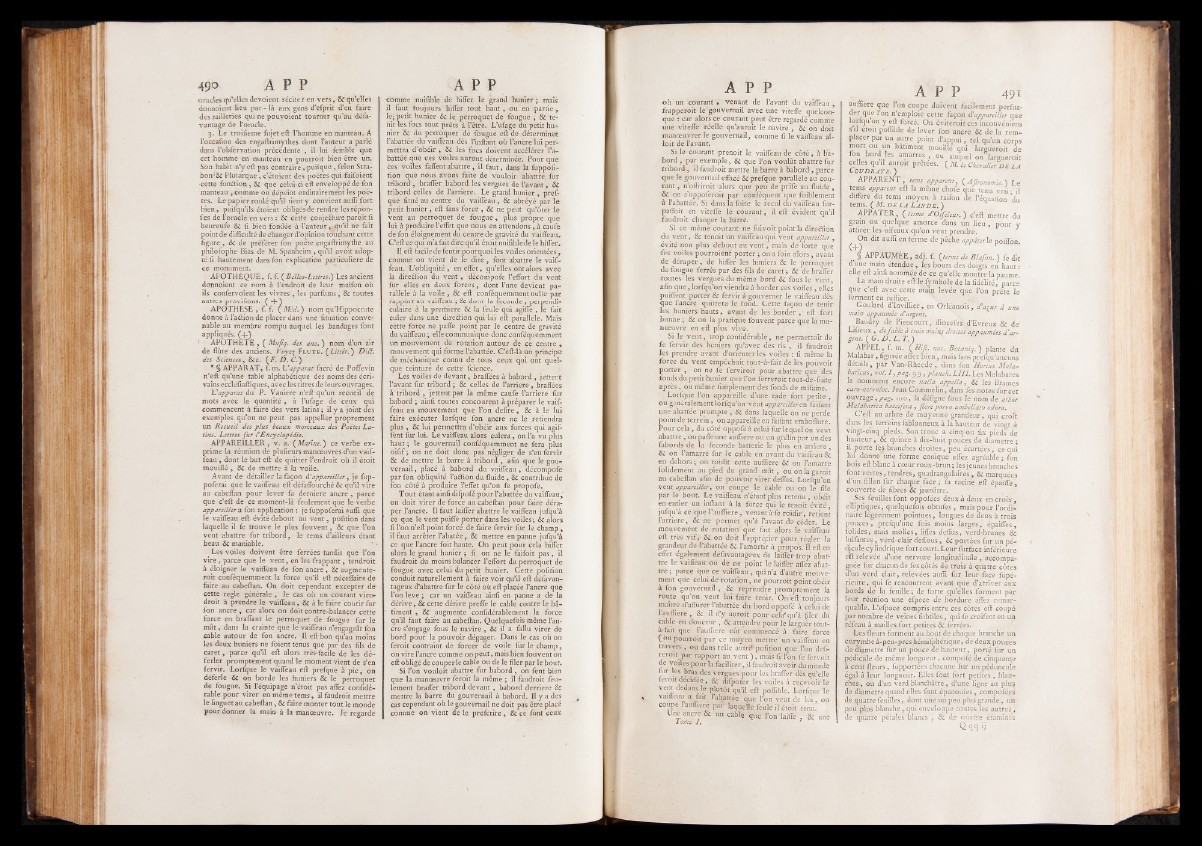
oracles qu’ elles dévoient réciter en vers, & qu’elles
donnoient lieu par - là aux gens d’efprit d’en faire
des railleries qui ne pouvoient tourner qu’au défa-
vantage de l’oracle.
3. Le troifieme fujet eft l ’homme en manteau. A
l’occafion des engaftrimythes dont l’auteur a parlé
dans l’obfervation précédente , il lui femble que
cet homme en manteau en pourroit bien être un.
Son habit n’y eft pas contraire, puilque, félon Stra-
bon'& Plutarque, c’étoient des poètes qui iaifoient
■ cette fondion, & que celui-ci eft enveloppé de fon
manteau ,-comme on dépeint ordinairement les poètes.
Le papier roulé qu’il tient y convient auffi fort
bien, puifqu’ils étoient obligés de rendre les répon-
f es de l’oracle en vers : & cette conjefture paroît fi
heureufe & fi bien fondée à l’auteur, qu’il ne fait
point de difficulté de changer d’opinion touchant cette
figure , & de préférer fon poëte engaftrimythe au
philofophe Bias de M. Spanheim , qu’il avoit adopté
fi hautement dans fon explication pàrticuliere de
ce monument.
APOTHÉQUE, f. f. ( Belles-Lettres.) Les anciens
donnoient ce nom à l’endroit de leur maifon oit
ils confervoient les vivres , les parfums, & toutes
autres provisions. ( + )
APOTHESE , f. f. ( Méd. ) nom qu’Hippocrate
donne à l’aétion de placer dans une fituation convenable
au membre rompu auquel les bandages font
appliqués. (+ )
APOTHETE , ( Mujîq. des anc. ) nom d’un air
de flûte des anciens. Voye\ Fl û t e . ( Luth. ) Dici.
des Sciences, &c. (F . D. C. )
* § APPARAT, f. m. L 'apparat facré de Poffevin
n’eft qu’une table alphabétique’ des noms des écrivains
eccléfiaftiques, avec les titres de leurs ouvrages.
1?apparat du P. Vaniere n’eft qu’un recueil de
mots avec la quantité , à l’ufage de ceux qui
commencent à faire des vers latins ; il y a joint des
exemples qu’on ne peut pas appeller proprement
un Recueil des plus beaux morceaux des Poètes Latins.
Lettres fur C Encyclopédie.
APPAREILLER, v. a. ( Marine.) ce verbe exprime
la réunion de plufieurs manoeuvres d’un vaiffeau
, dont le but eft de quitter l’endroit où il étoit
mouillé , & de mettre à la voile.
Avant de détailler la façon à'appareiller, je fup-
poferai que le vaiffeau eft défaffourché & qu’il vire
au cabeftan pour lever fa derniere ancre , parce
que c*eft de ce moment-là feulement que le verbe
appareiller a fon application : je fuppoferai auffi que
le vaifleau eft évité debout au vent, pofition dans
laquelle il fe trouve le plus fouvent, & que l’on
veut abattre fur tribord, le tems d’ailleurs étant
beau & maniable.
Les voiles doivent être ferrées tandis que l’on
vire , parce que le vent, en les frappant, tendroit
à éloigner le vaifleau de fon ancre , & augmente-
roit conféquemment la force qu’il eft néceflaire de
faire au cabeftan. On doit cependant excepter de
cette réglé générale , le cas où un courant vien-
droit à prendre le vaifleau, & à le faire courir fur
fon ancre , car alors on doit contre-balancer cette
force en braffant le perroquet de fougue fur l.e
mât, dans la crainte que le vaifleau n’engageât fon
cable autour de fon ancre. Il eft bon qu’au moins
les deux huniers ne foient tenus que par des fils de
caret, parce qu’il eft alors très*-fa ci le de les déferler
promptement quand le moment vient de s’en
fervir. Lorfque le vaifleau eft prefque à pic, on
déferle & on borde les huniers & le perroquet
de fougue. Si l’équipage n’étoit pas affez confidé-
rable pour virer en même tems, il faudroit mettre
le linguet au cabeftan, & faire monter tout le monde
pour donner la main à la manoeuvre. Je regarde
■ comme nuifible de biffer le grand hunier ; mais
il faut toujours hiffer tout haut, ou en partie >
le - petit hunier & le perroquet de fougue , & tenir
les focs tout prêts à.l’être. L’ufage du petit hunier
îk du perroquet de fougue eft de déterminer
l’abattée du vaifleau- dès l’inftant où l’ancre lui permettra
d’obéir , & les focs doivent accélérer l’a-
battéé que ces voiles auront déterminée. Pour que
ces voiles faffent abattre, il faut, dans la fuppofi-
tion que nous avons faite de vouloir abattre fur
tribord , braffer bâbord les vergues de l’avant, &
tribord celles de l'arriéré. Le grand hunier , presque
fitué au centre du vaifleau, & abréÿé par le
petit hunier, eft fans force , & ne peut qu’ôter lè
vent au perroquet de fougue, plus propre que
lui à produire l’effet que nous en attendons , à caufe
de fon éloignement du centre de gravité du vaiffeau.;
C’eft ce qui m’a fait dire qu’il étoit nuifible de le hiffer.
11 eft facile de fentir pourquoi les voiles orientées,
comme on vient de le dire, font abattre le vaiffeau.
L’obliquité, en effet, qu’elles ont alors avec
la dire&ion du vent , decompofe l’effort du vent
fur elles en deux forces , dont l’une devient parallèle
à la voile , & eft conféquemment nulle par
rapport au vaiffeau ; & dont la fécondé , perpendiculaire
à la p rem iè r e & la feule qui agiffe , le fait
culer dans une d ir e f t io n qui lui eft parallèle. Mais
. cette force ne paffe point par le centre de gravité
du vaifleau ; elle communique donc conféquemment
un mouvement de rotation autour de ce centre,
mouvement qui forme l’abattée. C’eft-là un principe
de méchanique connu de tous ceux qui ont quelque
teinture de cette" fcience.
Les voiles de devant, braffées à bâbord , jettent
l’avant fur tribord ; & celles de l'arriéré, braffées
à tribord , jettent par la même caufe l’arriere fur
bâbord ; ainfi toutes concourent à préparer le vaiffeau
au mouvement que l’on defire, & à le lui
faire exécuter lorfque fon ancre ne le retiendra
plus , & lui permettra d’obéir aux forces qui agif-
fent fur lui. Le vaiffeau alors culera, on l’a vu plus
haut ; le gouvernail conféquemment ne fera plus
oifif ; on ne dôit donc pas négliger de s’en fervir
& de mettre la barre à tribord , afin que le gouvernail
, placé à bâbord du vaiffeau, décompofe
par fon obliquité l’a&ion du fluide , & contribue de
ion côté à produire l’effet qu’on fe propofe.
Tout étant ainfi difpofé pour l’abattée du vaiffeau,'
on doit virer de force au cabeftan pour faire déraper
l’ancre. Il faut laiffer abattre le vaiffeau jufqu’à
ce que le vent puiffe porter dans les voiles; & alors
fi l’on n’eft point forcé de faire fervir fur le champ ,
il faut arrêter l’abatée, & mettre en panne jufqu’à
ce que l’ancre foit haute. On peut pour cela hiffer
alors le grand hunier; fi on ne le faifoit pas, il
faudroit- du moins balancer l’effort du perroquet de
fougue avec celui du petit hunier. Gette pofition
conduit naturellement à faire voir qu’il eft défavan-
tageux d’abattre fur le côté où eft placée l’ancre que
l’on leve ; car un vaiffeau ainfi en panne a de la
dérive, & cette dérive preffe le cable contre le bâ-
' timent , & augmente confidérablement la force
qu’il faut faire au cabeftan. Quelquefois même l’ancre
s’engage fous le navire, & il a fallu virer de
bord pour la pouvoir dégager. Dans le cas où on
feroit contraint de forcer de voile fur le champ,
on vire l’ancre comme on peut, mais bien fouvent on
eft obligé de couper le cable ou de le filer par le bout.
Si l’on vouloit abattre fur bâbord , on fient bien
que la manoeuvre feroit la même ; il faudroit feulement
braffer tribord devant , bâbord derrière &c
mettre la barre du gouvernail à bâbord. Il y a des
cas cependant où le gouvernail ne doit pas être placé
comme on vient de le prefcrire, & ce font ceux
où un courant, venant de l’avant du vaiffeau,
frapperoit le gouvernail avec une vîteffe quelconque
: car alors ce courant peut être regardé comme
une /vîteffe réelle qu’auroit le navire , & on doit
manoeuvrer le gouvernail, comme fi le vaiffeau' al-
loit de l’avant.
Si le courant prenoit le vaiffeau de côté, à bâbord
, par exemple, & que l’on voulût abattre fur
tribord, il faudroit mettre la barre à bâbord, parce
que le gouvernail effacé & prefque parallèle au courant
, n’offriroit alors que peu de prife au-fluide,
& ne s’oppoferoit par conféquent que foiblement
à l’abattée. Si dans la fuite le recul du Vaiffeau fur-
paffoit en vîteffe le courant, il eft évident qu’il
faudroit changer la barre.
Si ce même courant ne fuivoit point la d ire S i on
du vent, & tenoit un vaiffeau qui veut appareiller ,
.évité non plus debout au v en t, mais de forte que
fes voiles pourroient porter ; o r r a foin alors, avant
de déraper, de hiffer lés huniers & le perroquet
de fougue ferrés par des fils de caret ; & de braffer
toutes les vergues du même bord & fous le vent ,
afin que, lorfqu’ori viendra à border ces voiles, elles
puiffent portér & fervir à gouverner le v a iffe a u dès
que l’ancre quittera le fond. Cette façon de tenir
les huniers hauts, avant de les border , eft fort
bonne ; & on la pratique fouvent parce que la manoeuvre
en eft plus- vive.
Si le v en t, trop considérable, ne permettoit de
fe fervir des huniers qu’avec des ris , il faudroit
les prendre avant d’orientex les voiles : fi même la
force du vent empêchoit tout-à-fait de les pouvoir
porter , on ne le ferviroit pour abattre que d es
fonds du petit hunier que l’on ferreroit tout-de-fuite
après, ou même Simplement des fonds de mifaine.
Lorfque l’on appareille d’une rade fort petite ,
ou généralement lorfqu’on'veut appareiller en faifant
une âbattée'prompte , & dans laquelle on ne perde
point de terrein, on appareille en faifant emboffure.
Pour cela, du côté oppofé à celui fur lequel on veut
abattre, on paffe une auffiere ou un grélin par Un des
fabords de la fécondé,batterie le plus en arriéré,
& on l’amarre fur le cable en avant du vaiffeau &
en dehors ; on roidit cette auffiere & on l’amarre
folidement au pied du grand mât, ou on la garnit
au cabeftan afin de pouvoir virer deffus. Lorfqu’on
veut appareiller, on coupe le cable ou on le file
par le bout. Le vaiffeau n’étant plus retenu, obéit
en entier un inftant à la force qui le tenoit évité
jufqu’à ce que l’auffiere, venant à'fe, roidir', retient ;
l’arriere, & ne permet qu’à l’avant de céder. Le
mouvement de rotation que fait alors le vaiffeau
eft très vif,- & on doit l’apprécier pour régler la
grandeur de. l’abattée & l’amortir à propos. Il eft en
effet également défavantageux de laiffer trop abattre
le vaiffeau ou de ne point le laiffer affez abattre
; parce que ce vaiffeau, qui n’a d’autre mouvement
que celui de rotation, ne pourroit point obéir
à fon gouvernail, & reprendre promptement la •:
route qu’on veut lui faire tenir. On eft toujours
maître d’aflurer l’abattée du bord oppofé à celui de ;
1 auffiere, & il n’y auroit pour cela' qu’à filer du
cable en douceur , & attendre pour le larguer tout-
a-fait que l’aufliere eût commencé à faire force
( on pourroit par ce m o y e n mettre un vaiffeau en
travers , ou dans telle autré pofition que l’on defi-
reroit par rapport au Vent ) , mais fi l’on fie fervôrit
de voiles pour la faciliter, il faudroit avoir du monde
fur les bras des vergues, pour les braffer dés qu ’ e lle
leroit décidée, & difpofer les voiles à recevoir le
vent dedans le plutôt qu’il eft poflible. Lorfque le
vaiffeau a, fait l’ab^ttée q u e l’on veut de lu i, on
coupe I auffiere par laquelle feule il étoit tenu.
- U” ■ *” “ ! * un «i orne «Me que l’on laiffe , & une /. 7
auffiere que l’on coupe doivent facilement perfua-
der que l’on n’emploie cette façon $ appareiller que
v? jfU y forcé. On éviteroit ces inconvéniens
s il étoit poflible de lever fon ancre & de la remplacer
par un autre point d’appui, tel qu’un corps
mort ou un bâtiment mouillé qui largueroit de
Ion bord les amarres ,,o u auquel on largueroit
celles qu il auroit prêtées. ( M. le Chevalier d e l a
C ou D R A Y E . )
APPARENT , tems apparent, ( Afironomie.) Le
tems apparent eft la même chofe que tems vrai - il
différé du tems moyen à raifon de l’équation du
tems. ( M . d e l a L a n d e . )
APPATER, ( terme (TOifeleur. ) c’eft mettre du
grain ou quelque amorce dans un lieu , pour y
attirèr les oifeaux qu’on veut prendre.
O” dit auffi en terme de pêche appâter le poiffon.
. § APPAUMÉE, adj. f. (terne de Blafon. ) fe dit
d une main etehdue, les bouts des doigts en haut :
elle eft ainfi nommée de ce qu’elle montre la paume.
La main droite eft le fymbole de la fidélité, parce
que c’eft avec cette main levée que l’on prête le
ferment en juftice.
G o u l à r d d ’ I n v i l l i e r , e n O r l é a n ô i s , ddaqur d une
main appaumée dl argent.
Baudry de Piençourtdiocefes d’Evreux & de
Lifieux , de fable a trois mains droites ap paumées d.' argent.
( G . D . 1 . t a
A P P E L , f. m. ( Hiji'• nat. Botaniq. ) plante du
Malabar', figurée aflez bien, mais fans prefqu’aucuns
détails, par Van-Rheede , dans fon Hortus Mala-
baricuSf v o l.I , pag. ^cf, planch. LUI. Les Malabares
la nomment encore nalla appella, & ' les Brames
• càrù-nervoloe. Jean Çommelin, dans fies notes fur cet
ouvrage, pag. 10 o, la dëfigne fous le nom de arbor
Maldbarica baccifera, flore parvo umbellato odoro.
Ç’eft un arbre dè moyenne grandeur, qui croît
dans les t'erreins fablonneux à ja hauteur de vingt à
Vingt-cinq pieds. Son tronc a cinq ou fix pieds de
hauteur, & quinze à dix-huit pouces de diamètre ;
il porté fes branches droites ,, peu écartées , ce qui
lui donne une forme conique affez agréable; fon
bois eft blanc à coeur roux-brun ; les jeunes branches
font vertes , tendres, quadrangulaires, & marquées
d’un fillon fur chaque face; fa racine eft épaiffe-,
couverte de fibres & jaunâtre.
' Ses feuilles font oppofçes deux à deux en croix ,
elliptiques, quelquefois obtufes, mais pour Tordi-
naife légèrement pointues, longues de deux à trois
pouces, prefqu’une fois moins larges, épaiffes,
folideS, mais molles, lifles deffus,, verd-brunes &
luifantes, verd-clair deffous, & portées fur un pédicule
cylindrique fort court. Leur furface inférieure
elft relevée d’une nervure longitudinale » accompagnée
fur chacun de fes côtés de trois à quatre côtes
d’un yérd clair, relevées auffi fur leur face fupé-
rieure, qui fe rencontrent avant que d’atriver aux
bords de la feuille; de forte qu’elles forment par
lèur réunion une efpece de bordure affez remarquable.
L’efpace compris entre ces côtes eft coupé
par nombre de veines fubtiles, ,qui fe croifent en un
réfeau à.mailles fort petites & ferrées.
Les fleurs forment au bout de chaque branche un
corymbe à-peu-près hémifphérique, de deux pouces
de diamètre fur un pouce de haiiteur, porté fur un
pédicule de même longueur, compofé de cinquante
à cent fleurs, fupportées chacune fur un péduncule
égal à leur longueur. Elles font fort petites , blanches,
ou d’un verd blanchâtre, d’une ligne au plus
de diamètre quand elles font épanouies, compofées
de quatre feuilles, dont une un peu plus grande, un
peu plus blanche, qui enveloppe toutes les autres;
dè quatre pétales blancs , 6c de quatre étamine^
Q q q q ■