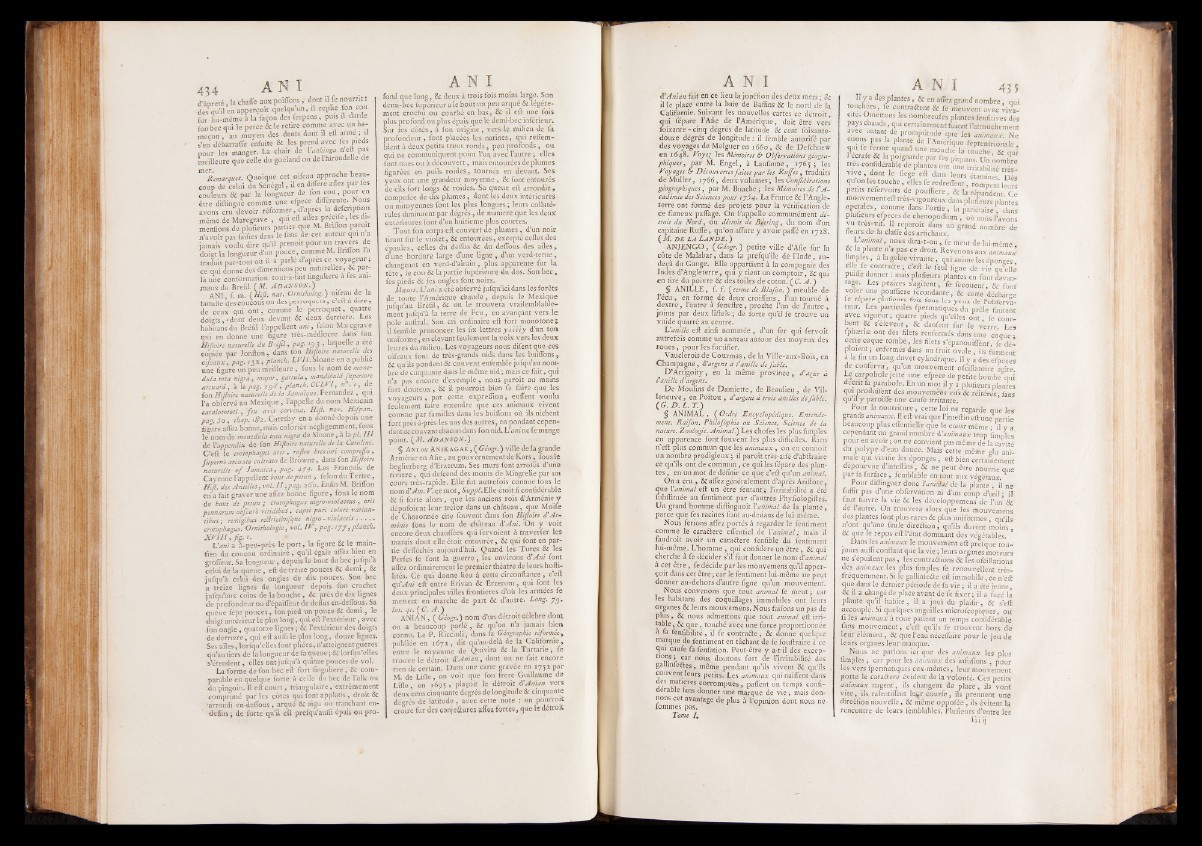
d’âoreté la chaffe aux poiffons,- dont il fe nourrit :
dès qu’il en apperçoit quelqu’un, il replie Ion cou
fur lui-même à la façon des ferpens , puis il darde
fon bec qui le perce & le retire comme avec un hameçon
, au moyen des dents dont il efl arme ; i
s’en débarraffe enfuite & les prend avec les pieds
pour les manger. La chair de l'anhmga ne« pas
meilleure que celle du goéland ou de l’hirondelle de
m!’Remarques. Quoique cet oifeau approche beaucoup
de celui du Sénégal, il'en différé allez par les
couleurs & par la longueur de f°n cou, P01“ en
être diffingué comme une efpece differente. Nous
avons cru devoir réformer, d’après la defcr.pt.on
même de Marcgrave , qui eft allez preerfe, les di-
menlions de plufieurs parties que M. Brillon paroît
n’avoir pas faif.es dans le fens de cet auteur qui n a
jamais voulu dire qu’il prenoit pour un travers de
doigt la longueur d’un pouce, comme M. Bnffon 1 a
traduit par-tout oh il a parle d’âpres ce voyageur;
ce qui donne des dimenfions peu naturelles , & par-
là une conformation foùt-à-fait finguhere à les animaux
du Brefil. ( M. A d a n s o n . )
ANI, f. m. {Hift. nat. Ornuholog. ) oifeau de la
famille des coucous ou des perroquets, c’eft-à-dire ,
de ceux qui ont, comme -le perroquet, quatre
doigts,-dont deux devant & deux derrière. Les
habitans du Bréfil l’appellent ani, félon Marcgrave
qui en donne une figure très-médiocre dans Ion
Hiftoire naturelle, du Bréfil, pag. 193 , laquelle a ete
copiée par Jonfton, dans fon Hiftoire naturelle des
oifeaux, pag. 132, planch. LVU. Sloane en a publie
une figure un peu meilleure, fous le nom de mone-
du La tôt a nigra, major, garrula, mandibulâ Juperiore
arcuatd, à la pag. zc>8 , planch. CCLVI, n . 1 , de
fon Hiftoire naturelle de la Jamaïque. Fernandez , q uiJ
l’a obfervé au Mexique, l’appelle du nom Mexicain
caçalotototl, feu avis corvina. Hift. nov. Hifpan.
Pa°. S o , chap. 182. Catesby en a donné depuis une
figure affez bonne, mais coloriée négligemment, fous
le nom de monedula tota nigra de Sloane, à la pi. III
de Yappendix de fon Hiftoire naturelle de la Caroline.
C ’eft le crotophagus ater, roftro breviori cômprejfo,
fupemï arcuato cultrato de Browne, dans fon Hiftoire
naturelle o f Jamaica, pag. 474- Les François de
Cayenne l’appellent bout depetun , felofi du Tertre,
Hift. des Antilles, vol. I l ,pag. 260. Enfin M. Briffon
en a fait graver une affez bonne figure, fous le nom
de bout de petun ; crotophagus nigro-violaceus , oris
pennarum obfcure viridibus, capri puri colore yarian-
tibus; remigibus reclricibufque nigro -violacés : . . . .
crotophagus. Ornithologie, vol. IV , pag. i j j , planch.
X V I I I , fig. 1. *■ ' .
U ani a à-peu-près le port, la figure & le maintien
du coucou ordinaire , qu’il égaie affez bien en
groffeur. Sa longueur, depuis le bout du bec jufqu’à
celui de la queue, eft de treize pouces & demi, &
jufqu’à Celui des ongles de dix pouces. Son bec
a treize lignes de longueur depuis fon crochet
jufqu’aux coins de la bouche, & près de dix lignes
de profondeur ou d’épaiffeur de demis en-deffous. Sa
queue fept pouces, fon pied un pouce & demi, le
doiot antérieur le plus long, qui eft l’extérieur, avec
fonongle, quatorze lignes ; & l’extérieur des doigts
de derrière, qui eft auffi le plus long, douze lignes.
Ses ailes, lorfqu’ellesfont pliées, n’atteignent gueres
qu’au tiers de la longueur de fa queue ; & lorfqu’elles
s’étendent, elles ont jufqu’à quinze pouces de vol.
La forme de fon bec eft fort finguliere , & comparable
en quelque forte à celle du bec de l’alk ou
■ du pingoin. Il eft court, triangulaire, extrêmement
comprimé par les côtés qui font applatis, droit &
'arrondi en-deffous , arqué & aigu ou tranchant en-
deffus ; de forte qu’il eft prefqu’auffi épais ou profofid
que long, & deux à trois fois moins large. Son
demi-bec fupérieur a le bout un peu arqué & légèrement
crochu ou courbé en bas,, & il eft une fois
plus profond ou plus épais que le demi-bec inférieur.
Sur fes côtés, à fon origine, vers de milieu de fa
profondeur, font placées les narines, qui reffem-
blent à deux petits trous ronds, peu profonds , ou
qui, ne communiquent point l’urç avec l’autre ; elles
font nues ou à découvert, mais entourées de plumes
figurées en poils roides, tournés en devant. Ses
yeux ont une grandeur moyenne , & font entourés
de cils fort longs & roides. Sa queue eft arrondie ,
compofée de dix plumes, dont les deux intérieures
ou mitoyennes font les plus longues ; leurs collaté-
raies diminuent par dégrés, de maniéré que les deux
extérieures font d’un huitième plus courtes.
Tout fon corps eft couvert de plumes, d’un noir
tirant fur le violet, & entourées, excepté celles des
épaules, celles du deffus & du deffous des ailes,
d’une bordure large d’une ligne, d’un verd-terne,
changeant en verd-d’airain, plus apparente fur la
tête, le cou & la partie fupérieure du dos. Son bec ,
fes pieds & fes ongles font noirs.
Moeurs. U ani a été obfervé jufqu’ici dans les forêts
de toute l’Amérique chaude, depuis le Mexique
jufqu’au Bréfil, & on le trouvera vraifemblable-
ment jufqu’à la terre de Feu, en avançant vers le
pôle auftral. Son cri ordinaire eft fort monotone;
il femble prononcer les fix lettres y i i i i y d’un ton
uniforme, en élevant feulement la voix vers les deux
lettres du milieu. Les voyageurs nous difent que ces
oifeaux font de très-grands nids dans les bluffons ,
& qu’ils pondent & couvent enfemble jufqu’au nombre
de cinquante dans le même nid; mais ce fait, qui
n’a pas encore d’exemple, nous paroît au moins
fort douteux, & il pourroit bien fe faire que les
~ voyageurs, par cette expreflion, euffent voulu
feulement faire entendre que ces animaux vivent
j comme par familles dans les buiffons où ils nichent
fort près-à-près les uns des autres, en pondant cependant
6c couvant chacun dans fon nid. U ani ne fe mange
point. ( M. A d a n so n .)
§ Ani ou â n ik ag a e , ( Géogr. ) ville de la grande
Arménie en A lié, au gouv ernement de Kars, fous le
beglierberg d’Erzerum. Ses murs font arrofés d’une
riviere, qui defeend des monts de Mingrelie par un
cours très-rapide. Elle fut autrefois connue fous le
nom à’Am. V. ce mot, Suppl. Elle étoit fi confidérable
& fi forte alors , que les anciens rois d’Arménie y
dépofoient leur trefor dans un château, que Moïfe
de Choronnée cite fouvent dans fon Hiftoire £ Arménie
fons le nom de château d'Ani. On y voit
encore deux chauffées qui fervoient à traverfer les
marais dont elle étoit entourée, & qui font en partie
defféchés aujourd’hui. Quand les Turcs & les
I Perfes fe font la guerre, les environs à'Ani font
affez ordinairement le premier théâtre de leurs hofti-
litës. Ce qui donne lieu à cette circonftance, c’eft
au*Ani eft entre Erivan & Erzerum, qui font les
I deux principales villes frontières d’où les armees fe
j mettent en marche de part & d’autre. Long. 79.
j lat. 41. ( C. À.')
ANIAM, ( Géogr.) nom d’un détroit célébré dont
on a beaucoup parlé, & qu’on n’a jamais bien
' connu. Le P. Riccioli, dans la Géographie réformée,
publiée en 16 7 1 , dit qu’au-delà de la Californie,
entre le royaume de Quivira & la Tartarie, fe
; trouve le détroit à’Anian, dont on ne fait encore
: rien de certain. Dans une carte gravée en 1752 par
M. de Lille, on voit que fon frere Guillaume de
Lille en 1695 , plaçoit le détroit d’Anian vers
deux cens cinquante dégrés de longitude & cinquante
dégrés de latitude, avec cette note : on pourroit
croire fur des conjectures affez. fortes, que le détroit
d’Anîan fait en ce lieu la jop&ion des deüx mers ; &
il le place entre la baie de Baffins & le nord dé la
Californie. Suivant les nouvelles cartes ce détroit,
qui fépare l’Afie de l’Amérique, doit être vers
foixante - cinq dégrés de latitude & cent foixante-
douze dégrés de longitude: il femble autorifé par
des voyages de Melguer en 1660 , & de Defchne-w
en 1648. Voye£ 1 es Mênfoires & Obfervatiôns géographiques,
par M. Engel, à Laufanne, 176 5 ; lés
Voyagts & Découvertes faites par les Rujfes, traduits
de Muller, 1766, deux volumes; les Conjidéra'tions
géographiques, par M. Buache ; les Mémoires: de l 'A cadémie
des Sciences pour tpS^. La France & l’Angleterre
ont formé des projets pour la vérification de
ce fameux paffage. On l’appelle communément détroit
du Hórd, ou détroit de Bjering, du nom d’un
capitaine Ruffe, qu’on afliire y avoir paffé en 1728.
( M . d e l a L a n d e . )
ANJENGO, ( Géogr. ) petite ville d’Afie fur la
côte dé Malabar, dans la prefqu’île de l’Inde, au-
deçà du Gange. Elle appartient à la compagnie des
Indes d’Angleterre, qui y tient un comptoir, &• qui
en tire du poivre & des toiles de coton. (C. A .)
§ ANILLE, f. f. ( terme de BlaJ'on.) meuble de
l ’écu, en forme de deux crOiffans, l’un tourné à
dextre, l’autre à feneftré, proche l’un de l’autre ,
joints par deux liftels ; de forte qu’il fe trouve un
vuide quarré au centre.
Vanille eft ainfi nommée , d’un fer qui fervoit
autrefois comme un anneau autour des moyeux des
roues, pour les fortifier.
Vaucleroisde Courmas , dé la' Ville-aux-Bois, en
Champagne, d’argent à lanille de fable.
D’Artigoity, en la même province, d’azur à
Vanille d'argent.
De Moulins de Damiette, de Beaulieu, de Villeneuve.
, en Poitou , d'argent à trois afiilles de fable.
( G. D. L. T.)
§ ANIMAL , ( Ordre Encyclopédique. Entendement.
Raifon. Phltofophie où Science. Science de la
nature. Zoölogie. Animal.) Les chofes les plus fimples
en apparence font fouvent les plus difficiles. Rien
il’eft plus commun que les animaux, on en connoît
lin nombre prodigieux ; il paroît très-aifé d’abftraire
ce qu’ils ont de commun, ce qui les fépare des plantes
, en un mot de définir ce que c’eft qu’un animal.
On a cru , 6c affez généralement d’après Ariftôte,
que l’animal eft un être fentant;. l’irritabilité a été
fubftituée au féntiment par d’autres Phyfiologiftes.
Un grand homme diftinguoit l'animal de la plante,
parce que fes racines font au-de dans dé lui-même.
Nous ferions affez portés à regarder le fentiment
comme le cara&ere effentiel de l'animal; mais il
faudroit avoir un cara frere fenfible du fentiment
lui-même. L’homme, qui confidere un être, & qui
cherché à fe décider s’il faut donner le nom d’animal
à cet être, fe décide par les mouvemens qu’il apperçoit
dans cet être ; car le fentiment lui-même ne peut
donner au-dehors d’autre ligne qu’un mouvement.
Nous convenons que fout animal fe meut ; car
les habitans des coquillages immobiles ont leurs
organes & leurs mouvemens. Nous faifons un pas de
plus, & nous admettons que tout animal eft irritable
, & que, touché avec une force proportionnée
à fa ferifibilité, il fe contrafre, & donne quelque
marque de fentiment en tâchant de fe fouftraire à ce
S P Caufe fa fenfation. Peut-être y a-t-il des excep-
tl0” s ». car nous doutons fort de l’irritabilité des
gallinfefres, même pendant qu’ils vivent & qu’ils ,
couvent leurs petits. Les animaux qui naiffent dans
îu M3tlr rCS corromPues 9 paffent un temps confidérable
fans donner une marque de vie ; mais donnons
cet avantage de plus à l’opinion dont nous nev
tommes pas.
Tome ƒ.
l î y a des plantes, & en affez grand nombre, qui
touchées, fe contraftent & fe meuvent avec vivacité.
Omettons les nombreufes plantes fenfuives des
pays chauds, qui certainement fuient l’attouchement
avec autant de promptitude que les animaux. Ne
c ons pas la-plante de l’Amérique feptentrionale,
qui fe ferme quand- une mouche la touche, & qui J e5 afe a Poignarde par fes piquans. Un nombre
tres-confidcrahle d'e plantes ont une irritabilité t ó -
viye dont le fiege eft dans leurs étamines Dès
qu on les touche, elles fe redreffent, rompent leurs
petits refervoirs de pouffiere , & la répandent, Ce
mouvement eft tres-vigoureux dans plufieurs plantes
apétales, comme dans l’ortie , la pariétaire , dans
plufieurs efpeces de chenopodium, où nous l’avons
vu très-y,f. Il reparoît dans un grand nombre de
fleurs de la claffe des artichaux-,
L W i , nous dira-t-on , fe meut de lui-même ,
& la plante n a- pas ce droit. Revenons aux anima J
fimples, à la gelee vivante, qui anime les éponges,
elle• fe contracie ; c’eft le feul figne de vie qn’ellé
puiffe donner : mais plufieurs plantes en font davantage.
Les pezizes s’agitent, fe fecouent, & font
voler une pouffiere fécondante , & cette décharge
le repe.te plufieurs fois, fous les yeux de l’obferva-
teur. Les particules lpermatiques du prêle fautent
dVec vigueur; quatre pieds qu’elles ont, fe courbent
& selevent, & danfent fur le verre Les
fphænæ ont des filets renfermés dans une coque ;
cette coque tombe, les;filets s’épânouiffiént, fe dé’
ploient ; enfermés dans un-fruit ovale, ils forment’
à la fin un long duvet cylindrique. 11‘y a dès efpeces
de conferva, qu’un mouvement ofcillatoire agite.
Le carpobole jette une efpece de petite bombe qui
décrit fa parabole. En un mot il y a plufieurs plantes
qui produifent des mouvemens vifs Ôc réitérés, fans
qu’ilyparoiffe une caufe irritante.
Pour la nourriture, cette loi ne regarde que les-
grands animaux. Il eft vrai que Finteftin eft une partie
beaucoup plus effentielle que le coeur même ; il y a
cependant un grand nombre A'animaux trop fimples
pour en avoir ; on- ne convient pas même de la cavité
dir polype d’eau douce. Mais cette même glu animale
qui vivifie les éponges, eft bien certainement
dépourvue d’mteftins, & ne peut être nourrie que
par fa furface, fenrblabie en; tout aux végétaux.
Pour diftinguêr donc Yamntal de la plante , il ne
fùffit pas d’urte obfervation ni d’un coup d’oeil ; il
faut^fuivre la vie & les développemens de l’un &
de 1 autre. On trouvera- alors que les mouvemens
des plantes font plus rares & plus uniformes, qu’ils-
n’ont qu’une feule direftion, qu’ils durent moins ,
& que le repos eft l’état dominant des végétâbles.
Dans les animaux le mouvement eft prefque toujours
auffi confiant que la vie ; leurs organes moteurs
ne s’épuifent pas , les contractions & les ofcillations
des animaux les plus fimples fe renouvellent très-
fréquemment. Si le gallinlefre eft immobile, ce n’eft
que dans le dernier période de fa vie ; il a été jeune,
& il a ohangé de place avant de fe fixer; il a fucé la
plante c^u’il- habite, il a joui du plaifir, & s’eft
accouple. Si quelques anguilles microfcopiques, ou
fi les animaux à roue paifent un temps confidérable
fans mouvement, c’eft qu’ils fe trouvent hors de
leur élément, & que l’eau néceffaire pour le jeu de
leurs organes leur manqUe.
Nqus ne parlons ici que des animaux les plus
fimples ; car pour les' Animaux des infufions , pour
lès vers fpermatiques eux-même's, leur mouvement
porte le carafrere évident de la volonté. Ces petits
animaux nagent, ils changent de place, ils vont
vîte , ils ralentiffent le*r courfe, ils prennent une
direction nouvelle, & même oppofée, ils évitent la
rencontre-de leurs femblâbles. Plufieurs d’errtre les
i i ü j