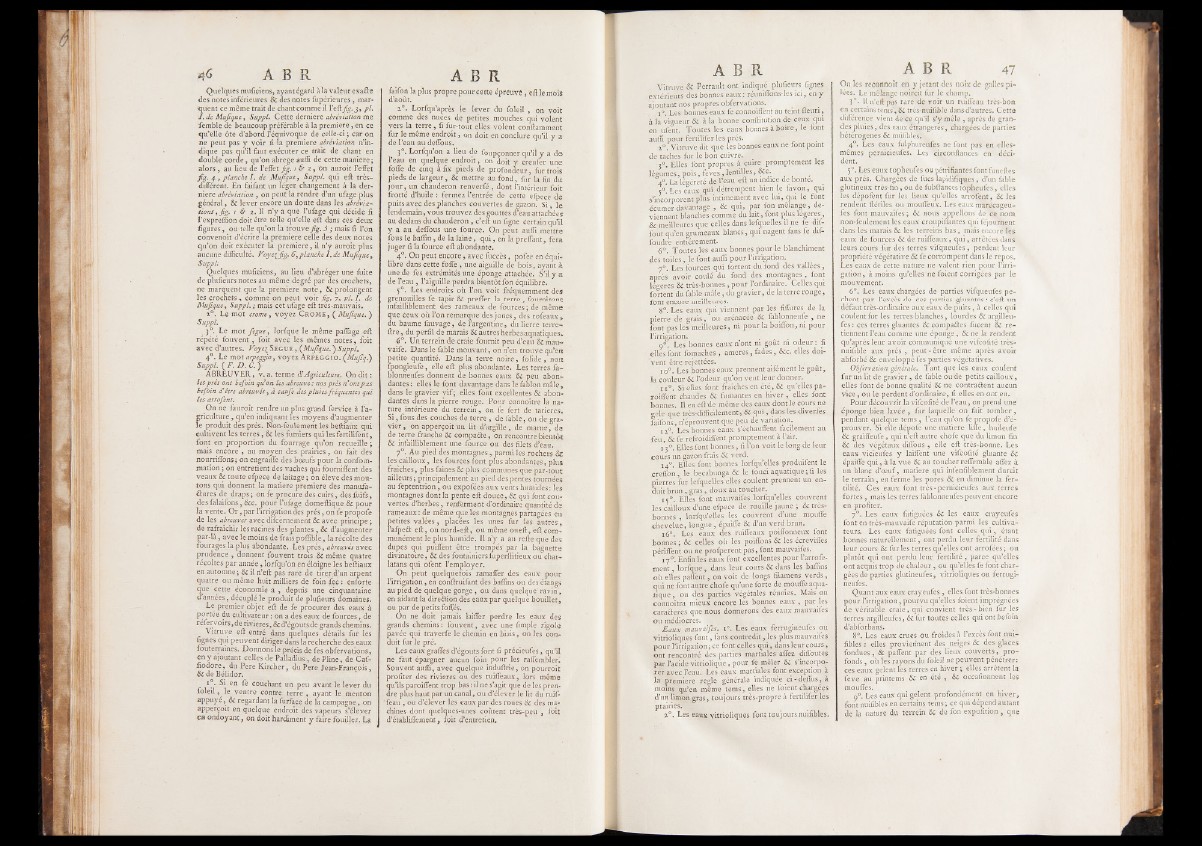
Quelques mufiçiens, ayant égard àlà valeur exafte
des notés inférieures SC des notes fupérieures -, marquent
ce même trait de chant comme il l’eft ƒ g. 3 , pl.
I . de Mufique, Suppl. Cette derniere abréviation me
femble de beaucoup préférable à la première, en ce
qu’elle ôte d’abord l’équivoque de celle-ci ; car on
ne peut pas v voir ii la première abréviation n’indique
pas qu’il faut exécuter ce trait de chant en
double corde, qu’on abrégé aufli de cette maniéré ;
alors, au lieu de l’effet fig. / <S* 2 , ôn auroit l’effet
fig. 4 , planche I . de Mufique, Suppl, qui eft très-
différent. En faifant un léger changement à la derniere
abréviation , on peut la rendre d’un ufage plus
général, & lever encore un doute dans les abréviations
, fig. 1 & 2. Il n’y a què l’ufage qui décide li
l ’exprelfion doit être telle qu’elle eft dans ces deux
figures, ou telle qu’on la trouve fig. 5 ; mais li l’on
convenoit d’écrire la première celle des deux notes
qu’on doit exécuter la première, il n’y auroit plus
aucune difficulté, Voye^fig. £f, planche ï . de Mufique,
Suppl:
Quelques mufiçiens, au lieu d’abréger une fuite
de plufieurs notes au même degré par des crochets,
ne marquent que la première note, & prolongent
les crochets , comme on peut voir fig. 7 , pl. I . de
Mufiquey Suppl.; mais cet ufage eft très-mauvais.
2°. Le mot crome, voyez Crome, ( Mufique. )
Suppl.
3 °. Le mot fegue, lorfqüe le même paffage eft
répété fouvent , foit avec les mêmes notes, foit
avec d’autres. Voye^ Següe , (Mufique. ) Suppl.
40. Le mot arpeggio, voyez Arpeggio. (Mufiq.')
Suppl. ( F . D. C. )
ABREUVER, v .a . terme d’Agriculture. On dit :
les près ont befoin quon les abreuve: nos prés nontpas
lefoin d'être abreuvés, à caufe des pluies fréquentes qui
les arrofent.
On ne fa’uroit rendre un plus grand fervice à l’agriculture
, qu’en indiquant les moyens d’augmenter
le produit des prés. Non-feulement les beftiaux qui
cultivent les terres, & les fumiers qui les fertilifent,
font en proportion du fourrage qu’on recueille ;
mais encore , au moyen des prairies, on fait dés
nourriffons ; on engraiffe des bçeufs pour la confom-
mation ; on entretient des vaches qui fourniffent des
veaux Sc toute efpece de laitage ; on éleve des moutons
qui donnent la matière première des manufactures
de draps; on fe procure des cuirs, des fui fs,'
des falaifons, 6cc. pour l’ufage domeftique Sc pour
la vente. O r , par l’irrigation des prés, on fe propofe
de les abreuver avec difcérnement Sc avec principe ;
de rafraîchir les racines des plantes, Sc d’augmenter
par-là, avec le moins de frais poflïble, la récolte des
fourages la plus abondante. Les prés, abreuvés avec
prudence , donnent fouvent trois Sc même quatre
récoltés par année, lorfqu’ôn en éloigne les beftiaux
en automne; Sc il n’eft pas rare de tirer d?un arpent
quatre ou même huit milliers de foin fec : enforte
que cette économie a , depuis une cinquantaine
d années, décuplé le produit de plufieurs domaines.
Le premier objet eft de fe procurer des eaux à
portée du cultivateur : on a des eaux de fources, de
refer voirs, de rivières, Sc d’égouts de grands chemins.
Vitruve eft entré dans quelques détails fur les
fignes qui peuvent diriger dans la recherche des eaux
fouterraines. Donnons le précis de fes obfervations,
en y ajoutant celles de P a llÿ f|s de Pline, de Caf-
fiodore, du Pere Kirçher, du Pere Jean-François,
& de Bélidor.
i° . Si en fe couchant un peu avant le lever du
foleil le ventre contre terre , ayant le menton
appuyé, & regardant la furface de la campagne., on
apperçoit en quelque endroit des vapeurs s’élever
ondoyant, on doit hardiment y faire fouiller. La
faifon la plus propre pour cette épreuve, eft le mois
d’août.
20. Lorfqu’après le lever du foleil , on voit
comme des nuées de petites mouches qui volent
vers la terre, fi fur-tout elles volent conftamrnent
fur le même endroit, on doit en conclure qu’il y a
de l ’eau au deffous.
30. Lorfqu’on a lieu de foupçonner qu’il y a dô
l’eau en quelque endroit, on doit y creufer une
foffe de cinq à fix pieds de profondeur, fur trois
pieds de largeur, Sc mettre au fond, fur la fin du
jo u r , un chauderon renverfé , dont l’intérieur foit
frotté d’huile : fermez l’entrée de çette efpece de
puits avec des planches couvertes de gazon. Si -, le
lendemain, vous trouvez des gouttes d’eau attachées
au dedans du chauderon, c’en un figne certain qu’il
y a au deffous une fource. On peut aufli mettre
fous le baflin, de la laine, q u i, en là preflant, fera
juger fi la fource eft abondante.
.. 40. On peut encore, avec fuccès, pofer en équilibre
dans cette foffe , une aiguille de bois, ayant à
une de fes extrémités une éponge attachée. S’il y a
de l’eau , l’aiguille perdra bientôt fon équilibre.
50. Les endroits où l’on voit fréquemment des
grenouilles fe tapir Sc preffer la terre , fourniront
infailliblement des rameaux de fources ; de même
que ceux où l’on remarque des joncs, des rofeaüx,
du baume fauvage, de l’argentine, du lierre terre-*
ftre, du perfil de marais & autres herbes aquatiques.
6°. Un terrein de craie fournit peu d’eau Sc mau-
vaife. Dans le fable mouvant, oîln’en trouve qu’en
petite quantité. Dans la terre noire, folide, non
fpongieufe, elle eft plus abondante. Les terres fa-
blonneufes donnent de bonnes eaux & peu abondantes:
elles le font davantage dans lefablon mâle,
dans le gravier v if; elles font excellentes & abondantes
dans la pierre rouge. Pour connoître la nature
intérieure du terrein, on fe fert de tarières.
S i, fous des couches de terre, de fable, ou de gravier
, on apperçoit un lit d’argille, de marne:, de
de terre franche Sc compafte, on rencontre bientôt
Sc infailliblement une fource ou des filets d’eau,
7°. Au pied des montagnes, parmi les rochers Sc
les cailloux, les fources font plus abondantes, plus
fraîches, plus faines Sc plus communes que par-tout
ailleurs; principalement au pied des pentes tournées
au feptentrion, ou expofées aux vents humides: les
montagnes dont la pente eft douce, Sc qui font couvertes
d’herbes, renferment d’ordinaire quantité de
rameaux: de même que les montagnes partagées en
petites valées, placées les unes fur les autres ,
l’afp eft eft, ou nord-eft, ou même oueft, eft communément
le plus humide. 11 n’y a au refte que des
dupes qui puiffent être trompés' par la baguette
divinatoire, Sc des fontainiersfuperftitieux ou charlatans
qui ofent l’employer.
On peut quelquefois ramaffer des eaux pour
l’irrigation, en conftruifant des baffins ou des étangs
au pied de quelque gorge, ou dans quelque1 ravin,
en aidant la direftion des eaux par quelque bouillet,
ou par de petits foffés.
On ne doit jamais laiffer perdre les eaux des
grands chemins: fouvent, avec une fimple rigole
pavée qui traverfe le chemin en biais, on les conduit
fur le pré.
Les eaux graffes d’égouts font fi précieufes, qu’il
ne faut épargner aucun foin pour les raffemblerl
Souvent aufli, avec quelque induftrie, on pourroit
profiter des rivières ou des ruiffeaux, lors même
qu’ils paroiffent trop bas: il ne s’agit que de les prendre
plus haut par un canal, ou d’élever le lit du ruifi-
feau , ou d’élever les eaux par des roues & des machines
dont quelques-unes coûtent très-peu , foit
d’établiffement, foit d’entretien.
Vitruve de Perrault ont indiqué plufieurs fignes
extérieurs des bonnes eaux:• réuniffons-les ic i, en y
ajoutant nos propres obfervations.
, i° . Les bonnes eàux fe connoiffent au teint fleuri,
à la vigueur Sc à la bonne conftitution de ceux qui
en ufent. Toutes les eaux bonnes à boire, le font
aufli pour fertilifer les prés. .
2.0. Vitruve dit que les bonnes eaux ne font point
de taches fur le bon cuivre. i < ' • '
3°. Elles font propres à cuire promptement les
légumes, pois, feves , lentilles, Scc. /
40. La légéreté de l’eau eft un indice de bonté.
5°. Les eaux qui détrempent bien le favon, qui
s’incorporent plus intimement avec lui, C[ui le font
écumer davantage , & qui, par fon mélange, deviennent
blanches comme du lait, font plus légères,
& meilleures que celles dans lefquelle.s il ne le dif-
fout qu’en grumeaux blancs , qui nagent fans fe dif-
foudre entièrement.
■ go, Toutes les eaux bonnes pour le blanchiment
des toiles, le font suffi pour l’irrigation.
7°. Les fources qui fortent du fond des vallées ,
après avoir coulé du fond des montagnes, font
légères Sc très-bonnes , pour l’ordinaire. Celles qui
fortent du fable mâle, du gravier, de la terre rouge,,
font encore meilleures. ^ , .
g°. Les eaux qui viennent pat les fiffures de la
pierre de grais, ou arénacée Sc fablonneufe , ne
font pas les meilleures, ni pour la boiffon, ni pour
l’irrigation. # J
90. Les bonnes eaux n’ont ni goût ni odeur : fi
ellës font foipaches,.;: ameres, fades, Scc. elles doi-
‘vent êtrçrejettées. ,. f . .. . a
io °. Les bonnes eaux prennent aifement le goût,
la couleur Sc l’odeur qu’on veut leur donner.
i i °. Si elles font fraîches en été, & qu’elles paroiffent
chaudes Sc fumantes en hiver , elles font
bonnes. 11 en eft de même des eaux dont le cours ne
gele que très-difficilement-, Sc q u i, dans les cliverfes
faifons, n’éprouvent que peu de variation.
120. Les bonnes eaux s’échauffent facilement au
feu , Sc fe refroidiflent promptement à l’air.
1 30. Elles font bonnes-, fi l’on voit le long de leur
cours un gazon frais Sc verd.
140. Elles font bonnes lorfqu’elles produifent le
.creffon, le becabunga Sc le fouci aquatique ; fi les
pierres fur. lefquelles elles coulent prennent un enduit
b run, gras, doux au toucher.
150. Elles font mauvailès lorfqu’elles couvrent
les cailloux d’une efpece de rouille jaune ; Sc très-
bonnes , lorfqu’ elles les couvrent d’une moufle
chevelue, longue, épaiffe Sc d’un verd brun.
160. Les eaux des ruiffeaux poiffonneux font
bonnes ; Sc celles où les poiffons & les écreviffes
périffent ou ne profperent pas, font mauvaifes.
iy ° . Enfin les eaux font excellentes pour larrofe-
ment, lorfque , dans leur cours Sc dans les baffins
où elles paffent, on voit de longs filamens verds,
qui ne font autre chofe qu’une forte de moufle aquatique
, ou des parties végétales réunies. Mais on
connoîtra mieux encore les bonnes eaux , par les
carafteres que nous donnerons des eaux mauvaifes
ou médiocres. :
Eaux mauvaifes. i°. Les eaux ferrugineufes ou
vitrioliques font, fans contredit, les plus mauvaifes
pour l’irrigation; ce font celles qui, dans leur cours,
ont rencontré des parties martiales affez difloutes
par l’acide vitriolique , pour fe mêler Sc s’incorporer
avec l’eau. Les eaux martiales font exception à
la première réglé générale indiquée ci - deftus, à
moins qu’en meme tems, elles ne foient chargées
d’un limo,n gras, toujours très-propre à fertilifer les
prairies.
2°. Les eaux vitrioliques font toujours nuifibles.
On les reconnoît en y jetant des noix de galles pilées.
Le mélange noircit fur le champ.
3°- Il n’eft pas rare de voir un ruiffeau très-bon
en certains tems', Sc très-nuifible dans d’autres. Cette
différence vient de-ce qu’il s’y mêle , après de grandes
pluies, des eaux étrangères, chargées de parties
hétérogènes Sc nuifibles.,
40. Les eaüx fulphureufes ne font pas en elles-
mêmes pernicieufes. Les circonftances en décident.
50. Les eaux topheufes ou pétrifiantes font funeftes
aux prés. Chargées de fucs lapidifîques, d’un fable
glutineux très-fin, ou de fubftances topheufes, elles
les dépofent fur les lieux qu’elles arrofent, & les
rendent ftériles ou mouffeux. Les eaux marécageu-
fes font mauvaifes ; Sc nous appelions de ce nom
non-Ieulement les eaux eroupiflàntes qui féjourhent
dans les marais Sc les terreins bas, mais encore les
eaux de fources Sc de ruiffeaux, q ui, arrêtées dans
leurs cours fur des terres vifqueufes, perdent leur
propriété végétative Sc fe corrompent dans le repos.
Les eaux de cette nature ne valent rien pour l’irrigation
, à moins qu’elles ne foient corrigées par le
mouvement.
; 6°. Les eaux chargées dé parties vifqueufes pèchent
par l’excès de ces parties gluantes : c’eft un
• défaut très-ordinaire aux eaux de puits, à celles qui
coulent fur les terres blanches, lourdes Sc argilleu-
fes : ces terres gluantes &compaftes fucent & retiennent
l’eau'comme une éponge, & n e la rendent
qu’après leur avoir communiqué une vifeofité très-
nuifible aux prés , peut - être même après avoir
abforbé Sc enveloppé fes parties végétatives.
Obfervation générale. Tant que les eaux coulent
fur un lit de gravier, de fable ou de petits cailloux,
elles font de bonne, qualité Sc ne contractent aucun
v ic e , ou le perdent d’ordinaire, fi elles en ont eu.
Pour découvrir la vifeofité de l’eau, on prend une
éponge bien lavée , fur laquelle on fait tomber,
pendant quelque tems , l’eau qu’on fe propofe d’éprouver.
Si elle dépofe une matière liffe, huileufe
Sc graiffeufe, qui n’eft autre chofe que du limon fin
Sc des végétaux diffous , elle eft très-bonne. Les
eaux vicieufes y biffent une vifeofité gluante Sc
épaiffe q ui, à la vue Sc au toucher reffemble affez à
un blanc d’oe u f, matière qui infenfiblement durcit
le terrain, en ferme les pores Sc en diminue la fertilité.
Ces eaux font très-pernicieufes aux terres
fortes, mais les terres fablonneufes peuvent encore
en profiter.
7°. Les eaux fatiguées Sc les eaux crayeufes
font en très-mauvaife réputation parmi les cultivateurs.
Les eaux fatiguées font celles q u i, étant
bonnes naturellement, ont perdu leur fertilité dans
leur cours Sc fur les terres qu’elles ont arrofées ; ou
plutôt qui ont perdu leur fertilité, parce qu’elles
ont acquis trop de chaleur, ou qu’elles fe font chargées
de parties giutineufes, vitrioliques ou ferrugineufes.
Quant aux eaux crayeufes , elles font très-bonnes
pour l’irrigation, pourvu qu’elles foient imprégnées
de véritable craie, qui convient très - bien fur les
terres argilleufes, Sc fur toutes celles qui ont befoin
d’abforbans. . ,
8°. Les eaux crues ou froides â l’excès font nuifibles
: elles proviennent des neiges & des glaces
fondues, & paffent par des lieux couverts, profonds
, où les.rayons du foleil ne peuvent pénétrer:
ces eaux gelent les terres en hiver ; elles arrêtent la
feve au printems Sc en ete , Sc occafionnent les
moufles. : . : •
90. Les eaux qui gelent profondément en hiver,
font nuifibles en certains tems; ce qui dépend autant
de la nature du terrein Sc de fon expofition, que