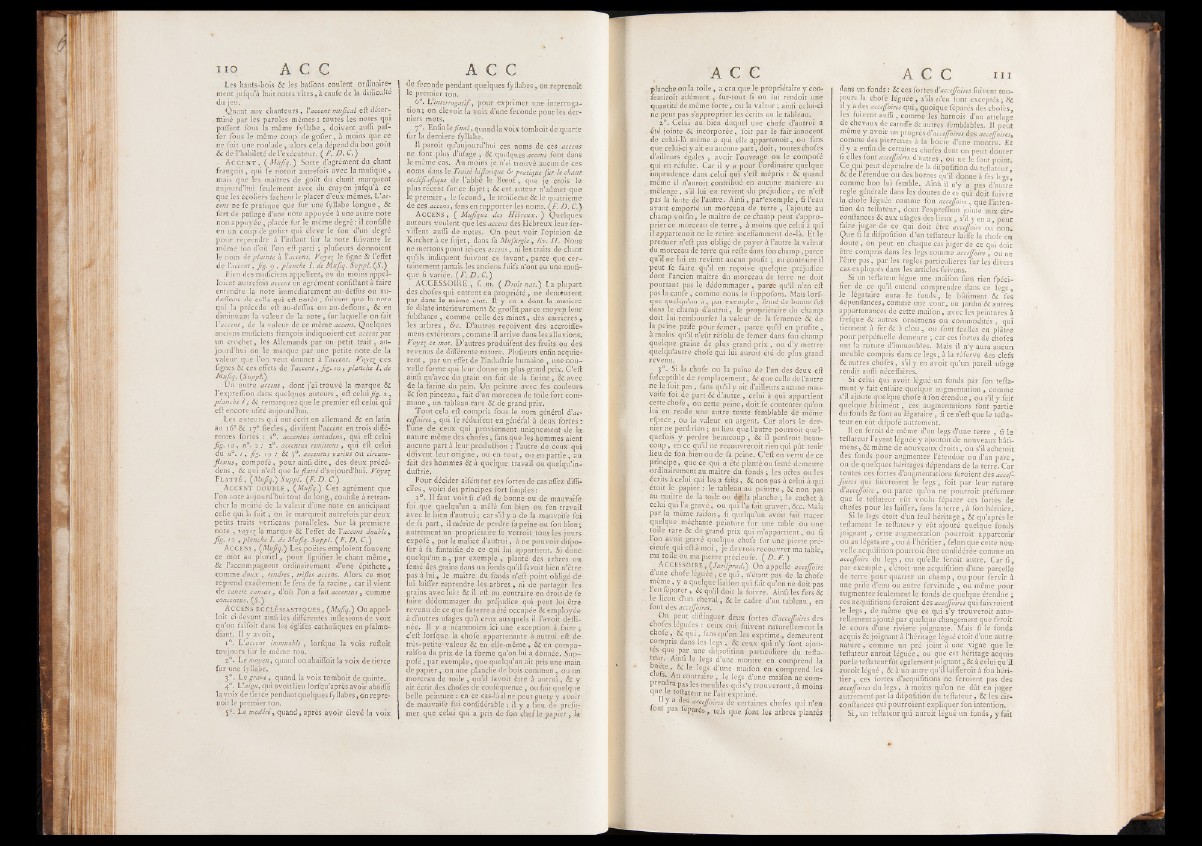
Les hauts-bois & les battons coulent ordinairement
jufqu’à huit notes v îte s, à caufe de la difficulté
du jeu.
Quant aux chanteurs , l'accent mufical eft deter-
miné par les paroles mêmes : toutes les notes qui
pattent fous la même fyliabe , doivent aufli paf-
fer fous le même coup de golier, à moins que ce
ne foit une roulade alors cela dépend du bon goût
& dé l’habileté de l’exécuteur. ( F. D. C.)
. Ac c en t , ( Mufiq.) Sorte d’agr.ément du chant
françôis, qui fe notoit autrefois avec la mufique ,
mais que les maîtres de goût du chant marquent
aujourd’hui feulement avec du crayon jufqu’à ce
que les écoliers fâchent le placer d’eux-mêmes. L’accent
ne fe pratique que fur une fyliabe longue, &
fert de paflâge d’une note appuyée à une autre note
non appuyée , placée fur le même degré : il confifté
en un coup de gofier qui éleve le fon d’un degré
pour reprendre à l’inftant fur la note fuivante le
même ion d’où l’on eft parti ; plufieurs donnoient
le nom de plainte à Vaccent. Voyeç le ligne & l’effet
de l'accent, fig. C), planche I. de Mufiq. Suppl. (S.)
Bien des muficiens appellent, ou du moins appel-
loienr autrefois accent un agrément confinant à faire
entendre la note immédiatement au-deffus ou au-
deffous de celle qui eft notée, fuivant que la note
qui la précédé eft au-deffus ou au-deffous, & en
diminuant là valeur de la note , fur laquelle on fait
Y accent, de la valeur de ce même accent. Quelques
anciens muftciens françôis indiquoient cet accent par
un crochet , les Allemands par un-petit trait, aujourd’hui
on le marque par une petite note de la
valeur que l’on veut donner à L accent. Voye£ ces
lignes & ces effets de l’accent, fig. io , planche 1. de
Mufiq. (Suppl.')
Un autre. accent, dont j’ai trouvé la marque &
l ’expreflion dans quelques auteurs , eft celui fig. a ,
planche l ; & remarquez que le premier eft celui qui
eft encore ufité aujourd’hui.
Les auteurs qui ont écrit en allemand & en latin
au 16e & 17e fiecles, divifent 1''accent en trois différentes
fortes : i°. accentus intendens, qui eft celui
fig. 10, n°. 2. : 1°. accentus remittens, qui eft celui
du n°. 1 , fig. 10 : & 30. accentus varias ou' circum-
jlexus, compofé, pour ainfidire, des deux précé-
dens , & qui n’eft que \z flatté d’aujourd’hui.. Voye^
Flatté, (Mufiq.) Suppl, (F. D . C.)
Accent double , (Mufiq.) Cet agrément que
l’on note aujourd'hui tout du long, confifté à retrancher
la moitié de la valeur d’une note en anticipant
celle qui la fuit ; on lé marquoit autrefois par deux
pétits traits verticaux parallèles. Sur là première
note , voye^ la marque & l’effet de Vaccent double,
fig. 12 , planche ï. de Mufiq. Suppl. (F . D . C.)
Accens, (Mufiq.) Les poètes emploient fouvent
ce mot au pluriel., pour lignifier le chant même,
& l’accompagnent ordinairement d’une épithete,
comme doux. , tendres, trifles accens. Alors ce mot
reprend exactement lé fens de fa racine, car il vient
de canere camus, d’où l’on a fait accentus , comme
concenltis. (S.)
Accens ecclesiastiques , (Mufiq.) On appel-
loit ci-devant ainfi les différentes inflexions de voix
qu’on faifoit dans les églifes catholiques enpfalmo-
diant. Il y âvôit,
i° . L 'accent immuable, lorfque la voix reftoit
toujours fur le même ton.
z°. Le moyen, quand on abaiffoit la voix de tierce
fur une fyliabe.
; 30. Le grave , quand la voix tomboit de quinte.
40. L’aigu, qui avoit lieu lorfqu’après avoir abaiffé
la voix de tierce pendant quelques fy llabes, on repre-
noit le premier ton.
50. Le modéréy quand, après avoir élevé la voix
de fécondé pendant quelques fyllabes, on reprenoit
le premier ton.
\ 6°. L’interrogatif, pour exprimer une interrogation
; on élevoit la voix d’une fécondé pour lès derniers
.mots.
- 7°- Enfin \e final, quand la voix tomboit de quarte
fur la derniere fyliabe.
Il paroît qu’aujourd’hui çes noms de ces accens
ne font plus d’ufage , & quelques accens font dans
le meme cas. Au moins je n’ai trouvé aucun de ces
noms dans \e.Traité hiflorique 61 pratique fur léchant
eccléfiafiique de l’abbé le Boeu f, que je crois le
plus récent fur ce fujet ; & e e t auteur n’admet que
le premier, le fécond , le troifieme & le quatrième
de ces accens, fans en rapporter les noms. ( F. D . C.)
Accens, ( Mufiqüe des Hébreux. ) Quelques
auteurs veulent que les accens des Hébreux leur fer- -
viffent aufli de notes. On peut voir l’opinion de.
Kircher à ce fujet, dans fa Mufurgie , liv. 11. Nous
ne mettons point ici-çes accens, ni les traits de chant-
qu’ils indiquent fuivant ce. favant, parce que certainement
jamais les anciens Juifs n’ont eu une mufique
fi variée. (F . D . C.)
ACCESSOIRE , f. m. (Droit nat.) La plupart
des chofes qui entrent en propriété , ne demeurent
pas dans le même état.. Il y en a dont la matière
fe dilate intérieurement & groflitpar ce moyen leur
fubftance , comme celle des mines, des carrières ,
les arbres , &c. D ’autres reçoivent des accroiffe-
mens extérieurs, comme il arrive dans les alluvions.
Voye1 ce mot. D ’autres produifent des fruits ou des
revenus de différente nature. Plufieurs enfin acquièrent
, par un effet de l’induftrie humaine , une nouvelle
forme.qui leur donne un plus grand prix. C ’eft
ainfi qu’avec du grain on fait de la farine , & avec
de la farine du pain. Un peintre avec fes couleurs
& fon pinceau, fait d’un morceau de toile fort commune
, un tableau rare & de grand prix.
Tout cela-eft compris fous le nom général d'accejfoires
, qui fe réduifent en général à deux fortes :
l’une de ceux qui proviennent uniquement dé la
nature même des chofes, fans que les hommes aient
aucune part à leur produ&ion : l’autre de ceux qui
doivent leur origine, ou en tout, ou _en partie, au
fait des hommes & à quelque travail ou quelqu’in-
duftrie.
_ Pour décider aifément ces fortes de cas affez difficiles
, voici des principes fort fimples :
i ° . Il faut voir.fi c’eft de bonne ou de mauvaife
foi que quelqu’un a mêlé fon bien ou fon travail
avec le bien d’autrui ; car s’il y a de la mauvaife foi
de fa part, il mérite de perdre fa peine ou fon bien ;
autrement un propriétaire fe verroit tous les jours
expofé , par la malice d’autrui, à ne pouvoir difpo-
fer à fa fantaifie.de ce qui lui appartient. Si donc
quelqu’un a , par exemple , planté des arbres ou
femé des grains dans un fonds qu’il fa voit bien n’être
pas à lu i, le maître du fonds n’eft point obligé de
lui laiffer reprendre les arbres , ni de partager, les
grains avec lui : & il eft au contraire en droit de fe
faire dédommager du préjudice qui peut lui être
revenu de ce que fa terre a été occupée & employée
à d’autres ufages qu’à ceux auxquels il l’avoit defti-
née.- H y a néanmoins ici une exception à. faire ;
c’eft lorfque la chofe appartenante à autrui eft de
très-petite-valeur & en elle-même , & en compà-
raifon du prix de la forme qu’on lui a donnée. Sup-
p o fé, par exemple, que quelqu’un ait pris une main
de papier, ou une planche de bois commun, ou un
morceau de toile , qu’il favoit être à autrui, & y
ait écrit des.chofes de conféquence, ou fait quelque
belle peinture : en ce cas-là il ne peut giier-e y avoir
de mauvaife foi confidérable : il y a lieu de préfumer
que celui qui a pris de fon chef le papier , la
planche ou la toile, a cru que le propriétaire y con-
. îentiroit aifément , fur-tout fi on lui rëndoit une
quantité de même forte, ou la valeur ; ainfi celui-ci
ne peut pas s’approprier les écrits ou le tableau.
20. Celui au bien duquel une chofe d’autrui a
- été jointe & incorporée, foit par le fait innocent
de celui-là même à qui elle appartenoit, ou fans
que celui-ci y ait eu aucune part, doit, toutes chofes
d’ailleurs égales , avoir l’ouvrage ou le compofé
qui en réfulte. Car il y a pour l’ordinaire quelque
imprudence dans celui qui s’eft mépris : & quand
même il n’aurait contribué en aucune maniéré au
mélange, s’il lui en revient du préjudice, ce n’eft
pas la faute de l’autre. Ainfi, par'exemple , fi l’eau
ayant emporté un morceau de térre , l’ajoute au
champ voifin, le maître de ce champ peut s’approprier
ce morceau de terre , à moins que celui à qui'
il appartenoit ne le retire inceffamment de-là. Et le-
premier n’eft pas obligé de payer à l’autre la valeur
du morceau de terre qui refte dans fon champ, parce
qu’il ne lui en revient aucun profit ; au contraire il
peut fe faire qu’il en reçoive quelque préjudice
dont l’ancien maître du morceau de terre ne doit
pourtant pas le dédommager, parée qu’il n’en eft
pas la caufe , comme nous le fuppofons. Mais lorfque
quelqu’un à , par exemple , femé de bonne foi
dans le champ d’autrui, le propriétaire du champ
doit lui rembourfer la valeur de. la femence & de
la peine prife pourfemer, parce qu’il en profite,
à moins qu’il n’eût réfolu de femer dans fon champ
quelque graine de plus grand p r ix , ou d’y metrre
quelqu’àufre chofe qui lui auroit été de plus grand
revenu. .
30. Si la chofe où la peine de l’un des deux eft
fufceptible de remplacement, & que celle de l’autre
•ne le foit pas , fans qu’il y ait d’ailleurs aucune mauvaife
foi de part & d’autre, celui à qui appartient
cette chofe, ou cette peine, doit fe contenter qu’on
lui en rende.une autre toute femblable de même
efpece, ou la valeur en argent. Car alors le dernier
ne perd rien ; au lieu que l’autre pourroit quelquefois
y perdre beaucoup , & il perdroit beau-
coup, en ce qu’il ne recouvreroit rien qui pût tenir
lieu.de fon bien ou de fa peine. C ’eft en Vertu de ce
principe, que ce qui a été planté ou femé demeure
ordinairement au maître du fonds ; les a êtes ou les
écrits à celui qui les a faits, & non pas à celui à qui
étoit le papier : le tableau au peintre , & non pas
au maître de la toile ou deîla planche ; lé cachet à-
celui qui l’a grave.,-, ou qui l’a fait graver, Sic. Mais
par la meme raifon, fi quelqu’un avoit fait trader
quelque méchante peinture fur une table ou une
toile rare & de grand prix qui m’appartient, ou fi
.l.on.avoit grave quelque chofe fur une pierte pré-
cieufe qui eft à moi, je devrois recouvrer ma table,
ma toile ou ma pierre pr,écieufe. ( D. F. )
Accessoire, (Jurifprud.) On appelle accejfoire
d une chofé-leguée, ce qui, n’étant pas de la chofe
meme , y a quelque liaifon qui fait qu’on ne doit pas
1 en feparer, & qu’il doit la fuivre. Ainfi les fers & •
• *5 hcou d’un cheval, & le cadre d’un tableau, en
font des accejfoires.
On peut diftinguer deux fortes d’accefloircs des
chofes leguees : ceux qui fuivent naturellement la
chofe , & q ui, fans qu’on les exprime , demeurent
compris dans les legs , & ceux qui n’y font ajoutes
que par une difpofition particulière du tefta--
téur. Ainfi le legs d’une montre en comprend la
ooete, & le legs d’une maifon en comprend les;
° eV * COntra^re > le legs d’une maifon ne comprendra
pas les meubles qui s’y trouveront, à moins
que le tefetou-ne l’ait exprimé.
r y a des accejfoires de certaines chofes qui n’en
lont pas ieparés, tels que font les arbres plantés
dans un fonds : & c es fortes dt accejfoires fuivent toujours
la chofe léguée , s’ils n’en font exceptés ; de
il y a des accejfoires qui, quoique féparés des chofes,
les fuivent aufli, comme les harnois d’un attelage
de chevaux de carotte & autres femblables. Il peut
même y avoir un progrès d'accejfoires des accejfoires,
comme des pierreries à la boëte d’une montre. Et
il y a enfin de certaines chofes dont on peut douter
fi elles font accejfoires d’autres , ou ne le font point.
Ce qui peut dépendre de la difpofition du teftatéur,
& de l’étendue ou des bornes qu’il donne à fes legs,
comme bon lui femble. Ainfi il n’ y a pas d’autre
réglé générale dans les doutes de ce qui doit fuivre
la chofe léguée comme fon accejfoire , que l’intention
du teftateur, dont l’expreflion jointe aux cir-
conftances & aux ufages des lieux, s’il y en a , petit
faire juger de ce qui doit être accejjoire ou non.
Que fi la difpofition d’un teftateur laifle la chofe en
doute, on peut en chaque bas juger de ce qui doit
être compris dans lès legs comme accejfoire , ou ne
l’être pas,. par les réglés particulières fur les divers
cas expliqués dans les articles fuivans.
Si un teftateur lègue une maifon fans rien fpéci-
fier de .ce qu’il entend comprendre dans ce legs ,
lè légataire aura-. le fonds, le " bâtiment & fes
dépendances, comme une cour, un jardin & autres
appartenances de cette maifon, avec les peintures à
frefque & autres ornemens ou commodités , qui
tiennent .à fer & à clou , ou font fcèllés en plâtre
pour perpétuelle demeure ; car ces fortes de chofes
ont la nature d’immeubles. Mais il n’y aura aucun
meuble compris dans ce legs, à la réferve des clèfs
& autres chofes , s’il y en avoit qu’un pareil ufage
rendît aiifli néceffaires.
■ .Si celui qui avoit légué un fonds par fon tefta-
ment y fait enfuite quelque augmentation , comme
s’il ajoute-quelque chofe à fon étendue, ou s’il y fait
quelque batiment, ces augmentations font partie
du fonds & font au légataire , fi ce n’eft que le teftateur
en eût difpofé- autrement.
Il en feroit de même d’un legs d’une terre , fi le
teftateur l’ayant léguée y ajoutoit de nouveaux bâti-
mens, & même de nouveaux droits, ou s’il achetoit
dés fonds pour augmenter l’étendue ou d’un parc,
ou de quelques héritages dépendans de la terre. Car
toutes ces fortes d’augmentations feroient des àccef-
foires qui fuivroieht le legs , foit par leur nature
d’accejfoire , ou parce qu’on ne pourroit préfümer
que le teftateur eût voulu féparer ces fortes de
chofes pour les laiffer, fans la terre , à fon héritier.
Si le legs étoit d’un feul héritage , & qu’après le
teftament le teftateur y eût ajouté quelque fonds
joignant, cette augmentation pourroit appartenir
Ou au légataire , ou à l’héritier, félon que cette nouvelle
acqüifitiôn pourroit être confidérée comme un
accejfoire du legs, ou qü’elle feroit autre. Car f i,
par exemple , c’étoit une acqüifitiôn d’une parcelle
dé.terre pour quarrer un champ, ou pour fervir à
une prife d’eau ou autre fervitude , ou même pour
augmenter feulement le fonds de quelque étendue ;
ces acquifitions feroient des accejfoires qui fuivroient
le legs, de même que ee qui s’ÿ trouveroit naturellement
ajouté par quelque changement que feroit
le.-cours d’une riviere joignante. Mais fi le fonds
acquis &C joignant à l’héritage légué étoit d’une autre
nature, comme un pré joint à une vigne que le
teftateur auroit léguée , 011 que cet héritage acquis
parle teftateur fût également joignant, & à celui qu’il
. auroit légué, & à un autre qu’il laifferoit à fon hérit
ie r , ces fortes d’acquifitions ne feroient pas des
accejfoires du legs, à moins qu’on ne dût en juger
autrement par la difpofition du teftateur, & les cir-
conftances qui pourroient expliquer fon intention.
Si ? un teftateur qui auroit légué un fonds, y fait