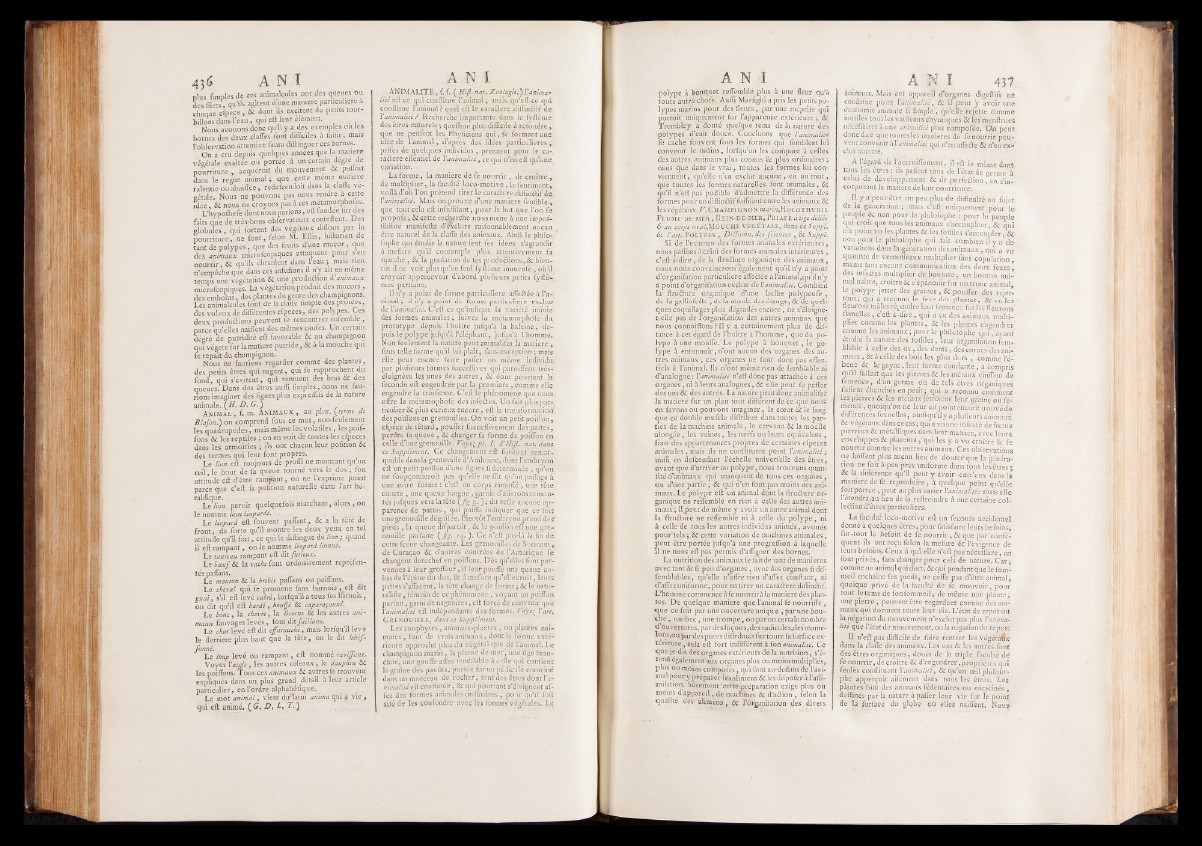
tilas Amples de ces animalcules ont des queues ou
des filets qu’ils agitent d’une .mamere.particulière a
chaque efpece , & dont ils excitent de -petits tourbillons
dans l’eau , qui eft leur élément.
Nous avouons donc qu’il y a des exemples ou les
bornes des deux cia fie s font difficiles à faffir; mais
l’obfervation attentive faura diftinguer ces bornes.
On a cru depuis quelques années que la matière
végétale exaltée ou portée à un certain degre de
pourriture , acquéroit du mouvement 5c .pafloit
dans le régné animal ; que cette meme matière
ralentie ou abaiffée, redelcendoit dans la claffe végétale.
Nous ne pouvons pas nous rendre à cette
idée, 8c nous ne croyons pas à ces metamorphofes.
L’hypothefe dont nous parlons, eft fondée fur des
faits que de très-bons oblervateurs contèftent. Des
globules, qui fortent des végétaux diffous par la
pourriture, ne font, félon M. Ellis, hiftonen de
tant de polypes, que des fruits d’une mucor, que
des animaux microfcopiques attaquent pour s en
nourrir, ôc qu’ils ébranlent dans l’eau; mais rien
n’empêche que dans ces infufions il n’y ait en meme
temps une végétation 6c une produdion d animaux
microfcopiques. La végétation produit des mucors,
des embolus, des plantes du genre des champignons.
Les animalcules font de la claffe fimple des protees,
des volvox de différentes efpeces, des polypes. Ces
deux productions peuvent fe rencontrer enfemble,
parce qu’elles naiffent des mêmes caufes. Un certain
dégré de putridité eft favorable 6c au champignon
qui végété fur lamatiere putride, 6c à la mouche qui
le repaît du champignon.
Nous ne faurions regarder comme des plantes,
des petits êtres qui nagent, qui fe rapprochent du
fond, qui s’évitent, qui remuent des bras 6c des
queues. Dans des êtres auffi fimples, nons ne fau-.
rions imaginer des fignes plus expreffifs de la nature
animale. (//. D . G .)
A n im a l , f. m. A n im a u x , au plur. {terme de
Blafon.) on comprend fous ce mot, non-feulement
les quadrupèdes, mais meme les volatiles, les poif-
fons 6c les reptiles ; on en voit de toutes les efpeces
dans les armoiries ; ils ont chacun leur pofition 6c
des termes qui leur font propres.
Le Lion. eft toujours de profil ne montrant qu un
Oeil, le bout de fa queue tourné vers le dos ; fon
attitude eft d’être rampant, on ne l’exprime point
parce que c’eft fa pofition naturelle dans l’art héraldique;
| . . .
Le lion paroît quelquefois marchant, alors , on
le nomme lion léopardè. A
Le léopard eft fouvent paffant, 6c a la tete de
front, de forte qu’il montre les deux yeux en tel
attitude qu’il foit, ce qui le diftingue du lion; quand
il eft rampant, on le nomme léopard lionne.
Le taureau rampant eft dit furieux.
tés paffans.
Le mouton 6c la brebis paffans ou paiffans.
Le cheval qui fe promene fans harnois , eft dit
suai, s’il eft levé cabré, lorfqu’il a tous fes harnois,
on dit qu’il ëft bardé, houQé 6C caparaçonné.
Le bouc, la ckevre, la licorne 6C les autres animaux
fauvages levés , font dit fadlans.
Le chat levé eft dit effarouché, mais lorfqu’il leve
le derrière plus haut que la tête, on le dit hérif-
fonné. r
Le loup levé ou rampant, eft nomme raviffant.
Voyez Y aigle, les autres oifeaux ; le dauphin 6c
les poiffons. Tous ces animaux 6C autres fe trouvent
expliqués dans un plus grand détail à leur article
particulier, en l’ordre alphabétique.
Le mot animal, vient dirlatin anima qui a vie ,
qui eft animé, {G , D , L, T.)
ANIMALITÉ, f. f. ( Hiß. nat. Zoologie.) Y anima»
kté eft ce qui conftitue l’animal ; mais qu’eft-ce qui
conftitue l’animal ? quel eft le cara&ere ,diftin£Hf de.
Y animalité? Recherche importante dans le fyftême,
des êtres naturels ; quéftion plus difficile à réfoudre,
que ne penfent les Phyficiens qui, fe formant une
idée de l ’animal, d’après. fies idées particulières,
prifes de quelques individus , prennent pour le ca-.
radiere effentiel de l ’animalité, ce qui n’en eft qu’une
variatiön. ,
La forme, la maniéré de fe nourrir , de croître ,
de multiplier, la faculté loco-motive , le fentiment.,
voilà d’où l’on prétend tirer le caractère diftinftif de
Y animalité* Mais on prouve d’une maniéré fenfible ,
que tout cela eft infuffifant, pour le but que I’on_fe.
propofe; 6c cette recherche nousmene à une impof-,
ïibilité manifefte d’exclure raifonnablement aucun
être naturel de la claffe des animaux. Ainfi le philo-
fophe qui étudie la nature fent les idées s’agrandir
à mefure qu’il contemple plus attentivement fa
rqarche , ôc la gradation de fes produâions, 8c bientôt
il ne voit plus qu’un feul fyftême immenfe , où il
croyoit appercevoir d’abord plufieurs petits fyftê-
mes partiaux.
Il n’y a point de forme particulière affedlée à l’animal;
il n’y a point de forme particulière exclue
de Y animalité. C’eft ce qu’indique la variété infinie
des formes animales'; fuivez la métamorphofe du
prototype depuis l’huître jufqu’à la baleine, depuis
le polype jufqu’à l’éléphant, jufqu’à- l’homme.
Non feulement la nature peut animalifer la matière ,
fous telle forme qu’il lui plaît, fans exception ; mais
elle peut encore faire paffer un même individu
par plufieurs formes fucceftïves qui paroiffent très-
éloignées les unes des autres, 6c dont pourtant là
feconde eft engendrée par la première, comme elle
engendre la troifieme. C ’eft le phénomène que nous'
offre la métamophofe des infectes. Un fait plus particulier
8c plus curieux encore , eft la transformatiorf
des poiffons en grenouilles. On voit lin petit poiffon,
efpece de têtard, pouffer fucceffivement des pattes,
perdre fa queue , Ôc changer fa forme de. poiffon en
cèlle d’une grenouille. Voyé^pl. I. d’Hiß. nat. dans
ce Supplément. Ce changement eft fur-tout remarquable
dans la grenouille d’Amboine, dont l’embryon
eft un petit poiffon d’une figure fi déterminée , -qu’on
ne foupçonnéroit pas qu’elle ne fût qu’un paffage à
line autre forme: c’eft un'corps ramaffé ,une tête
courte , une queue longue, garnie d’ailerons remontés
jufques vers la tête {fig9- ) » du refte aucune apparence
de pattes, qui puiffe indiquer que ce foit
une grenouille déguifée. Bientôt l’embryon prend des-
pieds , la. queue difpàroît, 6c le poiffon eft.une grenouille
parfaite {fig. '■ i- ')- Ce n’eft pas-là la fin de
cette feene changeante. Les grenouilles dé Surinam,
de Curaçao 6c d’autres contrées de l’Amérique fe
changent derechef en poiffons. Dès qu’elles fönt parvenues
à leur groffeur, il leur pouffe unè queue au-
bas de l’épine du dos, 6c à mefure qu’ellécroît, leurs
pa'ttes s’affacent, la têre change de forme ; 8c le natu-
raliftë, témoin de ce phénomène, voyant uh poiffon
parfait, garni de nageoires, eft forcé’de convenir que
Y animalité eft indépendante des formes. Voye{ Yart,.
Grenouille, dans ce Supplément.
Les zoophytes, animaux-plantes , Ou plantés animales
, font de vrais animaux, dont la forme exté-,
ri eure approche plus du végétal que de l’animal. Le
champignon marin, la plume de mer, une tige bran-
chùe,' une gouffe affez femblable à celle qui contient
la graine des pavôts, p’ortée fur un pédicule enraciné
dans un morceau de rocher, font des êtres dont lVz-
nimalité eft conftatée , 6c qui pourtant s’éloignent affez
dés formes animales ordinaires , pour qu’il foit
aifé de les confondre ayeç les formes végétale?.. Lç
bolype. à bouquet reffemble plus à une fleur , qu’à
toute autre’chofe. Auffi Marfighi a pris les petits polypes
marins pour des fleurs, par une méprîfe qui
portoit uniquement fur l’àppàrence.extérieure ; 6c
Trembley a douté quelque tems de la nature des
■ polypes d’eaù douce. Concluons què l'animalité
fe cache fo'ûvent fous les formes qui femblent lui
Convenir lé môins, lôrfqu’on les compare 'à celles
des autres animaux plus connus 8c plus ordinaires;
mais que dans le vrai, toutes les formes lui conviennent,
qu’elle n’en exclut 'aucune, eh un mot,
que toutes les formés naturelles font animales, 8c
qu’il n’éft pas poffible d’admettre la différence des
formes pour un diftinftif fuffifant entre les animaux ôc
lesvégétaux. F. C h a m p i g n o n marin,H o l o t h u r i e
P l u ME-DE-MER, R e ïN-DÈ-MER, P R i à PE à tige déliée
S? au ’Corps oydl, MO u c H e V e g e ï a l e , dans ce Suppl.
ÔC Üart. PolY’PES , Diclionn. des fcknces , 6c Suppl.
Si de l’examen des formes animales extérieures,
nous pàffoûs à'Celui des formes animales intérieures , •
c’eft-à-dire , de la ftruétiire organique des animaux,
nous nous convaincrons egalement qu’il h’y à point
d’organifatiôn particulière affeÛée à l’animàl, qu’il n’ÿ
a point d’otganifâtiOn exclue dé Y animalité. Combien
la ftrufture organique d’une bulbe pôlypéufe ,
de la gallihfeûe, delà moule des étangs, 6c de quelques
coquillages plus dégradés encore, ne s'éloigne-
t-elle pas de l’orgànifation des autres ânimàux quê
nous côrinoiffons ? Il y a certainement plus 'de défiance
à cet égard de l’huître à l’homme, que du po^-
lype à une moufle. Le polype à bouquet , lé polype
à entonnoir, rt’ônt aucun des organe? des autres
animaux ; ces organes ne font donc pas eflen-
iiels à l’animal. Ils rt’ont même rien de femblable ni
d’analogue : Y animalité rt’eft dônC pas attachée à ces
Organes, ni à leurs analogues, 6c elle peut fe pàffer
des uns 6c des autres. La nature peut donc animalifer
la matière fur un plan tout différent de ce que nous
en favons ou pouvons imaginer., le coeur 6c le fang
que ce double mufcle diftribue dans toutes ies parties
de la machine animale , le cerveau 6c lamôëllê
alongée, les veines, les nerfs ouieurs équivalens ,
font des appartenances propres de certaines efpeces
animales'; mais ils rte conftituent point Y animalité ;
auffi en defeendant, l’échelle univerfelle des êtres,
avant que d’arriver au polype, nous trouvons quantité
d’animaux qui manquent de tous ces Organes ,
ou d’une partie , 6c qui n’en font, pas moins des ành
maux. Le polype eft un animal dont là ftruéture organique
ne reffemble en rien à cèlle des autres animaux;
il .peut de même y avoir un autre animai dont
la ftruûure ne reffemble ni à celle du polype, ni
à celle de tous les autres individus animés, avoués
pour*tels ; 6c cette variation de machines animales,
peut être portée jufqu’à une progreffion à laquelle
il ne nous eft pas permis d’affigner des bornes.
La nutrition des animaux fe fait de tant de maniérés
avec tant ôefi peu d’organes , avec des organes fi dif-
femblables, qu’elle n’offre rien d’afl’ez confiant, rii
d’aflèzuniforme, pour en tirer un caraftere diftinftif.
L’homme commence à fe nourrir à la maniéré des plantes.
De quelque maniéré que l’animal fe nourriffe ,
que Ce foit par une ouverture uniqu e , par une bouche
, unfoec, une trompe , ou par un Certain nombre
«d’ouvertures, par desfuçoirS, des radicules,des marne-
Ions,ou par des pôres diflribués fur toute fa furface extérieure,
cela eft fort indifférent à fon animalité. Cë
que je dis dés organes extérieurs de la nutrition, s’étend
également aux organes plus ou.moinsmultipliés,
plus ou moins compblés, qui font au-dedatis de l'animal
pour y préparer les alimens 6c les difpofer à l’affi-
milation. Sûrement éette -préparation exige plus ou
moins d appareil, de machines ôc d’à&ion , félon la
qualité des aliméns, 6c l’organifation des divers
I. ànimâux. Mais cet appareil d’organes digeftifs ne
conftitue point Y animalité', ôc il peut y avoir une
• économie animale fi fi tapie , qu’elle rejette comme
j inijrifos tous les vâiffeaux çhy miques 6c les ibe'nftruei
; néçéffaires à uhe ahimàtité plus 'cbmpôféé. On peut
donc dire que toutes ies maniérés de fe nourrir peu-
I vent convenir al’ animalité qui C’en affe été 6c ri’en ex*
‘ ciut'aùcuhe.
À l’égard de l’accroilfement, il eft le meme dans
tous les ê t r e s i ls paffent tous de l’état de germe à
celui de développement 6c de perfedion, en s’in-
l eorporant la matière de leur nourriture^
Il y a peut-être un peu plus de difficulté au fujet
de là génération ; mais, e’eft uniquement pour le
peuple .ôc non pour le philofophe : pour le peuple
qffi croit que tous,les animaux s’accouplent, ôc qui
n’a point vu les,-plantes 6c les foffiles s’accoupler, &
: non pour le philofophe qui fait combien il y a de
variations dans fe .génération des animaux, qui a vu
quantité de vermifféaux multiplier fans -copulation ,
même fans aucune communication des deux fexes!
des infeâes multiplier de bouture ; un bouton animal
naître, croître Ôc s’épahouîr fur un tronc animal;
le polype jetter des graines ,, 6c pouffer-des rejet-
tons; qui à reconnu le fexe des plantés , & vu les ■
fleurons mâles répandre leuf femencè fur les fleurons
femelles , c’eft-à-dire, qui à vu des animaux multiplier
'comme les plantes, ôc lès plantes engendrer
comme les ànimaux ; pouf le philofophe qui, ayant
étudié la nature des foffiles, leur brganilàtion fem-
blàble à celle des ô's , des dents, des cornés clés animaux
, ôc à cèlle des bois les plus durs , comme l’ë-
benè ôc le gayac, leur“ forme coiiftarite, à é-ompris
qu’il fâll'oit que les pierres ôc les métaux vinffent dé
fémenee, d’un germe où fie tels êtres organiques
fuflënt ébauchés en petit; qui a reéonhu comment
les pierres 6c les métaux jètfôieht leur.graine ou fe-
méheè, quoiqu’on ne leur ait point encorë trouvé dé
différences fexueles, ainfi qit’ily aphifiêurs ànimaux
6c végétaux dans ce càs ; 'qui à vu une infinité de foetus
pierreux 6c métalliques dans leur'matrice, avec leurs
enveloppes 6c placenta, qui les y a vu croître Ôc fe
nourrir comme les autres animaux. Ces ôbfervations
ne laiffent plus aucun lieu de douter que la génération
ne foit à-peu-près uniforme dans tous les êtres v
6c là différence qu’il peut y avoir entr’eux dans là
taanierede fe reproduire j à quelque point qu’elle
foit p'brtée , peut au plusvarier Y animalité: maisellè
l’etendra,au lieu de la reftreindre à une certaine col-
leélion d’êtres particuliers:
La faculté locô-taotivë ëft ùn fec.bufs àccidenteî
donné à quelques êtres ; polir fatisfaire lëurs befoins;
fur-tout le befoin de fe nourrir, 6c que par confé-
quent ils ont reçu félon là mefure & l’exigence dé
leurs befoinSi Ceux à qui elle n’e'ft pas néceffàire, eii
font privés, fans chàngér pouf Cela de nature. Car;
comme un ànimàl qui dort-, ôc qui pendant que lé fom-
méil enchâîne fes pieds, ne çeffe pas d’être animal;
quoique privé de la faculté dé fe mouvoir, pouf
tout letëms de fonfommeil; de même une plante;
une pierre, peuvent être regardées comme des ani^
maux qui dorment toute leur vie. L’état de repos ou
la négation du mouvement h’ëxclut pas plus Y animalité
quê l’état de mouvement, ou la négationdu repos;
Il n’eft pas. difficile de faire f entrer lés végétàux
dans la claffe des animaux. Les Uns 6c les autres font
des êtres organiques, d'oués de là triple faculté dé
fe nourrir, de croître 8c d’ëngéndrer, propriétés qui
feules conftimerit Y animalité, 6c qu’un oeil philbfd-
phé apperçoit àifément dans tous lés êtres: Les
plantés font des ànimaux fédentaires ou eriracinés ,
deftinés par la nature à paffèr leur vie fur le poinÊ
de là furface du globe où elles naiffent. Nou$