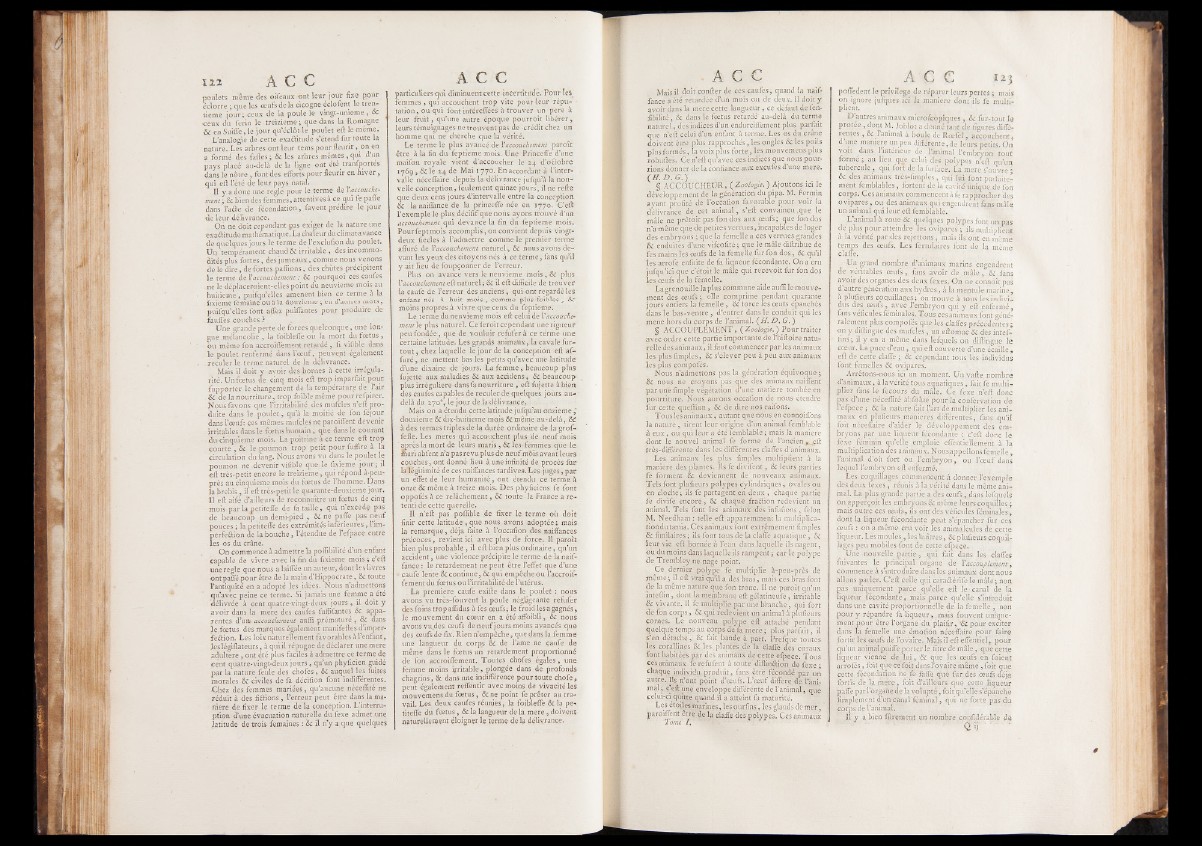
poulets même des oifeaux ont leur jou'r fixe pour
éclorre ; que les oeufs de la cicogne eclo fient le tien-
tieme jour; ceux de la poule le vingt-unieme , 6c
ceux du ferin le treizième ; que dans la Romagne
& en Suiffe , 1e jour qu’éclôt -le poulet eft le même.
L’analogie de cette exattitude s’étend fur toute la
nature. Les arbres ont leur tems pour fleurir, on en
a formé des faites ; 6c les arbres mêmes , qui d’un
pays placé au-delà de la ligne ont ete tranfportés
dans le nôtre , font des efforts pour fleurir en hiver ,
qui eft-Tété de leur pays natal.
Il y a donc une réglé pour le terme de Vaccouchement
bien des femmes, attentives à ce qui fe paffe
dans l’atte de fécondation, favent prédire le jour
de leur délivrance.
On ne doit cependant pas exiger de la nature une
exaâitude mathématique. La chaleur du climat-avance
de quelques jours le terme de l’exclufion du poulet.
Un tempérament chaud 6c irritable , des incommodités
plus fortes, des jumeaux, comme nous venons
de le dire, de fortes pallions, des chûtes précipitent
le terme del’accouchement: 6c pourquoi ces caufes
ne le déplaceroient-elles point du neuvième mois au
huitième, puifqu’elles amènent bien ce ternie à la
îixieme femaine ou à la douzième ; en d’autres mots,
puifqu’elles font alfez puiflantes pour produire de
. rauffes couches ) . \
Une grandepërte de forces quelconque , une longue
mélancolie , la foiblelfe ou la mort du foetus,
ou même fon accroiflëment.retardé , .fi. vifible dans
le poulet renfermé dans l’oeuf, peuvent également
reculer le terme naturel de la délivrance.
Mais il doit y avoir des-bornes à cette irrégularité.
Un foetus de cinq mois eft trop imparfait,pour
fupporter le changement de la température de l’air
& de la nourriture, trop foible même pourrefpirer.
Nous lavons que l’irritabilité des mufcles n’eft produite
dans le poulet, qu’à la moitié de fon féj.our
dans l’oeuf: ces mêmes mufcles ne paroiffent devenir
irritables dans le foetus humain, que dans le courant
du cinquième mois. La poitrine à ce terme eft trop
courte , & le poumon trop petit pour fuffire à la
circulation dufang. Nous avons vu dans le poulet le
poumon ne .devenir vifible quelle fixieme jour ; il
eft très-petit encore le treizième, qui répond à-peu-
près au cinquième mois du foetus de l’homme. Dans
la brebis, il eft très-petit le quarante-deuxieme jour.
11 eft aifé d’ailleurs de reconnoître un foetus de cinq
mois par la petiteffe de fa taille, qui n’excedç. pas
de beaucoup un demi-pied , 6c ne paffe pas neuf
pouces ; la petiteffe des extrémités inférieures, l’im-
perfettion de la bouche, l’étendue de l’efpacë. entre
les- os du crâné. .
On commence à admettre la poffibilité d’un enfant
capable de vivre avéc là fin du fixieme mois ; c’ eft
une réglé que nous a laiffée un auteur, dont les livres
ontpaffé pour être de la main d’Hippocrate, 6c toute
l’antiquité en a adopté les idées. Nous n’admettons
qu’avec peine ce terme. Si jamais une femme a ete
délivrée à cent quatre-vingt-deux jours , il doit y
avoir dans la mere des caufes fuffifante's & apparentes
d’un* accouchement auffi prématuré , & dans
le.foetus dès marques également manifëftes d’imper-
fettion. Les loix naturellement favorables à l’enfant,
leslégiflateurs, à qui il répugne de déclarer une mere
adultéré, ont été plus faciles à admettre ce terme de
cent quatre-vingt-deux jours, qu’un phyficien guidé
par la nature feule des chofes, 6c auquel les fuites
morales 6c civiles de fa décifion font indifférentes.
Chez des femmes mariées, qu’aucune neceffite ne
réduit à des fittions , l’erreur peut être dans la maniéré
de fixer le tèrme de la conception. L interruption
d’une évacuation naturelle du fexe admet une
latitude de trois femaines : 6c il n’y a que quelques
particuliers qui diminuent cette incertitude. Pour les
femmes , qui accouchent trop vite pour 'leur répu- •
tat-ion, ou qui font inféreffées à trouver un pere à
leur fru it, qu’une autre époque pourr-oit libérer >
leurs témoignages ne trouvent pas de crédit chez un
homme qui ne cherche que la vérité.
Le terme le plus avancé de Y accoucheifient paroît
être à la fin du feptieme mois. Une Princeffe d’une
maifon royale vient d’accoucher le -24 d’ottobre
1769, 6c le 24 de Mai 1770. En accordant à l’intervalle
néceffaire depuis la délivrance jufqii’à la nouvelle
conception, feulement, quinze jours, il ne refte
que deux cens jours d’intervalle entre la conception
6c la naiffance de la princeffe née en 1770. C’eft
l’ exemple le plus décifif que nous ayons trouvé d’un
accouchement qui devance la fin. du feptieme mois.
Pourfept mois accomplis, on convient depuis vingt-
deux fiecles à l’admettre comme le premièr terme
affuré de Yaccouchement naturel, & nous avons devant
les yeux des citoyens nés à ce terme,, fans qu’il
y ait lieu de foupçonner de l’erreur.
Plus on avance vers le neuvième mois , & plus
Yaccouchement eft naturel ; & il eft difficile de trouver
la caufe de. l’erreur, des anciens, qui.ont regardé les
enfans nés à . huit mois., comme plus fbibles , 6c
moins propres à vivre que ceux du feptieme.
Le terme du neuvième mois eft celui de Vaccouche-
ment le plus naturel. Céferoit cependant une rigueur
peu fondée , que dë.vouloir refufer à ce terme une
certaine latitude. Les grands animaux, la cavale fur-
tout , chez laquelle le jour de la conception eft affuré,
ne mettent bas les petits qu’avec une latitude
d’une dixaine de jours. La femme, beaucoup plus
fujette aux maladies 6c aux accidens, & beaucoup
plus irrégulière dans fa nourriture , eft fujette à bien
des caufes capables de reculer de' quelques jours au-
delà du 270e,-le jour de la délivrance.
Mais on a étendu cette latitude jufqu’au onzième
douzième & dix-huitieme mois 6c même au-delà, &
à des termes triples de la durée ordinaire de la grof-
fefle. Les meres qui accouchent plus.'de neuf mois
' après la mort de leurs maris , 6c lesrfemmes.que le
mari abfent n’a pas revu plus de neuf môis avant.leurs
couches , ont donné lieu à une infinité de procès fur
la légitimité, de ces naiffances tardives. Les juges-, par
un effet.de leur humanité, ont étendu ce terme à
onze & même à treize mois, Des phyficiens fe font
oppofés à ce relâchement, 6c toute la France a retenti
de cette querelle.
Il n’eft pas poffible de fixer le terme oîi doit
finir cette latitude , que nous avons adoptée ; mais
la remarque, déjà faite à Poccafion des naiffances
précoces, revient ici avec plus de force. Il paroît
bien plus probable, il eft bien plus ordinaire, qu’un
accident, une violence précipite le terme de la naif-
fànce : le retardement ne peut être l’effet que d’une
■ caufe lente & continue, & qui ëmpêche ou l’accroif-
fement du foetus ou l’irritabilité de l ’utérus.
La première caufe exifte dans le poulet : nous
avons vu très-fouvent la poule négligeante refufer
des foins tropaffidus àfesoeufs; le froid les a gagnés,
le mouvement du coeur en a été affoibli, 6c nous
avons vu.des oeufs de neuf jours moins avancés que
des oeufs de fix. Rien n’empêche, que dans la femme
une langueur du corps 6c de Pâme ne caufe de
même dans le foetus un retardement proportionné
de fon accroiffement. Toutes chofes égalés, une
femme moins irritable, plongée dans de profonds
chagrins, & dans une indifférence pour toute chofe ,
peut également reffentir avec moins de vivacité les
mouvemens.du foetus, 6c ne point fe prêter au travail.
Les deux caufes réuniès, la foibleffe 6c la petiteffe
d]u foetus, 6c la langueur de la mere , doivent
naturellement éloigner le terme de la délivrance.
Mais il doit confier de ,ces caufes, quand la naiffance
a été retardée d’un mois ou de deux. Il doit y
avoir dans la mer.e cette langueur, ce défaut de fen-
fibilité, 6c dans le foetus retardé" au-delà du terme
naturel, des indices d’un endurcilfement plus parfait
que n’eft celui d’un enfant à terme. Les os du crâne
doivent être plus rapprochés, les ongles & les poils
plus formés , la voix plus forte , les mou vemens plus
robuftes. Ce n’eft qu’avec ces indices que nous pourrions
donner de la confiance aux excufes d’une mere.
(H. D:G.)~ \„
§ ACCOUCHEUR, (Zoologie.) Ajoutons ici le
développement de la génération du pipa. M. Fermin
ayant profité de Poccafion favorable pour, voir la
délivrance de cet animal, s’eft convaincu,que le
mâle ne prêtpit pas fon, dos aux oeufs ; que fon dos
n’a même que de petites verrues, incapables de loger
des embryons ; que là femelle a ces verrues grandes
6c encjuites d’une vifcofité ; que le mâle diftrlbue de
fes mains les oeufs de la femelle fur fon dos, 6c qu’il
les arrofe enfuite de fa liqueur fécondante. On a cru
jufqu’ici.que c’éto.it le mâle qui recevoit fur fon dos
les oeufs de la femelle.
La grenouille la plus commune aide auffi le mouvement
des oeufs ; elle comprime pendant quarante
jours entiers la femelle , & force les oeufs épanchés
dans le'bas-ventre , d’entrer dans le conduit qui les
mene hors du corps de l ’animal. (H. D , G. )
§ ACCOUPLEMENT, ( Zoologie. ) Pour traiter
avec ordre cette partie importante de l’hiftoire naturelle
des animaux, il,faut commencer par les animaux
les plus (impies, 6c s’élever peu à peu aux animaux
les plus compofés.
Nous n’admettons pas la génération équivoque;
6c nous ne croyons pas que de;s'animaux naiffent
par une (impie végétatipn d’une matière tombée en .
'pourriture. Nous aprons occalion de nous étendre
fur cette queftion , 6c de dire nos raifons.
Tous les animaux, autant que rious en connoiffons
la nature tirent leur origine d’un animal femblable
à eu x, ou qui leur a été femblable ; mais la maniéré
dont le nouvel animal fe forme de. Pancien ^ f t
très-différente dans les différentes claffes d’animaux.
Les animaux lés plus'fimplës multiplient à .la
maniéré des plantes. Ils fe divifent, 6c leurs parties
fe Forment 6c deviennent de nouveaux animaux.
Tels font plufieurs polypes cylindriques ^ ovales ou
en cloche ; ils.fe partagent^en deux , chaque partie
fe divife encore, 6c chaque frattion redevient un
animal. Tels font les animaux .‘dés infufions, félon
M . Nèedham : telle eft apparemment la multiplica-
tiondu tamia. Ces animaux font extrêmement fimples
6c fimilaires; ils font tous de la claffe aquatique, &
leur vie. eft bornée;à l’eau dans laquelle ils nagent,
ou du moins dans laquelle ils rampent ; car le polype
de Tremhley né.nage point.
Ce dernier polype fe multiplie à-peu-près de
même; il eft vrai qu’il a des bras, mais ces bras font
de la même nature que fon tronc. Il ne paroît qu’un
inteftin,.dont la membrane eft gé.latineufe, irritable
6c vivante. Il fe multiplie par une branche, qui fort
dë fon corps, 6c qui redevient un animal à plufieurs
cornes. Le nouveau polype eft attaché pendant
quelque, temps au qorps de fa mère ; plus parfait, il
s’en d é ta c h é & fait bande à part. Prefque toutes
les corallines 6c_ les plantes de la claffe des coraux
font habitées par des animaux dé cettè efpece. Tous
ces animaux ferefufent à toute diftinttion de fexe •
chaque individu-produit, fans .être fécondé par un
autre. Ils n’ônjt point d’oeufs. L’oeuf différé de l’àni-
c’eft une enveloppe différente de l’animal, que
celui-ci quitte quand il a atteint fa maturité. “
Les etpiles marines, les ourfins, les glands de mer,
paroiffent etre de la claffe des polypes. Ces animaux
'Tonie I,
poffedent le privilège de réparer leurs pertes ; mais
on ignore jufques ici la maniéré dont ils fe multiplient.
D ’autres animaux microfcôpiques , & fur-tout le
protee , dont M. Joblot a donné tant de figures différentes
, & l’animal à boule de Roefel, accouchent t
d une maniéré un peu differente,de leurs petits. On
voit dans l’intérieur de ï’animal l’embryon tout
formé; au lieu que celui des polypes n’eft au’un
tubercule , qui fort de la furface. La mere s’ouvre ;
6c des animaux très-fimples, qui lui font parfaitement
fembla blés , fortent de la cavîté unique.de fon
corps..Ces animaux commencent à fe rapprocher des
ovipares , ou des animaux qui engendrent fans mâle
un animal qui leur eft femblable.
L ’animal à roue & quelqties polypes font un pas
de plus pour atteindre- les ovipares ; ils multiplient
à; la vérité par des rejettons, mais ils ont en même
temps des oeufs. Les fertulaires font de la même
claffe. ’ ’’
. •Un grand nombre d’animaux marins engendrent
de véritables oeufs, fans avoir de m â l e & (ans
avoir, des organes des deux fexes. Oh ne çônnôît pas
d’autre génération aux hydres, à la mentale:marine,
à plufieurs coquillages ; on.trouve à tous les'individus
des oeufs,, avec l’embryon qui y eft enfermé,
fans véficules féminales. Tous ces animaux font généralement
plus compofés que les claffes précédentes ;
on y diftingue des mufcles, un eftomac & des intef-
tins; il y en a même , dans lëfquels on diftingue le
coeur. La puce d’eau, qui eft couverte d’une écaille ,
eft de cette claffe ; 6c cependant tous les individus
font femelles 6c ovipares.
Arrêtons-nous ici un moment. Un vafte nombre
d’animaux , à'la vérité tous.aquatiques, fait fe multiplier
fans le fecours du mâle. Ce fexe n’eft donc
pas d’une néceffiré àbfolué pour, la confervation de
l’efpece ; 6c la nature fait l’art de multiplier les ani-r
maux en plufieurs maniérés différentes.‘.fans qu’il
fôit néceffaire d’aider le développement des embryons,
par une liqueur fécondante : c’eft donc le
fexe féminin qu’elle ..emploie effentiellement à la
multiplication des animaux. Nous appelions femelle,
l’animal d’où fort ou l’embryon, ou l’oeuf dans
lequel l’embryon eft enfermé.
Les coquillages commencent à donner l’exemple
des.deux (exes , réunis à la vérité dans le même animal.
La plus grande partie ,a des oeufs, d anslefquels
on apperç.oit les embryons & même leurs coquilles ;
mais outre ces oeufs, ils ont des véficules féminales ,
dont la liqueur! fécondante peut s’épancher fur ces
oeufs : pn a même cru.v.oir ,les animalcules de cette
liqueur. Les.moules, les huîtres , & plufieurs.coquil-
lages peu mobiles font de cette efpece.
Une ■ nouvelle partie , . qui fait dans les claffes
fùivantes le principal organe de Y accouplement,
commence, à s’introduire dans les animaux dont nous
allons parler. C’eft.celle qui cara&érife le mâle; non
pas uniquement parce qu?elle eft le .canal de la
liqueur fécondante , mais parce qu’elle s’introduit
dans une cavité proportionnelle de la femelle.',‘non
pour y répandre fa liqueur -,..mais. ..fouvent .uniquement,
pour être l’organe ‘du plaifir, ■ & pour exciter
dans la femelle une émotion néceffaire. pour faire
fortir les oeufs de l’ovaire. Mais il eft effentiel, pour
qu’iui animal puiffe porter lé titre de mâle ,• que cett,e
liqueur vienne de lu i, '6c que les oeufs , en foient
arrofés, foit que cé fpit dansToyaire même , fôit que
cette; fécondation ne', fe raffe que fur.des oeufs déjà
fortis de la me’r e , foit d’ailleurs que .cette liqueur
paffe par l’organe de la volupté, foit qu’elle s’épanche
fimplement d’un canal féminal , qui ne'forte pas du
.corps de l’animal.
Il y a bien fûrement un nombre confidérable dè
I l s ■ '
ê