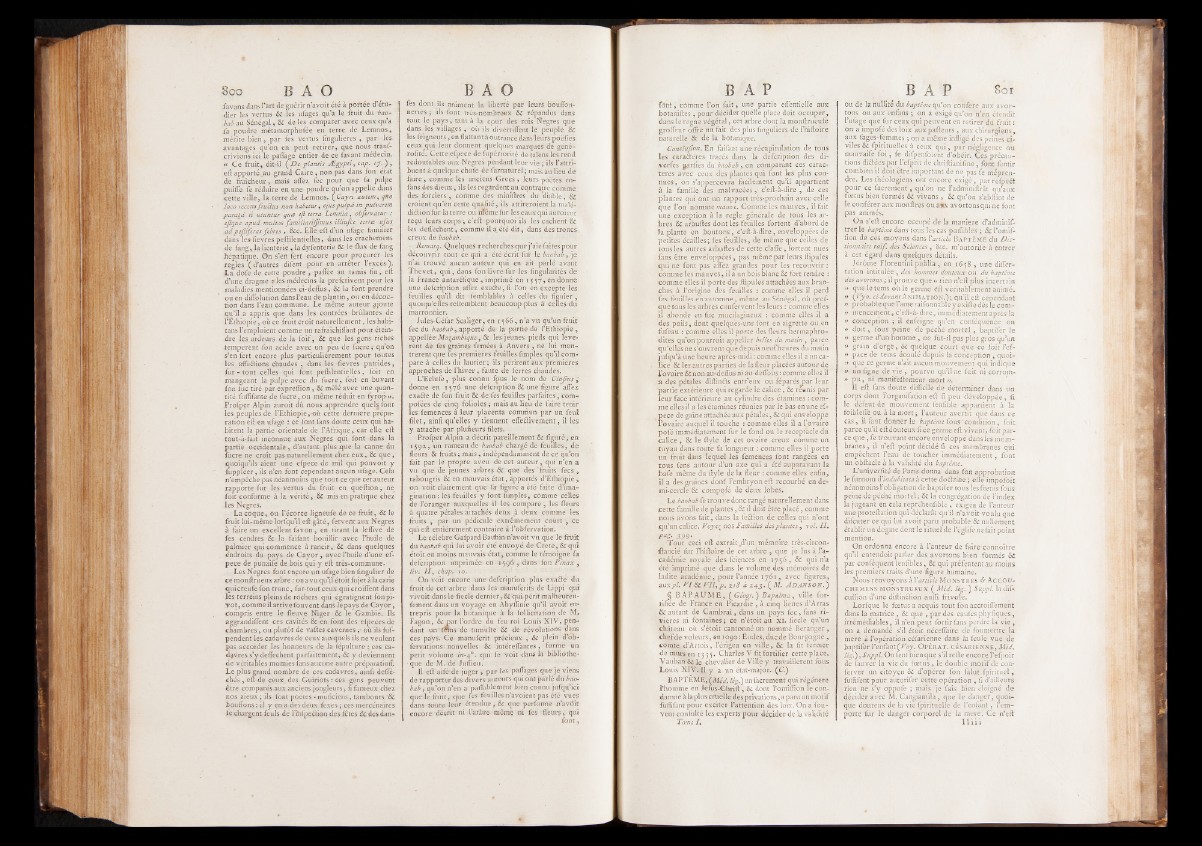
8oo B A O
iavans dans l’art de guérir n’avoit été à portée d’étü-
dier les vertus & les ufages qu’a le fruit du baobab
au Sénégal, & de les comparer avec ceux qu’a
fa . poudre métamorphofée en terre de Lemnos.,
mérite bien, par fes vertus fingulieres , par lés.
avantages qu’on en peut retirer, que nous tranf-
crivions ici le paffage entier de ce lavant médecin.
« Ce fruit,, dit-il {D e plantis Ægypti, cap. iy.^ ) ,
eft apporté ,au grand Caire , non pas dans fon état
de fraîcheur, mais affez. fec pour que fa pulpe
puiffe fe réduire en une poudre qu’on appelle dans
cette ville, la terre de Lemnos. ( Cayri autem, qûo
loco recens fruclus non habetur, ejus pulpâin pulverem
paratâ ii utuntur qucz ejl terra Lemnia, obfervatur :
ejlque apud multos familiarijjimus illiufce terra ufus
ad pejliferas febres , &c. Elle eft d’un ufage familier
dans les fievres peftilentielles, dans les crachemens
de fang, la lienterie , la dyfenterie & le flux de fan g
hépatique. On s’en fert encore pour procurer les .
réglés (d ’autres difent pour en arrêter l’excès ).
•La dofe de cette poudre , paffée au tamis fin, eft
d’une dragme f ie s médecins la prefcrivent pour les
maladies mentionnées ci-deffus, & la font prendre
ou en diflolution dans l’eau de plantin, ou en décoction
dans l’eau commune. Le même auteur ajoute
qu’il a appris que dans les contrées brillantes de
l’Ethiopie, où ce fruit croît naturellement, les habi-
tans l’emploient comme un rafraîchiffant pour éteindre
les ardeurs de la -foif, & que les gens riches
temperent fon acide avec un peu de fucre ; qu’on
s’en fert encore plus particuliérement pour toutes
les affections chaudes , dans lès fievres putrides,
fu r - tout-celles qui font peftilentielles, foit en
mangeant la pulpe avec du fucre, foit en buvant
fon fuc tiré par expreflîon, & mêlé avec une quantité
fuffifante de fucre, ou même réduit en fyrop ».
Profper Alpin auroit du nous apprendre quels font
les peuples de l’Ethiopie,-où cette derniere prépa^
ration eft en ufage : ce font fans -doute ceux qui habitent
la partie orientale de l’Afrique, car elle eft
tout-à-fait inconnue aux Negres qui font dans la
partie occidentale, d’autant plus que la canne du
fucre ne croît pas naturellement chez eux, & que,
quoiqu’ils aient une efpece de mil qui pouvoit y
fuppléer, ils n’en font cependant aucun ufage. Cela
n’empêche pas néanmoins que tout ce que cet auteur
rapporte fur les vertus du fruit en queftion, ne
foit conforme à la vérité, & mis en pratique chez
les Negres.
La coque, ou l’écorce ligneufe de ce f r u i t , & le
fruit lui-même lorfqu’il eft gâté, fervent aux Negres
à faire un excellent favon, en tirant la leflive de
fes cendres & la faifant bouillir avec l’huile de
palmier qui commence à rancir, & dans quelques
-endroits du pays de C a yo r , avec l’huile d’une efpece
de punaifé de bois qui y eft très-commune.
Les Negres font encore un ufage bien fingulier de
ce monftrueux arbre : on a vu qu’il- étoit fujet à la carie
quicreufefon tronc, fur-tout ceux quicroiffent dans
les terreins pleins de rochers qui égratignent fon piv
o t, comme il arrive fouvent dans le pays de Cayor,
Compris entre le fleuve Niger & le Gambie. Ils
aggrandiffent ces cavités & en font des efpeces de
chambres, ou'plutôt de vaftes cavernes où ils fuf-
pendent les. cadavres de ceux auxquels ils ne veulent
.pas accorder les honneurs de la fépulture : ces cadavres
s’y deffechent parfaitement, & y deviennent
de véritables momies fans aucune autre préparation.
Le plus grand nombre de ces cadavres, ainfideffé-
chés ,.eft de ceux des Guiriots : ces gèns peuvent
être comparés aux anciens jongleurs, fi fameux chez
nos aïeux •; ils font poètes -miificiens , tambours &
bouffons : il y en a des deux fexes-; ces mercenaires
fe chargent feuls de lWpection des fêtes & des dan-
B A O
fbs'dont, ils animent la liberté par leurs, bouffonneries.;
ils- font très-nombreux & répandus'dans
tout le pays , tant à la cour des rois. Negres que
dans les villages , où ils divértiffent le peuple &
les féigneurs, en flattant à outrance dans leurs poëfies
ceux qui leur donnent quelques marques de géné-
rofite. 'Cette efpece de fupériorité de talens les rend
redoutables aux Negres pendant leur vie • ils l’attribuent
à quelque chofe de fürnaturel; mais au lieu de
faire, comme les anciens G re c s leu r s poètes en-
fans des dieux, ils les regardent au contraire comme
des forciers comme des minîftres du diable j &
croient qu’en cette qualité, ils attireroient la malé- .
diélion fur la terre ou même fur les eaux qui àuroient •
reçu leurs corps; c’eft pourquoi ils les cachent &
les deffeehent, comme il a été dit, dans des troncs
creux de baobab.
Remarq. Quelques recherches que j’aie faites pour
découvrir tout ce qui a été écrit fur le baobab, je
n’ai trouvé aucun auteur qui en ait parlé avant
Thevet, qui , dans fon livre fur les fingularités de
la France antarctique, imprimé en 1557, en donne
une defcription. affez exaCte, fi l’on en excepte les
feuilles qu’il dit femblables à celles du figuier,
quoiqu’elles reffemblent beaucoup plus à celles du
marronnier. .
Jules-Céfar Scaliger, en 1 *j66, n’a vil qu’un fruit
fec du baobab, apporté de- la partie de' l’Ethiopie ,
appellée Mozambique, & les jeunes pieds qui levèrent
de fes graine.s femées à Anvers ■ , ne lui montrèrent
que fes premières feuilles fimples qu’il compare
à celles du laurier ; ils périrent aux premières
approches de l’h iver, faute de ferres chaudes.
L’Eclufe, plus connu fous le nom de Çlujtus
donne en 1576 une defcription & une figure affez
exaéte de fon fruit & de fes feuilles parfaites, com-
pofées de cinq, folioles.; mais au lieu dè faire tenir
les femences à leur placenta commun par ïm feul
•filet, ainfi qu’elles y tiennent effectivement, il les
y attache: par plufieurs filets. -
Profper Alpin a décrit pareillement & figuré, en
1592, un rameau de baobab chargé de feuilles, de
fleurs & fruits ; mais, indépendamment de ce qu’on
fait par le propre aveu de cet auteur, qui’ n’en a
vu que de jeunes arbres & que des ‘fruits fecs ,
rabougris & en mauvais état, apportés d’Ethiopie >
on voit clairement que fa figuré a été faite d’imagination
: les feuilles'y font fimples, comme celles
de l’oranger auxquelles il les compare, les-fleurs
à quatre pétales attachés deux à deux comme les
fruits , par un pédicule extrêmement court , ce
qui eft entièrement contraire à l’obfervation. 0 •'
Le célébré Gafpard Baifhin n’avoit vii que le fruit
du baobab qui lui avoir été envoyé de Cret'e, & qui
étoit en moins mauvais état, comme le témoigne fa
defcription imprimée- en -1-596' ,-dans -fon P'tnax ,
liv. H , chapi 10.
On voit encore une defcription plus exafte du
fruit de cet arbre dans les manufcrits de Lippi qui
vivoit dans le fiecle dernier ,-&'qui périt mâlhèureu-
fement dans un voyage en Abyflinie qu’il ayoit entrepris
pou-r la botanique-à la fol licitation de M.
Fagon, & par l’ordre du feu roi Louis XIV, pèn-
dant un"t£rns de tumulte & de révolutions dans
ces pays. Ce manufcrit précieux , & plein d’ôb-
fervatioiisi nouvelles 6c- intéreffantes , forme un
petit volume i/2-40. qui fe voit dans la bibliothèque
de'M.’ -de Juflieu.
Il eft' aifé' de juger, par les' paffages que je viens
de rapporter des divers auteurs qui ont parlé du baobab
, qu’on n’en a paffablement bien connu jufqu’ici
que le'fruit, que Tes feuilles n’âvoient pas été vue^
dans toute leur étendue, & que perfônne- rfavôit
encore décrit ni l’arbre, même ni fes fleurs, qui
font,
B A P
fôtït, cômme l’on fait, une partie effentielle aux
botaniftes-, pour décider quelle place doit occuper,
dans le régné végétal, cet arbre dont la monftrueufe
groffeur offre un fait des plus finguliers de l’hiftoire
naturelle & de la botanique.
Condition. En faifant une récapitulation de tous
les carafteres tracés dans la defcription des di-
,verfes parties du baobab, en comparant ces caractères
avec ceux des plantes qui font les plus connues,
on s’appercevra facilement qu’il appartient
à la famille des malvacées ,• c’eft-a-dire , de ces
plantes qui ont un rapport très-prochain avec celle
q ne l’on nomme mauve. Comme les mauves, il fait
une exception à la réglé générale de tous les arbres
& arbuftes dont les feuilles fortent d’abord de
la plante en boutons, ç’eft-à-dire, enveloppées de
petites écailles; les feuilles, de même que celles de
tous les autres arbuftes de cette claffe , fortent nues
fans être enveloppées, pas même par leurs ftipules
qui ne font pas affez grandes pour les recouvrir :
comme les mauves, il a un bois blanc & fort tendre ;
comme elles il porte des ftipules attachées aux branches
à l’origine des feuilles : comme elles il perd
jfes feuilles en automne, même au Sénégal, où pref-
que tous les arbres confervent les leurs : comme elles
i l abonde en fuc mucilagineux : comme elles il a
des poils, dont quelques-uns font en aigrette ou en
fufeau : comme elles il porte des fleurs hermaphrodites
qu’on pourroit appeller belles du matin, parce
qu’elles ne s’ouvrent que depuis neufheures du matin
jufqu’à une heure après-midi : comme elles il a un calice
& les autres parties de la fleur placées autour de
l’ovaire & non au-deffus ni au-deffous : comme elles il
a des pétales diftinfrs entr’eux ou.féparés par leur
partie extérieure qui regarde le calice, & réunis par
leur face intérieure au cylindre des étamines : comme
elles il a les étamines réunies par le bas en une ef-
pece de gaîne attachée aux pétales, & qui enveloppe
l’ovaire auquel il touche : comme elles il a l’ovaire
pofé immédiatement fur le fond ou le réceptacle du
calice, & le ftyle de cet ovaire creux comme un
tuyau dans toute fa longueur : comme elles il porte
un fruit dans lequel les femences, font rangées en
tous fens .autour d’un axe qui a été auparavant la
hafe même du ftyle de la fleur : comme elles enfin,
il a des graines dont l’embryon eft recourbé en demi
cercle & compofé de deux lobes.
Le baobab fe trouve donc rangé naturellement dans
jcette famille de plantes, & il doit être placé, comme
nous avons fait, dans la fection de celles qui n’ont
qu’un calice. Voyez nos Familles des plantes , vol. II.
P a§ • 3 9 9 » „ 1 . „ . . v .
Tout ceci eft extrait .d un mémoire tres-circon-
ilancié fur l’hiftoire de cet arbre , que je lus à l’académie
royale des fciçnces en 1756 , & qui n’a
été imprime que dans le volume des mémoires de
ladite académie, pour l’année 176 1 , avec figures,
aux pl. VI & VII, p . i i 8 à 243. ( M. A d an s o n .)
§ BAPAUME, ( Géogr. ) Bapalma, ville fortifiée
de France en Picardie , à cinq lieues d’Arras
autant de Cambrai, dans un pays fe c , fans rivières
ni fontaines ; ce n’étoit au x i . fiecle qu’un
château où s’étoit cantonné un nommé Beranger,
chef de voleurs, en 1090: Eudes, duc de Bourgogne ,
comte d’Artois, l’érigea en ville , & la fit fermer
de murs en 1335. Charles V fit fortifier cette place.
Vau ban&le chevalier de Ville y travaillèrent fous
Louis XIV. Il y a un état-major. (C.)
BAPTÊME, (Med.lég.')unfacrement qui régénéré
l’homme en Jefus-Chrift, & dont l’omiflion le condamne
à la plus cruelle des privations, a paru un motif
fiiffifant pour exciter l’attention des loix. On a fou-
vent confulté les experts pour décider de b validité
Tome I,
B A P 801
ou de la nullité du baptême qu’on conféré aux avortons
ou aux enfans ; on a exigé qu’on n’en étendît
l’ufage que fur ceux qui peuvent en retirer du fruit :
on a impofé des loix auxpafteurs , aux chirurgiens,
aux fages-femmes ; on a même infligé des peines civiles
& fpirituelles à ceux q ui, par négligence ou
mauvaife f o i , fe difpenfoient d’obéir. Ces précautions
dictées par l’efprit de chriftianifme, font fentir
combien il doit être important de ne pas fe méprendre.
Les théologiens ont encore exigé, par refpeét
pour ce facrement, qu’on ne l’adminiftrât qu’aux
foetus bien formés & vivans, & qu’on s’abftînt de
le conférer aux monftres ou aux avortons qui ne font
pas animes.
. On s’eft encore occupé de la maniéré d’adminif-
trer le baptême dans tous les cas pofîibles ; & l’omif-
fion de ces moyens dans Y article B a p t ê m e du Dictionnaire
raif. des Sciences , &c» m’autorife à 'entrer
à cet égard dans quelques détails.
Jérôme Florenfini publia, en 1658 , une différ-
tation intitulée , des hommes douteux ou du baptême
des avortons ; il prouve que * rien n’eft plus incertain
» que le tems où le germe eft véritablement animé.
» (Vyo. ci-devant Animation.); qu’il eft cependant
» probable que l’ame raifonnableyexifte dès le com-
» mencement, c’eft-à-dire, immédiatement après la
» conception ; il enfeigne qu’en conféquence on
» doit, fous peine de péché mortel , baptifer le
» germe d’un homme, ne fut-il pas plus gros qu’un
» grain d'orge, & quelque court que ce foit l’ef-
» pace de tems écoulé depuis la conception , quoi-
» que ce germe n’ait aucun mouvement qui indique
» un figne-de vie , pourvu qu’il ne foit ni corrom-
» pu , ni manifeftemenf mort ».
Il eft fans doute difficile de déterminer dans un
corps dont l’organifation eft fi peu développée, fi
le défaut de mouvement fenfible appartient à la
foibleffe ou à la mort ; l’auteur avertit que dans ce
cas, il faut donner le baptême fous'condition, foit
parce qu’il eft douteux fi ce germe eft vivant, foit parce
que, fe trouvant encore enveloppé dans les membranes
, il n’eft point décidé fi ces membranes qui
empêchent l’eau de toucher immédiatement, font
un obftacle à la validité du baptême.
L’univerfité de Paris donna dans fon approbation
le furnom d’indubitatah. cette doéfrïne ; elle impofoit
néanmoins l’obligation de baptifer tous les foetus fous
peine de péché mortel; ôc la congrégation dè l’index
la jugeant en cela repréhenfibk , exigea de l’auteur
une proteftation qui déclarât qu’il n’avoit voulu que
difcuter ce qui lui avoit paru probable & nullement
établir un dogme dont le rituel de l’églife ne frit point
mention.
Gn ordonna encore' à l’auteur de faire-connoître
qu’il entendoit parler des avortons bien formés ôc
par conféquent fenfibles \ & qui préfentent au moins
les premiers traits d’une figure humaine.
Nous renvoyons à l’article M o n s t r e s & A c cou -
CHEMENS MONSTRUEUX ( Méd, Ug. ) Suppl, la difr-
cuffion d’une diftinftion auffi frivole.
Lorfque le foetus a acquis tout.fon accroiffement
dans la matrice , & que , par des caufes phyfiques,
irrémédiables, il n’en peut fortir fans perdre la vie ,
on a demandé s’il étoit néceffaire de foumettre la
mere à l’opération céfarienne dans la feule vue de
baptifer l’enfant(J'oy. O p é r â t , c é s a r i e n n e , Méd.
lég.) , Suppl. On fent bien que s’il refte encore l’efpoir
de fauver la vie du foetus , le double motif de con-
ferver un citoyen & d’opérer fon falut fpirituel,
fuffifent pour autorifer cette opération , fi d’ailleurs
rien ne s’y oppofe ; mais je fuis bien éloigné de
décider avec M. Cangiamila, que le danger, quoique
douteux de la vie fpirituelle de l’enfant, l’emporte
fur le danger corporel de la mere. Ce n’eft
Hi i i