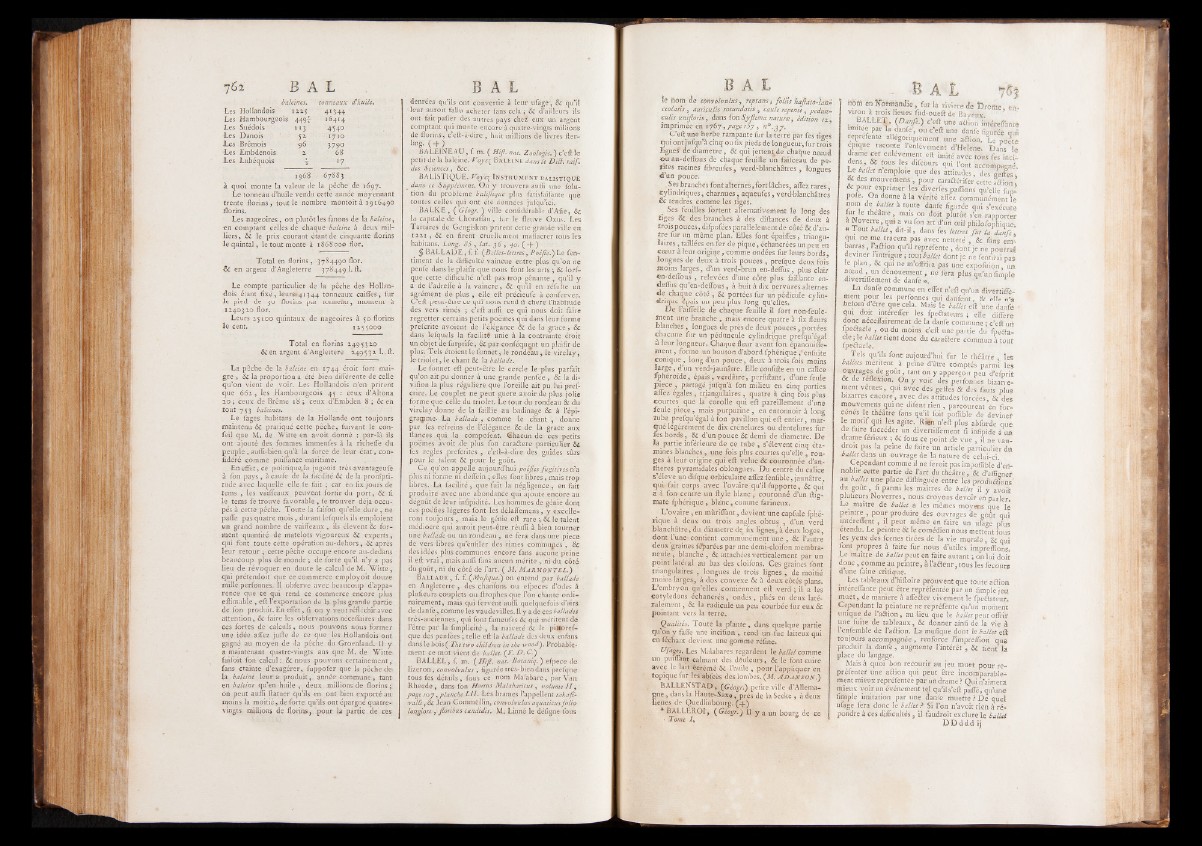
baleines. tonnt aux cT huile.
Les Hollandois ■ 122:5 41344
Les Hambourgeois 4497 16414
Les Suédois 113 . 4540
Les Danois ‘ 5^ ï 1710
Les B rémois 96 3790
Les Embdenois ' 68
Les LubéqUois i ' ;. !7
1968 67883
à quoi monte la valeur de la pêche de 1697.
Le tonneau d’huile vendu cette année moyennant
trente florins, tout le nombre montoit à 1916490
florins.
Les nageoires, ou plutôt les fanons de la baleine,
en comptant celles de chaque baleine à deux milliers,
& le prix courant étant de cinquante florins
le quintal, le tout monte à 186800© flor.
Total en florins , 3784490 flor.
8c en argent d’Angleterre 378449 1. fl.
Le compte particulier de la pêche des Hollan-
dois étant fixé, leurs*4i344 tonneaux caiffes, fur
le pied de 30 florins par tonneâu, montent à
1240320 flor.
Leurs 25100 quintaux de nageoires à 50 florins
le cent. 1255000 •
Total en florins 2495320
& en argent d’Anglettere 249532 1. .fl.
La pêche de la baleine en 1744 étoit fort maigre,
6c la proportion a été bien differente de Celle
qu’on vient de voir. Les Hollandois n’en prirent
que 662 , les Hambourgeois 45 : ceux d’Altona
20 ; ceux de Brême 18; ceux d’Embden 8 ; & en
tout 753 baleines.
Le fages habitans de la Hollande ont toujours
maintenu & pratiqué cette pêche, fuivant le con-
feil que M. de Witte en avoir donné : par-là-ils
ont .ajouté des fommes immenfes à la richeffe du
peuple, auffi-bien qu’à la force de leur état , con-
fidéré comme puiflance maritime.
En effet, ce politiqueja jugeoit très-avantageufe
à fon pays, à caufe de la facilité & de la prom'pti-
tude avec laquelle elle le fait ; car en fix jours de
tems , les vaiffeaux peuvent fortir du port, & fi
le tems fe trouvé favorable , fe trouver déjà occupés
à cette pêche. Toute la faifon qu’elle dure , ne
paffe pas quatre mois, durant lefquels ils emploient
un grand nombre de vaiffeaux, ils élevent & forment
quantité de matelots vigoureux & experts,
qui font, toute cette opération au-dehors, & après
leur retour , cette pêche occupe encore au-dedans
beaucoup plus de monde ; de forte qu’il n’y a pas
lieu de révoquer en doute le calcul de M. Witte,
qui prétendoit que ce commerce employoit douze
mille perfonnes.’. Il obferve avec beaucoup d’apparence
que ce qui rend ce commerce .encore plus
eAimable , eft l’exportation de la plus grande partie
de fon produit. En effet, fi on y veut réfléchir avec
attention, & faire les ôbfervatiôns néceffaires dans
ces fortes de calculs, nous /pouvons nous former
une idée affez jufte de ce que les Hollandois ont
gagné aù moyen de -la pêche du Groenland. Il y
a maintenant quatre-vingts ans que M. de Witte
faifoit fon calcul: & nous pouvons certainement,
fans crainte d’exagérer, fuppofer que la pêche de»
la baleine leur a produit, année »commune., tant
en, baleine qu’en huile deux millions.de florins ;'
on peut auffi ftatuer qu’ils en ont bien exporté au
moins la moitié ,.de forte qu’ils ont épargné quatre-
vingts millions de florins, pour la partie de ces
denrées qu’ils ont convertie à leur irfàgë", & qu’il
' leiir auroit fallu acheter fans cela ; 8c d’ailleurs ils
ont fait paffer des autres pays chez- eux un argent
comptant qui monte encore à’quatre-vingts millions
de florins, c’eft-à-dire , huit millions de livres fter-
ling. ( + )
BALEINEAU, fi m. ( Hiß. nat. Zoologie.- ) c’eft le
petit de la baleine. Voye{ Baleine dans le Dicl. raif.
des Sciences, &e.
BALISTIQUE. Voÿe^ In s t r u m e n t b a l i s t iq u e
_ dans ce Supplément. On y trouvera auffi une folu-
tion du problème balijhque plus fatisfaifante què
toutes celles qui ont été données jufqu’ici.
BALKE, ( Gèogr. ) ville confidérable d’Afie, 8c
la capitale de Choraflàn, fur le fleuve Oxus. Les
Taftares de Gengiskan prirent cette grande ville en
î 2.2,1 , & en firent cruellement maflacrer tous les
habitans. Long. 85 , Lat. 3 6 , 40. ( - f )
.§ BALLADE, f. f. ÇBelles-lettres, Poêliez) Le fen-
timent de la difficulté vaincue entre plus qu’on ne
penfe dans le plaifir que nous font les arts ; & lorf-
qué cette difficulté n’eft pas trop gênante , qu’il y
a de l’adreffe à la vaincre, 8c qu’il en réfulte un
agrément do plus , elle eft précieufe à conferver.
C ’eft peut-être ce qui' nous rend fi chere l’habitude
des vers rimés ; c’eft auffi ce qui nous doit faire
regretter certains petits poëmes qui dans leur forme
prefcrite avoient de l’élégance & de la grâce, 8c
dans lefquels la facilité unie à la contrainte étoit
un objet de furprife, 8c par conféquent un plaifir de
plus. Tels étoient le fonnet , 1e rondeau, le virelay,
le triolet, le chant & la ballade.
Le fonnet eft peut-être le cercle le-plus parfait
qu’on ait pu donner à une grande penfée , & la di-
vifion la plus régulière que l’oreille ait pu, lui pref-
crire. Le couplet ne peut guere avoir de plus jolie
forme que celle du triolet. Le tour du rondeau & du
virelay donne de la faillie au badinage & à l’épi-
granjme. La ballade t comme le chant , donne
par fes refreins de l'élégance &.de la grâce aux
fiances qui la compofent. Chacun de ces petits
poëmes avoit .de plus fon caraftere particulier &
les réglés prefcrites , c’eft-à-dire des guides sûrs
pour le talent & pour le goût.
Ce qu’on appelle aujourd’hui poéfies fugitives n’a
plus ni forme ni deffein ; elles font libres, mais trop
libres.-La facilité , que fuit la. négligence , en fait
produire avec une abondance qui ajoute encore au
dégoût de leur infipidité. Les hommes de génie dont
ces poéfies légères font les délaffemens, y excelleront
toujours j mais. le génie eft rare.; & le talent
médiocre qui auroit peut-être réùffi à bien tourner
une ballade ow un rondeau , ne fera dans une piece
de vers libres qu’enfiler des rimes communes , 8c
des idées plus communes encore fans aucune peiné
il eft v ra i, mais auffi fans aucun mérite , ni du côté
du goût, ni du côté de l’art. ( M. Ma rm o n t e l .')
Ballade , f. f..(Mufique.') on entend par ballade
en Angleterre , des chanfoifs ou efpéces d’odes à
plufieurs couplets ou.ftrophes que l’on chante ordinairement,
mais qui fervent auffi quelq uefois'd’airs
de danfe, comme les vaudevilles. Il y a de ces ballades
très-anciennes, qui font fameufes & qui méritent de
l’être par la fimplicité , la naïveté & le piigoref-
que des penfées ; telle eft la ballade des deux enfans
dans le bois( Thetwo children in the wood').^Probablement
ce mot vient de ballet. (F. D. C.)
B ALLEL, f. m. (Hiß. nat. Botaniq. ) efpece de
lizeron, convolvulus , figurée très-bien dans prefque
tous fes. détails, fous ce nom MaJabare, par Van
Rheede , dans fon Hortus Malabaricus , volume I I ,
page \ o j, planche LU. Les brames l’appellent takafi
yalli r8c Jean Commellin, convolvulus aquaticus folio
longiore , floribus candidis, M, Linné le défigne fous
îé hom de convolvulus, reptans, foliis haflaïo-lati*
ceo laits , auriçufisrotundatis , carde repente, pedun-
culis unifions, dans fon Syfiema natures > édition tz ,
imprimée en 1767, page iSy ,
C ’eft une herbe rampante fur la terré pâr fes tiges
qui ont jufqu’à cinq ou fix pieds de longueur, fur trois
lignes’ de diamètre, & qui jetten^de chaque noeud
©u au-deffo.us de chaque feuille un faifeeau de petites
racines fibreufes, verd-blanchâtres, longues
d’un poucei
.Ses branches font alternes, fort lâches, affez rares,
'cylindriques, charnues, aqueufes, verd-blanchâtres
& tendres, comme les tiges.
Ses feuilles fortent alternativement le long dés
figes & des branches à des diftances de deux à
trois pouces, difpofées parallèlement de côté & d’autre
fur un même plan. Elles font épaiffes, triangulaires
, taillées en fer de pique, éçhancrées un peu en
coeur à leur origine, comme ondées fur léurs bords,
longues de deux à trois pouces , prefque deux fois
moins larges,. d’un verd-brun en-dëffus, plus clair
en-deffous ,. relevées d’une côte plus faillante en-
deffus qu’en-deffbus, à huit à dix nervures alternes
de^ chaque côté , & portées fur un pédicule cylindrique
épais un peu plus long qu’elles.
De l’ailfelle de chaque feuille il fort non-feulë-
ment une branche , mais encore quatre à fix fleurs
blanches, longues de près dé deux pouces ».portées
chacune fur un pédoncule cylindrique prefqu’égal
à leur longueur. Chaque fleur avant fon épanouiffe-
anent, forme un boiiton d’abord fphérique ,‘ enfuite
conique , long d’un pouce, deux à trois fois moins
ï arge > d’un verd-jaunâtre. Elle confifte en un calice
iphéroïdè , épais, verdâtre, perfiftant, d’une feule
piece , partagé jufqu’à fon milieu en cinq parties
affez égales, triangulaires , quatre à cinq fois plus
courtes que la corolle qui eft pareillement d’une
feule piece, mais purpurine , en entonnoir à long
tube prefqu’égal à fon pavillon qui eft entier, marqué
légèrement de dix crénelures ou dentelures fur
les bords, & d’un pouce ôe demi de diamètre. De
la partie inférieure de ce tube , s’élèvent cinq étamines
blanches, une fois plus courtes qu’elle , rouges
à leur origine qui eft velue & couronnée d’an-
theres pyramidales oblongues. Du centré du calice
s’élève un difque orbiculaire affez fenfible, jaunâtre,
qui fait corps avec l’ovaire qu’il fupporte, & qui
a à fon- centre un ftyle blanc , couronné d’un ftig-
mate fphérique, blanc, comme farineux.
o L’ovaire , en mûriffant, devient une capfule fphérique
à deux ou trois angles, obtus , d’un verd
blanchâtre, du diamètre de^ fix lignes,*à deux loges,
dont l’une, contient communément une , 8c l’autre
deux graines fé^arées par une demi-eloifon membra-
neufe , blanche, & attachées verticalement par un
point latéral au bas des doifons. Ces graines font
triangulaires , longues de trois lignes , de moitié
moins larges, à dos convexe & à deux côtés plans.
L ’embryon qu’elles contiennent eft verd ; il a les
cotylédons échancrés, ondés, pliés en deux latéralement
, 8c la radicule un peu courbée fur eux 8c
pointant vers la terre.
Qualités. Toute la plante, dans quelque partie
qu’on y faffe une incifion , rend un fuc laiteux qui
en féchant devient une gomme réfine.
&fag*s. Les Malabares regardent le ballel comme
un puîffaqt calmant des douleurs, 8c le font cuire
avec le lait écrémé 8c l’huile , pour l’appliquer en
topique fur les abfcès des, lombes. (M. A d a n s o n .)
BALLENSTAD, (Gèogrl) petite ville d’Allemagne
, dans la Haute-Saxe, près de la Seeke , à deux
lieues de Quedlinbourg. (+ )
* BALLEROI, ( Géogr,) Il y a un bourg de ce
’ Tome i.
B a l 7^5
iicini en H’ôfmamlie, fur là rivière de b rèm e , em
viron à trois lieues fud-oueft de Bayénx.
BALLET, (Danfe.) c’eft une aftion iiitéreffanté
îmrtee par la danfe, ou c eft une danfe figurée qui
reprefente allégoriquement une aftion. Le noetê
epique raconte l’enlèvement d’Helene. Dans le
drame cet enlèvement eft imité avec tous fes iiici-
dens & tous es dfteours qui l’ont accompagné.
Le baluc nemploie que des attitudes, des geïtes-
& des mouvemens pour caraftérifer cette aftion l
& pour exprimer les diverfes paffiqns qu’elle fups.
pofé. Qn donne à la vérité affez communément lé
qom de ballet à toute danfe figurée qui s’exécute
lur le rheatre, mais on doit plutôt s’en rapporter
à Noverre, qui a vu fon art'd’ün oeil philofophique,
« Tout ballet, dit-il, dans fes lettres fur la danfe h
qui ne me tracera pas avec netteté , & fans embarras
, l’a&ion qu’il repréfente , dont je ne pourrai
deviner 1 intrigue ; tout ballet dont je ne fentirai pas
le plan, 8c qui ne m’offrira pas une expofîtion , u i
noeud , un dénouement, né fera plus qu’un fimple
.divertmement de danfe ».
La danfe commune en effet n’eft qu’un divëftiffè-
ment pour les perfonnes qui danfent, & elle n’à
befoin d’être que Cela. Mais le ballet eft une danfe '
qui doit intéreffer les fpeftateürs ; elle différé
donc néeeffairement de la danfe commune ; c’eft urt
fpeâracle , ou du moins c’eft une partie du fpefta-
cle ; leballet tient donc du earattere commun à tout
fpeâacle.
Tels qu’ils font aujourd’hui fur le théâtre , les
ballets méritent à- peine d’être comptés parmi les
Ouvrages de goût, tant on y apperçou peu d’efprit
& de réflexion. On y voir des perfonnes bizarrement
vêtues, qui avec des gefies & des fauts plus
bizarres encore, avec des attitudes forcées, & des
mouvemens qui ne difent..rien , parcourent en forcenés
le théâtre fans qu’il foit poffible de deviner
le motif qui les agite. Rien n’eft plus abfurde que
de faire fuCcéder un diver'tiffement fi infipidë à un
drame férieux ; 8c fous ce point -de vue , il né vau-
droit pas la peine de faire un article particulier dü
.ballet dans un ouvrage de la hatùre de: celui-ci.
Cependant comme il ne feroit pas impoffible d’ennoblir
cette partie de l’art du théâtre, & d’affigner
au ballet une place diftinguée entre les prodüâions’
du goût , fi parmi les maîtres de ballet il y avoit
plufieurs Noverres, nous croyons devoir en parler.
Le maître de ballet a les mêmes moyens que lé
peintre , pour produire des ouvrages de goût qui
intéreffent , il peut même, en faire un ufage plus
étendu. Le peintre 8c le comédien nous mettent fous
les yeux des feenes tirées de la vie morale, & qui
font propres à faire fur nous d’utiles impreffionsi
Le maître de ballet peut en faire autant-, on lui doit
donc » comme au peintre, à Facteur, tous les fecours
d’une faine critique.
Les tableaux d’hiftoire prouvent que toute a&ioii
intéreffante peut être repréfentée par un fimple jeu
muet, de maniéré à affeâer vivement le fpeétateuri
Cependant la peinture ne repréfente qu’un moment
unique de l’aètion, au lieu que le ballet peut offrir
une fuite de tableaux, 8c donner ainiî de la vie à
l’enfemble de l’aétion. La mufique dont le ballet eft
toujours accompagnée, renforce l’impreffiori que
produit la danfe , augmente l’intérêt , & tient la
place du langage.
Mais à quoi bon recourir au jeu muet pour re-
préfenter une aftion qui peut être incomparable*
ment mieux repréfentée par un drame? Quin’aimçra
mieux voir un événement tel qu’ils’eft paffé, qu’une
fimple imitation par une danfe muette ? De quel
ufage fera donc le ballet ? Si l’on h’avoit rien à répondre
à ces difficultés, il faudroit exclure le ballet
D D d d d ij