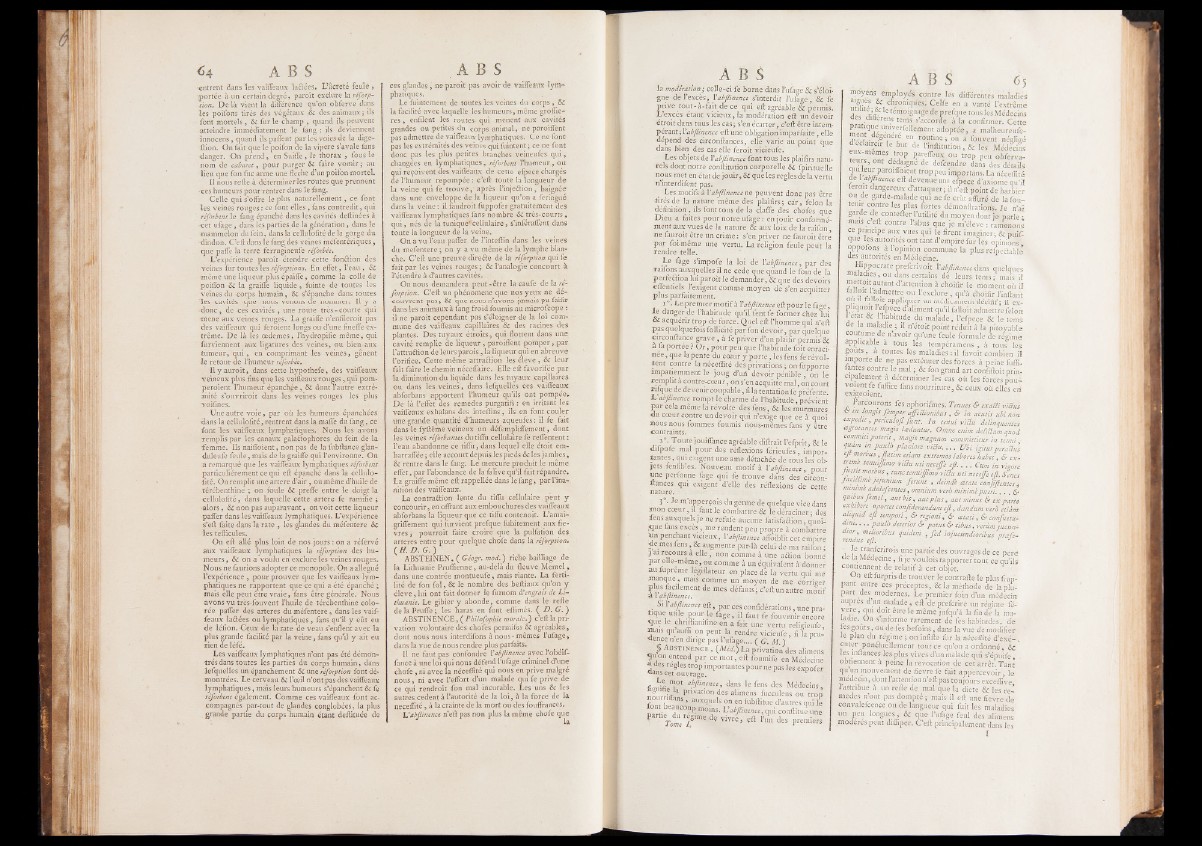
«entrent Bans les vaiffeaux laftées. L’ âcreté feule ,
.portée à un certain degré, paroît exclure la rèforp-
tion. D elà'vien t la différence qu’on.obferve dans
•les poifons tirés des végétaux ,& des animaux ; ils
font mortels , & fur le champ , quand ils peuvent
atteindre immédiatement le fang : ils deviennent
innocens, quand ils paffent par les voies de la dige-
ition. On fait que le poifon de la vipere s’avale fans
danger. On prend, en Suiffe , le thorax , fous le
nom de cabaret, pour purger & faire vomir ; au
lieu que fon fuc arme une fléché d’un poifon mortel.
Il nous refte à déterminer!es routes que prennent
des humeurs .pourrentrer dans le fang.
Celle qui s’offre le plus naturellement, -ce font
les veines rouges : ce font elles, flans contredit, qui
réforbent \e fang épanché dans les cavités deftinées à
■ cet ufage, dans les parties de la génération, dans le
mammelon du fein, dans la cellulofité de la gorge du
dindon, C’eft dans le fang des veines méfemériques,
que paffe la terre, ferrugineufe- réforbée.
L’expérience paroît étendre cette fonction des
veines fur toutesles réforptions. En effet, l’éau , &
même une liqueurplus épaiffe, comme la colle de
pciffon & la graille liquide, fuinte de toutes les
veines du corps humain, &c s’épanche dans toutes
-les cavités que -nous venons de nommer. Il y a
•'donc , de -ces cavités , une route très - courte qui
-mene aux veines rouges. La graiffe n’enfileroit pas
des vaiffeaux qui feroient longs ou d’une fineffe extrême.
De là les oedemes, l’hydropilie même, qui
furviennent aux ligatures des veines, ou bien aux
tumeur, q u i , en comprimant les veines, gênent
le retour de l ’humeur réforbèe.
I ly a u ro it , dans cette hypothefe, des vaiffeaux
veineux plus fins que les vaiffeaux rouges, qui pom-
peroient l’humeur épanchée, & dont l’autre extrémité
s’ouvriroit dans les veines rouges les plus
voifines. f
Une autre v o ie , par où les humeurs épanchées
-dans la cellulofité,rentrent dans la maffe du fang, ce
font le s vaiffeaux. lymphatiques. Nous les avons
remplis par les canaux galaftophores du fein de la
■ femme. Ils naiffoient, non pas de la fubftance glan-
duleufe feule, mais de la graiffe qui l’environne. On
a remarqué que les vaiffeaux lymphatiques réforbent
particuliérement ce qui eft épanché dans la cellulofité.
On remplit une artere d’air , ou même d’huile de
térébenthine ; on foule & preffe entre le doigt la
-cellulofité, "dans laquelle cette artere fe ramifie;
•alors, & non pas auparavant, on voit cette liqueur
paffer dans les vaiffeaux lymphatiques. L’expérience
s’eft faite dans'la rate , les glandes du méfentere &
les tefticules.
On eft allé plus loin de nos jours : on a réfervé
aux vaiffeaux lymphatiques la réforption des humeurs
, & on a voulu en exclure les veines rouges.
Nous ne faurions adopter ce monopole. On a allégué
l’expérience , pour prouver que les vaiffeaux lymphatiques
ne rapportent que ce qui a été épanché ;
mais elle peut être vraie, fans être générale. Nous
avons vu t-rès-fouvent l’huile de térébenthine colorée
paffer des arteres du méfentere, dans les vaiffeaux
laftées ou lymphatiques, fans qu’il y eût eu
de léfion. Ceux de la rate de veau s’enflent avec la
plus grande facilité par la veine , fans qu’il y ait eu
rien de léfé.
Les vaiffeaux lymphatiques n’ont pas été démontrés
dans toutes les parties du corps humain, dans
lefquelles un épanchement & une réforption font démontrées.
Le cerveau & l’oeil n’ont pas des vaiffeaux
lymphatiques, mais leurs humeurs s’épanchent & fe
réforbent egalement. Comme ces vaiffeaux font accompagnés
par-tout de glandes conglobées, la plus
grande partie du corps humain étant deftituée de
ces glandes, ne paroît pas avoir de vaiffeaux lymphatiques.
■ .
Le fuintement de toutes les veines du corps , 8c
la facilité avec laquelle les humeurs, même grofïie-
r e s , enfilent les routes- qui mènent aux cavités
grandes ou petites du corps animal, ne paroiffent
pas admettre de vaiffeaux lymphatiques. Ce ne font
pas les extrémités des veines qui fuintent; ce ne font
donc pas les plus petites branches veineufes q ui,
changées.en lymphatiques, réforbent l’humeur, ou
qui reçoivent des vaifleaux de cette efpece chargés
de l ’humeur repompée : c’eft toute la longueur de
la veine qui fe trouve,' après l’injeCtion, baignée
dans une enveloppe de la liqueur qu’on a feringué
dans la veine: il faudroit fuppofer gratuitement des
vaiffeaux lymphatiques fans nombre & très-courts,
q u i, nés de la tunique*cellulaire, s’inféraffent dans
toute la longueur de la veine.
On a vu l’eau paffer de l’inteftin dans les veines
du mefentere ; on y a vu même de la lymphe blanche.
C ’eft une preuve direéle de la réforpàon qui fe
fait par les veines,rouges; & l’analogie concourt à
l’étendre à d’autres cavités.
On nous demandera peut -être la caufe de la réforption.
C’eft un phénomène que nos yeux ne découvrent
pas, & que nous n’avons jamais pu faifir
dans les animaux à fang froid fournis au microfcope :
il ne paroît cependant pas s’éloigner de la loi commune
des vaiffeaux capillaires & des racines des
plantes. Des tuyaux étroits, qui-flottent dans une
cavité remplie de liqueur, paroiffent pomper, par
l’attraâion de leu rs parois, la liqueur qui e n abre uve
l’orifice. Cette même attra&ion les éleve , & leur
fait faire le chemin néceffaire. Elle eft favorifée par
la diminution du liquide dans les tuyaux capillaires
ou dans les.veines, dans lefquelles ces vaiffeaux
abforbans apportent l’humeur qu’ils ont pompée.
De là l’effet des remedes purgatifs : en irritant les
vaiffeaux exhalans des inteftins, ils en font.couler
une grande quantité d’humeurs aqiteufes : il fe fait
dans le fyftême veineux un défempliffement, dont
les veines rèforbantes dutiflu cellulaire fe relîèntent:
l ’eau abandonne ce tiffu,-dans lequel elle étoit em-
barraffée ; elle accourt depuis les pieds & les jambes,
& rentre dans le fang. Le mercure produit le même
effet, par l’abondance de la falivequ’il fait répandre.
La graiffe même eft rappellée dans le fang, par l’inanition
des vaiffeaux.
La contra&ion lente du tiffu cellulaire peut y
concourir, en offrant aux embouchures des vaiffeaux
abforbans la liqueur que ce tiffu contenoit. L’amai-
griffement qui lurvient prefque fubitement aux fièvres,
1 pourroit faire croire que la pulfàtion des
arteres entre pour quelque chofe dans la réforption.
{H . D . G .)
ABSTEINEN, ( Géogr. mod. ) riche-bailliage de
la Lithuanie Pruflienne, au-delà du fleuve Memel,
dans une contrée montueufe, mais riante. La fertilité
de fon fo l, & le nombre des beftiâux qu’on y
•éleve, lui ont fait donner le furnom d'engrais de Lithuanie.
Le gibier y abonde, comme dans le refte
de la Pruffe ; les haras en font eftimés. ( D . G. )
ABSTINENCE, ( Philofophie morale.') c’eft la privation
volontaire des chofés permifes & agréables,
. dont nous nous interdifons à nous-même# l’ufage,
dans la vue de nous rendre plus parfaits.
Il ne faut pas confondre Yabjlinence avec l’obéif-
fance à une loi qui nous défend l’ufage criminel d’une
chofe , ni avec la néceflîté qui nous en prive maigre
nous, ni avec l’effort d’un malade qui fe prive de
ce qui rendroit fon mal incurable. Les uns & les
autres cedent à l’autorité de la loi , à la force de la
necefîité, à la crainte de la mort ou des fouffrances.
L’dbjlinence n’eft pas non plus la même chofe que
la modération; celle-ci fe borne dans l’ufage & s’éloigne
de l’excès, Yabjlinence s’interdit l’ufage, & fe
prive tout-à-fait de ce qui eft agréable & permis.,
L exces étant vicieux, la modération eft un devoir
étroit dans tous les cas; s’en écarter, c’eft être intempérant
; Yabjlinence eft une obligation imparfaite, elle
dépend des circonftances, elle varie au point que
dans bien des cas elle feroit vicieufe.
Les objets de Yabjlinence font tous les plaifirs naturels
dont notre conftitution corporelle & fpirituelle
nous met en état de jouir, & que les réglés de la vertu
n’interdifent pas. '
Les.motifs à Yabjlinence ne peuvent donc pas être
tirésde la nature même des plaifirs; car, félon la
définition , ils font tous de la claffe des chofes mu
Dieu a faites pour notre ufage : en jouir conformé
ment aux vues de la nature & aux loix de la raifon.
ne fauroit être un crime: s’en priver ne fauroit être
par foi-meme une vertu. La religion feule peut la
rendre telle.
Le fage s’impofe la loi de Yabjlinence, par dès
raifons auxquelles il ne cede que quand le foin de 1<
perfeâion lui paroît le demander, & que des devoirs
«ffentiels l’exigent comme moyen de s’en acquitter
plus parfaitement.
I<>; Le.premier motif à Yabjlinence eftpour le fage,
le danger de l’habitude qu’iL fent fe former chez lui
& acquérir trop de force. Q uel eft l’homme qui n’eft
pas quelquefois follicité par fon devoir, par quelque
circonftance grave , à fe p river d’un plaifir permis &
à fa portée ? O r , pour peu que l’habitude foit enracinée
, que la pente du coeur y porte, les fens fe révoltent
contre la néceflîté des privations ; onfupporte
impatiemment le joug d’un devoir pénible , on le
remplit à contre-coeur, on s’en acquitte mal, on court
nique de devenir coupable, fi la tentation fe prefente.
xJabjhnence^ rompt le charme de l’habitudè, prévient
par cela même la révolte des fens, & les murmures
du coeur contre un devoir qui n’exige que ce à quoi
nous nous fommes fournis nous-mêmes fans y être
contraints.
. • Toute jouiffance agréable diftrait l’efprit, & le
difpofe mal pour des réflexions férieufes, importantes,
qui exigent une ame détachée de tous les objets
fenfibles. Nouveau motif à Yabjlinence, pour
nne perfonne fage qui fe trouve dans des circon-
ftances qui exigent d’elle des réflexions de cette
n a t u r e . -
3°. Je m’appèrçois du germe de quelque vice dans
mon coeur, il faut le combattre & le déraciner ; des
sens auxquels je ne refufe aucune fatisfaâion, quoique
ians. excèsi, me rendent peu propre à combattre
iin penchant vicieux, Yabjlinence affoiblit cet empire
^e mes fens, & augmente par-là celui de ma raifon :
j ai recours à elle , non comme à une aftion bonne
par eHe-memç, ou comme à un équivalent à donner
au fupreme legiflateur en place de la vertu qui me
manque, mais comme un moyen de me corriger
plus faciiementde mes défauts; c’eft un autre motif
a 1 abfhnence. £
... S i l abjluience eft, par ces confidérations, une pra-
tique utile ; pour le fag e, il faut fe fouvenir encore
que le chriftiamfme en a fait une vertu religieufe,
mais qu aufli on peut la rendre vicieufe, fi la pru-
•aence n en dirige pas l’ufage.... ( G. M. )
§ Abstinence , (_Méd.') La privation des alimens
? ll.on e,n‘ end par ce mot, eft foumife en Médecine
1 es ref!les troP importantes pour ne pas les expofer
Hans cet ouvrage. 1 , RHH m°t abjilncnce, dans le fens des Médecins,
lignine la privation des alimens fucculens ou trop
. auxquels on en fubftitue d'autres qui le
Z ie j ‘3 m° “ s- qui conftitue une
f T ô t ? dç ym e i r ' ln d“ premiers
moyens employés contre lès différentes maladies
n if r ïï a . chroni<Iues- Celle en a vanté l’extrême
m m m le tem°igmiged<; prefque tous les Médecins
acs cluterens tems s’accorde à la confirmer. Cette
pratique umyerfellement adoptée, a malheureufé-
en routine; on a fou vent négligé
“ ,cu le bllt de l’inftitutioii, & lés Médecins
muc-menies trop [wreffeux ou trop peu obferva-
teuis, ont dédaigné de defcendre daiis des détails
He l'eifl Par0lff nejnt tr0p peu importons; Là néceflîté
ae iMmcnce eft devenue une efpece d’axiome qu'il
feroit dangereux, d’attaquer; iln’eft point de barbier
ou de garde-malade qui ne fe crût affuré de lafou-
tenir contre les plus fortes démonftratioris. Je n’ai
garde de^contefter l’utilité du moyen dont ie parle ;
ma« e eft contre l’abus que je m’élève : ramenons
ce principe aux vues qui le’ firent imaginer; & puifi
que les autorités ont tant d’empire fur les opinions
oppofo.ns à l’opinion commune la plus refpe&able
des autorités en Médecine.
Hippocrate prefcrivoit Yabjlinence dans quelques
maladies, ou dans certains dé leurs tems ; mais il
mettpit autant d’attention à choifir le niomerit où il
' u c -mettre- ou f exclu r e , qu’à chôifir l’inftant
°u il ralloit appliquer un médicament décifif ; il ex-
phquoit refpéce d’aliment qu’il falloit admettre félon
1 état & l’habitude du malade, l’efpece & le tems
de la maladie ; il n’étoit point réduit à la pitoyable:
coutume de n’avoir qu’une feule formule de régime
applicable à tous les tempérameris , à tous les
goûts, à 1 toutes les maladies : il fa voit combien il
importe de ne pas exténuer des forces à peine fuflî-
lantes contre le mal ; & fon grand art confiftoit principalement
à déterminer les cas où les forces pou-
voient fe fuffire fans nourriture, &c ceux où elles en
exigeoient.
Parcourons fes aphorifmes. Tenues & exacîi victus
<y in longis femper affeclionibus , & in acutis ubi non
expedit ; penculofi funt. . In unui vicia deÜnquentes
agrotantes magis Laduntur. Qhine enim delictum quoi
comniiti poterit, magis magnum committitur in tenui
quam in paulbplaniote vic lu .... Ubi igiturperaclul
ejt morbus , Jlatim etiam extremos labores habet, & ex-
tremh tenuijfimo viclu utinecejfe ejl. . . . Cum in vigorè
puent morbus, tune tenuijfimo viclu uti necejfe ejl, Senes
faculimè jèjunium ferunt , deindb cètate conjijlentes à
minime adolefcentes, omnium verà minïmlpueri.. . . 6*
quibusfemel, aut bis, autplus, aut minus & ex parte
exhibere oportet conjiderandum ejl, dandum verb etiànt
aliqmd ejl tempori, & régiôjû, & oetati, & confuetu-
aini. . . . paulb deterior & potus & cibus^veràm jucun-
dior, melioribus quideni , fed injucundioribus prtzfe-
rendus ejl. v
Je tranferirois une partie des ouvrages de ce pere
de la Medecine, fi je voulois rapporter tout ce qu’ils
contiennent de relatif à cet objet. '
On eft furpris de trouver le contrafte le plus frappant
entre ces préceptes, & la méthode de la plupart
des modernes. Le premier foin d’un médecin
auprps d’un malade, eft de preferire un régime fé-
V j1-6 ’ f(P Boit être le même jufqu’à la fin de la ma-
adie.^On s’informe rarement de fes habitudes, de
|es goûts, du de-fes.befoins, dans la vue de modifier
lé plan du régime ; on infifte fur la néceflîté d’exé- .
enter ponctuellement tout ce qu’on a ordonné, &
les inftances les plus vives d’un malade qui s’épuife ,
obtiennent à peine la revocation de cet arrêt. Tant
qu’un mouvement de fievre fe fait appercevoir , le
médecin, dont l’attention n’eft pas toujours exceflî ve
rattribue à un refte de mal que la diete & les remèdes
n’ont pas dompté ; mais il eft une fievre de
convalefcence ou de langueur qui fuit les maladies
un peu longues, & que l’ufage feul des alimens
modérés peut diffiper. C ’eft principalement dans les
I