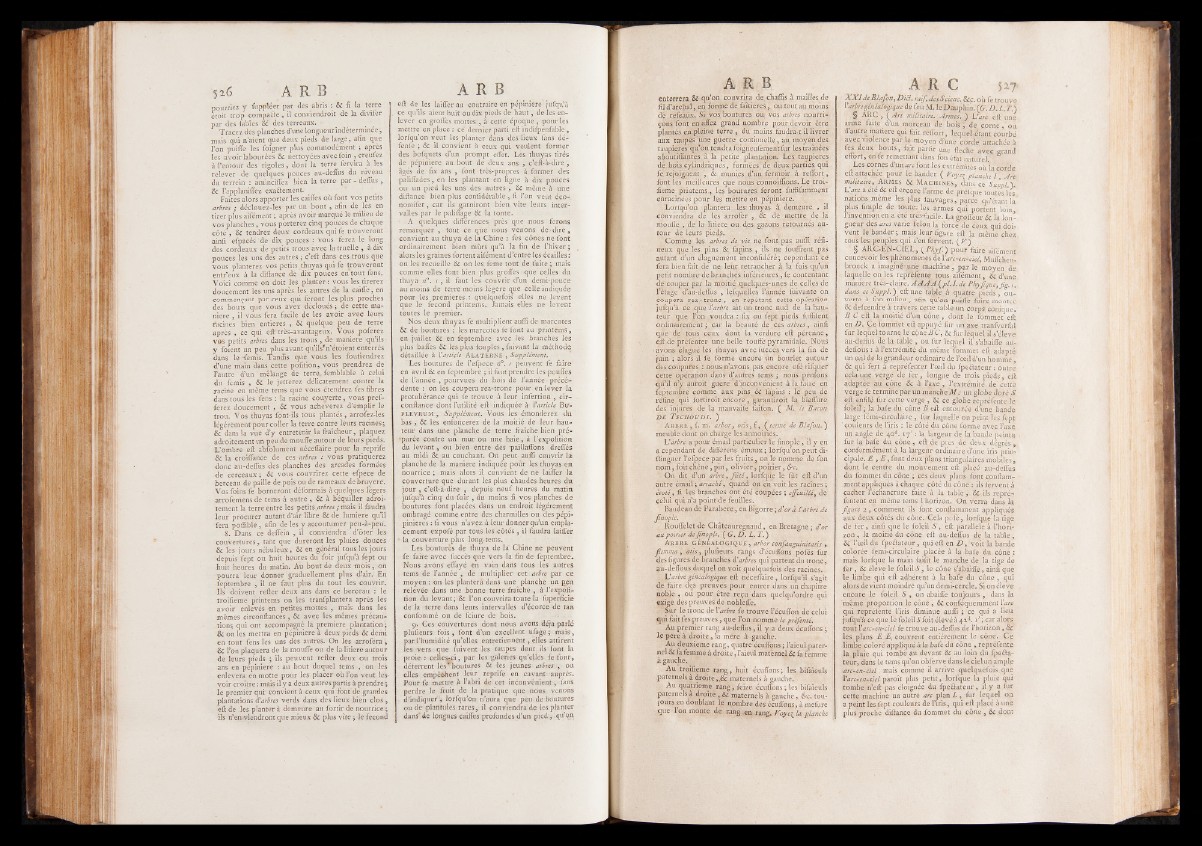
5 2.6 A R B
pourriez y fupptéer par des abris : & fi la terre
etoit trop compare , il convièndroit de la divifer
par des labiés &' des terreaux. ■
Tracez des planches d’une longueur indéterminée,
mais qui n’aient que deux pieds de large, afin que
l’on puiffe les foigner plus commodément ; apres
les avoir labourées & nettoyées avec foin , creufez
à l’entour des rigoles, dont la terre fervira à les
relever de quelques pouces. au-deffus du niveau
du terrein : amincifféz bien la terre par - defîiis ,
6 l’ap planifiez exa&ement.
Faites alors apporter lés caiffes oii font vos petits
arbres ; déclouez-les par un bout , afin de les en
tirer plus aifément ; après avoir marqué le milieu de
vos planches, vous porterez cinq pouces de chaque
côté , & tendrez deux cordeaux qui re trouveront
ainfi efpacés de dix pouces : vous ferez le long
des cordeaux de petits trous avec la truelle , à dix
pouces les uns des autres ; e’ e ft dans ces.trous que
vous planterez vos petits thuyas qui fe trouveront
entr’eüx à la diftance de dix pouces en tout fens.
Voici comme on doit les planter-: vous les tirerez
doucement les uns après les autres de la caiffe, en
commençant par ceux qui feront les plus proches
des bouts que vous avez décloués ; de cette maniéré
, il Vous fera facile de les avoir avec leurs
racines bien entières , & quelque peu de terre
après , ce qui eft très-avantageux. Vous poferez
vos petits arbres dans les trous, de-maniéré qu’ils-
y foient un peu plus avant qu’ils'n’étoient enterrés
dans le Ternis. Tandis que vous les foutiendrez
d’une main dans cette pofition, vous prendrez de
l’autre d’un mélange de terre, femblable à celui
du femis , & le jetterez délicatement contre la
racine en même tems que vous étendrez fes fibres
dans tous les fens : la racine couverte, vous pref-
fërez doucement , & vous achèverez d’emplir le
trou. Vos thuyas font-ils tous plantés, arrofez-les
légérëmentpôur coller la terre contre leurs racinés;
& dans la vue d’y entretenir la fraîcheur, plaquez
adroitement un peu de moufle autour de leurs pieds.
L’ombre eft abfolument néceffaire pour la reprife
& la croiffance de ces arbres : Vous pratiquerez
donc aü-deffus des planches des arcades formées
de cerceaux; & vous couvrirez cette efpece de
berceau de paille de pois ou de rameaux de bruyere.
Vos foins fe borneront déformais à quelques légers
arrofemens de tems à autre , & à béquiller adroitement
la terre entre les petit s arbres ; mais il faudra
leur procurer autant d’air libre & de lumière qu’il
fera poflible, afin de les y accoutumer peu-à-peu.
8. Dans ce deffein , il conviendra' d’ôter les
couvertures, tant que dureront les pluies douces
& les jours nébuleux, & en général tous les jours
depuis fept ou huit heures du foir jufqu’à fept ou
huit heures du matin. Au bout de deux mois, on
pourra leur donner graduellement plus d’air. En
feptembre , il ne faut plus du tout les couvrir.
Ils doivent, refter deux ans dans ce berceau : le
troifieme printems on les trânfplantera après les
avoir enlevés en petites mottes , mais dans les
mêmes circonftances, & avec les mêmes précautions
qui ont accompagné là première plantation’;
& on les mettra en pépinière à deux pieds & demi
en tout fens les uns des autres. On les arrofera,
& l’on plaquera de la moufle ou de la litiere autour
de leurs pieds ; ils peuvent refter deux ou trois
ans en pépinière : au bout duquel tems , on les
enlevera en motte pour les placer oh l ’on veut les-
voir croître : mais il y a deux autres partis à prendre ;
le premier qui Convient à ceux qui font de grandes
plantations d’arbres verds dans des lieux bien clos ,
eft de les planter à demeure au fortir de nourrice ;
ils n’en-viendront que mieux 8c plus yîte ; le fécond
eft de les laiffer au contraire en pépinière jufqu’à
ce qu’ils aient huit' ou dix pieds de haut, de les enlever
en groffes mottes , à cette époque , pour les
mettre en place : ce dernier parti eft indifpenfable,
lorfqu’on veut les planter dans des lieux fans dé-
fenfé ; & il convient à ceux qui veulent former
des bofquets d’un prompt effet. Les thuyas tirés
de pépinière au bout de deux ans , c’eft-à-dire,
âgés de. fix ans , font très-propres à former des
paliffades, en les plantant en ligne à dix pouces
ou un pied les uns des autres , 8 c même à une
diftance bien plus confidérable, fi l’on veut éco-,
nomifer, car ils garniront bien vîte leurs intervalles.
par le paliflàge & la tonte.
• A quelques différences, près que nous ferons
remarquer , tout ce que nous venons de-dire,
convient au thuya de la Chine : fes cônes ne font
ordinairement bien mûrs qu’ à la fin de l’hiver ;
alors les graines fortent aifément d’entre les écailles:
on les recueille & on les feme tout de fuite ; mais
comme elles font bien plus groffes que celles du
'thuya n°. / , il faut les couvrir d’un demi-pouce
au moins de terre moiris légère que celle indiquée
pour les premières.: quelquefois elles ne lèvent
que le fécond printems. Jamais elles ne lèvent
toutes le premier.
Nos deux thuyas fe multiplient auffi de marcotes
& de boutures : les marcotes le font au:printems,
en juillet & en feptembre avec les branches les
plus baffes 8c. les plus fouples , fuivant la méthode
détaillée à l'article A l a t e r n e , Supplément.
’ Les bouture? de l’efpece n°. i peuvent fe faire
en avril & en feptembre ;-il fauf prendre les pouffes
de l’année., pourvues du bois de l’année-précédente
: on les coupera rez-tronc pour en lever la
protubérance qui fe trouve à leur infertion , cir-
conftance'dont l’utilité eft indiquée à l’article Bu-
p l e v r u m , Supplément. Vous les émonderez du
bas , 8c les enfoncerez de la moitié de leur hauteur
dans une planche de terre fraîche bien préparée
contre un mur ou une h a ie ,à l ’expofition
du levant, ou bien entre des •paillaffons dreffés
au midi 8t au couchant. On peut- aufli couvrir la
planche de la maniéré indiquée pour les thuyas en
nourrice ; mais alors il convient de ne laiffer la
couverture que durant les plus chaudes heures du
jour , c’eft-à-dire ,. depuis neuf heures du matin
- jufqu’à cinq du foir , du moins fi vos planches de
boutures font placées dans un endroit légèrement
ombragé comme entre des charmilles ou des pépi-
pinieres : fi vous n’avez à leur donner qu’un emplacement
expofé par tous les côtés , il faudra laiffer
g la couverture plus long-tems.
Les boutures de thuya de la Chine ne peuvent
fe faire avec fuccès que vers la fin de feptembre.
Nous avons effayé en vain dans tous les autres
tems dè l’année , dé multiplier cet arbre par ce
moyen.:.on les planterâ dans une planche im peu
relevée dans une bonne terre fraîche , à l ’expofition
du levant; & l’on couvrira toute la fuperficie
de'la :terre dans leurs:intervalles d’écorce de tan
confommé ou de fciure de bois.
q. Ces couvertures dont nous avons déjà parlé
, plüfieurs fois , font d’un excellent .ufage ; mais-,
par l’humidité qu’elles entretiennent, elles attirent
les-vers. :que fuivent les taupes dont ils font la
proie : celles-ci, par les: galeries qu’ellés fe font,
déterrent lès™bôutures & les jeunes arbres ou
elles empêchent leur reprife en cavant auprès.
Pour fe: mettre à l’abri de cet inconvénient -, fans
perdre le fruit de la pratique que nous venons
d’indiquer ’; lorfqu’on n’aura que peu.de boutures
ou de plantules rares, il conviendra de les planter
dans* de longues caiffes profondes d’un pied:, : qu’qi^
enterrera.. 8c qu’on couvrira de, chaflis à mailles de
fil d’arcfial en. forme de faî$iere$r ou tout au moins •
de refeaux. Si; vos bouture;» , ou, vos arbres npurri-
, çons font en raflez grand nombre pour, devoir être
plantés en plçiné terre.,. du moins. faudrait-il livrer
aux taupés un,e guerre continuelle,, au moyen des
taupieres"qu’on tendrafiojgneufefiie.ntfu.r les traînées
ahôuriffàntès\ûTa petite plantation. Les taupieres
de.bpis.cylinclriquës., forméejsfoe deux parties; qui
fe rejoignent , & munies., d’un, ferriiqir. à reflbrt,
font les meilleures que nous connoiffions. Le troifieme
printems., les boutures; feront fuffifamment
enracinées pour les mettre en pépinière.
..Loriqu’on -plantera.-les: thuyas à demeure , il
conviendra de lès arrofer , & de mettre de là
moufle. ; d;e; la- litiere ou. de,s.,gazons retournés autour
de leurs pieds.
Compte les arbres de. vie ne font, pas auffi réfi-
nèux que les. pins & fapins ,,iîs ne fouffrent pas
autant d’un élagué ment mconfidere; cependant ce
fera bien fait, de ne; leur retrancher à la fpis qu’un
petit nombre-de branches inférieures,, fe contentant
de couper par la moitié quelques-unes de celles de
l’eiàge d’au-deffus , lefquelles l’année fuivante on
coupera rezrtronc, en répétant cette opération
jufqu’à ce qu efarbre ait; un.trq.nç nud de la hauteur
que, l’on ,voudra : fix ou fept.spieds fuffifent
Ordinairement ; car la beauté de ces arbres, ainfi
que de tous ceux dont la verdure eft pérenne,
eft de préfenter une belle touffe pyramidale. Nous
< avons élagué les thuyas avec fuccès, vers la fin de
juin ; àlbfs il fè forme encore un bourlet autour
des coupures : nous n’avons pas. encore ofé rifquer
cettë opération jd’anSf d’autres tems ; nous penlons
qu’il n’y autoif guere‘ d’inconvénient à la faire en
feptembre comme àux pins, & lapins : le peu de
réfine qui fortiroit encore, garantiroit la bleffure
des injures de la mâuvaife laifon. ( M. 'le Barpn
DE TSCHÔÜDIv )
A r b r e , 1. m. arbor, orjs, f , .( terme de Blafon
meuble dont on charge les armoiries.
Lyàrbre a pour émail particulier le finoplé, il y en
a cependant de différens émaux ; lorfqu’on peut di-
ftinguer l’efpece par les fruits., on le npmme de fon
nom, foit chêne, pin, olivier, poirier, &c.
- On dit d’un arbre, fu té , lorfdiie le fût eft d’un
autre émail ; arraché, quand on en voit les racines ;
écoté, fi leS branches ont été coupées ; effeuillé, de
celui qui n’a point de feuilles.
Batidean de Parabere, en Bigorre ; d'or a Üarbre de
Jinople.
Rouffelet de Châteauregnaud, en Bretagne ; fo r
au poirier de jinople. ( G. D. L. T. )
A r b r e GENEALOGIQUE, arbor confanguinitatis ,
femrna , atis9 plufieurs rangs d’écuffons p.ofés fur
des figures dq branches àéarbres qui partent du tronc,
3u-deffous duquel on voit quelquefois des racines.,
L’arbre généalogique eft néceffaire, lorfqu’il s’agit
de faire des preuves pour entrer , dans un chapitre
noble , .ou pour être , reçu dans quelqu’ordre qui
exige des preuves de nobieffe.
■ Sur le tronc de Varbre fe trouve l’écuffon de celui
qui fait fes preuves, que l’on nomme le préfenté.
Au premier rang au-deflus , il y a deux écuffons ;
le pere à droite, la mere à gauche.
Au deuxieme rang, quatre écuffons ; l’aïeul paternel
& fa femme à droite, l’aïeul maternel & fa femme
à gauche.,
Au troifieme rang, huit écuffons ; Tes bifaïeuls
paternels à droite „ & maternels à gauche.
Au quatrième rang, feize, écuffons ; les bifaïeuls
paternels à droite , & maternels à gauche, &c. toujours
en doublant le nombre des écuffons, à mefure
que Ion monte de rang .en rang. Voye^la plpnche
X X Id e Blafon, Dict. raif. des S dette. &c. où fe trouve
l’àrire généalogique de feit M. le Dauphin. (G. D .L .T .)
§ ARC > militaire. Armes. ) L’are eft une
arpte faite d’un morceau de bois ; de corne , ou
«P* fait reflbrt, lequel étant courbé
: ayec violence par Le moyen d’une corde attachée à
fçs deux bouts, fait partit une fléché avec grand
effort, ente remettant dans fon état naturel '
Les cornes d-unarc font les extrémités où'ia corde
eft attachée pour le; bander ( Voyt?. planche I , Art
militaire, Armus & Machines, dans, ce Suvpl.Y
Lorc a, été & eft encore l’arme de prëlque toutes les
nations même les plus fauvages, parce qu’étant la
plus iiinple de toute-, les armes qui portent loin,
l'invention en a été trés-facile. La groffeur & la longueur
des unit varie félon la force de ceux qui doivent
le bander; mais leur figure eft la même chez
tous lesipeuples qui s’en fervent. ( V f
S ARC-EN-ÇiEL, (PhyJ.) pour faire aifément
concevoir les phénomènes de Y arc-en-ciel, Mitffçhen-
brp,eck a imaginé'sune •machine, par le moyen de
laquelle on les repréfente tous aifément, & d’une
maniéré très-claire. A 4 4 A (pL I. de Phyfiqui3fie. u
dans ce Suppl: eft une table à quatre pieds, ouverte
à fon milieu:, afin qu’on puiffe faire monter
& defçendre à tràvçrs cette table S corps: conique.
B C eft la moitié d’un cône , dont le fommet eft
en D. Ce fommet eft appuyé fur un axe tranfverfal
fur leqiieliourne le cçne B C ,S c fur lequel il s’élève
au-deffus de la table , ou fur lequel il s’abaiffe àu-
deffoiis : à l’extrémité du même fommet eft adapté.-
un oeil de la grandeur ordinaire de l’oeil d’un hommé,
& qui fert à représenter l’oeil du fpedateur : outre,
cela; une verge, de fe r , longue de trois pieds1, eft
adaptée au cqne & à l’a x e , l ’extrémité de cette
verge fe termine par un manche M : un globe doré S
eft enfilé fur cette verge , & ce globe tepféfente le
foleil ; la bafe.du cône: B eft entourée d’une -bande
large fémi-cirçulaire , fur laquelle on peint les fept
' couleurs de l’iris : lè côté du cône forme avec l’axe
un angle de 4©d. 17' : la largeur de la bandé peinte
fur la bafe du cône, .eft de près de deux degrés ,
conformément à la largeur ordinaire d’iine iris principale.
E , E , font deux plans triangulaires mobiles,
dont le. centre du mouvement eft placé au-deflus
du fommet du cône ; ces deux plans font çpnftam-
ment appliqués à chaque côté du cône : ils fervent à
cacher l’échancrure faite à la table, & ils repré-
fentent en même tems l’horizon. . On verra dans la
figure 2 , comment ils font, conftamment appliqués
aux deux cotés du. cône. Cela pofé, lorfque la tige
de fe r , ainfi que le foleil S , eft parallèle à l’horizon
, la moitié du cône eft au-deffus de la table,
& l’oeil du fpeâateur, qui eft en D , voit la bande
colorée femi-circulaire placée à la bafe du cône :
mais lorfque la main failit le manche de la tige de
fe r , & éleve le foleil S , le cône s’gbaiffe, ainfi que
le limbe qui eft adhérent à la bafe du cône , qui
alors devient moindre qu’un demi-cçrcle. Si oh éleve
encore le foleil S , on abaiffe toujours , dans la
même proportion le cône , & conféqüemmenr Y arc
qui repréfénte l’iris diminue aufli ; ce qui a lieu
jufqu’à ce que le foleil S foit élevé à 42**, ri; car alors
toùtïarc-en-ciel fe tro.uve au-deffus de l’horizon, 8c
les plans E E, couvrent entièrement le cône. Ce
limbe, coloré appliqué à la bafe du cône , repréfente
la pluie qui tombé au devant & au loin du fpeéla-
teur, dans le tems qu’on obferve dansle cielun ample
arc-en-ciel : mais comme il arrive quelquefois|que
Y arc-en-ciel paroît plus petit, lorfque la pluie qui
tombe n’.eft pas éloignée du fpeâateur, il y a fur
cette machine un autre arc plan L , fur lequel on
a peint les fept couleurs de l’iris, qui eft placé à une
plus ^proche diftance du fommet du cône , 8c dont