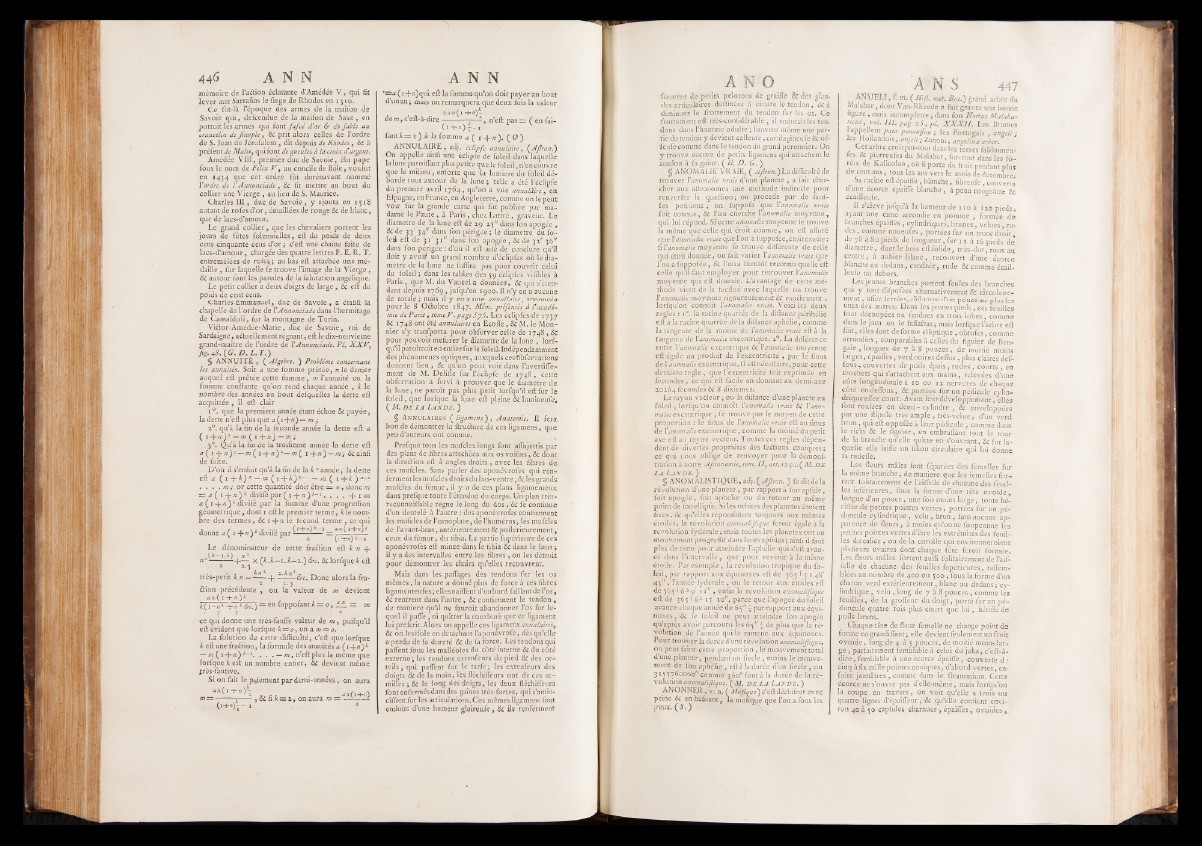
mémoire de l’a&ion éclatante d’Amédée V , qui fit
lever aux Sarrafins le fiege de Rhodes en 1310.
Ce fut-là l’époque des armes de la maifon de
Savoie qui, d.efcendue de ia maifon de Saxe , en
portoit les armes qui font fafcè £ or & de fable au
crancelin de Jinople, & prit alors celles de l’ordre
de S. Jean de Jérufalem , dit depuis de Rhodes, 8c à
préfent de Malte, qui font de gueules à la croix dargent.
Amédée VIII, premier duc de Savoie, élu pape
fous le nom de Félix V 9 au concile de Bâle, voulut
en 1434 que eèt ordre fût dorénavant nommé
Xordre de V Annonciade, 8c fit mettre au bout du
collier une Vierge , au lieu de S. Maurice.
Charles I II, duc de Savoie, y ajouta en 1518
autant de rofes d’o r , émaillées de rouge 8c de blanc,
que de lacs-d’amour.
Le grand collier, que les chevaliers portent les
jours de fêtes folemnelles, eft du poids de deux
cens cinquante écus d’or ; c’eft une chaîne faite de
lacs-d’amour, chargée des quatre lettres F. E. R . T.
entremêlées de rofes,; au bas eft attachée une médaille
, fur laquelle fe trouve l’image de la Vierge ,
8c autour font les paroles de la falutation angélique.
Le petit collier a deux doigts de large, 8c eft du
poids de cent écus.
Charles-Emmanuel, duc de Savoie, a établi la
chapelle de l’ordre de XAnnonciade dans l’hermitage
de Camaldoli, fur la montagne de Turin.
•Victor-Amédée-Marie, duc de Savoie, roi de
Sardaigne, a&uellementrégnant, eft le dix-neuvieme
grand-maître de l’ordre de XAnnonciade. PI. X X P ,
fig.48 . (G .D .L .T . )
§ ANNUITÉ , ( Algèbre. ) Problème concernant
les annuités. Soit a une fomme prêtée, n ie denier
auquel eft prêtée cette fomme, m l’annuité ou la
fomme confiante qu’on rend chaque année , k le
nombre des années au bout defquelles la dette eft
acquittée, il eft clair
i ° . que la première année étant échue 8c payée,
la dette n’eft plus que a ( 1 — m ;
20. qu’à la fin de la fécondé année la dette eft a
( I + / z ) a — m ( i + n ) — m ;
30. Qu’à la fin de la troifieme année la dette eft
<i( i+ / z ) 3 — /æ( i + zî) 2—/ra( i — 8cainfi
de fidte.
D ’où il s’enfuit qu’à la fin de la k e année, la dette
eft a ( 1 +Æ ) " — ot( — m ( .1+ & ) " -*
. . . . m ; or cette quantité doit être = o , donc m
■ = a ( 1 n~) k divifé par ( 1 +72 ) . . . . -J-i =
a ( 1 -f- n ) * divifé par la fomme d’une progreflion
géométrique, dont 1 eft le premier terme, à le nombre
des termes, 8c 1 -\-n le fécond terme , ce qui
donne a ( 1 + /z )* divifé par — * _ an(i-+-n)k
n
Le dénominateur de cette frattion eft k n 4-
»*-— x f k .k —i.k—i.^&c. 8clorfque A: eft
très-petit kn —— 4- ~ kn~&c. Donc alors la fraction
précédente , ou la valeur de m devient
an ( 1 H-fl)*
k ( i -n % + « 3 &c.) ~~en fuppofantk = o , f j l = 00
• • â T , 0
ce qui donne une très-fauffe valeur de m, puifqu’il
eft évident que lorfque k = 0, on a m — o. •
La folution de cette difficulté, c’eft que lorfque
k eft une fraétion, la formule des annuités a ( 1 4-n) k
— /7z.(i 4 - — m, n’eft plus la même que
lorfque k eft un nombre entier, 8c devient même
Jrès-fautive.
Si on fait le paiement par demi-années, on aura SttlfiS
- ,8 c f i/ c^ 2 , on aura m =
(l- i-n ) - - Z
•rra ( i - f «)qui eft la fomme qu’on doit payer ail bout
d’unan; mais on remarquera que deux fois la valeur
a a n f n - « ) *
de m, c’eft-à-dire — ■— — j— n’eft pas =2 ( en fai-
( X + « ) ^ I -
fant k = 1 ) .à la fomme a ( i + n ) . ( O )
ANNULAIRE, adj. éclipfe annulaire, (AJlron.)
On appelle ainfi une éclipiè de foleil dans laquelle
la lune paroiffant plus petite que le foleil, n’en couvre
que le milieu, enforte que la lumière du foleil déborde
tout autour de la lune ; telle a été l’éclipfe
du premier avril 1764, qu’on a vue annulcUre, en
Efpagne, en France, en Angleterre, comme on le peut
voir fur la grande carte qui fut publiée par madame
le Paute , à Paris, chez Lattré, graveur. Le
diamètre de la lune eft de 29' 25" dans fon apogée ,
8c de 33' 34" dans fon périgée ; le diamètre du foleil
eft de 31' 31" dans fon apogée , 8c de 32' 36"
dans fon périgée : d’où il eft ailé de conclure qu’il
doit y avoif un grand nombre d’éclipfes où le diamètre
de la lune ne fuffira pas pour couvrir celui
du foleil; dans les tables des 59 éclipfes vifibles à
Paris , qué M. du Vaucel a données, 8c qui s’étendent
depuis 1769, jufqu’en 1900. Il n’y en a aucune
de totale ; mais il y en a une annullaire, annoncée
pour le 8 Ottobre 1847. Mém. préfentés à Cacadémie
de Paris, tome V. page 5j 5. Les éclipfes de 1737
8c 1748 ont été annulaires en Ecoffe, 8c M. le Mon-
nier s’y tranfporta pour obferver celle de 1 7 4 8 ,8c
pour pouvoir mefurer le diamètre de la lune , lorf-
qu’il paroîtroit en entier fur le foleil. Indépendamment
des phénomènes optiques; auxquels ces■ Cbfervarions
donnent lieu, 8c qii’on peut voir dans l’avertiffe-
ment de M. Deliile fur l’éclipfe de 1748, cette
obfervation a fervi à prouver que le diamètre de
la lune, ne paroît pas plus petit Iorfqu’il eft fur le
foleil, que lorfque la lune eft pleine 8c lumineufe,
( M . d e j l a L a n d e . )
§ A n n u l a ir e s ( ligamens ) , Anatomie. Il fera
bon de démontrer la ftru&ure de ces ligamens, que
peu d’auteurs, ont connue.
Prefque tous les mufcles longs font affujettis par
des plans de fibres attachées aux os voifins, 8c dont
la direction eft à angles droits , avec les fibres de
ces mufcles. Sans "parler des aponévrofes qui renferment
les mufcles droits du bas-ventre, 8c les grands
mufcles du fémur, il y a de ces plans ligamenteux
dans prefque toute l’étendue du corps. Un plan très-
reconnoiflable régné le long du dos, 8c fe continue
d’un dentelé à l’autre : des aponévrofes contiennent
les mufcles de l’omoplate, de l’humérus, les mufcles
de l’avant-bras, antérieurement 8c poftérieurement,’
ceux du fémur, du tibia. La partie fupérieure de ces
aponévrofes eft mince dans le tibia 8c dans le bras ;
il y a des intervalles entre les fibres , on les détruit
pour démontrer les chairs qu’elles recouvrent.
Mais dans les paffages des tendons fur lés os
mêmes, la nature a donné plus de force à ces fibres
ligamenteufes ; elles naiffent d’un bord faillant de l’os ,
8c rentrent dans l’autre, 8c contiennent le tendon,
de maniéré qu’il ne fauroit abandonner l’os fur lequel
il paffe , ni quitter la courbure que ce ligament
lui prefcrit. Alors on appelle ces ligamens annulaires^
8c on lesifole en détachant l’aponeyrofe, dès qu’elle
a perdu de fa dureté 8c de fa force. Les tendons qui
paffent fous les malléoles du côté interne 8c du côté
externe ; les tendons extenfeurs du pied 8c des orteils
, qui paffent fur le tarfe ; les extenfeurs des
doigts 8c de la main, les fléchiffeurs ont de ces ar-
milles ; 8c le long des doigts, les deux fléchiffeurs
font enfermés dans des gaines très-fortes, quis’amin-
ciffent fu r les articulations. Ces mêmes ligamens font
enduits d’une humeur glaireufe, 8c ils renferment
{bavent de petits pelotons de graiffe 8c des gîàti-
des articulaires deftinées à oindre le tendon, 8c à
diminuer le frottement du tendon fur les os. Ce
frottement eft très-cônfidérable , il endurcit les tendons
dans l’homme adulte ; fouvent même une partie
du tendon y devient calleufe, cartilagineufe. 8c of-
feufe comme dans le tendon du grand peronnier. On
y trouve encore de petits ligamens qui attachent le
tendon à fa gaîne. ( H. D. G. )
§ ANOMALIE VRAIE, ( AJlron.) La difficulté de
trouver Xanomalie vraie d’une planete , a fait chercher
aux aftronomes une méthode indiredte pour
renverfer la queftion; on procédé par de fauf-
fes pofxtions ; on .fuppofe que Xanomalie vraie
foit Connue, 8c l’on cherche Xanomalie moyenne,
qui lui répond. Sï cette anomalie moyenne fe trouve
la même que celle qui étoit connue, on eft affuré
que Xanomalie vraie que l’on a fuppofée, étoit exacte: '
fi Xanomalie moyenne fe trouve différente de celle
qui étoit donnéé , on fait varier Xanomalie vraie que
l’on a fuppofée, 8c l’on a bientôt reconnu quelle eft
celle qu’il faut employer pour retrouver Xanomalie
moyenne qui eft donnée. L’avantage de cette méthode
vient de la facilité avec laquelle on trouve
y.anomalie moyenne rigoureilfement 8c exaélément,
lorfqu’on connoît Xanomalie vraie. Voici les deux
réglés : i°. là racine quarrée de la diftance périhélie
eft à la racine quarrée de la diftance aphélie, comme
la tangente de la moitié de Xanomalie vraie eft à la
tangente de Xanomalie excentrique. 20. La différence
entre Xanomalie excentrique 8c Xanomalie moyenne
•eft égale au produit de l’excentricité , par le finus
de Xanomalie excentrique. 11 eft néceffaire, pour cette
derniere réglé , que l’excentricité foit exprimée en
fécondés, ce qui eft facile en donnant au demi-axe
20264 fécondés 8c 8 dixièmes.
Le rayon veéteur, ou la diftance d’une planete au
foleil, lorfqu’on connoît Xanomalie vraie 8c Vanomalie
excentrique , fe trouve par le moyen de cette
proportion : le finus de Xanomalie vraie eft au finus
de Xanomalie excentrique, comme la moitié du petit
axe eft au rayon veéteur. Toutes ces réglés dépendent
de diverfes propriétés des feétions coniques;
ce qui nous oblige de renvoyer pour la démonf-
tration à notre AJtronomie, tom. //, art. 1240. ( M. d e
l a La n d e . )
§ ANOMALISTIQUE, adj.( AJlron. ) fe ditdela
révolution d’une planete , par rapport à fon apfide,
foit apogée, foit aphelie ou du retour au même
point de fonellipfe. bi les orbites des planètes étoient
fixes, 8c qu’elles répondiflent toujours aux mêmes
étoiles, la révolution anomalijlique feroit égale à la
révolution fydérale ; mais toutes les planètes ont un
mouvement progreffit dans leurs aplides; ainfi il faut
plus de te ms pour atteindre l’aphélie qui s’eft avancé
dans l’intervalle, que pour revenir à la même
étoile. Par exemple, la révolution tropique du foleil
, par rapporr aux équinoxes eft de 365 i 5 h 48'
4 5 " , l’année fydérale, ou le retour aux étoiles eft
de 365 i 6 h 9' 1 1 " , enfin la révolution anomaliflique
eft de 365 i 6 h 15' 20", parce que l’apogée du foleil
avance chaque année de 65" | par rapport aux équinoxes,
8c le foleil ne peut atteindre fon apogée
qu’après avoir parcouru les 65" 7 de plus que la révolution
de l’année qui le ramene aux équinoxes.
Pour trouver la durée d’une révolution anomalijlique,
on peut faire cette proportion, le mouvement total
d’une planete, pendant un fiecle , moins le mouvement
de fon aphélie., eft à la durée d’un fiecle, ou
315 5760000" comme 360° font à la durée de la révolution
anomalijlique. ( AL DE LA La n d e . )
ANONNER, v. n. ( Mujique ) c’eft déchifrer avec I
peine 8c en héfitant, la muuque que l’on a fous les
.veux. (<y.)
AÜSJELI, f. tri. ( Hijli nnt. Bot!) grànd arbre du
Malabar, dont Van-Rheede a fait graver une bonne
figure, mais incomplette, dans fon Hortus Malata-
ncus, vol. III, pag x S , pl. X X X I l . Les Brames
1 appellent /»atu ponouffou ; les Portugais , anseli :
les Hollandois, anjdi ; Zanoni, angdïna arbor.
L « arbre croîtpar-tout dans les terres fablonneu-
fes & p.errenfes du Malabar, fur-tout dans les forêts
de Kahcolan, ou il porte du fruit pendant plus
de cent ans , tous les ans vers le mois de décembre’
. Sa racine eft épaiffe , blanche, fibreufe , couvert»
d’une écorce épaiffe blanche, î peau rougeâtre &
écailleufe.
Il s’élève jiifqu’à la hauteur dé 110 à 120 pieds;
ayant une cime arrondie en pomme , formée de
branches épaiffes, cylindriques, brunes, velues, rudes,
comme noueufes , portées fur un tronc droit*
de 78 à 80 pieds de longueur, fur 12 à 16 pieds de
diamètre , dont le bois eftfolide, très-dur, roux aii
centre , à aubier blanc, recouvert d’une écorce,
blanche au dedans, cendrée, rude 8c comme écailleufe
au dehors. ^
Les jeunes branches portent feules des branches
qui y font difpofées alternativement 8c circulaire-
ment, affez ferrées, diftantes d’un pouce au plus les
unes des autres. Dans les jeunes pieds , ces feuilles
■ font découpées ou fendues en trois lobes, comme
dans le jaca ou le faffafras ; mais lorfque l’arbre eft
fait, elles font déformé elliptique , obtufes, comme
arrondies, comparables à celles du figuier de Bengale
, longues de 7 à 8 pouces, de moitié moins
larges, épaiffes, verdnoires deffus, plus claires def-
fous, couvertes de poils épais, rudes, courts , en
crochets qui s’attachent aux mains, relevées d’une
cdtc longitudinale à 10 ou 12 nervures de chaque
côté en deffous, 8c portées fur un pédicule cylindrique
affez court. Avant leur développement, elles
font roulées en demi - cylindre , 8c enveloppées
par une .ftipule très-ample , très-velue, d’un verd
brun, qui eft oppofée à leur.pédicule , comme dans
le ricin 8c le figuier, en embraffant tout le tour
de la branche qu’elle quitte en s’ouvrant, 8c fur laquelle
elle laiffe un fillon circulaire qui lui donne
là rudeffe.
Les fleurs mâles font féparées des femelles fur
la même branche, de maniéré que les femelles for-
tent folitairement de l’aiffelle de chacune des feuil-
les inférieures, fous la forme d’une tête ovoïde,
longue d’un pouce, une fois moins large, toute hé-
rifiëe de petites pointes vertes, portées fur un pé-
duncule cylindrique, velu , brun, fans aucune apparence
de fleurs, à moins qu’on ne foupconne les
petites: pointes vertes d’être les extrémités des feuil-
• lés du calice , ou de la corolle qui environneroient
plufieurs ovaires dont chaque tête feroit formée4
Les fleurs mâles fortent aufli folitairement de l’aif-
fielle de chacune des feuilles fupérieures, raffem-
blées au nombre de 400 ou 500, fous la forme d’un
chaton verd extérieurement, blanc au dedans; cylindrique
, velu , long de 7 à 8 pouces, comme les
feuilles, de la groffeur du doigt, porté fur un pé-
duncule quatre fois plus court que lu i, hériffé de
poils bruns.
Chaque tête de fleur femelle ne change point de
forme en grandiffant ; elle devient feulement un fruit
ovoïde, long de 4 à 5 pouces, de moitié moins lar-
. ge , parfaitement femblable à celui du jaka, c’eft-à-
dire , femblable à une écorce épaiffe, couverte d*
cinq àfix mille pointes coniques, d’abord vertes, en-
fuite jaunâtres , comme dans ,1e ftrammium. Cette
écorce ne s’ouvre pas d’elle-même, mais lorfqu’on
la coupe en travers, on voit qu’elle a trois ou
quatre lignes d’épaiffeur, 8c qu’elle contient environ
40 à 50 capfules charnues , épaiffes, ovoïdes ,