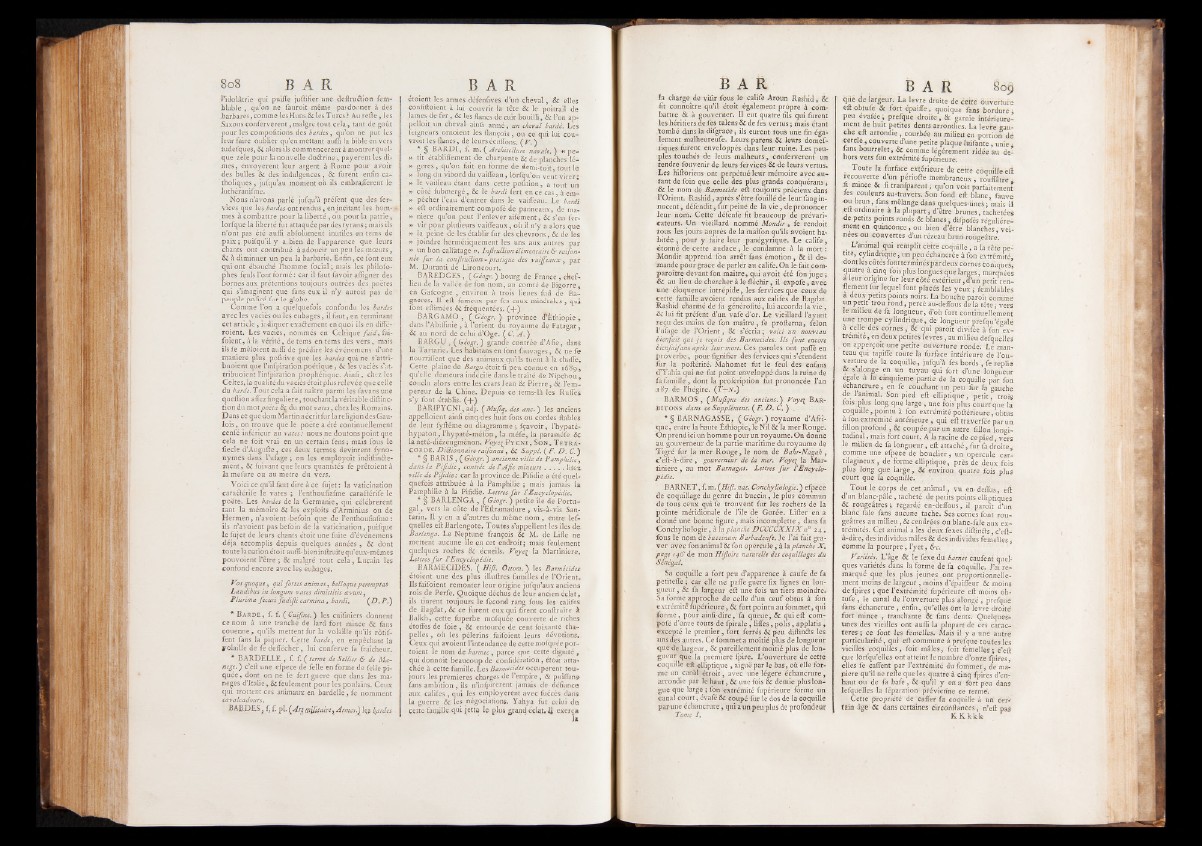
l ’ i d o l â t r i e q u i p u i f f e j u f t i f i e r u n e d e f t r u £ t i o n f e m -
b l a b l e , q u ’ o n n e f a u r o i t m ê m e p a i d o n n e r à d e s
b a r b a r e s , c o m m e l e s H u n s & l e s T u r c s ? A u r e f t e , l e s
S a x o n s c o n f e r v e r e n t , m a l g r c t o u t c e l a , t a n t d e g o û t
p o u r l e s c o m p o r t i o n s d e s bardes, q u ’ o n n e p u t l e s
l e u r f a i r e o u b l i e r q u ’ e n m e t t a n t a u f f i l a b i b l e e n v e r s
î u d e f q u e s , & a l o r s i l s c o m m e n c è r e n t à m o n t r e r q u e l q
u e z e l e p o u r l a n o u v e l l e d o ô r i n e ; p a y è r e n t l e s d î m
e s , e n v o y è r e n t l e u r a r g e n t à R o m e p o u r a v o i r
d e s b u l l e s & d e s i n d u l g e n c e s , & f u r e n t e n f i n c a t
h o l i q u e s , j u f q u ’ a u m o m e n t o ù i l s e m b r a s è r e n t l e
l u t h é r a n i f m e .
N o u s n ’ a v o n s p a r l é j u f q u ’ à p r é f e n t q u e d e s f e r -
v i c e s q u e l e s bardes o n t r e n d u s , e n i n c i t a n t l e s h o m m
e s à c o m b a t t r e p o u r l a l i b e r t é , o u p o u r l a p a t r i e ,
l o r f q u e l a l i b e r t é f u t a t t a q u é e p a r d e s t y r a n s ; m a i s i l s
n ’ o n t p a s é t é a u f f i a b f o l u m e n t i n u t i l e s e n t e m s d e
p a i x ; p u i f q u ’ i l y a . b i e n d e l ’ a p p a r e n c e q u e l e u r s
c h a n t s o n t c o n t r i b u é à a d o u c i r u n p e u l e s m oe u r s ,
& à d i m i n u e r u n p e u l a b a r b a r i e . E n f i n , c e f o n t e u x
q u i o n t é b a u c h é l ’ h o m m e f ô c i a l ; m a i s l e s p h i l o f o -
p h e s f e u l s l ’ o n t f o r m é : c a r i l f a u t f a v o i r a f f i g n e r d e s
b o r n e s a u x p r é t e n t i o n s t o u j o u r s o u t r é e s d e s p o è t e s
q u i s ’ i m a g i n e n t q u e f a n s e u x i l n ’ ÿ a u r o i t p a s d e
p e u p l e p o l i c é f u r l e g l o b e .
C o m m e l ’ o n a q u e l q u e f o i s c o n f o n d u l e s bardes
a v e c l e s v a c i è s o u l e s e u b a g e s , i l f a u t , e n t e r m i n a n t
c e t a r t i c l e , i n d i q u e r e x a c t e m e n t e n q u o i i l s e n d i f f é -
r o i e n t . L e s v a c i è s , n o m m é s e n C e l t i q u e faid, f a i -
f o i e n t , à l a v é r i t é , d e t e m s e n t e m s d e s v e r s , m a i s
i l s f e m ê l o i e n t - a u f f i d e p r é d i r e l e s é v é n e m e n s d ’ u n e
m a n i é r é p l u s p o f i t i v e q u e l e s bardes q u i n e s ’ a t t r i -
b u o i e n t q u e l ’ m f p i r a t i o n p o é t i q u e , & l e s v a c i è s s ’ a t -
t r i b u o i e n t l ’ i n f p i r a t i o n p r o p h é t i q u e . A i n f i , c h e z l e s
C e l t e s , l a q u a l i t é d u v a c i è s é t o i t p l u s r e l e v é e q u e c e l l e
d u barde. T o u t c e l a a f a i t n a î t r e p a r m i l e s f a v a n s u n e
q u e f t i o n a f f e z f i n g u l i e r e , t o u c h a n t l a v é r i t a b l e d i f t i n c -
t i o n d u m o t po'èta & d u m o t vates, c h e z l e s R o m a i n s .
D a n s c e q u e d o m M a r t i n a é c r i t f u r l a r e l i g i o n d e s G a u l
o i s , o n t r o u v e q u e l e p o è t e a é t é c o n t i n u e l l e m e n t
c e n f é i n f é r i e u r a u vates: n o u s n e d o u t o n s p o i n t q u e
c e l a n e f o i t v r a i e n u n c e r t a i n f e n s ; m a i s f o u s l e
f i e c l e d ’ A u g u f t e , c e s d e u x t e r m e s d e v i n r e n t f y n o -
n y m e s d a n s l ’ u f a g e ; o n l e s e m p l o y o i t i n d i f t i n & e -
m e n t , & f u i v a n t q u e l e u r s q u a n t i t é s f e p r ê t o i e n t à
l a m e f u r e o u a u m é t r é d u v e r s .
V o i c i c e q u ’ i l f a u t d i r e à c e f u j e t : l a v a t i c i n a t i o n
c a r a & é r i f e l e v a t e s ; l ’ e n t h o u f i a f m e c a r a f t é r i f e l e
p o è t e . L e s bardes d e l a G e r m a n i e , q u i c é l é b r è r e n t
t a n t l a m é m o i r e & l e s e x p l o i t s d ’ A r m i n i u s o u d e
H e r m e n , n ’ a v o i e n t b e f o i n q u e d e l ’ e n t h o u f i a f m e :
i l s n ’ a v o i e n t p a s b e f o i n d e l a v a t i c i n a t i o n , p u i f q u e
l e f u j e t d e l e u r s c h a n t s é t o i t u n e f u i t e d ’ é v é n e m e n s
d é j à a c c o m p l i s d e p u i s q u e l q u e s a n n é e s , & d o n t
t o u t e l a n a t i o n é t o i t a u f f i - b i e n i n f t r u i t e q u ’ e u x - m ê m e s
p o u v o i e n t l ’ ê t r e ; & m a l g r é t o u t c e l a , L u c a i n l e s
c o n f o n d e n c o r e a v e c l e s e u b a g e s .
Vos quoque, qui fortes animas, belloque peremptas
Laudibus in longum vates dimittitis cevum,
P lurima fecuri fudijli carmina , hardi. ( D % R . )
* B a r d e , f . f . ( Cuijîne. ) l e s c u i f i n i e r s d o n n e n t
c e n o m à u n e t r a n c h e d e l a r d f o r t m i n c e & f a n s
c o u e n n e , q u ’i l s m e t t e n t f u r l a v o l a i l l e q u ’ i l s r ô t i f -
f i e n t f a n s l a p i q u e r . C e t t e barde, e n e m p ê c h a n t l a
y o l a i l l e d e f e d e f f é c h e r , l u i c o n f e r v e f a f r a î c h e u r .
* B A R D E L L E , f . f . ( terme de Sellier & de Manège.
) c ’ e f t u n e e f p e c e d e f e l l e e n f o r m e d e C e l l e p i q
u é e , d o n t o n n e f e f e r t g u e r e q u e d a n s l e s m a n
è g e s d ’ I t a l i e , & f e u l e m e n t p o u r l e s p o u l a i n s . C e u x
q u i t r o t t e n t c e s a n i m a u x e n b a r d e l l e , f e n o m m e n t
ç avalcadours.
B A R D E S , f f . p l . {Ar t militaire, Armes.) lyzrdes
étoient les armes défenfives d’un c h e v a l, & elles
confiftoient à lui couvrir la tête & le poitrail de
lames de f e r , & les flancs de cuir bouilli, & ’on ap-
pelloit un cheval ainfi armé , un cheval bardé. Les
ftigneurs ornoient les fiançais, ou ce qui lui cou-
vroit les flancs, de leurs édifions. ( V . )
§ B A R D I , f. m. ( Architecture navale. ) « pe-
» tit établiffement de. charpente & de planches lé-
» gérés , qu’on fait en forme de demi-toït, tout le
» long du vibord du vaiffeau, lorfqu’on veut v irer *
» le vaiffeau étant dans cette pofition, a to u t un
» côté lubmergé, & le hardi fert en ce ca s, à em-
» pêcher l’eau d’entrer dans le vaiffeau. Le bardé
» eft ordinairement compofé de panneaux, de ma-
» niere qu’on peut l’enlever aifément, & s’en fer-
» vir pour plufieurs vaiffeaux, o ù il n’y a alors que
» la peine de les établir fur des chevrons, & de les
» joindre hermétiquement les uns aux autres par
» un bon calfatage ». Injlruclion élémentaire & raifon-
nee fu r la confruclion - pratique des vàijfeaux , par
M. Duranti de Lironcourt.
BAREDGES, ( Géogr. ) bourg de France , chef-
lieu de la vallée de fon nom , au comté de Bigorre ,
en Gafcogne , environ à trois lieues fud de Ba-
gneres. Il eft fameux par fes eaux minérales, qui
font eftimées & fréquentées. ( + )
BARGAMO , ( Géogr. ) province d’Éthiopie ,
dans l’Abiffinie , à l’orient au royaume de Fatagar ,
& au nord de celui d’Oge. (C . A . )
BARGU , ( Géogr. ) grande contrée d’Afie, dans
la Tartarie. Les habitans en font fauvages, & ne fe
nourriffent que des animaux qu’ils tuent à la chaffe.
Cette plaine de Bargu étoit fi peu connue en 1689,
qu’elle demeura ihdécife dans le traité de Nîpchou ,
conclu alors entre les czars Jean & Pierre , & l’empereur
de la Chine. Depuis ce tems-là les Ruffes
s ’y font établis, (fl-)
B A R I P Y C N I , a d j. {M u fq . des anc. ) le s an ciens
a p p e llo ien t ainfi cinq des h u it fo n s o u co rd e s f ta b le s
d e le u r fy f têm e o,u d ia g ram m e ; f ç a v o i r , l’h y p a té -
h y p a t o n , i’h y p a t é -m é fo n , la m é f e , la paramél'e &:
la ne té -d ié z eu gm én o n , Voye1 P y c n i , S o n , T e t r A-
CORDE. Dictionnaire raifonné, & Suppl. ( F . D . C. )
§ BARIS , { Géogr. ) ancienne ville de Pamphiliey
dans la Pijîdie, contrée de ÜAfie mineure...........liiezville
de Pijîdie : car la province de. Pifidie a été quelquefois
attribuée à la Pamphilie ; mais jamais la
Pamphilie à la Pifidie. Lettres fu r CEncyclopédie.
* § BARLENGA , ( Géogr. ) petite île de Portug
a l, vers la côte de l’Eftramadure , vis-à-vis San-
tarin. Il y en a d’autres du même nom , entre lesquelles
eft Barlengote. Toutes s’appellent les îles de
Barlenga. Le Neptune françois & M. de Lifle ne
mettent aucune île en cet endroit ; mais feujement
quelques roches & écueils, Voye{ la Martiniere.
Lettres fu r ÜEncyclopédie.
t BARMECIDES. ( Hift. O nom. ) les Barmécidee
étoient une des plus illuftres familles de l’Orie n t.
Ils faifoient remonter leur origine jufqu’aux anciens
rois de Perfe. Quoique déchus de leur ancien éclat,
ils tinrent toujours le fécond rang fous les califes
de Bagdat, & ce furent eux qui firent conftruire à
Balkh, cette fuperbe mofauee couverte de riches
étoffes de foie , & entourée de cent foixanté chapelles
, où les pèlerins faifoient leurs dévotions.
Ceux qui avoient l’intendance de cette mofquée por-
toient le nom de barmec, parce que cette dignité ,
qui donnoit beaucoup de confidération , étoit atta-r
chée à cette famille. Les Barmicides occupèrent toujours
les premières charges de l’empire, & puîffans»
fans ambition, ils n’infpuCrent jamais de défiance
aux califes , qui les employèrent avec fuccès dans
la guerre & les négociations. Yahya fut celui d e
ç.ette faowUe qui jetta le plus gran4 éclat. U exerça
la charge de vifir fous le califè Aroun Rashid ; &
fit connoître qu’il étoit également prôpre à combattre
& à gouverner. Il eut quatre fils qui furent
les héritiers de fes talens & de fes vertus ; mais étant
tombé dans la difgrace ; ils eurent tous une fin également
malheureufe. Leurs parens & leurs domef-
tiques furent enveloppés dans leur ruine. Les peuples
touchés de leurs malheurs, cônferverent un
tendre fouvenir de leurs ferviçes & de leurs vertus.
Les hiftbriens ont perpétué leu r mémoire avec -autant
de foin que celle des plus grands conquérans ;
& le nom dé Barmecide eft toujours précieux dans
l’Orient; Rashid, après s’être fouillé de leur fang innocent
, défendit j fur peiné de la v ie , de prononcer
leu r nom. Cette défenfe fit beaucoup de prévaricateurs.
Un vieillard nommé Mondir, fe rendoit
tous lés jours auprès de la mâifon qu’ils avoient ha*
bitée ; pour ÿ faire leur panégyrique. Le calife j
étonné de cette audace , le condamne à la mort :
Mondir apprènd fon: arrêt fans émotion, & il demande
pour grâce de parler au calife. On le fait c©m-
p a ro ître devant fon maître, qui avoit été fon juge ;
& au lieu de chercher à le fléchir, il expofè, avec
une éloquence' intrépide, les ferviçes que ceux de
ce tte faüiille avoient rendus aux califes de Bagdat.
Rashid chartné de fa générofité, lui accorda la v ie ,
& lui fit préfejit d’un vafe d ’or. Le vieillard l’ayant
reçu, des mains de fon maître , fe profterna, félon
l ’ufage de l’O rie n t, & s’écria ; voici un nouveau
bienfait que j e reçois des Barmecides. Ils fon t encore
bienfaifahs après leur mort. Ces paroles ont paffé en
p ro v e rb e , pour lignifier des ferviçes qui s’étendent
fur la poftéritéi Mahomet fut le feul des enfans
d’Yahia qui ne fut point enveloppé dans la ruine de
fa famille , dont la profeription fut prononcée l’an
,187 de l’hégire. (T—jv.)
BARMOS , ( Mufique dès anciens.) Poye^ Ba r -
BITONS dans ce Supplément. {F . D . C . ) .
* § BARNAGASSE, { Géogr.) royaume d’Afriq
u e , entre la haute É thiopie, le N ü & la m er Rouge.
O n prend ici uh homme pour un royaume. On donne
au gouverneur de la partie maritime du royaume de
.Tigré fur la mer R o u g e , le nom de Bahr-Nagah ,
c’eft-à -d iré , gouverneur de la mer. Voye^ la Martiniere
, au mo t Barnagas. Lettres fu r ü Encyclopédie.
BARNET, f. m. {Hiß. nat. Conchyliologie. ) efpece
de coquillage du genre du buccin, le plus commun
de tous ceux qui fe trouvent fur les rochers de la
pointe méridionale de l’île de Gorée. Lifter en a
donné une bonne figure j mais incomplette , dans fa
Conchyliologie, à la planche D C C C C X X IX n ° 2 4 ,
fous le nom de buccinum Barbadenfe. Je l’ai fait grav
e r avec fon animal & fon o p e r c u le à la planche X .
page 146" de mon Hißoire naturelle des coquillages du
Sénégal,
Sa coquille a fort peu d’apparence à caufe de' fa
petiteffe ; car elle ne paffe guere fix lignes en long
u eu r, & fa largeur eft une fois un tiers moindre.-
Sa forme approche de celle d’un oe u f Obtus à fon
extrémité füpérieure, & fort pointu au fommet, qui
fo rm e , pour ainfi-dire, fa queue , & qui eft compofé
d’onze tours de fpirale , liffes ,• p o lis, âpplatis,
excepté le premier, fort ferrés & peu diftinûs les
uns des autres. Ce fommet a moitié plus de longueur
que de largeur, & pareillement moitié plus de longueur
que la première fpire. L’ouverture de cette
coquille eft elliptique , aiguë par le bas, où elle forme
un eanàl é tro it, avec une légère échanc rure,
arrondie par le h a u t, & une fois & demie plus longue
que large ; fon extrémité fupérieure forme un
canal c o u rt, évafé & coupé fur le dos de la coquille
p a r une échancrure, qui a un peu plus de profondeur
Tome I.
qiié de largeur. La levré droite de cetté ouverture
eftobtufe & fo rt épaiffe, quoique fané bordure i
peu évafée; prefque d ro ite , & garnie intérieurement
de huit petites dents arrondies. La levfe gauche
eft arro n d ie, courbée au milieu en portion dé
ce rc le , couverte d’une petite plaque luifante, unie 1
ians bo u rrelet, & comme légèrement ridée au dehors
vers fon extrémité fupérieure;
Toute la furfàce extérieure de cette coquille e ii
recouverte d’un péribfte membraneux, louffâtre x
.û mince & fi tranfparent ; qu’on voit parfaitement
les couleurs au-iraveirs. Son fond eft blanc, fauve
ou b ru n , fans mélange dans quelques-unes ; mais il
eft ordinaire à la plupart ; d’etre brurtes, tachetées
de petits points ronds & blanc s, difpofés régulièrement
en quinconce, ou bien d’être blanches, vei-
nees ou couvertes d’un rézèâu brun-rougeâtre.
L’animal qui remplit cèttë coquille , a la tête petite,
cylindrique, un peu échancrée à fon extrémité,
•dont les côtés foht terminés'pàr deux cornes Coniqueâ;
quatre à cinq fois plus longues que larges; marquées
à leur origine fur leur côte extérieur, d’un petit renflement
fur lequel font placés les yeux ; femblableS
à deux petits points noirs. La bouche paroît comme
un petit tro u to n d , percé au*deffous de la tête ; vers
le milieu de fa longueur, d’où fort contirluellçment
une trompe cylindrique,.de longueur pfèfqU’égalë
à celle des' c o rn e s, qui paroît divifée à fon extrémité,
en deux petites le v re s , au milieu defquèlles
on apperçoit une petite o uverture ronde; Le manteau
qui tapiffe toute la furfàce intérieure de l’ouverture
de la coquille, jufqu’à fes bords , fe replié
& s’alonge en un tuyau qui fort d’une longueur
égalé à la cinquième partie de la coquille par fon
échancrure, en fe couchant un peu fur la gauche
de l’animal. Son pied eft elliptique, p e tit, trois
fois plus long que large , une fois plus co u rt que la
coquille, pointu à fon extrémité poftérieure, obtus
à fon extrémité antérieure , qui eft traverfée p ar un
fillqn profond , & coupée par un autre fillon longitudinal
, mais fort court. A la racine de ce pied, vers
le milieu de fa longueur, eft attaché, fur fa d ro ite ,
comme une efpece de b o u clier, un opercule cartilagineux
de forme elliptique -, près de deux fois
plus long que la rg e , & environ quatre fois plus
court que la coquille.
To u t le corps de cet animal v u en-deflus, eft
d’un blanc-pâle, tacheté de petits points elliptiques
& rougeâtres ; regardé èn-deffous, il paroît d’un
blanc fale fans aucune tache. Ses cornes font rougeâtres
au milieu, & cendrées ou blanc-fale aux extrémités.
Cet animal a les deux fexes diftinfts, c’eft-
à-dire, des individus mâles & des individus femelles,
comme la p o u rp re , l’y e t, & a
Variétési L’âge & le fexe du caufent quelques
variétés dans la forme de fa coquille. J’ai re marqué
que les plus jeunes .ont proportionnellement
moins de largeur , moins d ’épaiffeur & moins
de fpires ; que l’extrémité fupérieure eft moins ob-
tufe , le canal de l’ouverture plus alongé ; prefque
fans échancrure , enfin, qu’elles ont la levre droite*
fort mince , tranchante & fans dents. Quelques-
unes des vieilles ont auffi la plupart de ces caractères
; ce font les femelles. Mais il y a une autre
particularité, qui eft commune à prefqùe toutes les
vieilles coquilles, foit mâles, foit femelles ; ê’eft
que lorfqu’elles ont atteint le nombre d’onze fpire s,
elles fe eaffent par l’extrémité du fommet,- de maniéré
qu’il ne refte que les quatre à cinq fpires d’en-
haut ou de fa bafe , & qu’il y en a fort peu dans
lefquelles la iéparation prévienne ce terme.
Cette propriété de caffer fa coquille à un eer-’
tain âge & dans certaines éirco'rtftances, n’eft pas
K K k - k - f e