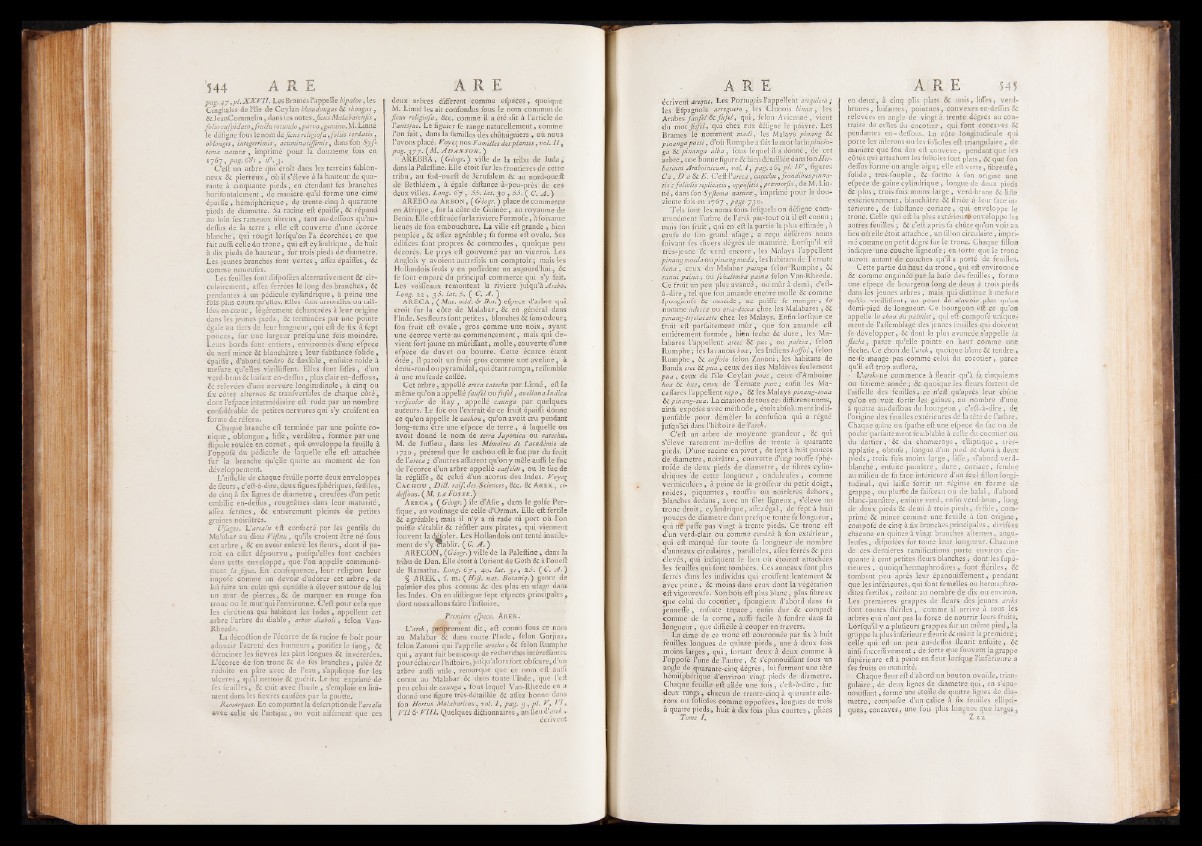
pa<>. 47, pl- X X V IL Les Brames l’appelle bipaloe, les
Cinghales de Pile de Ceylan bkoudougas & rhoogas,
& JeanCommelin, dans les notes,ficus Malabarenjis,
folio cufpidato ,fruclu rotundo ,parvo 9gemino. M. Linné
le défigne fous le nom de ficus religiofafoliis cordaùs ,
oblongis, inttgcrrimis, acuminatîjfimis, dans ion
tema. naturce , imprimé pour la douzième fois en
176 7, /»«g. 6S'i t n°. j .
C’eft un arbre qui croît dans les terreins fablon-
neux & pierreux , où il s’élève à la hauteur de quarante
à cinquante pieds, en étendant fes branches
horifontalement, de maniéré qu’il forme une cime
épaiffe, hémilphérique, de trente-cinq à quarante
pieds de diamètre. Sa racine eft épaiffe, & répand
au loin fes rameaux fibreux, tant au-deffous qu’au-
deffus de la terre ; elle eft couverte d’une écorce
blanche, qui rougit lorfqu’on l’a écorchée; ce que
fait auffi celle du tronc, qui eft cylindrique, de huit
à dix pieds de hauteur, fur trois pieds de diamètre.
Les jeunes branches font vertes, affez épaiffes, &
comme noueufes.
Les feuilles font difpofées alternativement & cir-
culairement, affez ferrées le long des branches, &
pendantes à un pédicule cylindrique, à peine une
fois plus court qu’elles. Elles font arrondies ou taillées
en coeur, légèrement échancrées à leur origine
dans les jeunes pieds, & terminées par une pointe
égale au tiers de leur longueur, qui eft de fix à fept
pouces, fur une largeur prefqu’une fois moindre.
Leurs bords font entiers, environnés d’une efpeee
de nerf mince & blanchâtre ; leur fubftancé folide ,
épaiffe, d’abord tendre & flexible, enfuite roide à
mefure qu’elles vieilliffent. Elles font liffes, d’un
verd-brun & luifant en-deffus, plus clair ën-deffous,
& relevées d’une nervure longitudinale, à cinq ou
fix côtes alternes & tranfverfales de chaque côté,
dont l’efpace intermédiaire eft rude par un nombre
confidérable de petites nervures qui s’y croifent en
forme de réfeau.
Chaque branche eft terminée par une pointe conique
, oblongûe, liffe, verdâtre, formée par une
ftipule roulée en cornet, qui enveloppe la feuille à
l’oppofé du pédicule de laquelle elle eft attachée
fur la branche qu’elle quitte au moment de fon
développement.
L’aiffelle de chaque feuille porte deux enveloppes
de fleurs, c ’eft-à-dire, deux figues fphériques, feffiles,
de cinq à fix lignes de diamètre, creufees d’un petit
ombilic en-deffus, rougeâtres dans leur maturité,
affez fermes, & entièrement pleines de petites
graines noirâtres.
Ufages. Uarealu eft confacré par les gentils du
Malabar au dieu Viflnü, qu’ils croient être hé fous
cet arbre , & en avoir enlevé les fleurs, dont il pa-
roit en effet dépourvu, puifqu’elles font cachées
dans cette enveloppe, que l’on appelle communément
La figue. En conséquence, leur religion leur
impofe comme un devoir d’adorer cet arbre, de
lui faire un culte qui confifte à élever autour de lui
un mur de pierres, & de marquer en rouge fon
tronc ou le mur qui l’environne. C ’eft pour cela que
les chrétiens qui habitent les Indes, appellent cet
arbre l’arbre du diable, arbor diaboli, félon Van-
• Rheede. ; ,
La décoélion de l’écorce de fa racine fe boit pour
adoucir l’acreté des humeurs , purifier le fang, &
déraciner les fievres les plus longues & invétérées.
L’écorce de fon tronc & de fes branches, pilée &
réduite en pâte avec de l’eau, s’applique fur les
ulcérés, qu’il nettoie & guérit. Le pic exprimé de
fes feuilles, & cuit avec l’huile , s’emploie en Uniment
dans les fievres caufées par la goutte.
Remarques. En comparant la defcription de Yarealu
avec celle de l’antsjac, on voit aifément que ces
deux arbres different comme efpeces:, quoique
M. Linné les ait confondus fous le nom commun de
ficus religiofa, &c. comme il a été dit à l’article de
Yantsjac. Le figuier fe range naturellement, comme
l’on fait, dans la familles des châtaigniers , où nous
l’avons placé. Voye{ nos Familles des plantes, vol. I l ,
pag. 377- (M. A d a n s o n . )
AREBBA, ( Géogr. ) ville de la tribu de Juda
dans la Paleftine. Elle étoit fur les frontières de cette
tribu, au fud-oueft de Jérufalem & au nord-oueft
de Bethléem, à égale diftance à-peu-près de ces
deux villes. Long, 6 7 , 55. lat. 3 0 , 55. (C . A . )
AREBOcta A r b o n , {G é o g r .) place de commerce
en Afrique fur la côte de Guinée , au royaume de
Bénin. Elle eftfituée furlariviereFormofe, àfoixante
lieues de fon embouchure. La ville eft grande bien
peuplée , & affez agréable; fa forme eft ovale. Ses
édifices font propres & commodes, quoique peu
décorés. Le pays eft gouverné par un viceroi. Les
Anglois y avoient autrefois un comptoir ; mais les
Hollandois feuls y en poffedent un aujourd’hui, &
fe font emparé du principal commerce qui s’y fait.
Les vaiffeaux remontent la riviere' jufqu’à Arebo«
Long. 2 2 ,3 5, lat. 5. ( C. A. )
ARECA, ( Mat. méd. & Bot.) efpeee d’arbre qui.
croît fur la côte de Malabar, & eh général dans
l’Inde. Ses fleurs font petites, blanches & fans odeur ;
fon fruit eft o vale, gros comme une noix, ayant
une écorce verte au commencement, mais qui devient
fort jaune en mûriffant, molle, couverte d’une
efpeee de duvet ou bourre. Cette écorce étant
ôtée, il parôît un fruit gros comme une aveline, à
demi-rond ou pyramidal, qui étant rompu, reffemble
à une mufeade caffée.
Cet arbre, appellé areca catechu par Linné, eft le
même qu’ôn a appellé faufel ou fufel, avellana Indica
verjicolor de R a y , appellé caunga par quelques
auteurs. Le fut Ou l’extrait de ce fruit épaifîi donne
ce qu’on appelle le cachou, qu’on avoit cru pendant
long-tems être une efpeee de terre , à laquelle on
avoit donné le nom de terra Japonica ou catechu,
M. de Juflieu, dans les Mémoires de Üacadémie de
1720, prétènd que le cachou eft le fuc pur du fruit
de Y areca ; d’autres affurent qu’on y mêle auffi le fuc
de l’écorce d’un arbre appellé catfchu, ou le fuc de
la régliffe, & celui d’un acorus des Indes. Voye^
C a c h o u , Dicl, raif.des Sciences, &c. & A r e k , ci-
dejfous. (M . l a F o s s e . )
A r e c a , ( Géogr. ) île d’Afie, dans le golfe Per-
fique, au voifinage de celle d’Ormus. Elle eft fertile
& agréable ; mais il n’y a ni rade ni port où l’on
puiffe s’établir & réfifter aux pirates, qui viennent
fouvent la défoler. Les Hollandois ont tenté inutilement
de s’y CTablir. (C. A . )
ARECON, (Géogr.) ville de la Paleftine, dans la
tribu de Dan. Elle étoit à l’orient de Geth & à l’Oueft
de Ramatha. Long.- 6 7 , 40. lat. 3 1 , z 5. ( C. A . )
§ A R E K , f. m. (Hifi. nat. Botaniq.) genre de
palmier des plus connus & des plus en ufage dans
les Indes. On en diftingue fept efpeces principales ,
dont nous allons faire l’hiftoire.
Première efpeee, AR EK .'
U arek, proprement dit, eft. connu fous ce nom
au Malabar & dans toute l’Inde, félon Garjias,
félon Zanoni qui l’appelle arecha, & félon Rumphe
qui, ayant fait beaucoup de recherches intéreflântes
pour éclaircir l’hiftoire, jufqu’alors fort obfcure, d’un
arbre auffi utile, remarque que ce nom eft auffi
connu au Malabar & dans toute l’Inde, que l’eft
peu celui de caunga , fous lequel Van-Rheede en a
donné une figure très-détaillée & affez bonne dans
fon Hortus Malabaricus, vol. / , pag. g , pl. F » 9
V i l & V l l l . Quelques dictionnaires, au fieu à!arek
écrivent
écrivent areque. Les Portugais l’appeHent arequiero ;
les Hfpagnols arreguero , les Chinois, binan, les
Arabes fakifU & fùfel, qui, félon Avicenne , vient
du mot fiefel, qui chez eux défigne le poivre. Les
Brames le nomment madi, les Malays pinang &
pinanga poeti, d’où Rumphe a fait le mot \ztmpincin-
ga & pinanga alba, fous lequel il a donné, de cet
arbre, une bonne figure & bien détaillée dans fon Her-
barium Amboinicurri, vol. / , pag. 2S, pl.' IV , figures
C a , D aScE. C’eft Y areca, catechu, frondibus pinna-
tis : foliolis replicam, oppofitis, prtemorfis, de M. Linné,
dans fon Syjlema naturce, imprimé pour la douzième
fois en' 1767, page 730.
Tels font les noms fous lefquels on défigne .communément
l’arbre de Ydrek par-tout où il eft connu ;
mais fon fruit, qui en eft la partie la plus eltimée, à
caufe de fon grand ufage, a reçu différens noms
fuivant fes divers dégrés de maturité. Lorfqu’il eft
très-jeune & verd encore , les Malays rappellent
pinang moeda ou pinangmuda, les habitans de Ternate
hena , ceux - du Malabar painga felon-'Rumphe, &
tanni paina, ou fchalemba paina félon Van-Rheede.
Ce fruit un peu plus avancé, ou mur à demi, c’eft-
à-dire , tel que Ion.amande encore molle & comme
fpongieufe & mucide, ne puiffe fe manger , fe
nomme adecca ou aria-decca chez les Malabares , &
pinang-tdjelacatte chez.les Malays. Enfin lorfque ce
fruit eft parfaitement mûr , que fon amande eft
entièrement formée , bien feche & dure , les Malabares
l’appellent areec 8>C pac , ou paleca, félon
Rumphe ; les Javanois boa, les Indiens koffol, félon
Rumphe, & coffolo félon Zanoni ; les habitans de
Banda erec & pua, ceux des îles Maldives feulement
pua, ceux de l’île Ceylan poac, ceux d’Amboine
hoa & hue, ceux de Ternate parei enfin les Ma-
caffares l’appellent rapo, & les Malays pinang-toua
& pinang-tua. La citation de tous ces différens noms,
ainfi expofés avec méthode, étoit abfolu ment indif-
penfable pour démêler la confufion qui a régné
julqu’ici dans l’hiftoire àe Yarek.
C’eft un arbre de moyenne grandeur, & qui
s’élève rarement au-deffus de trente à quarante
pieds. D’une racine en p ivot, de fept à huit pouces
de diamètre, noirâtre , couverte d’une touffe fphé-
roïde de deux pieds de diamètre, de fibres cylindriques
de cette longueur , onduleufes , comme
vermiculées , à peine de la groffeur du petit doigt,
rojdes, . piquantes , rouffes ou noirâtres dehors ,
"blanches dedans, avec un filet ligneux, s’élève un
tronc droit,. cylindrique, affez égal, de fept à huit
pouces de diamètre dans prefque toute fa longueur,
qui ni? paffe pas vingt à trente pieds. Ce tronc eft
d’un verd-clair ou comme cendré à fon extérieur,
'qui eft marqué fur toute fa longueur de nombre
d’anneaux circulaires, parallèles, affez ferrés & peu
élevés, qui indiquent le lieu où étoient attachées
les feuilles qui font tombées. Ces anneaux font plus
ferrés dans les individus qui croiffent lentement &
avec peine , & moins dans ceux dont la végétation
‘eft vigoureufe. Son bois eft plus blanc, plus fibreux
que celui du cocotier, fpongieux d’abord dans fa
jeuneffe, enfuite tepace, enfin dur & compaét
comme de la corne, auffi facile à fendre dans fa
longueur, que difficile à couper en travers.
La cime de ce tronc eft couronnée par fix à huit
feuilles longues de quinze pieds, une à deux fois
moins larges, q ui, fortant deux à deux comme à
l’oppofé l’une de l’autre, & s’épanouiffant fous un
angle de quarante-cinq dégrés, lui forment une tête
hémifphénque d’environ vingt pieds de diamètre.
Chaque feuille eft ailée une fois, c’eft-à-dire, fur
•deux rangs , chacun de trente-cinq à quarante aile-
tons ou folioles comme oppofées, longues de trois
à quatre pieds, huit à dix fois plus courtes, pliées.
Tome I,
eh deux, à cinq plis plats & unis, liffes, verd-
brunes, luifantes, pointues, convexes en-deffus &
relevées en angle de vingt à trente dégrés au contraire
de celles du cocotier, qui font concaves &
pendantes en-deffous. La côte longitudinale qui
porte les ailerons ou les folioles eft triangulaire , de
maniéré que fon dos eft convexe, pendant que les
côtés qui attachent les folioles font plats, & que fon
deffuSforme un angle aigu; elle eft verte, fibreufe,
folide, très-fouple , & forme à fon origine une
efpeee de gaîne cylindrique , longue de deux pieds
& plus, trois fois moins large , verd-brune & lifte
extérieurement, blanchâtre & ftriée à leur face intérieure
, de fubftancé. coriace, qui enveloppe le
tronc. Celle qui eft la plus extérieur© enveloppe les
autres feuilles ; & c’eft après fa chûte qu’on voit au
lieu où elle étoit attachée, un fillon circulaire, imprimé
comme un petit dégrë fur le tro.nc. Chaque fillon
indique'une couche ligneufe ; éh forte que le tronc
auroit autant de couches qu’il a porté de feuilles»
Cette partie du haut du tronc, qui eft environnée
& comme engainée par la bafe des feuilles, forme
une efpeee de bourgeon long de deux à trois pieds
dans les jeunes arbres , mais, qui diminue à mefure
qu’ils vieilliffent,.au point de n’avoir plus qu’un
demi-pied de longueur. Ce bourgeon eft ce qu’on
appelle le chou du palmier, qui eft compofé uniquement
de l’affemblage des jeunes feuilles qui doivent
fe développer, & dont la plus avancée's’appelle la
fléché -, parce qu’elle pointe en haut comme une
fléché. Ce chou .de Y arek, quoique blanc & tendre ,
ne*fe mange pàsÿcomme celui du cocotier, parce
qu’il eft trop auftere. .
- U arek» ne commence à fleurir qu’à fa cinquième
ou fixieme année ; & quoique les fleurs fortent de
l’aiffelle des feuilles, ce n’eft qu’après leur chûte
qu’on en .'voit fortir les.gaînes, au nombre d’una
à quatre au-deffous dû bourgeon , c’eft-à-dire , de
l’origine des feuilles extérieures de là tête de l’arbre.
Chaque gaîne ou fpathe eft une efpeee de fac ou de
poche parfaitement femblable à celle du cocotier ou
du dattier, ' & du chamærops , elliptique , très*
applatie , obtufe, longue d’un pied & demi à deux
pieds, trois fois moins large , liffe , d’abord verd-
blanchè , enfuite jaunâtre , dure, coriace, fendue
au milieu de fa face intérieure d’un feul fillon longitudinal,
qui laiffe fortir un régime en forme de
grappe, ou plutôt de faifeeau ou de balai, d’abord
blanc-jaunâtre, enfuite verd, enfin verd-brun, long
de deux pieds & demi à trois pieds, feffile, comprimé
& mince comme une feuille à fon origine,
compofé de cinq à fix branches principales, divifées
chacune en quinze à vingt branches alternes, angu-
leufes, difpofées fur toute leur longueur. Chacune
de ces dernieres ramifications porte environ cinquante
à cent petites fleurs blanches, dont les fupé-
rieùres , quoiqu’hermaphrodites , font ftériles, &
tombent peu après leur épanouiffement, pendant
que les inférieures, qui font femelles ou hermaphrodites
fertiles , relient au nombre de dix ou environ»
Les premières grappes de fleurs des jeunes areks
font toutes ftériles, . comme il arrive à tous les
arbres qui n’ont pas la force de nourrir leurs fruits.
Lorfqu’il y a plufieurs grappes fur un même pied, la
grappe la plus inférieure fleurit & mûrit la première ;
celle qui eft un peu au-deffus fleurit enfuite, &
ainfi fucceffivement ; de forte que fouvent la grappe
fupérieure eft à peine en fleur lorfqug l’inférieure a
fes fruits en maturité.
Chaque fleur eft d’abord un bouton ovoïde, triangulaire
, de deux lignes de diamètre qui, en s’épanouiffant
, forme’une étoile de quatre lignes de diamètre,
compofée d’un calice à fix feuilles elliptiques,
concaves, une fois plus longues que larges J(