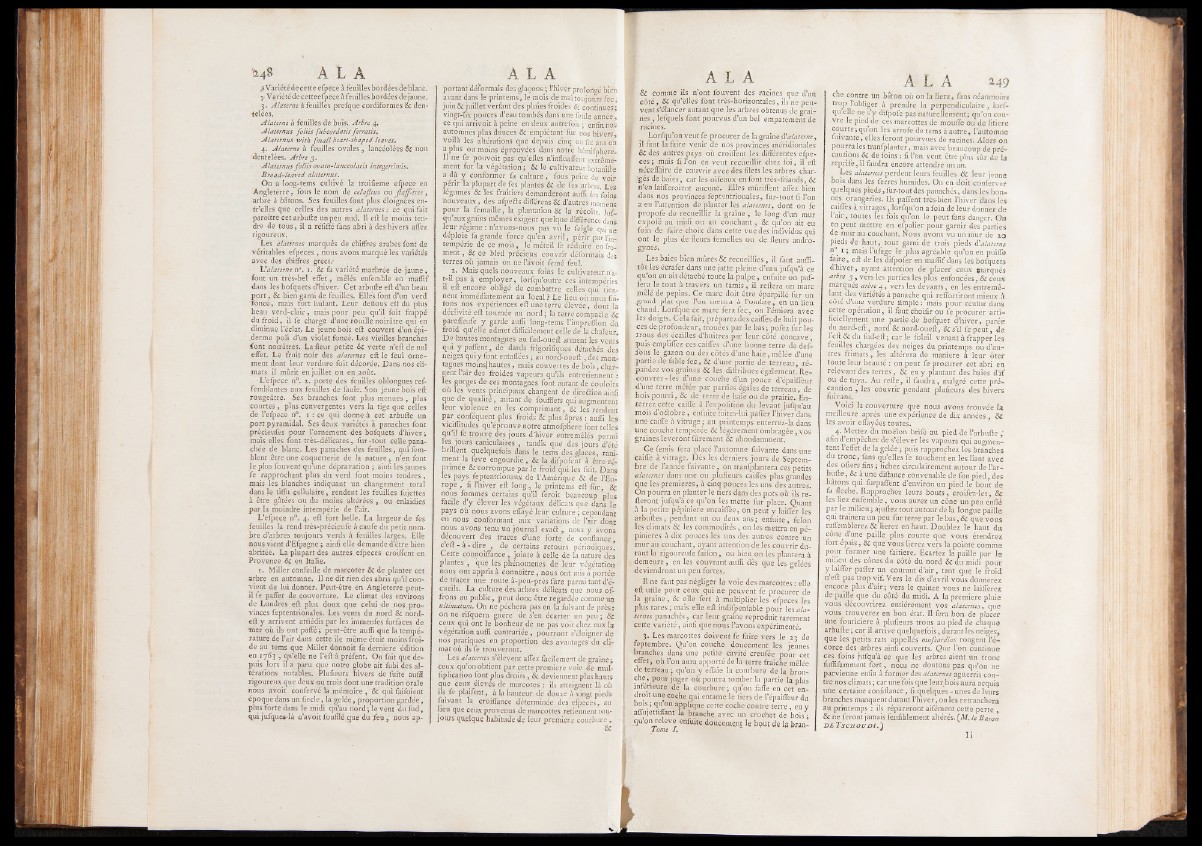
A I A
(8 Variété de cette efpece à feuilles bordées de blanc.'
y Variétédeeetteefpece à feuilles bordées de jaune.
3. Alaterne à feuilles prefque cordiformes & dentelées.
A Interne à feuilles de Arbre 4.
Alattrnus foliis fubcordatis ferratïs.
Alaternus with fniall heart-shaped leaves.
4. Alaterne à feuilles ovales, lancéolées & ïioû
dentelées. Arbre 3.
Alaternus foliis ovato-lanctolatis integerrimis. .
Broàd-leaved alaternus.
On a long-tems cultivé la troifieme efpece en
Angleterre, fous le nom de celaflrus ou jlajf-tree,
arbre à bâtons. Ses feuilles font plus éloignées en-
tr’elles que celles des autres alatemes : ce qui fait
paroître cet arbufte un peu nud. Il eft le moins tendre
de tous, il a réfifté fans abri à des hivers affez
rigoureux.
Lés alaternes marqués de chiffres arabes font de
véritables efpeces , nous avons marqué les variétés
avec des chiffres grecs/
L’alaterne n°„ 1. & fa variété marbrée de* jaune ,
font un très-bel effet, mêlés enfemble en maffif
dans les bofquets d’hiver. Cet arbufte eft d’un beau
p o r t , & bien garni de feuilles. Elles font d’un verd
fon cé, .mais fort luifant. Leur deffous eft du plus
beau verd-clair, mais pour peu qu’il foit frappé
du froid, il fe charge d’une rouille noirâtre qui en
diminue l’éclat. Le jeune bois eft couvert d’un épiderme
poli d’un violet foncé. Les vieilles branches
font noirâtres., La fleur petite &c verte n’eft de nul
effet. Le fruit noir des alaternes eft le feul ornement
dont leur verdure foit décorée. Dans nos climats
il mûrit en juillet ou en .août.
•L’efpece n°. 2. porte des feuilles oblongues ref-
femblantes aux feuilles de faule. Son jeune bois eft
rougeâtre. Ses branches font plus menues , plus
courtes , plus convergentes vers la tige que celles
de l’efpecé n°. 1 : ce qui donne à eet arbufte un
port pyramidal. Ses deux variétés à panaches font
précieufes pour l’ornement des bofqu.ets d’hiver;
mais elles font très-délicates, fur-tout celle panachée
de blanc. Les panaches des feuill.es, qui fem-
blent êtreime coquetterie de la nature, n’en font
le plus fouvent qu’une dépravation ; ain.fi les jaunes
jfe rapprochant plus du verd font moins tendres .,
mais les blanches indiquant un changement total
dans le tiffu cellulaire, rendent-les feuilles fujettes
à être gâtées ou du moins altérées , ou enlaidies'
par la moindre intempérie de l’air.
L’efpece _n°. 4. eft fort belle. La largeur de fes
feuilles la rend très-précieufe à çaufe du petit nombre
d’arbres toujours verds à feuilles larges. Elle
nous vient d’Efpagne ; ainfi elle demande d’être bien
abritée. La plupart des autres efpeces croiffent en
Provence & en Italie.
1. Miller confeille de marcoter & de planter cet
arbre en . automne. Il ne dit rien des abris qu’il convient
de lui donner. Peut-être en Angleterre peut-
il fe paffer de couverture. Le climat des environs
de Londres eft plus doux que celui de nos provinces
feptentrionales. Les vents du nord & nord-
eft y arrivent attiédis, par les immenfes furfaces de
mer où ils ont paffé ; peut-être auffi que la température
de l’air dans cette île même étoit moins froi- j
de au. tems que Miller donnoit fa derniere édition
en 1763 , qu’elle ne l’eft à préfent. On fait que depuis
lors il a paru que notre globe ait fubi des altérations
notables. Plufieurs hivers de fuite auflî
rigoureux que deux ou trois dont une tradition orale
nous avoir confervé la mémoire, & quifaifoîent
époque dans un fiecle, la gelée, proportion gardée,
plus forte dans le midi qu’au nord; le vent dufud,
qui jufques-là n’avoit foufflé que du fe u , nous ap-
A L A
portant déformais des glaçons ; l’hiver prolongé bien
avant dans le printems, le mois de mai toujours fec ;
juin & juillet verfant des pluies froides & continues;
vingt-fix pouces d’eau tombés dans une feule année,
ce qui arrivoit à peine en deux autrefois ; enfin nos ■
automnes plus douces & empiétant fur nos hivers,
voilà les altérations que depuis cinq ou ans on
a plus ou moins éprouvées dans notre hémifphere.
Il ne fe pouvoit pas qu’elles n’influaffent extrêmement
fur la végétation ; & le cultivateur botanifte
a dû y Conformer fa culture, fous peine de voir
périr la plupart de fes plantes & de fes arbres. Les
legum.es & les fruitiers' demanderont aulîi des foins
nouveaux, des afpefts différens & d’autres moméns
pour la femaille, la plantation & la récolte. j u{L
qu’aux grains mêmes exigent quelque différence dans
leur régime : n’avons-no.us pas vu le feigle qui ne
déploie fa grande force qu’en avril, périr par Pin- I
: tempérie de ce mois, le méteil fe réduire en fro-, I
ment, & ce bled précieux couvrir déformais des 1
| terres où jamais on ne l’âvoit femé feul.
2. Mais quels nouveaux foins le cultivateur n’a- r
i t-il pas à employer, lorfqu’outre ces intempéries I
| il eft encore obligé de combattre celles qui tien- I
nent immédiatement au local? Le lieu où nous fai- I
fons nos expériences eft une terre élevée, dont la !
■ déclivité eft tournée au nord; la terre compare &c I
pareffeufe y garde auffi long-tems l’impreffion du I
froid qu’elle admet difficilement celle de la chaleur. I
De hautes montagnes au fud-ouèft arment les vents I
qui y paffertt, de dards frigorifiques détachés des I
neiges qui y font entaffées ; au nord-oueft , des mon- I
tagnes moins]hautes, mais couvertes de bois, char- I
gent l’air des froides vapeurs qu’ils entretiennent : I
les gorges de ces montagnes font autant de couloirs I
où les vents principaux changent de direâion ainfi 1
que de qualité, autant de foufflets qui augmentent
leur violence en les comprimant, & les rendent
par conféqiient plus froids & plus âpres : auffi les
viciffitudes qu’éprouve notre atmofphere font telles
qu il fe trouvé des jours d’hiver entremêlés parmi -
les jours Caniculaires , tandis que des jours d’été Ë
brillent quelquefois dans le tems des glaces, rani- I
ment la feve engourdie , & la .difpofent à .être ré- I
primée & corrompue par îe froid qui les fuit. Dans |
les pays feptentrionaux de l’Amérique & de l’Eu- I
ro p e , fi l’hiver eft long , le printems eft fûr, Si I
nous fournies certains qu’il fero.it beaucoup plus I
facile d’y élever les végétaux délicats que dans le I
pays où nous avons effayé leur culture ; cependant I
en nous conformant aux - variations de l’air dont I
nous avons tenu un journal exaél , nous y avons
découvert des traces d’une forte de confiance,
c eft - à - dire , de certains retours périodiques.
Cette connoiffance , jointe à celle de la nature des
plantes , que les phénomènes de leur végétation
nous ont appris à çonnoître , nous ont mis à porté©
de tracer une route à-peu-près fûre parmi tant d’écueils.
La culture des arbres délicats que nous offrons
au public, peut donc être regardee comme un
ultimatum. On ne péchera pas en la fuivant de près :
on ne rifquera guere de, s’en écarter un peu ; &
ceux qui ont le bonheur de ne pas voir chez eux la
végétation auffi contrariée , pourront s’éloigner de
nos pratiques en proportion des avantages du climat
où ils fe trouveront.
Les alaternes s’elevent affez facilement de graine; I
Ceux qu’on obtient par cette première voie de mul- I
tiplication font plus droits , & deviennent plus hauts I
que ceux élèves de marcotes : ils atteignent là où I
ils f e plaifent, à la hauteur de douze à vingt pieds I
fuivant la croiffance déterminée des efpeces, au |
lieu que ceux provenus de marcottes retiennent tou- |
jours quelque habitude de leur premiers courbure , • a
A L A
Si comme ils n’ont fouvent des racines que d’un
cô té , & qu’elles font très-horizontales, ils ne peuvent
s’élancer autant que les arbres obtenus de graines
, lefq.uels font pourvus d’un bel empâtement de
racines.,
Lorfqu’on veut fe procurer de la graine Üalaterne,
il faut la faire venir de nos provinces méridionales
& des autres pays où croiffent les différentes efpeces
; mais fi, l’on en veut recueillir chez fo i, il eft
néceffaire de couvrir avec des filets les. arbres chargés
de baies, car les oifeaux en font très-friands, &
n’en laifferoient aucune. Elles mûriffent affez bien
dans nos provinces feptentrionales, fur-tout fi l’on
a eu l’attention de planter les alaternes, dont on fe
propofe de recueillir la graine , le long d’un mur
expofé au midi ou au couchant, & qu’on ait eu
foin de faire choix dans cette vue des individus qui
ont le plus de fleurs femelles ou de fleurs andro-
gynes.
Les baies bien mûrês Si recueillies , il faut auffi-
tôt les écrafer dans une jatte pleine d’eau jufqu’à ce
qu’on en ait détaché toute la pulpe, enfuite on paf-
fera le tout à travers un tamis, il reliera un marc
mêlé de pépins. Ce marc doit être éparpillé fur un
grand plat que l’on mettra à l’ombre, en un lieu
chaud. Lorfque ce marc fera fec, on l’émiera avec
les doigts. Cela fait, préparez des caiffes de huit pouces
de profondeur, trouées par le bas; pofez fur lès
trous des écailles,d’huîtres par leur.côté concave,
puis empliffez ces caiffes d’une bonne terre de deffous
le gazon ou des côtés d’une haie, mêlée d’une
partie de fable fe c , & d’une partie de terreau, répandez
vos graines & les diftribuez également. Recouvrez
- les d’une couche d’un pouce d’épaiffeur
d’une terre mêlée par parties égales de terreau, de
bois pourri, & de terre de haie ou de prairie. Enterrez
cette caiffe à l’expofitiôn du levant jufqu’au
mois d’oélobre , enfuite faites-lui paffer l’hiver dans
; une caiffe à vitrage ; au printemps enterrez-la dans
une couche tempérée & légèrement ombragée, vos
graines lèveront fûrement & abondamment.
Ce fenils fera placé l’automne fuivante dans une
caiffe à vitrage. Dès les derniers jours de Septembre
de l’année fuivante, on tranfplantera ces petits
alaternes dans une ou plufieurs caiffes plus grandes
que les pfemieres, à cinq pouces les uns des autres.
On pourra en planter le tiers dans des pots où ils relieront
jufqu’à ce qu’on les mette fur place. Quant
à la petite pépinière encaiffée, on peut y laiffer les
arbuftes, pendant un ou deux ans; enfuite, félon
les climats & les commodités, on les mettra en pépinières
à dix pouces les Uns des autres contre un
mur au couchant, ayant attention de les couvrir durant
la rigoureufe faifon, ou bien on les plantera à ;
demeure, en les couvrant auffi dès que les gelées
deviendront un peu fortes.
Il ne faut pas négliger la voie des marcottes : elle
eft utile pour ceux qui ne peuvent fe procurer de
la graine, & elle fert à multiplier les efpeces les
plus rares ; mais elle eft indifpenfable pour les alaternes
panachés, car leur graine reproduit rarement
cette variété, ainfi que nous l’avons expérimenté.
3. Les marcottes doivent fe fair.e vers le 23 de
feptembre. Qu’on couche doucement les jeunes
branches dans une petite cavité creufée pour cet
effet| où l’on aura apporté de la terre fraîche mêlée •
de terreau ; qu’on y effaie la courbure de la bronche,
pour juger où pourra tomber la partie la plus
inférieure de la courbure ; qu’on faffe en cet endroit
une.coche qui entame le tiers de l’épaiffeur du
bois ; qu on applique cette coche contre terre, en y
affujettiffant la branche avec un crochet de bois ;
qu on releve enfuite doucement le bçrnt de la bran-
> Tome I. 1
A L A 2.49
che Contre un bâton où on la liera, fans néanmoins
trop l’obliger à prendre la perpendiculaire, lorfi*
qu elle ne s’y difpofe pas naturellement; qu’on couvre
le pied de ces marcottes de moufle ou de litiere
.courte; qu on les arrofe de tems à autre, l’aittomne
buvante, elles feront pourvues de racines. Alors on
pourra les tranfplanter, mais avec beaucoup de précautions
& de foins : fi l’on veut être plus sûr de la
reprife, il faudra encore attendre un an.
Les alaternes perdent leurs feuilles & leur jeune
bois dans les ferres humides. On en doit conferver
quelques pieds, fur-tout des panachés, dans les bonnes
orangeries. Ils paffent très-bien l’hiver dans les
caiffes à vitrages, lorfqu’on a foin de leur donner de
l’air, toutes les fois qu’on le peut fans danger. On
en peut mettre en efpalier pour garnir des parties
de mur au couchant. Nous avons vu un mur de 20
pieds de haut, tout garni de trois pieds Üalaterne.
n° 1 ; mais l’ufage le plus agréable qu’on en puiffe
faire, eft de les difpofer en maffif dans les bofquets
dh iver, ayant .attention de placer ceux marqués
arbre 3 , vers les parties les plus enfoncées, & ceux
marqués arbre 4 , vers les devants, en les entremê-
lant;. des variétés à panache qui reffortiront mieux à
côte d’une verdure fimple : mais pour réuffir dans
cette operation, il faut choifir ou fe procurer artificiellement
une partie de bofquet d’hiver, parée
du nord-eft, nord & nord-oueft, & s’il fe p eu t, de
Iflfeft & du fud-eft ; car le foleil venant à frapper les
feuilles chargées des neiges du printemps ou d’au-
| très frimats, les altérera de maniéré à leur ôtèf
toute leur beauté : on peut fe procurer cet abri en
relevant des terrés, & en y plantant des haies d’i f
ou de tuya. Au relie, il faudra, malgré cette précaution
, les couvrir pendant plufieurs des hivers
fuivans.
Voici la côuvérture que nous avons trouvée la
meilleure après une expérience de dix années , Si
les avoir effâyées toutes.
4. Mettèz du moëlon brifé ait pied de l*arbufte
afin d’empêcher de s’élever les vapeurs qui augmen®
tent l’effet de la gelée ; puis rapprochez les branches
du tronc, fans qu’elles fe touchent en les liant avec
des ofiers fins ; fichez circulairement autour de far -
biifte, & à une diftance convenable de fon pied, des
bâtons qui furpaffent d’environ un pied le bout de
fa fléché. Rapprochez leurs bouts, croifez-Ies, Si
les liez enfemble, vous aurez un cône un peu enflé
par le milieu ; ajuftez tout autour de la longue paille
qui traînera un peu fur terre par le bas, & que vous
raffemblerez & lierez en haut. Doublez le haut du
cône d’une paille plus courte que vous étendrez
fort épais, & que vous lierez vers la pointe comme
pour former une faîtiere. Ecartez la paille par le
milieu des cônes du côté du nord & du midi pour
y laiffer paffer un courant d’a ir , tant que le froid
n’eft pas trop vif. V ers le dix d’avril vous donnerez
encore plus d’air; vers le quinze vous ne laiflerez
de paille que du côté du midi. A la première pluie
vous découvrirez entièrement vos alaternes, que
vous trouverez en bon état. Il fera bon-de placer
une fouriciere à plufieurs trous au pied de chaque
arbufte ; car il arrive quelquefois, durant les neiges,
que les petits rats appellés mufcardins rongent l’écorce
des arbres ainfi couverts. Que l’on continue
ces foins jufqu’à ce que les arbres aient un tronc
fuffifamment fo r t , nous ne doutons pas qu’on ne
parvienne enfin à former des alaternes aguerris contre
nos climats ; car une fois que leur bois aura acquis
une certaine confiftance, fi quelques - unes de leurs
branches manquent durant l’hiver, on les retranchera
au printemps : ils répareront aifément cette perte ,
& ne feront jamais fenfiblement altérés. (M, U Baron
DE Ts CHOVDI.')
I i