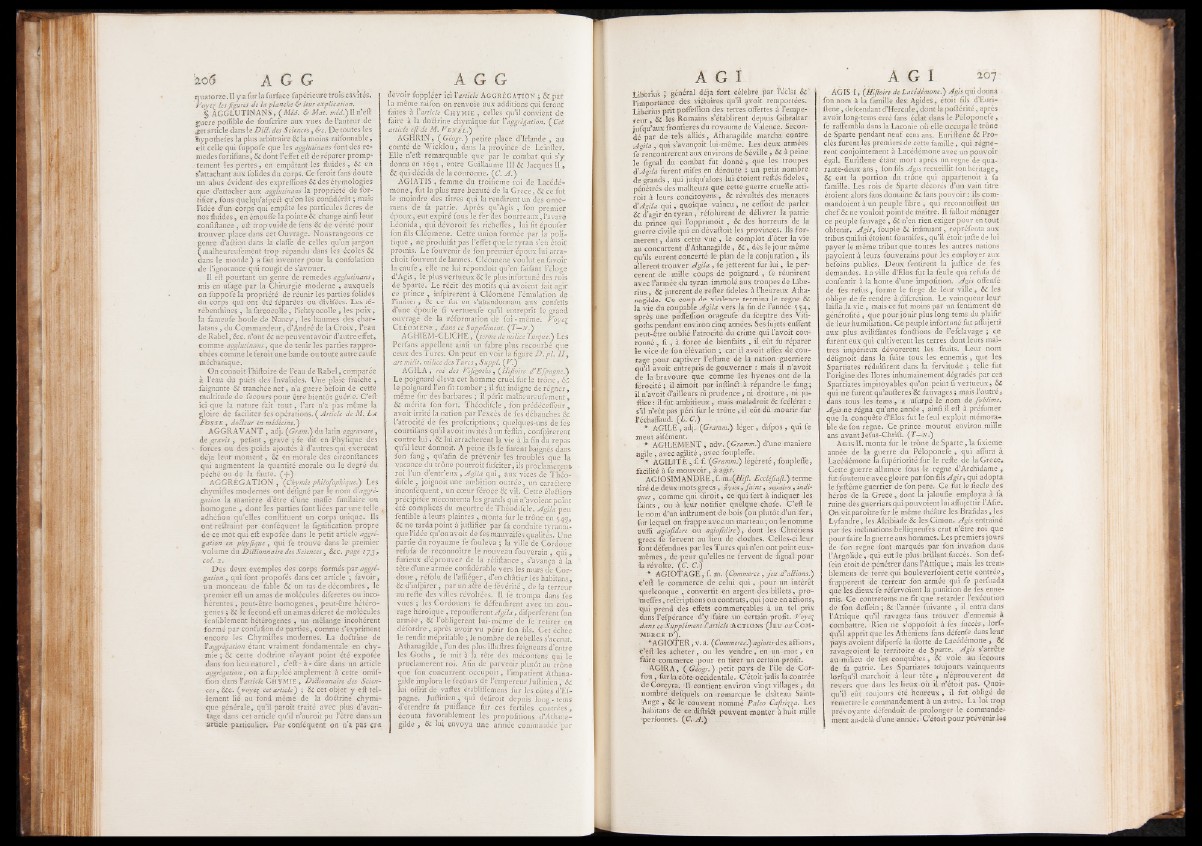
io(5 A G G
quatorze. Il y a fur la furface fupérieure trois cavités.
Voyer les figures de la planche & leur explication.
§ AGGLÜTINANS, (Méd. & Mae. méd) Il n’eft
guere poflible de foufcrire aux vues de l’auteur de
ijet article dans le Dicl. des Sciences, &c. De toutes les
ftypothefes la plus arbitraire & la moins raifonnable,
eft celle qui fuppofe que les agglutinons font des re-
medesfortifiaris, &dont l’effet eft de réparer promp-
• tement les pertes, en empâtant les fluides , & en
s’attachant aux folides du corps. Ce feroit fans doute
un abus évident des exprefîions & des étymologies
que d’attacher aux agglutinons la propriété de fortifier
, fous quelqu’afpeft qu’on les confidérât ; mais
l’idée d’un corps qui empâte les particules âcres de
nos fluides, en émouffe la pointe & change ainfi leur
coniiftance , eft trop vuide de fens & de vérité pour
trouver place dans cet Ouvrage. Nousrangeons ce
genre d’adtion dans la claffe de c,elles qu’un jargon
( malheureufement trop répandu dans les écoles &
dans le monde ) a fait inventer pour la confolation
de l’ignorance qui rougit de s’avouer.
Il eft pourtant un genre de remedes agglutinons,
mis en ufage par la Chirurgie moderne , auxquels
on fuppofe la propriété de réunir les parties folides
du corps qui ont été féparées ou divifées. Les térébenthines
, la farcocolle, Pichtyocolle , les p oix,
la fameufe boule dé Nancy, les baumes des charlatans
, du Commandeur, d’André de la Croix, l’eau
de Rabel, &c. n’ont Sc ne peuventavoir d’autre effet,
comme agglutinons, que de tenir les parties rapprochées
comme le feroit une bande ou toute autre caufe
méchanique.
On connoît l’hiftoire de l’eau de Rabel, comparée
à l’eau du puits des Invalides. Une plaie fraîche , 1
faignante & tranchée n e t , n’a guere béfoin de cette
multitude de fecours pour être bientôt guérie. C ’eft
ici que la nature fait to u t , l’art n’a pas même la
gloire de faciliter fes opérations. ( Article de M. L a
F o s se , docteur en médecine.')
AG GRAVAN T , adj. (Gram?) du latin aggravarè,
de .gravis , pefant, grave ; fe dit en Phyfique dés
*• forces ou des poids ajoutés à d’autres qui exercent
déjà leur moment, & en, morale des circonftances
qui augmentent la quantité morale ou le degré du
péché ou de la faute. (+ )
AGGRÈGATION , (iChymie philofophique) Les
chymiftes modernes ont défigné par le nom d’aggré-
gation la maniéré d’être d’une maffe fimilaire où
homogène , dont les parties font liées par i\ne telle
adhéfion qu’elles conftitUént un corps unique. Ils
ont reftraint par conféquent la lignification propre
de ce mot qui eft ëxpofée dans le petit article aggrè-
gatïon en phyfique , qui fe trouve dans le premier
volume du Dictionnaire des Sciences, &c. page iyg ,
col. Z.-
Des deux exemples des corps formés par aggré-
gation, qui font propofés dans cet article ; favoir,
un monceau de fable & un tas de décombres, le
premier eft un amas de molécules difcretes ou incohérentes
, peut-être homogènes , peut-être hétérogènes
; & le fécond eft un amas difcret de molécules
fenfiblement hétérogènes , un mélange incohérent
•formé par confufion de parties, comme s’expriment
encore les Chymiftes modernes. La doctrine de
Y aggrègation étant vraiment fondamentale en chymie
; & cette doctrine n’ayant point été expofee
dans fon lieu naturel, c’eft - à - dire dans un article
aggrègation, on a fuppléé amplement à cette omif-
fion dans \article C hymie , Dictionnaire des Scien-
■ ces, &c. (voyez cei article) ; & cet objet y eft tellement
lié au fond même de la doctrine chymi-
que générale, qu’il paroît traité avec plus d’avantage
dans cet article qu’il n’auroit pu l’être dans un
article particulier. Par conféquent on n’a pas cru
A G G
devoir fuppîéer ici l'article Aggrègation ; & par
la même raifon on renvoie aux additions qui feront
faites à l’article Chymie , celles qu’il convient de
faire à la doctrine chymique fur l’aggrègation. ( Cet
article eft de M> V ejcel.)
AGHRIN j ( Géogr. ) petite place d’Irlande , au
comté de Wicklou, dans la province de Leinfter.
Elle n’ eft remarquable que par le combat qui s’y
donna en 1691 , entre Guillaume III & Jacques II ,
& qui décida de la couronne. (C. A )
AGIATIS , femme du troifieme roi de Lacédémone
, fut la plus rare beauté de la G rece, & ce fut
le moindre des titres qui la rendirent un des orne-
mens de fa patrie. Après qu’Agis , fon premier
époux, eut expiré fous le fer des bourreaux, l’avare
Léonida, qui dévoroit fes richeffes , lui fît époufer
fon fils Cléomene. Cette union formée par la politique
, ne produifit pas l’effet que le tyran s’en étoit
promis. Le fouvenir de fon premier époux lui arra-
choit fouvent de larmes. Cléomene voulut en favoir
la caufe , elle ne lui répondoit qu’en faifant l’éloge
d’Agis, le plus vertueux & le plus infortuné des rois
de Sparte. Le récit des motifs qui avoient fait agir
ce prince , infpirerent à Cléomene l’émulation de
l’imiter, & ce fut en, s’abandonnant aux „cônfeils
d’une époufe fi vertueufe qu’il entreprit le grand
ouvrage d e là réformation dé foi-même. Voyez
Cléomene , dans ce Supplément. (T—N.)
AGHIEM-CLICHE, (terme de milice Turque.) Les
Perfans appellent ainfi un fabre plus recourbé que
ceux des Turcs. On peut en voir la figure D .p l. 119
art milït. milice: des Turcs, Suppl. ( V.)
AG ILA , roi des Vifigoths, (Hifioire d'Efpagne.)
Le poignard éleva cet homme cruel fur le trône, Sc.
le poignard l’en fit tomber ; il fut indigne de régner,
même fur des barbares ; il périt malheureufement,
& mérita fon fort. Théodifcle , fon prédéceffeür ,
avoit irrité la nation par l’excès de fes débauches &
l’atrocité' de fes proferiptions; quelques-uns de fes
courtifans qu’il avoit invités à un feftin, confpirerent
contre lu i, & lui arrachèrent la vie à la fin du repas
qu’il leur donnoit. A peine ils fe furent baignés dans
fon fang, qu’afin de prévenir les troubles que la
•vacance du trône pourroit fufeiter, ils proclamèrent»
roi l’un d’entr’eux , Agild qui, aux vices de Théodifcle
, joignoit une ambition outrée, un cara&ere
inconféquent, un coeur féroce & vil. Cetté élection-
précipitée mécontenta les grands qui n’avoient point
été complices du meurtre de Théodifcle. Agila peu
fenfible à leurs plaintes , monta fur le trône en 549,
& ne tarda point à juftifier par fà conduite tyrannique
l’idée qu’on avoit de fes mauvaifes qualités. Une
partie du royaume fe fouleva ; la ville de Cordoue
refufa de recônnoître le nouveau fouverain , qui,
furieux d’éprouver de la réfiftance, s’avança à la
tête d’une armée confidérable vers les murs de Cordoue
, réfolu de l’affiéger, d’en châtier les habitans,
& d’infpirer, par un a de de févérité , de la terreur
au refte des villes révoltées. Il fe trompa dans fes
vues ; les Cordouans fe défendirent avec un courage
héroïque, repoufferent-^gïAz , difperferentfon
armée , & l’obligerent lui-même de fe retirer en
défordre, après avoir vu périr fon fils. Cet échec
le rendit méprifable ; le nombre de rebelles s’accrut.
Athanagilde, l’un des plus illuftres fçigneurs d’entre
les Goths , fe mit à la tête des mécontens qui le
proclamèrent roi. Afin de parvenir plutôt au trône
que fon concurrent occupoit, l’impatient Âthana-
gilde implora le fecours de l’empereur Juftinien ,'ôc
lui offrit de vaftes établiffemens fur les côtes d’Ef-
pagne. Juftinien, qui defiroit depuis long-tems
d’étendre fa puiffance fur ces fertiles contrées,
écouta favorablement les propofitions d’Athana-
gilde , 5c lui envoya une armée commandée par
A G I
tiiberiu’s | général déjà fort célébré par î’éclàt & "
l ’importance des vi&oires qu’il avoit remportées.
Liberius prit poffefiîon des terres offertes à l’empereur
& les Romains s’établirent depuis Gibraltar
jufqu’aux frontières du royaume de Valence. Secondé
par de tels alliés, Athanagilde marcha contre
A ° ila , qui s’avançait lui-même. Les deux armees
fe rencontrèrent aux environs de Séville , &c à peine
le fignal du combat fut donné, que les troupes
à?Agila furent niifes en déroute : uii petit nombre
de grands , qui jufqu’alors lui étoient reftésfideles,
pénétrés des malheurs que cette guerre cruelle atti-
roit à leurs concitoyens^ & révoltés des menaces
à?Agila q u i, quoique vaincu, ne ceflbit de parler
& d’agir én tyran , réfolurent de délivrer la patrie
du prince qui Topprimoit , & des horreurs de la
guerre civile qui en dévaftoit les provinces. Ils formèrent
j dans cette vue , le complot d’ôter la vie
au concurrent d’Athanagilde, & , dès le jour même
qu’ils eurent concerté le plan de la conjuration , iis
allèrent trouver Agila , fe jetteront fur lu i, le percèrent
de mille coups de poignard , fe réunirent
avec l’armée du tyran immolé aux troupes de Liberius
, & jurèrent de relier fideles à l’héureux Athanagilde.
Ce coup de violence termina le régné &
la vie du coupable Agild vers la fin de l’année 5 54,
après une poffeftion orageufe du feeptre des Vifigoths
pendant environ cinq années. Sesfujets euffent
peut-être oublié l’atrocité, du crime qui l’a voit couronné
, fi , à force de bienfaits , il eût fu réparer
le vice de fon élévation ; car il avoit a fiez de courage
pour captiver l’eftime de la nation'guerriere
qu’il avoit entrepris de gouverner : mais il n’avoit
dé la bravoure que comme les hyenes ont de la
férocité ; il aimoit par inftin& à répandre le fang;
il n’avoit d’aillêurs ni prudence , ni droiture, ni ju-
ftice : il fut ambitieux , mais maladroit & fcélérat :
s’il n’eut pas péri fur le trône, i l eût dû mourir fur
l’échaffaud. :(£. C.)
* AG ILE, adj. (Gratnm.) lég e r , difpôs j qui fe
meut aifément. .
* AGILEMENT , zdv. (Gramm.) d’une maniéré
agile , avec agilité ,.avecfoupleffe.
* AGILITÉ f. f. (GrammS) légéreté, foupleffe,
facilité à fe mouvoir, .à agir.
AGIOSIMANDRE,f, m.(Hifi. Ecclèfiafi.) terme
tiré de deux motsgrecs , ayite^ /aint, mt/Mtivcà, indiquer,
-comme qui diroit, ce qui fert à indiquer les
faints, ou à leur notifier quelque chofe. -G’eft le
le nom d’utt inftrument de;bois (ou plutôt d’un fer ,
fur lequel on frappe^avec un marteau ; on le nomme
aufli agidfidere bu agiofidire) , dont les Ghrétiens
grecs fe fervent au lieu de cloches. Celles-ci leur
font défendues par les Turcs qiii n’en ont point eux*
mêmes, de peur qu’elles ne fervent de fignal pour
la révolte. (G. C.)
* A G IO TAG E , f. m. (Commerce , jeu d'allions?)
C’eff le commerce de celui q u i, pour un intérêt
quelconque , convertit en argent, des billets, pro-
%neffes, referiptions ou contrats, qui joue en aûions,
qui prend des effets commerçables à un tel'prix
dansTèfpérance -d’y faire un certain profit. Voyez
dans ce Süppltm tnt IIarticle A CT IO NS ( J EU o/tCoM -
■ MERCED’).
* AGIOTER, V. â. (Commerce) agioter des, avions
C’èft les acheter, ou les vendre, en un m o t , en
faire commerce pour en tirer un certain profit.
AGIRA, ( Géogr. ) petit pays ; de l’île de ■ Cor-*
fou , ‘fur la côte'occidentàle. C’étoit jadis la contrée
de Corçyra. Il contient environ vingt villages , du
nombre defquèls on remarque le château Saint-
Ange , & le couvent nommé Paleo Cafirizgu. Les
•hàbkans de ce diftrift peuvent monter à huit mille
-perfonnes. (C. A )
A G I 207
AGIS î , (Hifioire de Lacédémone) Agis qui donna
fon nom à la famille des AgideS, étoit fils d’Euri-
ftene, defeendant d’Hercule ,dont la poftérité, après
avoir long-tems erré fans éclat dans le Péloponefe,
fe raffemblà dans la Laconie ou elle occupa le trône
de Sparte pendant neuf cens ans. Euriftene & Pro-
clès furent les premiers de cette famille, qui régnèrent
conjointement à Lacédémone avec un pouvoir
égal. Euriftene étant mort après un régné de quarante
deux ans , fon fils Agis recueillit fon héritage,
& eut la portion du trône qui àppartenoit à fa
famille. Les rois de Sparte décorés d’un yain titre
étoient alors fans domaine & fans pouvoir : ils eom-
martdoient à un peuple libre , qui reconnoiffoit un
chef & ne vouloit point de maître. Il falloit ménager
ce peuple fauvàge, .& n’en rien exiger pour en tout
obtenir. Agis, fouple & infinuant, repréfenta aux
tribus qiiidui étoient foumifes j qu’il étoit j.ufte de lui
payer le même tribut que toutes les autres nations
payoient à leurs fouverains pour les employer aux
befoins publies. Deux fentirent la juftice de fes
demandes. La ville d’Elos fut la feule qui refufa dé
confentir à la honte d’une impofition. Agis, offenfé
de fes refus, forme le fiegë de iéur v ille , & les
oblige de fe rendre à diferétion. Le vainqueur leur
laiffa .la .vie , mais ce fut moins par un fentiment de
générofité , que pour jôuir plus long-tems du plaifif
de leur humiliation. Ce peuple infortuné fut affujettî
aux plus aviliffantes fondions de l’efclavage ; ce
furent eux qui cultivèrent les terres dont leurs maîtres
impérieux dévorèrent les fruits. Leur nom
défignoit dans la fuite tous les ennemis , que les
Spartiates réduifirent dans la feryitüde ; telle fut
l’origine des Ilotes inhumainement dégradés par ces
Spartiates impitoyables qu’on peint.fi vertueux, &C
qui ne furent qu’aufteres & fauvages ; mais l’outré^
dans tous les tems 9 a .ufurpé le nom de fublime.
Agis.ne régna qu’une année , ainfi .il eft à préfumer
que la conquête d’Elos fut lefeul exploit mémorable
de fon régné. Ce .prince mourut environ mille
ans avant Jefiis-Chrift. (T—n )
Agis II. monta fur le trône de Sparte, la fixieme
année de la guerre du Péloponefe j qui affura à
Lacédémone la fiipérioritéiur le refte de laGrece^
Cette guerre allumée fous le régné d’Archidame ÿ
fut ifputenüe .avec gloire par fon fils Agis # qui adopta
le fyftême-guerrier de fon pere. .Ce fiit le fiecle des
héros de là Gre ce, dont la jaloufie employa à fà
I ruine des guerriers qui pouvoient lui affujettir l’Afie.
On vitparoître fur le même théâtre les Brafidas, les
Lyfandre, les.Alcibiade & les Cirnon. Agis entraîné
par fes inclinations belliqueufes crut n’être.roi que
pour faire la guerre aux hammes.:Les premiers jours
• de fon régné font marqués .par fon .invafion dans
l’Argolide , -qni eût le .plus^ brillant.fuccès. Son def-
feiii étoit de pénétrer dans l’Attique ; mais les trem*
blemens de terre qui bouleverfoient cette contrée,
frappèrent de terreur .fon armée qui fe perfuada
que les dieux fe réfervoient la punition de les ennemis.
Ce contretems ne fit que retarder l’exécution
de-fon deffein ; & d’année fuivante , il..entra dans
l’Attique qu’il ravagea fans trouver d’ennemis a
combattre. Rien ne s’oppôfoit à fes fuccès, lor£*
qu’il apprit que les Athéniens fans défenfe dans leur
pays avoient difperfé la.flotte de Lacedemone , St
ravageoient le territoire de Sparte. Agis s’arrête
âu milieu de fes conquêtes, & vole au fecours
de fa patrie. Les Spartiates toujours vainqueurs
lorfqu’il marchoit à leur tête * n’éprouvèrent de
reyers que dans les lieux où il n’étoit pas. Quoiqu’il
eût toujours été heureux, il fut obligé de
remettre le commandement à un autre. La loi trop
prévoyante défendoit de prolonger le commandement
au-delà d’une -année; -C’étoit pour prévenir les