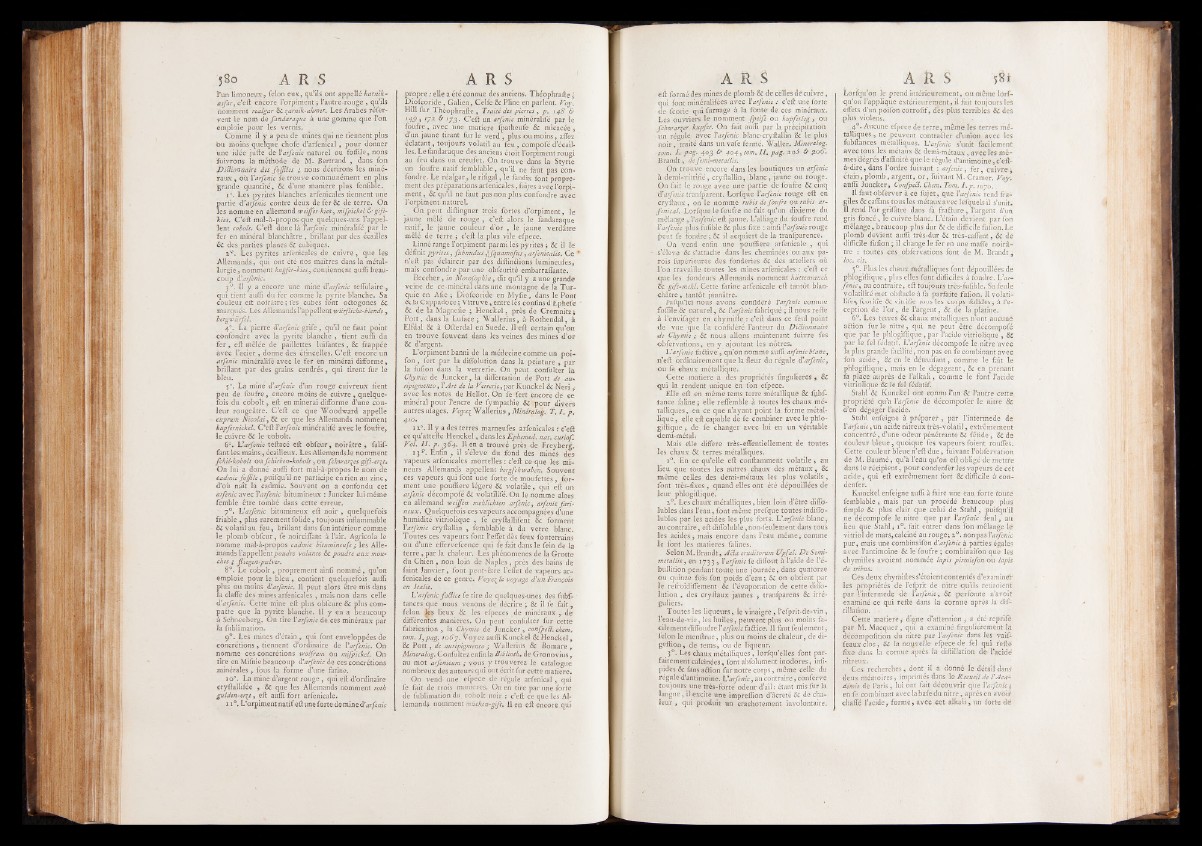
l’un limoneux-, félon eux, qu’ils ont appellek-arnik-
asfar, c’eft encore l’orpiment ; l’autre.rouge , qu’ils
nomment realgar & £arnîk-ahmer. Les Arabes réfervent
le nom de fandaraque à une gomme que l’on
emploie pour les vernis.
Comme il y a peu de mines qui ne tiennent plus
Ou moins quelque cliofe d’arfenical, pour donner
une idée jufte de 1’arfenic naturel ou foffile, nous
'fuivrons la méthode de M. Bertrand , dans fon
Dictionnaire des fojfiles ; nous décrirons les minéraux
, où Yàrfenic fe. trouve communément en plus
'grande quantité, & d’une maniéré plus fenfible;
i°. Les pyrites blanches arfenicales tiennent une
partie d'arfenic contre deux de fer & de terre. Oh
les nomme en allemand weiffer-kïes, m.ifpickel & gift-
kies. C’eft mal-à-propos que quelques-uns l’appellent
cobolt. C’eft donc là l’arfenic minéralifé par le
fer en minéral blanchâtre , brillant par des écailles
& des parties planes & cubiques.
Les pyrites arfenicales de cuivre, que les
Allemands, qui ont été nos maîtres dans la métallurgie,
nomment kugfer-kies, contiennent auffi beaucoup
$ arfenic*
3°. II y a encore une mine $ arfenic teffulaire-,
qui tient auffi du fer comme la pyrite blanche. Sa
couleur eft noirâtre ; fes cubes font oôogones &
marqués. Les Allemands l’appellent würfliche-blende,
bergwürfel.
4°. La pierre d’arfenic grife , qu’il ne faut point
confondre avec la pyrite blanche , tient auffi du
fer , eft mêlée de paillettes luifantes, & frappée
avec l’acier , donne des étincelles. C’eft encore un
arfenic minéralifé avec le fer en minérai difforme,
brillant par des grains cendrés, qui tirent fur le
bleu.
5°. La mine d’'arfenic d’un rouge' cuivreux tient
peu de fouffe, encore moins de cuivre, quelquefois
du cobolt, eft en minerai difforme d’une couleur
rougeâtre. C ’eft ce que Woodward appelle
tuprum Nicolai,~8c ce que les Allemands nomment
kupfcrnickel: C’eft Y arfenic minéralifé avec le foufre,
le cuivre & le cobolt;
6°. Varfenic teftacé eft obfcur, noirâtre , falif-
fant les mains, écailleux. Les Allemands le nomment
fchil-kobolt ou fchirben-kùbolt, ou fchwaiyes gift-erçt*
On lui a donné auffi fort màl-à-propos le nom de
cadmie foflile, puifqu’il ne participe en rien au zinc,
d’où naît la cadmie. Souvent on a confondu cet
arfenic avec Y arfenic bitumineux : Juncker lui même
femble être tombé dans cette erreur.
' 70. Varfenic bitumineux eft noir , quelquefois
friable , plus rarement foliae, toujours inflammable
& volatil au feu, brillant dans fon intérieur comme
le plomb obfcur, fe noirciffant à l’air. Agricola le
nomme mal-à-propos cadmie bitumineufe ; les Allemands
l’appellent poudre volante & poudre aux mouches
; fliegen-pulver.
8°. Le cobolt, proprement ainfi nommé, qu’on
emploie pour le bleu, contient quelquefois auffi
plus ou moins $arfenic. Il peut alors être mis dans
la claffe des mines arfenicales , mais non dans celle
d’arfenic. Cette mine eft plus obfcure & plus compacte
que la pyrite blanche. 11 y en a beaucoup
à Schneeberg. On tire Y arfenic de ces minéraux par
la fublimation.
9°. Les mines d’étain , qui font enveloppées de
concrétions, tiennent d’ordinaire de Y arfenic. On
nomme ces concrétions wolfram ou mifpickel. On
tire en Mifnie beaucoup d’arfenic de ces concrétions
minérales, fous la forme d’une farine.
io°. La mine d’argent rouge, qui eft d’ordinaire
cryftallifée , & que les Allemands nomment roth
gulden-erçt, eft auffi fort arfenicale.
11°. L’orpiment natif eft une forte déminé d'arfenic
propre : elle a été connue des anciens. Théophrafte |
Diofcoride , Galien, Celfe & Pline en parlent. Voy.
Hill fur Théophrafte, Traité des pierres , p. 148 &
‘43 9 ‘72- & ‘73 • C ’eft un arfenic minéralifé par le
foufre, avec une matière fpatheufe & micacée,
d’un jaune tirant fur le verd , plus .ou moins, affez
éclatant, toujours volatil au fe u , compofé d’écailles.
Le fandaraque des anciens étoit l’orpiment rougi
au feu dans un creufet. On trouve dans la Styrie
un foufre natif femblable, qu’il ne faut pas confondre.
Le réalgar, le rifigal, le fandix font proprement
des préparations arienicales, faites avec l’orpiment
, & qu’il ne faut pas non plus confondre avec
l’orpiment, naturel.
On peut diftinguer trois fortes d’orpiment, le
jaune mêlé de rouge, c’eft alors le fandaraque
natif, le jaune couleur d’or , le jaune verdâtre
mêle de terre ; c’eft la plus vile efpeee.
Linné range l’orpiment parmi les pyrites ; & il le
définit pyrites, fubnudus ,\fquamofus,.arfenicalis. Ce '
n’eft pas éclaircir par des diftin&ions lumineufes,
mais confondre par une obfcurité embarraffante.
Beccher, in Morofophia, dit qu’il y ,à une grande
veine de ce-minéral dans unè montagne de la Turquie
en Afie ; Diofcoride en Myfie, dans le Pont
& la Cappadoce ; V itruve, entre les confins d’Ephefé
& de la Magnefie ; Henckel, près de Cremnitz;
Pott, dans la Luface ; Wallerius, à Rothendàl, à
Elfdal & à Ofterdal en Suede. Il eft certain qu’on
en trouve fouvent dans les veines des mines d’or
. & d’argent.
L’orpiment banni de la médecine comme un poi-
fon , fert par la diffolution dans la peinture , par
la fufion dans la verrerie. Ôn peut confulter la
Chyfnie de Juncker, la differtation de'Pott de au-
ripigmento, Y Art de la Verrerie, par Kunckel & Neri ,
avec les notes de Hellot. Ôn fe fert encore de ce
minéral pour l’encre de fympathie & pour divers
autres ufages. Voye^ Wallerius, Minémlo'g. T . I .p .
4/©.
1 z°. Il y a des terres marneufes arfenicales i e’eft
ce qu’attefte Henckel, dans les Ephemed. nat, curiof.
Vol. II. p. 364. Il en a trouvé près de Freyberg.
„ 13p- Enfin , il s’élève du fond des mines des
vapeurs arfenicales mortelles : c’eft ce que les mineurs
Allemands appellent bergfchwaben. Souvent
ces vapeurs qui font une forte de moufettes, forment
une pouffiere légère & volatile, qui eft un
arfenic décompofé & volàtilifé. On le nomme alors,
en allemand weijfen mehlichten arfenic, arfenic farineux.
Quelquefois ces vapeurs accompagnées d’une
humidité vitriolique , fe cryftallifent & forment
Y arfenic cryftallin , femblable à du verre blanc.
Toutes ces vapeurs font l’effet des feux fouterrains
ou d’une effervefeence qui fe fait dans le fèin de la
terre, par la chaleur. Les phénomènes de la Grotte
du Chien, non loin de Naples, près des bains de
faint Janvier, font peut-être l’effet de vapeurs arfenicales
de ce genre. Voye£ le voyage dun François
en Italie. -
L’arfenic factice fe tire de quelques-unes des fubt
tances que nous venons de décrire ; & il fe fait,
félon les lieux & les efpeces .de minéraux , de'
différentes maniérés. On peut confulter fur cette
fabrication , la Chymie de Juncker , confpect. chcm*
tom. l,pag. 10 (S'y. Voyez auffi Kunckel & Henckel,
& P o tt, de auripigmento ; Wallerius & Bomare ,■
Mineralog. Confultez enfin la Biblioth. de Gronovius,
au mot arfenicum ; vous y trouverez le catalogue
nombreux des auteurs qui ont écrit fur cette matière.
On vend une efpeee de régule arfenical, qui
fe fait de trois maniérés. On en tire par une forte
de fublimation du, cobolt noir : c’eft ce que les Allemands
noniment miicken-gift. 11 en eft encore qui
eft formé des mines de plomb & de celles de cuivre,
qui font minéralifées avec Y arfenic : C’eft une forte
de feorie qui fumage à la fonte’ de ces minéraux.
Les ouvriers le nomment fpeife ou kupferleg, ou
fehwar^er, kupfer. On fait auffi par la précipitation
un régule avec Y arfenic blanc-cryftallin & le plus
noir, traité dans unvafe fermé. Waller. Mineralog.
tom. I. pug, 403 & 404, tom. II. pag. xoS & £06'.
Brandt | defemi-metallisi
On trouve encore dans les boutiques un arfenic
à demi-vitrifié, cryftallin, blanc, jaune ou rouge.
On fait le rouge avec une partie de fouffe & cinq
d'arfenic tranfparent. Lorfque Y arfenic rouge eft en
cryftaux , on le nomme rubis de foufre ou rubis arfenical.
Lorfque le foufre hé fait qu’un dixième du
mélange , Yàrfenic eft jaune. L’alliage .du foufre rend
Yarfenic plus fufible & plus fixe : ainfi Y arfenic rouge
peut fe fondre ; & il acquiert de la tranfparence.
On vend enfin une pouffiere arfenicale , qui
•s’élève & s’attache dans les cheminées ou aux parois
fupérieufes des. fonderies & des atteliers où
l ’on travaille toutes les mines arfenicales : c’eft ce
que les fondeurs Allemands nomment h'ùttenrauch
8c gift-mehl. Cette farine arfenicale eft tantôt blanchâtre
, tantôt jaunâtre.
Jufqu’ici nous avons confidéré Yàrfenic comme
foffile &C naturel, & Yàrfenic fabriqué ; il nous reft'e
à l’envifâger en ch y mille : c’eft dans ce feul point
de vue que l’a confidéré l’auteur du Dictionnaire
de Chytnie ; & nous allons maintenant fuivre fes
©bfervations, en y ajoutant les nôtres.
U arfenic faôive , qu’on nomme auffi arfenic blanc,
n’eft Ordinairement que la fleur du régule $ arfenic,
©u fa chaux métallique;
Cette matière a des propriétés fingulieres ,. &
qui la rendent unique en fon efpeee.
Elle eft en même tems terre métallique & ftjbf-
tance faline ; elle reffemble à toutes les chaux métalliques,
en ce que n’ayant point la forme métallique
, elle eft capable de fe combiner avec le phlo-
giftique $ de fe changer avec lui en un véritable
demi-métal;
Mais elle différé très-effentiellement de toutes
les chaux & terres métalliques.
1 °; En ce qu’elle eft conftamment volatile j au
lieu que toutes les autres chaux des métaux, &
même cellès des demi-métaux les plus volatils,
font très-fixes, quand elles ont été dépouillées de
leur phlogiftique.
20. Les chaux métalliques, bien loin d’être diffo-
lublesdans l’eau, font même prefque toutes indiffo-
lubles par les acides les plus forts. arfenic blanc ,-
au contraire, eft diffoluble, non-feulement dans tous
les acides j mais encore dans l’eau même,- comme
le font les matières falines;
Selon M. Brândt, Acta eruditorum Upfal. DeSenti-
metallis, en 1733 , Yàrfenic fe diffout à l’aide de l’ébullition
pendant toute line journée j dans quatorze
Ou quinze fois fon poids d’eau ; & On obtient par
le refroidiffement & l’évaporation de cette diffolution
, des cryftaux jaunes , tranfparens & irréguliers;
Toutes les liqueurs, le vinaigre , l’efprit-de-vin ,
l’eau-de-vie, les huiles, peuvent plus ou moins, facilement
diffoudre Yàrfenic faûice. Il faut feulement j
félon le menftrue, plus ou moins de chaleur, de di-
geftion, de tems, ou de liqueur.-
3°- Les chaux métalliques , lorfqu’elles font parfaitement
calcinées, font abfolument inodores, infi-
pides & fans aftion fur notfe corps, même celle du
légale d’antimoine. L’arfenic, au contraire, conferve
toujours une très-forte odeur d’ail: étant mis fur la
langue, il excite une impreffion d’âcreté & de chaleur
, qui produit un crachotement involontaire.
Lorfqu’on le prend intérieurement, ou même lorf-
qu’on l’applique extérieurement, il fait toujours les
effets d’un poifon corrofif, dès plus terribles & des
plus violenS. .
40. Aucune efpeee de terre, même les terres métalliques
, ne peuvent contracter d’union avec les
fubftances métalliques. L'arfenic s’unit facilement
avec tous^ les métaux & demi-métaux, avec les mêmes
'dégrés d’affinité que le régule d’antimoine, c’eft-
à-dire,dans l’ordre fuivant : arfenic, fer, cuivre j
étain, plomb, argent, or, fuivant M. Cramer. Voy.
auffi Juncker, Confpect. Chem. Tom. l.p . ioyo.
11 faut obferver à ce fujet, que Yàrfenic rend fragiles
& caffans tous les métaux avec lefquels il s’unit.
Il rend l’or grifâtre dans fa frafture, l’argent d’uii
gris foncé, Te cuivre blanc. L’étain devient par fon
mélange, beaucoup plus dur & de difficile fufion. Le
plomb devient auffi très-dur & très-caffant, & dé
difficile fufion ; il change le fer en une maffe noirâtre
: toutes ces obfervations font de M. Brandt^
'toc. dt.
50. Plus les chaux métalliques font dépouillées de
phlogiftique, plus elles font difficiles à fondre. Varfenic
, au contraire, eft toujours très-fufible. Sa feule
volatilité met obftacle à fa parfaite fufion. Il volati-
life^ feorifié & vitrifié tous les corps folides, à l’e-
eeption de l’o r, de l’argent, & de la platine.
6°. Les terres & chaux métalliques, n’ont auctmé
aôion fur le nitre 3 qui ne peut être décompofé
que par le phlogiftique, par l’acide vitriolique , &
par le .fel fédatif. Varfenic décompofé le nitre'avec
la plus grande facilité, non pas en fe combinant avec
fon acide, & en le détruifant, comme le fait le
phlogiftique, mais en le dégageant, & en prenant
fa place auprès de l’alkali, comme le font l’acide
vitriolique & Je fel fédatif.
Stahl & Kunckel ont connu l’un & l’autre cette.
propriété qu’a Yàrfenic de décompofer le nitre 8c
d’en dégager l’acide.
Stahl enfeigne à préparer, par Pintermede de
Yarfenic, \\h acide nitreux très-volatil, extrêmement
concentré, d’une odeur pénétrante & fétide, & de
couleur bleue, quoique fes vapeurs foient rouffes.
Cettè couleur bleue n’eft due, fuivant l’obfervatioh
de M. Bauffié, qu’à l’eau qu’on eft obligé de mettre
dans le récipient, pour condenfer les vapeurs decét
acide, qui eft extrêmement fort & difficile à condenfer.
Kunckel enfeigne auffi à faire line eau forte toute
femblable, mais par un procédé beaucoup plus
fimple & plus clair que celui de Stahl, pùifqu’il
ne décompofé le nitre que par Yàrfenic feul, au
lieu que Stahl 3 i°. fait entrer dans fon mélange lë
vitriol de mars, calciné au rouge; zG. nonpasiW/e/2ic
pur, mais une combinaifon d'arfenic à parties égales
avec l’antimoine & le’fôufre ; combinaifon que les
chymiftes avoient .nommée lapis pirmiefon ou lapis
de tribus. .
Cès deux chymiftes S’étoient contentés d’examinéf
les propriétés de l’efprit de nitre qu’ils retiroient
par Pintermede dé Yàrfenic, & perfonne n’avoir,
examiné ce qui refté dans la cornue après la dif-
tillation. •
Cettë matière3 digne d’attention,- a été reprifè
par M. Maçquer , qui a examiné finguliérement la
déepmpofition du nitre par Yàrfenic dans les vaif-
féaux clos, & la nouvelle efpeee de fel qui refté
fixe dans la cornue après la diftillation dè l-’acidé
nitrèüx:
Ces recherches, dont il a donné le détail dans
deux mémoires, imprimes dans le Recueil de P Académie
de Paris, lui ont fait découvrir que Yàrfenic 1
en fe combinant aveclabafedu nitre, après en avoir
chaffé l’acide, forme, avec eet alkali, un forte dë