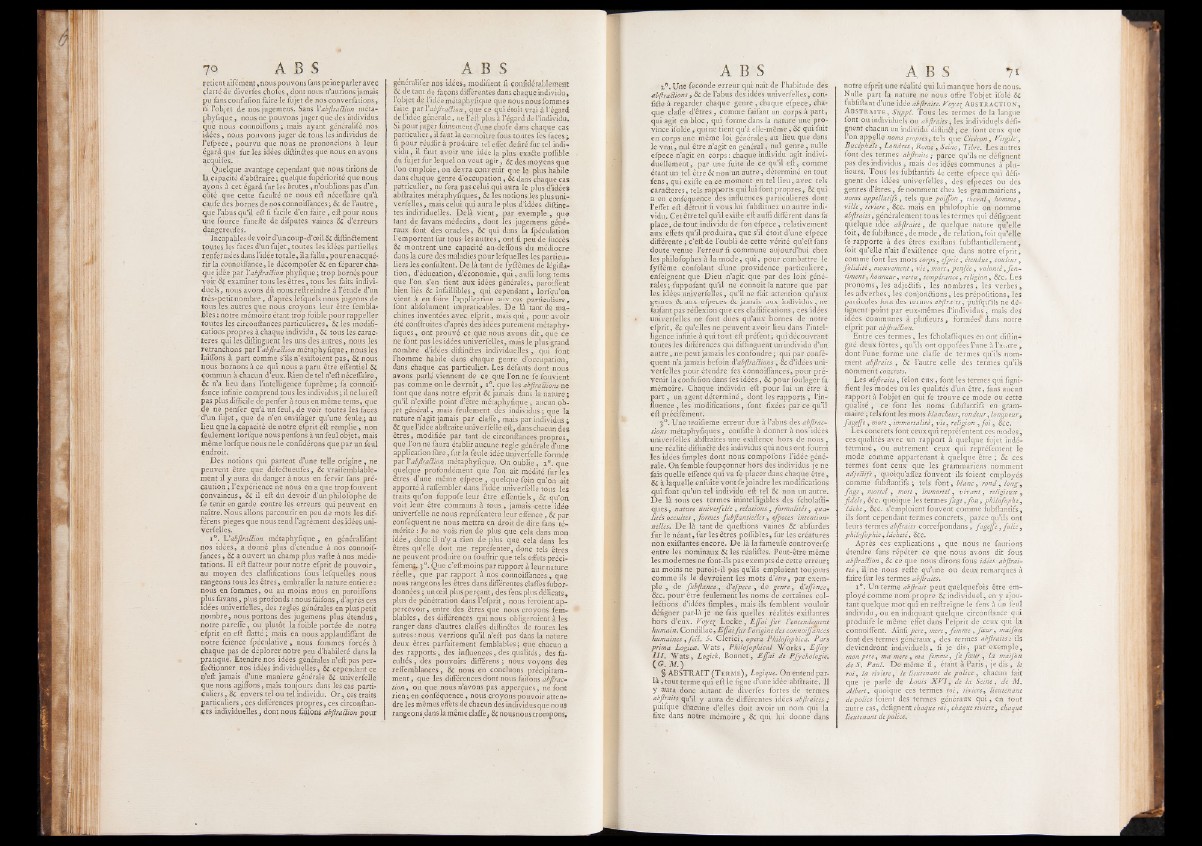
retient: aifénjerçt, nous pouvons fans peine parler avec
clarté de diverfes choies, dont nous n’aurions jamais
pu fans coufufion faire le fujet de nos conventions,
ni l’objet de nos jugemçns. Sans Yabjlraciion métaphyfique
, nous ne pouvons juger que des individus
que nous eonnoiffons ; mais ayant généralifé nos
i.dées, nous pouvons juger de tous les individus de
l’efpece, pourvu que nous ne prononcions à leur
égard que l'ur les idées diftin&es que nous en avons
àçquifes. •
Quelque avantage cependant que nous tirions de
la capacité d’abftraire ; quelque fupériorité que nous
ayons à çet égard fur les brutes, n’oublions pas d’un
coté que cette faculté ne nous eft néceffaire qu’à
çaufe des bornes de nos connoiflances ; & de l’autre,
que l’abus qu’il eft fi facile d’en faire, eft pour nous
une fource funefte de difputes vaines & d’erreurs
dangereufes.
Incapables de voir d’un coup-d’oeil & diftindement
toutes les faces d’un fujet, toutes les idées partielles
renfermées dans l’idée totale, il a fallu, pour en acquérir
la connpifiance, le décompofer & en féparer chaque
idée par Y abjlraciion phyfique ; trop bornés pour
yoir êç examiner tous les ê tres, tous les faits individuels,
nous avons dû nous reftreindre à l’étude d’un
très-petit nombre , d’après lefquels nous jugeons de
tous les autres que nous croyons leur être fembla-
jbles. : notre mémoire étant trop foible pour rappeller
toutes lescirconftancesparticulières, &: les modifications
propres à chaque individu, & tous les caractères
qui les diftjnguent les uns des autres, nous les
retranchons par Y" abjlraciion métaphyfique, nous les
laiffons à part comme s’ils n’exiftoient pas, & nous
nous bornons à ce qui nous a paru être effentiel &
commun à chacun d’eux. Rien de tel n’eft néceffaire,
& n’a lieu dans l’intelligence fuprême ; rfa connoif-
fance infinie comprend tous-les individus ; il ne lui eft
pas plus difficile de penfer à tous en même tems, que
de ne penfer qu’à un feul, de voir toutes les faces
d’un fujet, que de n’en envifager qu’une feule,; au
lieu que la capacité de notre efprit eft remplie, non
feulement lorfque nous penfons à un feul objet, mais
même lorfque nous ne le confidérons que par un feul
endroit.
Des notions qui partent d’une telle origine, ne
peuvent être que défectueufes, & vraifemblable-
ment il y aura du danger à nous en fervir fans précaution
; l ’expérience ne nous en a que trop fouvent
convaincus, & il eft du devoir d’un philofophe de
fe tenir en garde contre les erreurs qui peuvent en
naître. Nous allons parcourir en peu de mots les dif-
férens piégés que nous tend l’agrément des idées uni-
verfelles.
i ° . abjlraciion métaphyfique, en généralifant
nos idées, a donné plus d’étendue à nos connoif-
fiances, & a ouvert un champ plus vafte à nos méditations.
Il eft flatteur pour notre efprit de pouvoir,
au moyen des claflifications fous lefquelles nous
rangeons tous les êtres, embraffer la nature entière :
nous en fournies, ou au moins nous en paroiffons
plus favans, plus profonds : nous faifons, d’après ces
idées universelles, des regies générales en plus petit
nombre, nous portons des jugemens plus étendus,
notre pareffe, ou plutôt la foiblé portée de notre
efprit en eft flatté ; mais en nous applaudiffant de
notre fcience fpéculative , nous fommes forcés à
chaque pas de déplorer notre peu d’habileté dans la
pratique. Etendre nos idées générales n’eft pas perfectionner
nos idées individuelles, & cependant ce
n’eft jamais d’une maniéré générale & univerfelle
que nous agiffons, mais toujours dans les cas particuliers,
& envers tel ou tel individu. O r , ces traits
particuliers, ces différences propres, ces circonftan-
ices individuelles, dont nous faifons abjlraciion pour
genéralifer nos idées, modifient fi çonfidér-ablement
6ç de tant de façons différentes dans chaque individu,
l’objet de l'idée métaphyfique que nous nous fommes
faite par Y abjlraciion, que ce qui étoit vrai à l’égard
de l’idée générale, ne l’eft plus a l’égard de l’individu.
Si pour juger fainement d’une chofe dans chaque cas
particulier, il faut la connaître fous toutes fes faces ;
u pour réuifir à produire tel effet defiré fur tel individu
g il faut avoir une idée la plus exa&e poffible
du fujet fur lequel on veut agir, & des moyens que
l’on emploie,on devra convenir que le plus habile
dans chaque genre d’o.cçupation, & dans chaque cas
particulier, ne fera pas celui qui aura le plus d’idées
abftraites métaphyfiques, & les notions les plus univerfelles
, mais celui qui aura le plus d’idées diftinc-
tes individuelles. Delà vient, par exemple , que
tant de favans médecins, dont les jugemens généraux
font des oracles, & qui dans la fpéculation
l ’emportent fur tous- les autres, ont fi peu de fuccès
& montrent une capacité au-deffous du médiocre
dans la cure des maladies pour lefquelles les particuliers
les confultent. De là tant de lyftêmes de légifla-
tion, d’éducation, d’économie, q u i, aufli long tems
que l’on s’en tient aux idées générales, paroiffent
bien liés & infaillibles, qui cependant, lorfqu’on
vient à en faire l’application aux cas particuliers,
font abfolument impraticables. De là tant de machines
inventées avec efprit, mais q u i, pour avoir
été conftruites d’après des idées purement métaphyfiques
, ont prouvé ce que nous avons dit, que ce
ne font pas les idées univerfelles, mais le plus grand
nombre d’idées diftinftes individuelles , qui font
l’homme habile dans chaque genre d’occupation,
dans chaque cas particulier. Les défauts dont nous
avons parlé viennent de ce que l’on ne fe fouvient
pas comme on le devroit, i°. que les abjlraaions ne
font que dans notre efprit & jamais dans la nature ;
qu’il n’exifte point d’être métaphyfique , aucun objet
général, mais feulement des individus ; que la
nature n’agit jamais par claffe, mais par individus ;
& que l’idée abftraite univerfelle eft, dans chacun des
êtrés, modifiée par tant de circonftances propres,
que l’on ne faura établir aucune réglé générale d’une
applicationfure, fur la feule idée univerfelle formée
par Y abjlraciion métaphyfique. On oublie , i ° . que
quelque profondément que l’on ait médité furies
êtres d’une même efpece , quelque foin qu’on ait
apporté à raffembler dans l’idee univerfelle tous les
traits qu’on fuppofe leur être effentiels, & qu’on
voit leur être communs à tous , jamais cette idée
univerfelle ne nous repréfentera leur effence, & par
conféquent ne nous mettra en droit de dire fans témérité
: Je ne vois rien de plus que cela dans mon
idée, donc il n’y a rien de plus que cela dans les
êtres qu’elle doit me repréfenter, donc tels êtres
ne peuvent produire ou fouffrir que tels effets préci-
fémenfc 30. Que c’eft moins par rapport à leur nature
réelle, que par rapport à nos connoiflances , que
nous rangeons les êtres dans différentes claffes fubor-
données ; un oeil plus perçant, des fens plus délicats ,
plus de pénétration dans l’efprit, nous feroient ap-
percevoir, entre des êtres que nous croyons fem-
blables, des différences qui nous obligeroient à les
ranger dans d’autres claffes diftin&es de toutes les
autres : nous verrions qu’il n’eft pas dans la nature
deux êtres parfaitement femblables ; que chacun a
des rapports, des influences, des qualités, des facultés
, des pouvoirs différens ; nous voyons des
reffemblances, & nous en concluons précipitamment
, que les différences dont nous faifons abjlrac-
tion, ou que nous n’avons pas apperçues, ne font
rien ; en conféquence, nous croypns pouvoir attendre
les mêmes effets de chacun des individus que nous
rangeons dans la même claffe, & nousnous trompons.
2.0. Une fécondé erreur qui naît de l’habitude des
abftraclions, & de l’abus des idées univerfelles, confiée
à regarder chaque genre , chaque efpece, chaque
claffe d’êtres , comme faifant un corps à part,
qui agit en b loc, qui forme dans la nature une province
ifolée, qui ne tient qu’à elle-même, & qui fuit
en corps une même loi générale ; au lieu que dans
le v rai, nul être n’agit en général , nul genre, nulle
efpece n’agit en corps : chaque individu agit individuellement,
par une fuite de ce qu’il eft, comme
étant un tel être & non un autre, déterminé en tout
fens, qui exifte en ce moment en tel lieu, avec tels
carafteres, tels rapports qui lui font propres, & qui
a en conféquence des influences particulières dont
l’effet eft détruit fi vous lui fubftituez un autre individu.
Cet être tel qu’il exifte eft aufli différent dans fa
place, de tout individu de fon efpece , relativement
aux effets qu’il produira, que s’il étoit d’une efpece
différente ; c’eft de l’oubli de cette vérité qu’eft fans
doute venue l’erreur fi commune aujourd’hui chez
les philofophes à la mode, qui, pour combattre le
fyftême eonfolant d’une providence particulière,
enfeignent que Dieu n’agit que par des loix générales;
fuppofant qu’il ne connoît la nature que par
les idées univerfelles, qu’il ne fait attention qu’aux
genres & aux efpeces & jamais aux individus, ne
faifant pas réflexion que ces claflifications, ces idées
univerfelles ne font dues qu’aux bornes de notre
efprit, & qu’elles ne peuvent avoir lieu dans l’intelligence.
infinie à qui tout eft préfent; qui découvrant
toutes les différences qui diftinguent un individu d’un
autre, ne peut jamais les confondre ; ■ qui par conféquent
n’a jamais befoin (Y abfractions , & d’idées univerfelles
pour étendre fes connoiflances, pour prévenir
la confufton dans fes id ées, & pour foulager fa
mémoire. Chaque individu eft pour lui un être à
p a rt , un agent déterminé, dont les rapports ," l’influence
, les modifications, font fixées par ce qu’il
eft précifément.
30. Une troifieme erreur due à l’abus des abjlrac-
dons métaphyfiques, confifte à donner à nos idées
univerfelles abftraites une exiftence hors de nous ,
une réalité diftinéte des individus qui nous ont fourni
les idées fimples dont nous compofons l’idée générale.
Onfemble foupçonner hors des individus je ne
fais quelle effence qui va fe placer dans chaque être,
& à laquelle enfuite vont fe joindre les modifications
qui font qu’un tel individu eft tel & non un autre.
D e là tous ces termes inintelligibles des fcholafti-
ques, nature univerfelle , relations, formalités, qualités
occultes, formes fubjlantielles, efpeces intentionnelles.
De là tant de queftions vaines & abfurdes
fur le néant, fur les êtres poflibles, fur les créatures
non exiftantes encore. De là la fameufe controverfe
entre les nominaux & les réaliftes. Peut-être même
les modernes ne font-ils pas exempts de cette erreur;
au moins ne paroît-il pas qu’ils emploient toujours
comme ils le devroient les mots d’être, par exemple
, de fubjlance , d’efpece , de genre, d'effence,
& c . pour être feulement les noms de certaines collerions
. d’idées fimples, mais ils femblent vouloir
défigner par-là je ne fais quelles réalités exiftantes
hors d’eux. Voye{ L o c k e , Ejfai fur Ventendement
humain. Condillac, Ejfai fur U origine des connoijfances
humaines, fecl. 5. Clerici, opéra Philofophica. Pars
prima Logicoe. V a t s , Philofophical "Works, Ejfay
■ III. W a ts , Logick. Bonnet, Ejfai de Pfychologie'.
(G . M. )
§ ABSTRAIT (T erme) , Logique. On entend par-
là , tout terme qui eft le ligne d’une idée abftraite. II
y aura donc autant de diverfes fortes de termes
abjlraits qu’il y aura de différentes idées abflraites ;
puifque chacune d’elles doit avoir un nom qui la
fixe dans notre mémoire, & qui lui donne dans
notre efprit line réalité qui lui manque hors de nous.
Nulle part la nature ne nous offre l’objet ifolé &
fubfiftant d’une idée abftraite. Voye{ ABSTRACTION,
Abstraite, Suppl, fous les termes de la langue
font ou individuels ou abjlraits, les individuels défi-
gnent chacun un individu diftinéi ; ce font ceux que
l’on appelle noms propres, tels que Cicéron, Virgile',
Bucephale, Londres, Rome , Seine, Tibre. Les autres
font des termes abjlraits ; parce qu’ils ne dëfignent
pas des individus , mais des idées communes à plu—
fleurs. Tous les fubftantifs de cette efpece qui défi-
gnent des idées univerfelles, des efpeces ou des
genres d’êtres, fe nomment chez les grammairiens,
noms appellatifs , tels que poiffon , cheval, homme ,
ville, riviere, &c. mais en philofophie on nomme
abjlraits} généralement tous les termes qui défignent
quelque idée abjlraite, de quelque nature qu’elle
foit, de fubftance, de mode, de relation, foit qu’ elle
fe rapporte à des êtres exiftans fubftantiellement,
foit qu’elle n’ait d’exiftence que dans notre efprit,
comme font les mots corps, efprit, étendue, couleur,
folidité, mouvement, vie, mort, penfée , volonté,Jen-
timent, honneur, vertu, tempérance, religion, &c. Les
pronoms, les a d je& i fs le s nombres; les verbes,
les adverbes, les conjoriûions, les prépofitions, les
particules font des termes abjlraits, puifqu’ils ne défignent
point par eux-mêmes d’individus, mais des
idées communes à plufieurs, formées’dans notre
efprit par abjlraciion.
Entre cès termes, les fcholaftiques en ont diftin-
gué deux fortes, qu’ils ont oppofees l’une à l’autre ,
dont l’une, forme une claffe de termes qu'ils nomment
abjlraits , & l’autre celle des termes qu’ils
nomment concrets.
Les abjlraits, félon e u x , font les termes qui figni-
fient-les modes ou les qualités d’un être, fans aucun
rapport à l’objet en qui fe trouve ce mode ou cette
qualité , ce font lès noms fubftantifs en grammaire
; tels font les mots blancheur, rondeur, longueur,
fagejfe , mort, immortalité, vie, religion , f o i , &c.
Les concrets font ceux qui repréfentent ces modes,"
ces qualités avec un rapport à quelque fujet indéterminé,
ou autrement ceux qui repréfentent le
mode comme appartenant à quelque être ; & ces
termes font ceux que les grammariens nomment
adjectifs, quoiqu’affez fouvent ils foient employés
comme fubftantifs ; tels fon t, blanc, rond, long,
fage , mortel , mort, immortel, vivant, religieux ,
fidele, &rc. quoique les termes fage, fou , philofophe,
lâche, &c. s’emploient fouvent comme fubftantifs,
ils font cependant termes concrets, parce qu’ils ont
leurs termes abjlraits correfpondans, fagejfe, fo lie,
philofophie, lâcheté, &c.
Après ces explications , que nous ne faurions
étendre fans répéter ce que nous avons dit fous
abjlraction, & ce que nous dirons fous idées- abffaites
, il ne nous refte qu’une ou deux remarques à
faire fur les termes abjlraits.
i° . Un terme abjlrait peut quelquefois être employé
comme nom propre & individuel, en y ajoutant
quelque mot qui en reftreigne le fens à un feul
individu, ou en indiquant quelque circonftance qui
produife le même effet dans l’efprit de ceux qui la
connoiffent. Ainfi pere, mere, femme , foeur, maifon
font des termes généraux, des termes abjlraits : ils
deviendront individuels, fi je dis, par exemple,
mon pere, ma. mere, ma femme, fa feeur, la maifon
de S. Paul. De même f i , étant à Paris, je dis , le
roi, la riviere,; le lieutenant de police , chacun fait
que je parlé de Louis X V I , de la Seine, de M.
Albert, quoique ces termes roi, riviere, lieutenant
de police loient des termes généraux q u i, en tout
autre cas, defignent chaque roi, chaque riviere, chaque
lieutenant de police.