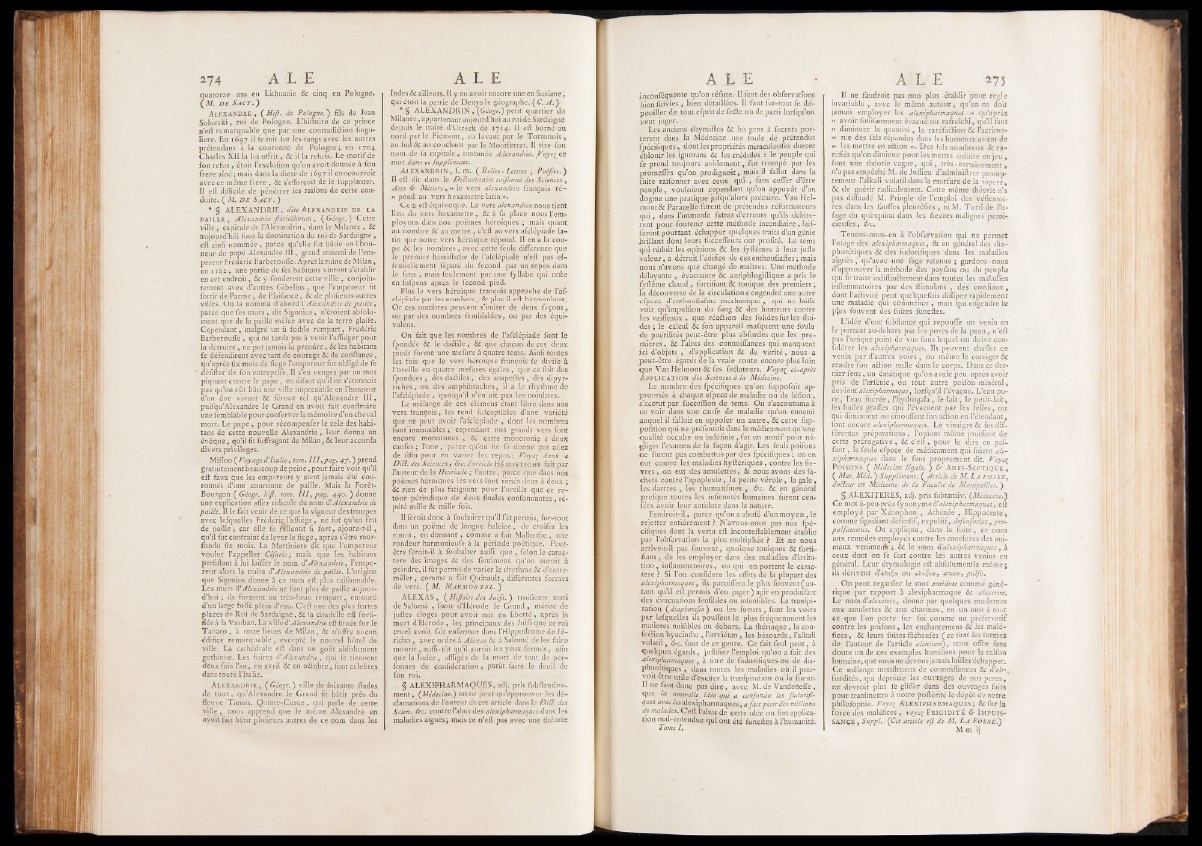
quatorze ans en Lithuanie 6c cinq en Pologne.
( M. d e Sa c y . )
Alexandre , ( Hiß. de Pologne. ) fils de Jean
Sobieski, roi de Pologne. L’hiftoire de ce prince
n’eft remarquable que par une contradiction fingu-
liere. En 1697 il fe mit fur les rangs avec les autres
prétendans à la couronne de Pologne; en 1704
Charles XII la lui offrit, & il la refufa. Le motif de
ion refus , étoit l’exclufion qu’on avoit donnée à fon
frere aîné ; mais dans la diete de 1697 il concourroit
avec ce même frere , & s’efforçoit de le fupplanter.
Il eft difficile de pénétrer les raifons de cette conduite.
( M. d e S a c y . )
* § ALEXANDRIE, dite Alexandrie de la
PAILLE, Alexandria ßatiellorum , ( Géogr. ) Cette
y ille , capitale de l’Alexandrin, dans le Milanez , 6c
aujourd’hui fous la domination du roi de Sardaigne ,
eft ainfi nommée , parce qu’elle fut bâtie en fhon-
neur du pape Alexandre III, grand ennemi de l’empereur
Frédéric Earberoune. Après la ruine de Milan,
en 116 2, une partie de fes habitans vinrent s’établir
en cet endroit, & y fondèrent cette ville , conjointement
avec d’autres Gibelins, que l’empereur fit
fortir de Parme , de Plaifance, 6c de plufieurs autres
villes. On la nomma d’abord Y Alexandrie de paille,
parce que fes murs , dit Sigonius , n’étoient abfolu-
ment que de la paille mêlée avec de la terre glaife.
Cependant, malgré un fi foible rempart, Frédéric
Barberouffe, qui ne tarda pas à venir l’affiéger pour
la détruire, ne put jamais la prendre, 6c les habitans
fe défendirent avec tant .de courage & de confiance,
qu’a près fix mois de liege l’empereur fut obligé de fe
défifter' de fon éntreprife. Il s’en vengea par un mot
piquant contre le pape , en difant qu’il ne s’étonnoit
pas qu’on eût bâti une ville imprenable en l’honneur
d’un âne vivant & féroce tel qu’Alexandre I I I ,
puifqu’Alexandre le Grand en avoit fait conftruire
une femblable pour conferver la mémoire d’un cheval
mort. Le pape , pour récompenfer le zele des habitans
de cette nouvelle Alexandrie, leur donna un
évêque, qu’il fit fuffragant de Milan, 6c leur accorda
divers privilèges.
Miffon ( Voyage d'Italie, tom. I lfp a g . 47. ) prend
gratuitement beaucoup de peine, pour faire voir qu’il
éft faux que les empereurs y aient jamais été couronnés
d’une couronne de paille. .Mais la Forêt-
Bourgon ( Géogr. hiß. tom. I I I , pag. 440. ) donne
une explication affez ridicule du nom d’Alexandrie de
paille. Il le fait venir de ce que la vigueur des troupes
avec lefquelles Frédéric l’affiéga, ne fut qu’un feu
de paille ; car elle fe rallentit fi fo r t , ajoute-t-il,
qu’il fut contraint de lever le liege, après s’être morfondu
fix mois. La Martiniere dit que l ’empereur
voulut l’appeller Céfarèe ; mais que les habitans
perfiftant à lui laiffer le nom d’Alexandrie, l’empereur
alors la traita d’Alexandrie de paille. L’origine
que Sigonius donne à ce nom eft plus raifonnable.
Les murs d’Alexandrie ne. font plus de paille aujourd’hui
; ils forment un très-beau rempart, entouré
d’un large foffé plein d’eau. C’eft une des plus fortes
places du Roi de Sardaigne, & fa citadelle eft fortifiée
à la Vauban. La ville d’Alexandrie eft fituée fur le
Tanaro, à onze lieues de Milan, & n’offre• aucun
édifice remarquable, excepté le nouvel hôtel de
ville. La cathédrale eft dans un goût abfolument
gothiaue. Les foires Alexandrie, qui fe tiennent
deux fois l’an, en avril & en octobre, font célébrés
dans toute l’Italie.
Alexandrie, ( GJogr. ) ville de foixante ftades
de tou r, qu’Alexandre.le Grand fit bâtir près du
flpuve Tanaïs. Quinte-Curce, qui parle de cette
v ille , nous apprend que le même Alexandre en
avoit fait bâtir plufieurs autres de ce nom dans les
Indes & ailleurs. Il y en avoit encore une en Suziane j
qui étoit la patrie de Denys le géographe. ( C .A . )
* § ALEXANDRIN , {Géogr.') petit quartier du
Milanez, appartenant aujourd’hui au roi.de Sardaigne
depuis le traité d’Utreck de 17.14. Il eft borné au
nord parle Piémont, au levant par le Tortonois,
au fud 6c au couchant par le Montferrat. Il tire fon
nom de fa capitale, nommée Alexandrie. .Voye1 ce
mot dans çe fupplément.
Alexandrin, f. m. { B elles-Lettres , Poéjies. )
Il eft dit dans le Dictionnaire raifonné des Sciences ,
Arts & Métiers, « le vers alexandrin françois ré-
» pond au vers hexametre latin ».
Cela eft équivoque. Le vers alexandrin nous tient
lieu du vers hexametre, & à fa place nous l’employons
dans nos poèmes héroïques ; mais quant
au nombre 6c au métré , c’eft au vers afclépiade latin
que notre vers héroïque répond. Il en a la coupe
6c les nombres , avec cette feule différence que
le premier hémiftiche de l’âfclépiade n’eft pas ef-
fentiellement féparé du fécond par un repos dans
le fens , mais feulement par une fyllabe qui refte
en fufpens après le fécond pied.
Plus le vers héroïque françois approche de l’air
clépiade par les nombres, 6c plus il eft harmonieux.
Or ces nombres peuvent s’imiter de deux façons ,
ou par des nombres femblables, ou par des équi-
valens.
On fait que les nombres de l’afclépiade foht le
fpondée & le daftile, & que chacun de ,ces deux
pieds forme une mefure à quatre tems. Ainfi toutes
les fois que le vers héroïque françois fe divife à
l’oreille en quatre mefures égales , que ce foit des
fpondées , des daétiles, des anapeftes , des dipyr-
riches, ou des amphibraches, il a le rhythme de
l’afclépiade , quoiqu’il n’en ait pas les nombres.
Le mélange de ces, élémens étant libre dans nos
vers françois, les rend fufceptibles d’üne variété
que ne peut avoir l’afclépiade , dont les nombres
• font’ immuables ; cependant nos grands vers font
encore monotones , 6c cette monotonie a deux
caufes ; l’une , parce qu’on ne fe donne pas allez
de fôin pour en varier lès repos : Voye{ dans ,'e
D i cl. des Sciences, &c. l'article HÉMISTICHE fait par
l’auteur de la Henriade ; l’autre, parce que dans nos
poèmes héroïques les vers font rimés deux à deux ;
& rien de plus fatiguant pour l’oreille que ce retour
périodique de deux finales confonnantes , répété
mille 6c mille fois.
Il feroit donc à' fouhaiter qu’il.fût permis, fur-tout
dans un poème dé longue haleine, de croifer les
rimes , en donnant , comme a fait Malherbe , une
rondeur harmonieufe à la période poétique,. Peut-
être feroit-il à fouhaiter auffi que , félonie caractère
des images 6c des fentimens qu’on auroit à
peindre, il fut permis.de varier le rhythme & d’entremêler
, comme a fait Quinault, différentes formes
d e ve rs . ( M. Ma rm q n t e l . )
ALEX A S , ( Hijloire des Juifs; ) troifieme mari
de Salomé , foeur d’Hérode le Grand , mérite de
juftes éloges pour avoir mis en liberté, après la
mort d’Hérode, les_principaux des Juifs que ce roi
cruel avoit fait enfermer dans l’Hippodrome de Jéricho
, avec ordre à Alex as 6c à Salomé de les faire
mourir, auffi-tôt qu’il auroit les yeux fermés, afin
que la Judée, affligée de la mort de tant de per-
fonnes de eonfidération, parût faire. le deuil de
fbp roi.
§ ALEXIPHARMAQUES,.adj. pris fubftantive-
ment, {Médecine.) on ne peut qu’approuver les déclamations
de l’auteur de cet article dans le D i cl. des
Scien. &c. contre l’abus des alexipharmaques dans les
maladies aiguës ; mais ce n’eft pas avec une théorie
inconféquente qu’on réfute. Il faut des obfervatîons
bien fuivies , bien, détaillées. Il faut fur-tout fe dépouiller
de toutefprit de feéfe .ou de parti lorfqu’on
yeut juger.
Les anciens ehymiftes & les gens à fecrets portèrent
dans la Médecine une foule de prétendus
fpécifiques, dont les propriétés miraculeufes durent
éblouir les ignorans 6c les crédules : le peuple qui
jfe prend toujours avidement, fut trompé par les
promeffes qu’on prodiguoit, mais il fallut dans la
fuite raifonner avec ceux qui , fans eeffer d’être
peuple, vouloient cependant qu’on appuyât d’un
dogme une pratique jufqu’alors précaire. Van Hel-
mont& Paraçelfe furent de prétendus réformateurs
q u i, dans l’immenfe fatras d’erreurs qu’ils débitèrent
pour foutenir cette méthode incendiaire, laif-
ferent pourtant échapper quelques traits d’un génie
brillant dont leurs fuccefl’eurs ont profité. Le tems
qui réduit les opinions 6c les fyftêmes à leur jufte
valeur, a détruit l ’édifice de ces enthoufiaftes ; mais
nous n’avons que changé de maîtres. Une méthode
délayante , évacuante 6c antiphlogiftique a pris le
fyftême chaud, fortifiant 6c tonique des premiers ;
la découverte de la circulation a engendré une autre
efpece d’enthoufiafme méchanique, qui ne laiffe
voir qu’impulfion du fang 6c des humeurs contre
les vaiffeaux , que réadion des folides fur les fluides
; le calcul 6c fon appareil mafquent une foiile
de puérilités peut-être plus abfurdes que les premières
, 6c l’abus des connoiffances qui manquent
ici d’objets , d’application 6c de vérité, nous«, a
peut-être égarés de la vraie route encore plus loin
que Van Helmont & fes fedateurs. Voyeç ci-après
Application des Sciences à la Médecine.
Le nombre des fpécifiques qu’on fuppofoit appropriés
à chaque efpece de maladie ou de léfion,
s’accrut par fucceflion de tems. On s’accoutuma à
ne voir dans une caufe de maladie qu’un ennemi
auquel il falloit en oppofer un autre, & cette fup-
pofition qui ne préfentoit dans le médicament qu’une
qualité occulte ou indéfinie, fut un motif pour négliger
l’examen de fa façon d’agir. Les feuls poifons
lie furent pas combattus par des fpécifiques; on en
eut contre les maladies Hyftériques , contre les fièvres
, on eut des amulettes, & nous avons des fa-
chets contre l ’apoplexie, la petite v éro le, la gale,
les dartres,, les rhumatifmes , &c. 6c en général
prefque toutes les infirmités humaines furent cen-
fées avoir leur antidote dans la nature.
Faudroit-il, parce qu’on a abufé d’un moyen , le
rejetter entièrement ? N’avons-nous pas nos fpécifiques
dont la vertu eft inconteftablement établie
par l’obfervation la plus multipliée ? Et ne nous
arrive-t-il pas fouvent, quoique toniques 6c forti-
fians, de les employer dans des maladies d’irritation
, inflammatoires, ou qui en portent le caractère
? Si l’on confidere les effets de la plupart des
alexipharmaques, ils paroiffent le plus fouvent ( autant
qu’il eft permis d’en juger) agir enproduifant
des évacuations fenfibles ou infenfibles. La tranfpi-
ration {diaphorejis) ou les- Tueurs , font les voies
par lefquelles ils pouffent le plus fréquemment les
matières nuifibles au dehors. La thériaque, la con-
feâion hyacinthe , l’orviétan , les bézoards , l’alkali
volatil, &c. font de ce genre. Ce fait feul peut, à
quelques égards, juftifier l’emploi qu’on a fait des
alexipharmaques , à titre de fudorifiques ou de dia-
phorétiques , dans, toutes les maladies où il pou-
voit etre utile d’exciter la tranfpiration ou la fueur.
Il ne faut donc pas; dire, avec M . de Vandeneffe,
que la nouvelle idée qui a confondu les. fudorifiques
avec /«alexipharmaques, a fait périr des millions
de malades. C ’eft l’abus de cette idée ou fon application
mal-entendue qui ont été funeftes à l’humanité.
Tome /.
Il ne fàudroit pas non plus établir pour réglé
invariable , avec le même auteur, qu’on ne doit
jamais employer les alexipharmaques « qu’après
» avoir fuffifamment évacué ou rafraîchi, qu’il faut
» diminuer la quantité, la raréfa&ion 6c l’acrimo-
» n;e des fels répandus dans les humeurs1 avant de
» les mettre en aôion ». Des fels nombreux & raréfiés
qu’on diminue pour les mettre enfuite en jeu ,
font une théorie vague, q u i, très-certainement,
n’a pas empêché M. de Juffieu d’adminiftrer promptement
l’alkali volatil dans la morfure de la vipere,
& de guérir radicalement. Cette même théorie n’a
pas diffuadé M. Pringle de l’emploi des véficatoi-
res dans les fauffes pleurëfies , ni M. Torti de l’u-
fage du quinquina dans les fievres malignes perni-
cieufes, &c.
Tenons-nous-en à l’obfervation qui ne permet
l’ufage des alexipharmaques, & en général des diaphoniques
6c des fudorifiques dans les maladies
aiguës,' qu’avec une fage retenue ; gardons-nous
d’approuver la méthode des payfans ou du peuple
qui fe traite indiftin&ement dans toutes les maladies
inflammatoires par des ftimulans , des cordiaux,
dont l’aftivité peut quelquefois diffiper rapidement
une maladie qui commence , mais qui engendre le
plus fouvent dés fuites funeftes.
L’idée d’une fubftance qui repouffe un venin en
le portant au-dehors par les pores de la peau, n’eft
pas l’unique point de vue fous lequel on doive con-
fidérer les alexipharmaques. Ils peuvent chaffer ce
venin par d’autres voies , ou même le corriger 6c
rendre fon aftion.nulle dans le corps. Dans ce dernier
fens, un émétique qu’on avale peu après avoir
pris de l’arféaic, ou tout autre poifon minéral,
devient alexipharmaque, lorfqu’il l’évacue. L’eau pur
e , l’eau fucrée, l’hydrogala , le lait, le petit-lait,
les huiles graffes qui l’évacuent par les telles, ou
qui diminuent ouémouffentfona&ion en l’étendant,
font encore alexipharmaques. Le vinaigre 6c fes différentes
préparations , l’opium même jouiffent de
cette prérogative, 6c c’e f t , pour le dire en paf-
fant, la feule efpece de médicamens qui foient alexipharmaques
dans le fens proprement dit. Voye^
Poisons ( Médecine légale. ) & Anti-Septique ,( Mat. Méd. ) Supplément. ( Article de M. La FOSSE,
docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier. )
§ ALEXITERES, adj. pris fubtantiv. {Médecine.')
Ce mot à-peu-près fynonyme d’alexipharmaques, eft
employé par Xénophon , Athénée , Hippocrate,
comme lignifiant défenfif, expulfif, defenforius, pro-
pulfatorius. On appliqua, dans la fuite, ce nom
aux remedes employés contre les morfures des animaux
venimeiHc ; 6c le nom d’alexipharmaques, à
ceux dont on fe fert contre les autres venins en
général. Leur étymologie eft abfolumentlà même 4
ils dérivent d’àAef« ou aAe'fe«, arceo, pulfo.
On peut regarder le mot antidote comme générique
par rapport à alexipharmaque & alexitere.
Le nom d'alexitere, donné par quelques modernes
aux amulettes & aux charmes, en un mot à tout
ce que l’on porte fur foi comme un préfervatif
contre les poifons, les enchantemens & les maléfices,
6c leurs fuites facheufes ( ce font les termes
de- l’auteur de l’article alexitere) , nous offre fans
doute un de ces exemples humilians pour la raifon
humaine, que nous ne devons jamais laiffer échapper.
Ce mélange monftrueux de connoiffances 6c d’ab-v
furdités, qui déprécie les ouvrages de nos peres,
ne devroit plus fe gliffer dans des ouvrages faits
pour tranfmettre à notre poftérité le dépôt de notre
philofophie. Voyei Alexipharmaques ; 6c fur la
force des maléfices , voye^ Frigidité 6* Impuis-
sa-nçe , Suppl. {Cet article efi de M. La Fo s s e .)
M m ij