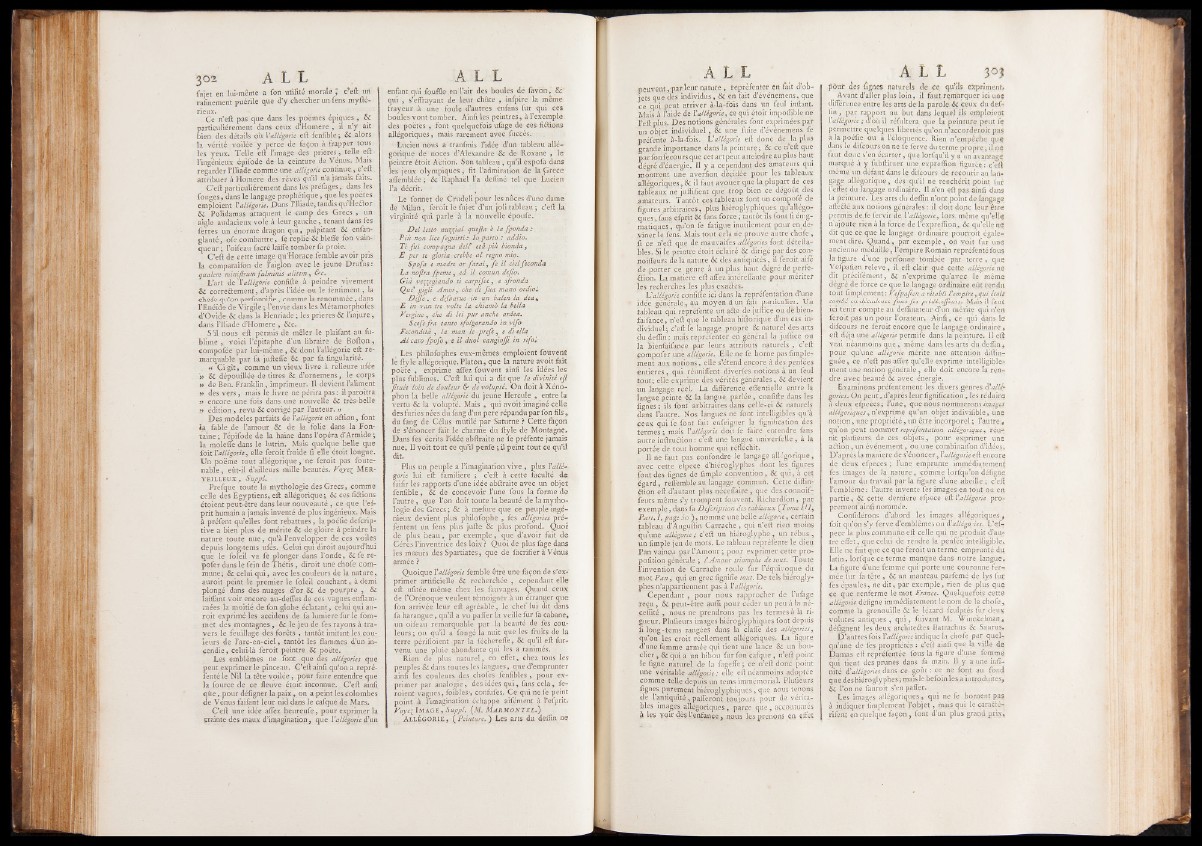
fujet en lui-même a fon utilité morale l c’eft lui
rafinement puérile que d’y chercher un fens myfté-
rieux. -
Ce n’eft pas que dans les poemes épiques , &
particuliérement dans ceux d’Homere , il n’y ait
bien des. détails pii l'allégorie eft fenfible ; 6c alors
la vérité voilée ÿ perce de façon à frapper tous
les yeux. Telle eft l’image des prières , telle eft
l’ingénieux épifode do la ceinture de Vénus. Mais
regarder l’Iliade comme une allégorie continue.,.c’eft
attribuer à Homere des rêves qu’il n’a jamais faits.
C’eft particuliérement dans les préfages, dans les
longes, dans le langage prophétique, que les poetes
emploient l'allégorie. Dans l’Iliade, tandis qu Heétor
& Polidamas attaquent le camp des Grecs , un
aigle audacieux vole à leur gauche, tenant dans fes
ferres un énorme dragon qui, palpitant 6c enfati-
glanté, ofe combattre, fe replie 6c bleffe fon vainqueur
; l’oifeau facré laiffe tomber fa proie.
C ’eft de cette image qu’Horace femble avoir pris
la comparaifon de l’aiglon avec le jeune Drufus:
qualem minijlrum fulminis alitent, &c.
L’art de l'allégorie confifte à peindre vivement
& corre&ement, d’après l’idée ou le fentiment, la
chofe qu’on personnifie, comme la renommée, dans
l’Enéide de Virgile ; l’envie dans les Métamorphofes
d’Ovide & dans la Henriade ; les prières 6c l’injure,
dans l’Iliade d’H'omere , &ç.
S ’il nous eft permis de mêler le plaifant au fu-
blime ,. voici l’épitaphe d’un libraire de Bofton,
compofée par lui-même , 6c dont l’allégorie eft remarquable
par fa jufteffe 6c par fa lingularité.
. « C i gît, comme un vieux livre à relieure ufée
’» & dépouillée de titres & d’ornemens,: le Corps
» de Ben. Franklin, imprimeur. 11 devient l’aliment
» des v er s , mais le livre ne périra pas : il paroitrâ
» encore une fois dans .une nouvelle 6c très-belle
» édition , revu & corrigé par l’auteur. »
Des modèles parfaits de l’allégorie en a£tion, font
la fable de l’amour & de. la folie , dans la Fontaine
; l’épifode de la haine dans l’opéra d’Armide ;
la moleffe dans le lutrin. Mais quelque belle que
foitTallégorie, elle feroit froide fi elle étoit longue.
Un poëme tout allégorique, ' ne feroit pas foute-
nable, eût-il d’ailleurs mille beautés. Voye^ Merveilleux
, Suppl.
Prefque toute la mythologie des G recs, comme
celle des Egyptiens, eft allégorique; & ces fixions
étoiènt peut-être dans leur nouveauté , ce que Fef-
prit humain a jamais inventé de plus ingénieux. Mais
à préfent qu’elles font rebattues, lapoéfie defcrip-
tive a bien plus de mérite & de gloire à peindre la
nature toute nue, qu’à l’envelopper de ces voiles
depuis long-tems ufés. Celui qui diroit aujourd’hui
que le foleil va fe plonger dans l’onde, & fe re-
pofer dans le fein de Thétis, diroit une chofe commune;
& celui qui, avec les couleurs de la nature,
auroit peint le premier le foleil couchant, à de-mi
plongé dans des nuages d’or & de pourpre , &
laiffant voir encore au-deffus de ces vagues enflammées
la moitié de fon globe éclatant, celui qui auroit
exprimé les accidens de fa lumière fur le fom-
met des montagnes, & le jeu de fes rayons à travers
le feuillage des forêts , tantôt imitant les. couleurs
de Farc-en-ciel, tantôt les flammes d’un incendie,
celui-là feroit peintre & poète.
Les emblèmes ne font que des allégories que
peut exprimer le pinceau. C’eft ainfi qu’on a représenté
le Nil la tête voilé e, pour faire entendre que
la fource de ce fleuve étoit inconnue. C ’eft ainfi
que, pour défigner la paix, on a peint les .colombes
de Vénus faifant leur nid dans le cafque de Mars.
. C ’eft une idée allez heureufe, pour exprimer la
Crainte des maux d’imagination, que l'allégorie d’un
enfant qui fouflle en l’air des boules dé fàvo'n, 6t
qui , s’effrayant de leur chute , infpire la même
frayeur, à une foule d’autres enfans fur qui ce*
boules vont tomber. Ainfi les peintres , à l’exemple
des poètes , font quelquefois ufage de cès fiâions
allégoriques, mais rarement avec fuecès.
Lucien nous a tranfmis l’idée d’un tabléau allégorique
dé noces d’Alexandre 6c de Roxane , le
peintre étoit Aëtiori. Son tableau , qu’il expofa dans
les jeux olympiques, fit l’admiration de la Grece
affemblée ; 6c Raphaël l’a defliné tel que Lucien
l’a décrit.
Le fortnet de Crudeli pour les nôces d’une dame
de Milan, feroit le fujet d’un joli tableau ; c’eft la
virginité qui parle à la nouvelle époufe.
Del letto nu^fial quejla é la fporïda ;
Piu non lice feguirti; Io parto : addio.
Ti fu i compagna de 11' et à piu Honda,
E per te gloria crebbeal regno mio.
Spofa t madré or far ai, fe il ciel féconda
La no [Ira fpeme , ed il comun defiot
Già veqjegiando ti carpifce, e sfronda
Que' gigli Amor, ckedi fua nia.no ordiol
D ijfe, e difparue in un balen.la dea%
E in van tre yolte la chiamb la bella
Vergine , che di lei pur anche ardea.
Scefe fra tanto sfolgqrando inyifo
Fécondité. , la man le prefe, e ditlla
Alcaro fpofo, e il duol cangiojji in ri fol
Les philofophes eux-mêmes emploient fouvént
■ lé ftyle allégorique. Platon, que la nature avoit fait
poète , exprime affez fouvent ainfi les idées les
plus fublimes. C ’eft lui qui a dit que la divinité ejl
fîtuée loin de douleur & di. volupté. On doit à Xéno-
phon la belle allégorie du jeune Hercule , entre la
vertu & la volupté. Mais , qui avoit imaginé celle
des furies nées du fang d’un pere répandu par fon fils ,
du fang de Célus mutilé par Saturne ? Cette façon
de s’énoncer fait le charme du ftyle de Montagne.
Dans fes écrits l’idée abftraite ne fe préfente jamais
nue. Il voit tout ce qu’il penfe ; il peint tout ce qu’il
dit.
Plus un peuple a l’imagination v ive , plus ¥ allégorie
lui eft familière ; c’eft à cette faculté de
faifir les rapports d’une idée abftraite avec un objet
fenfible, & de concevoir l’une fous' la forme de
l’autre, que l’on doit toute la beauté de la mythologie
des Grecs; & à mefure que ce peuple ingénieux
devient plus philofophe , fes allégories pré-
fentent un fens plus jufte & plus profond. Quoi
de plus beau, par exemple,' que d’avoir fait de
Ç é r è s l’inventrice des loix ? Q u o i de plus fage dans
les moeurs des Spartiatès, que de facrifier à Vénus
armée 11
Quoique 1sallégorie femble être une façon de s’exprimer
artificielle 6c recherchée , Cependant elle
eft ufitée même chez les fauvages. Quand ceux
de l’Orénoque veulent témoigner à un étranger que
fon arrivée leur eft agréable, le chef lui dit dans
; fa harangue, qu’il a vu paffer la veille fur fa cabane,
un oifeau remarquable par la beauté de fes couleurs
; ou qu’il a fongé la nuit que les fruits de la
terre périffoient .par la féchereffe, 6c qu’il eft fur-
venu une pluie abondante qui les a ranimés.
Rien de plus naturel, en effet, chez tous les
peuples & dans toutes les langues, que d’emprunter
ainfi les couleurs des chofes fenfibles , pour exprimer
par analogie, desideesqui, fans .cela, f e r
a ie n t vagues, fa ib le s - , confufes. Ce qui ne fe peint
point à l’imagination échappe aifément à l’efprit.
Voye^ Image , Suppl. (M. Ma rm o n t e l ,)
Allégorie, ( Peinture. ) Les arts du deflin nç
-peuvent , par teuf nature, repréfenter èii fait ^objets
que des individus, en fait d’événemens, que
ce qui p.eut arriver à-la-fois dans un feul inftant.
Mais à l’aide de l’allégorie, ce qui étoit impoflïble, ne
l’eft plus. Des notions générales font exprimées par
un objet individuel, & une fuite d’événemens fe
préfente à-la-fois. L'allégorie eft donc de la plus
grande importance dans la peinture; 6c ce n’eft que
parfonfecoursque cet art peut atteindre au plus haut
degré d’énergie. Il y a cependant des amateurs qui
montrent une averfion décidée pour les tableaux
allégoriques, & il faut avouer que la plupart de ces
tableaux ne juftifient que trop bien ce clegOût des
.amateurs. ' Tantôt ces tableaux font un compofé de
figures ^arbitraires, plus hiéroglyphiques qu’allego-
ques:, fans efprit & fans force ; tantôt ils font fi énigmatiques
, qu’on fe fatigue inutilement pour ende-
,yiner le fens. Majs. tout cela rie prouve autre chofe ,
fi çe n’eft que de mauvaifes allégories font détefta-
ble"s. Si le peintre étoit éclairé & dirigé par des con-
noiffeurs de la pâture & des antiquités, il feroit aifé
de porter ce genre à un plus haut dégré de perfe-
étion. La matière eft affez iptéreffante pour mériter
les recherches les plus exactes.
L'allégorie confifte ici dans la repréfentation d’une
idée generale;, au moyen d’un, fait particulier. Un
tableau qui repréfente un a£te de juftice ou de bien-
faifance, n’eft que le tableau hifto.rique d’un cas individuel;
c’eft le langage propre & naturel des arts
du deflin : mais repréfenter en général la juftice ou
la bienfaifauce par leurs attributs naturels , c’eft
compofer une allégorie. Elle ne fe borne pas Amplement
aux notions, elle s’étend encore à des penfées
entières , qui réunifient diverfes notions à un feul
tout; elle exprime des vérités générales, & devient
iiq langage réel. La différence effentielle entre la
langue peinte & la langue, parlée, confifte dans les
îignès ; ils font arbitraires dans celle-ci & naturels
dans l’autre. Nos langues ne font intelligibles qu’à
ceux qui fe font fait enfeigner la fignification des
termes ; mais l'allégorie doit fe faire entendre fans
autre mftru&io.n : c’eft une langue univerfelle , à la
portée de tout homme qui réfléchit.
. Il ne faut pas confondre le langage allégorique,
avec cette efpece d’hiéroglyphes dont les figures
font des lignes de fimple convention , & qui, à cet
égard, reflèmble au langage commun. Cette diftin-
éfion eft d’autant plus néceffaire , que des connoif-
feurs même s’y trompent fouvent. Richardfpn, par
exemple, dans fa Description des tableaux (Tome H I ,
P.art. I, page io ) , nomme une belle allégorie, certain
tableau d’Auguftin Carraçhe, qui n’eft rien moins
qu’une allégorie ; c’eft un hiéroglyphe, un rébus
un fimple jeu de mots. Le tableau repréfente le dieu
Pan vaincu par l’Amour; pour exprimer cette pro-
pofition générale ; l'Amour triomphe de tout. Toute,
l’invention de Carràche roule fur l’équivoque du
mot Pan, qui en grec fignifie tout. De tels hiéroglyphes
n’appartiennent pas à l’allégorie.
Cependant , pour nous rapprocher, de l’ufage
reçu, & peut-être aufli pour céder un peu à la né-
ceflité , nous ne prendrons pas les termes à la rigueur.
Plufieurs images hiéroglyphiques font depuis
fi long-tems rangées dans la clafie des allégories,
qu’on les croit réellement allégoriques. La figure
d’une femme armée qui tient une lance & un bouclier
, & qui a un hibou fur fon Cafque , n’eft point
le figne naturel de la fageffe ; ce n’eft donc point
une véritable allégorie : elle eft néanmoins adoptée
comme telle depuis un teins immémorial. Plufièurs
fignes purement hiéroglyphiques, que nous tenons
de l’antiquité, pafferont toujours pour de véritables
images allégoriques, parce que , accoutumés
à les voir dès l’enfançe, nous les prenons en effet
pôiiir des lignes naturels de ce qu’ils expriment*
Avant d’aller plus loin, il faut rem.arquer ici unç
différence entre les arts de la parole & ceux du def-
fin, par rapport au but dans lequel ils ertiploient
y allégorie ; d’où il réfultera. que la peinture peut fe
permettre quelques libertés qu’on n’accorderoit pas
à la poéfie ou à l’elôquence. Rien n’empêche, que
dans le difcours on ne fe ferve du terme propre ; il: ne
faut donc s’en écarter, que lorfqu’il y a un avantagé
marqué à y fubftituer une expreffion figurée.: c ’eft
même un défaut dans le difcours de recourir au langage
allégorique, dès qu’il né renchérit, pbint fur
l’effet du langage ordinaire. Il ri’én eft pas ainfi dans
la peinture. Les arts dii deftin n’ont point de langage
aie été aux notions générales : il doit donc leur être
permis de/e fervir de \'allégorie, lors, même qu’elle
n’ajpute rien à la force de l’ëxpreflion, & quelle né
dit que ce que le langage ordinaire pourroit également
dire. Quand, par exemple, on voit fur une
ancienne médaille, l’empire Romain repréfentéfous
la figure d’une perfonne tombée par terre , que
Vefpafien releve, il eft clair que cette allégorie ne
dit préeifément, & n’exprime qu’avec le même
degré de force Ce que le langage ordinaire eût fendu
tout Amplement: Kefpajien a rétabli l'empire, qui étoit
tonibé en décadence fous fes prédécejfeurs. Mais il. faut
ici tenir compte au deflinateur d’un mérite qui n’erl
feroit pas un pour l’orateur. Ainfi, Çe qui dafts le
difcours nq feroit encore que le langage ordinaire*
eft déjà une allégorie permife dans la peinture. Il eft
vrai néanmoins que , même dans les arts du deflàg *
pour qu’une allégorie, mérite une attention diftin-
guée, ce n’eft pas affez qu’elle exprime intelligiblement
une notion générale , elle doit encore la rendre
avec beauté 6c avec énergie.
Examinons préfentement les divers genres à'allé1'
gories.i On peut, d’après leur lignification, les réduire
a deux efpeees; l’une, que nous nommerons images
allégoriques, n’exprime qu’un objet indivifible, une
notion, une propriété , uri être incorporel ; l’autre *
qu’on peut nommer repréfentation allégorique, réunit
plufieurs de ces objets, pour exprimer une
aéfion, un événement, ou une combinaifon d’idées.
D’après la maniéré de s’énoncer, l'allégorie eft encore
de deux efpeees ; l’une emprunte immédiatement
fes images de la nature, comme, lorfqu^on dé figne
l’amour du travail par la figure d’une abeille ; c’eft
l’emblème : l’autre invente fes images en tout ou en
partie, & cette derniere efpece eft l'allégorie proprement.
ainfi nommée.
Confidérons d’abord les images allégoriques,
fdit qu’on s’y ferve d’emblèmes ou d5allégories. L’ef-
pece la plus commune eft celle qui ne produit d’au-:
tre effet, que celui de rendre la penfée intelligible*
Elle ne fait que ce que feroit un termè emprunté du
latin, lorfque ce terme manque dans notre langue.
La figure d’une femme qui porte une couronne fermée
fur fa tête , 6c un manteau parfemé de lys fur
fes épaules, ne dit, par exemple, rien de plus que
ce que renferme le mot France. Quelquefois cette
allégorie défigne immédiatement le nom de la chofe,
comme la grenouille 6c le lézard fculptés fur deux
volûtes antiques , q u i, fuivant M. ’Winckeknan,
défignent les deux architectes Batrachus & Saurus*
D ’autres fois l'allégorie indique la chofe par quelqu’une
de fes propriétés : c’eft ainfi que la ville de.
Damas eft repréfentée fous la figure d’une femme
qui tient des prunes dans fa main. Il y a une infinité
$ allégories dans ce août: ce ne font au fond
que des hiéroglyphes'; mais le befoinles a introduites,
6c Fon ne fauroit s’en paffer... ^
Les images allégoriques, qui ne fe bornent pas
à indiquer fimplement l’o b je t , mais qui le çâracté-
rifent en quelque façon, font d’un plus grand prix*