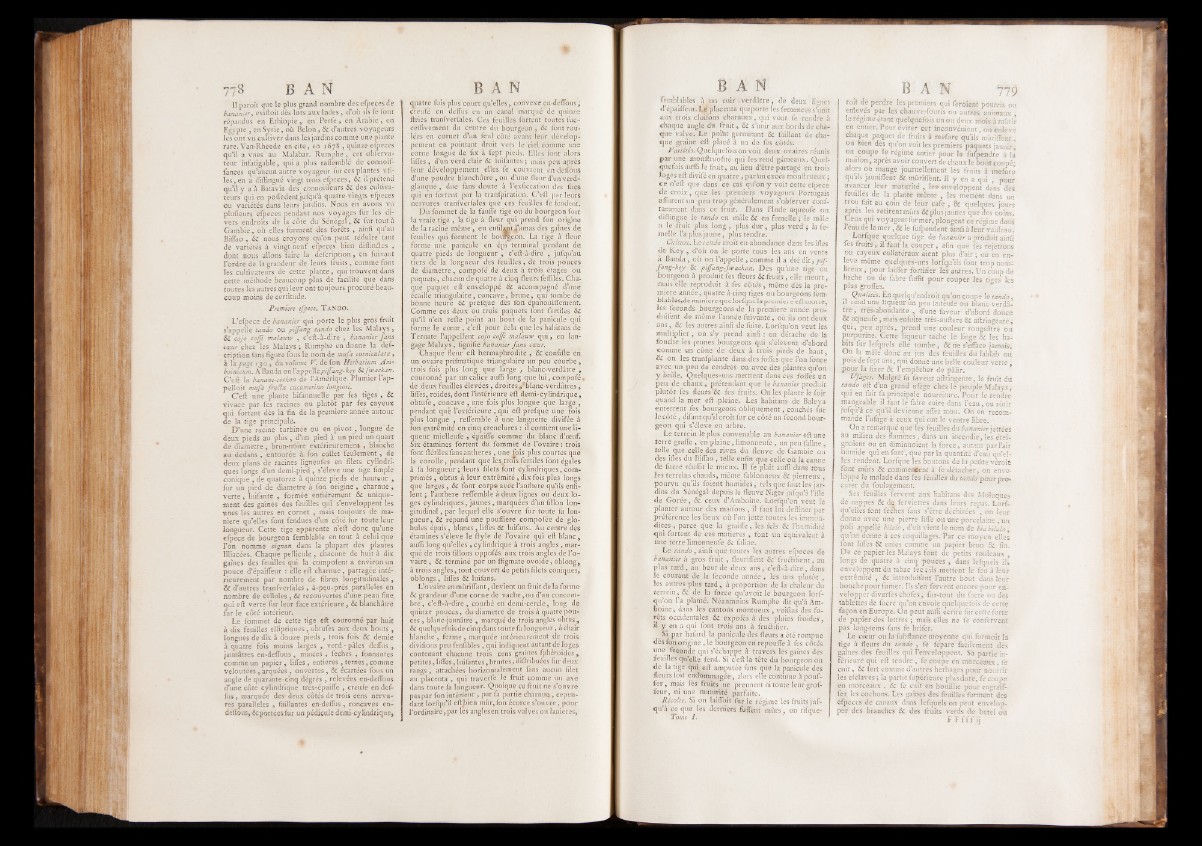
Il paroît que le plus grand nombre des efpeces de
bananier, exiftoit dès lors aux Indes, d’oii ils le l'ont
répandus en Ethiopie , en Perfe, en Arabie , en
Egypte , en Syrie, où Beloh, & d’autres voyageurs
les ont vu cultiver dans les jardins comme une plante
rare. Van-Rheede en cite, en 1678 , quinze efpeces
qu’il a vues au Malabar. Rumphe , cet oblerva-
teur infatigable, qui a plus raflemblé de connoif-
fances qu’aucun autre voyageur fur ces plantes utiles,
en a diftingué vingt trois efpeces, & il prétend
qu’il y a à Batavia des connoifleurs 8c des cultivateurs
qui en poffedentjufqu’à quatre-vingts efpeces
ou variétés dans leurs jardins. Nous en avons vu
plufieurs efpeces pendant nos voyages fur les divers
endroits de la côte du Sénégal, 8c fur-tout à
Gambie, où elles forment des forêts , ainli qu’au
Biffao , & nous croyons qu’on peut réduire tant
de variétés à vingt-neuf efpeces bien diftinftcs ,
dont nous allons faire la defcription, en fuivant
l’ordre de la grandeur de leurs fruits , comme font
les cultivateurs de cette plante, qui trouvent dans
cette méthode beaucoup plus de facilité que dans
toutes les autres qui leur ont toujours procuré beaucoup
moins de certitude.
Première efpece. T ando.
L’efpece de bananier qui porte le plus gros fruit
s’appelle tando ou pijfang tando chez les Malays,
& cojo .cojp. rnalauw , c’eft-à-dire , bananier fans
coeur chez les Malays ; Rumphe en donne la defcription
fans figure fous le nom de mufa corniculata,
à la page ig o , du volume V , de fon Herbarium j4ïïi-
boinicum. A Banda on l’appellepiffang-key 8cfwackan.
C ’eft la banane-cochon de l'Amérique. Plumier lap-
pelloit mufa fmclu cucumerino longiori.
Ç’eft une plante bifannuelle par fes tig es , 8c
vivace par fes racines ou plutôt par fes cayeux
qui fortent dès la fin de la première année autour
de la tige principale.
D ’une racine turbinée ou en p iv o t , longue de
deux pieds au plus , d’un pied à un pied un quart
de diamètre, brun-noire extérieurement, blanche
au dedans , entourée à fon collet feulement, dé
deux plans de racines ligneufes en filets cylindriques
longs d’un demi-pied , s’élève une tige fimple
conique , de quatorze à quinze pieds de hauteur ,
fur un pied de diamètre à fon origine, charnue,
verte , luifante , formée entièrement & uniquement
des gaines des feuilles qui s’enveloppent les
unes les autres en cornet , mais toujours de maniéré
qu’elles font fendues d’un côté fur toute leur
longueur. Cette tige apparente n’eft donc qu’une
efpece de bourgeon femblable en tout à celui que
l’on nomme oignon dans la plupart des plantes
liliacées. Chaque pellicule , chacune de huit à dix
gaines des feuilles qui la compofent a environ un
pouce d’épaiffeur : elle eft charnue, partagée intérieurement
par nombre de fibres longitudinales ,
& d’autres tranfverfales, à-peu-près parallèles en
nombre de cellules , & recouvertes d’une peau fine,
qui eft verte fur leur face extérieure, & blanchâtre
fur le côté intérieur.
Le fommet de cette tige eft couronné par huit
à dix feuilles elliptiques, obtufes aux deux bouts ,
longues de dix à douze pieds , trois fois & demie
à quatre fois moins larges , verd - pâles defliis
jaunâtres en-deffous, minces , feches , fonnantes
comme un papier, liftes , entières , ternes, comme
veloutées, arquées , ouvertes, 8c écartées fous un
angle de quarante-cinq dégrés , relevées en-deffous
d’une côte cylindrique très-épaiffe , creufe en def-
fus, marquée des- deux côtés de trois cens nervures
parallèles , faillantes en-deffus, concaves en-
deffous, Scportées fur un pédicule demi-cylindrique,
quatre fois plus court qu’elles, convexe en-deffous;
creufé en deffus en un canal marqué- de quinze
ftries tranfverfales. Ces feuilles fortent toutes fuc-
ceflivement du centre du bourgeon, 8c font roulées
en cornet d’un feul côté avant leur développement
en pointant droit vers le ciel comme une
corne longue de fix à fept pieds. Elles font alors
liffes , d’un verd clair 8c luifantes ; niais peu après
leur développement elles fe couvrent en deffous
d’une poudre blanchâtre , ou d’une fleur d’un verd-
glauque, due fans doute à l’exficcation des fucs
qui en fortent par la tranfpiration. C ’eft par leurs
nervures tranfverfales que ces feuilles fe fendent.
Du fommet de la fauffe tige ou du bourgeon fort
la vraie tige , la tige à fleur qui prend" fon origine
de la racine même, en enfilant4’amas des gaines de
feuilles qui forment le bourçeon. La tige à fleur
forme une panicule en épi terminal pendant de
quatre pieds de longueur , c’ eft-à-dire , jufqu’au
tiers de la longueur des feuilles, de trois pouces
de diamètre, compofé de deux à trois étages ou
paquets, chacun de quatre à cinq fleurs feflîles. Chaque
paquet eft enveloppé 8c accompagné d’une
écaille triangulaire, concave, brune, qui tombe de
bonne heure & prefque dès fon épanouiffemenr.
Comme ces deux ou trois paquets font fertiles 8c
qu’il n’en refte point au bout de la panicule qui
forme le coeur, c’eft pour cela que les habitans de
Ternate l’appellent cojo coffi malauw qui, en langage
Malays, fignifie bananier fans coeur.
Chaque fleur eft hermaphrodite , & confifte en
un ovaire prifmatique triangulaire un peu courbe,
trois fois plus long que large , blanc-verdâtre ,
couronné par un calice auffi long que lui, compofé.
de deux feuilles élevées, droites^blanc-verdâtres,
liffes, roides,dont l’intérieure eft demi-cylindrique,
obtufe, concave , une fois plus longue que large ,
pendant que l’extérieure , qui eft prefque une fois
plus longue , reffemble à une languette divifée à
fon extrémité en cinq crenelures : il contient une liqueur
mielleufe , épaiffe comme du blanc d’oeuf.
Six étamines fortent du fommet de l’ovaire : trois
font ftériles fans anthères , une fois plus courtes que
la corolle, pendant que les^trors,fertiles font égales
à fa longueur; -leurs filets font cylindriques, comprimés
, obtus à leur extrémité , dix fois plus longs
que larges , 8c font corps-- avec l’anthere qy’ils enfilent
; l’anthere reffemble à deux lignes ou deux loges
cylindriques, jaunes, marquées d’un fillon longitudinal
, par lequel elle s’ouvre fur toute fa longueur,
8c répand une poufliere compofée de globules
épais, blancs, liffes 8c luifans. Au centre des
étamines s’élève le ftyle de l’ovaire qui eft blanc,
aufli long qu’elles , cylindrique à trois angles , marqué
de trois filions oppofés aux trois angles de l ’ovaire
, & terminé par un ftigmate ovoïde, oblong,
à trois angles, tout couvert de petits filets coniques,
oblongs , liffes 8c luifans.
L’ovaire en mîiriffant, devient un fruit de la fdrme
8c grandeur d’une corne de vache,ou d’un concombre,
c’eft-à-dire , courbé en demi-cercle, long de
quinze pouces, du diamètre de trois à quatre pouces,
blanc-jaunâtre , marqué de trois angles obtus,
& quelquefois de cinq dans toute fa longueur, à chair
blanche, ferme, marquée intérieurement de trois
divifions peu fenfibles , qui indiquent autant de loges
contenant chacune trois cens graines fphéroïdes
petites, liffes, luifantes, brurfes, diftribuées fur deux
rangs, attachées horizontalement fans aucun filet
au placenta , qui traverfe le fruit comme un axe
dans toute fa longueur. Quoique ce fruit ne s’ouvre
pas par fon intérieur, par fa partie charnue, cependant
lorfqu’il eft bien mûr, fon écorce s’ouvre, pour
l’ordinaire, par les angles en trois valves ou lanières,
femblables il un cuir .verdâtre, de deux lignes
d’épaiffeur. Lé placenta quiportè les femences s’uhit
aux trois eloifons charnues, qui vont fe rendre à
chaque angle du fruit, & s’unir aux bords de chaque
valve. Le poiht germinant & faillant de chaque
graine eft placé à un de fes côtés.
Variétés. Quelquefois on voit deux ovaires réunis
par une monftruofité qui les rend gémeaux. Quelquefois
aiffli le fruit, au lieu d’être partagé en trois
loges eft divifé en quatre, par lin excès monftrueux ;
ce n’eft que dans ce cas qu’on y voit cette efpece
de croix, que les premiers voyageurs Portugais
affurent un peu trop généralement s’obferver eonf-
îamment dans ce fruit. Dans l’Inde âquèufe on
diftingué le tando en mâle 8c en femelle ; le mâle
a le fruit plus long , plus dur, plus verd ; la femelle
l’a plus jaune , plus tendre.
Culture. Le tando croît en abondance dans les ifles
de K e y , d’où on le porte tous les ans en vente
à Banda, où on l’appelle, comme il a été dit > piffang
key & piffang-fwackàn. Dès qu’une tige ou
bourgeon à produit fes fleurs 8c fruits, elle meurt,
mais elle reproduit à fes côtés, môme dès la première
année, quatre à cinq tiges ou bourgeons fèm-
blables,de maniéré que lôrfque la première eft morte,
les féconds bourgeons de la première année pro-
duifent de même l’année fui vante, où ils ont deux
ans, & les autres ainfi de fuite. Lorfqu’on veut les
multiplier, on s’y prend ainfi : on détache de là
louche les jeunes bourgeons qui s’élèvent d’abord
comme un cône de deux à trois pieds de haut,
& on les tranfplante dans des foffes que l’on fonce
avec un peu de cendres ou avec des plantes qu’on
y brûle. Quelques-uns metttent dans ces foffes un
peu de chaux, prétendant que' le bananier produit
plutôt fes fleurs '& fes fruits. On les plante le foir
quand la mer eft pleine. Les habitans de Baleya
enterrent fes bourgeons obliquement, couchés fur
Je côté, difant qu’il croît fur ce côté un fécond bourgeon
qui s’élève en arbre.
Le terrein lè plus convenable au bananier eft une
terré graffe , en plaine, limonneufe, un peufaline ,
telle que celle des rives du fleuve de Gambie ou
des ifles du Biffao, telle enfin que celle où la canne
de fucré réùflït le mieux. Il fe plaît aufli dans tous
les terreins chauds, même fablonneux & pierreux,
pourvu qu’ils foiênt humides, tels que font les jardins
du Sénégal depuis le fleuve Niger jufqu’à Pifle
de Corée, 8c ceux d’Amboine. Lorfqu’on veut lè
planter autour des maifons , il faut lui deftiner par
préférence les lieux où l’on jette toutes les immondices.,
parce que la graiffe, les fels 8c Phumidite
qui fortent de ces matières , font un équivalent à
une terre limonneufe & faline.
Le tando, ainfi que toutes les autres efpeces de
bananier à gros fruit , fleuriffent 8c' fruâifient, au
plus tard, au bout de deux ans, c’eft-à-dire, dans
le courant de la fécondé année, les uns plutôt ,
les autres plus tard, à proportion de la chaleur du
terrein, 8c de la force qu’avoit le bourgeon lorfqu’on
l’a planté. Néanmoins Rumphe dit qu’à Am-
boine, dans les cantons montueux, voifins des fo-
xêts occidentales 8c expofés à des pluies froides,
il y en a qui font trois ans à fruâifier.
Si par hafard la panicule des fleurs a été rompue
dès fon origine , le bourgeon en repouffe à fes côtés
ime fécondé qui s’échappe à travers les gaînes des
feuilles qu’elle fend. Si c’eft la tête du bourgeon ou
de la tige qui eft amputée fans que la panicule des
fleurs foit endommagée, alors elle continue à pouffer
, mais fes fruits ne prennent ni toute leur grof-
feur, ni une maturité parfaite.
Récolte. Si on Iaiffoit fur le régime les fruits juf-
qu’à ce que les derniers fuflent mûrs, on rifqüe- I
Torne I,
roit dé perdre les premiers qui feroîent pourris ou
enlevés par les chauye-fouris ou autres animaux ,
le régime étant quelquefois un ou deux mois à mûrir
en entier. Pour éviter cet inconvénient, on enleve
chaque paquet de fruits à mefure qu’ils mûriffent,
ou bien dès qu’on voit les premiers paquets jaunir;
on coupe le régime entier pour le fu{pendre à la
maifon, âpres avoir couvert de chaux le bout coupé;
alors on mange journellement les fruits à mefure
qu’ils jauniffent 8c mûriffent. Il y en a qui , pour
avancer leur maturité , les* enveloppent dans des
feuillés de la plante même , les mettent dans un
trou fait au coin de leur café , & quelques jours
après les retirent mûrs & plus jaunes que des coins.
Ceux qui voyagent fur mer, plongent ce régime dans
1 eau de la mer, & lè fufpendent ainfi à leur vaiffeau.
Lorfque quelque tige de bananier a produit ainfi
fes fruits, il faut la couper, afin que fes remettons
ou cayéux collatéraux aient plus d’air ; on en enleve
même quelques-uns lorsqu’ils font trop nom-
breiix, pour laiffer fortifier les autres. Un coup dé
hache ou de fabre fuffit pour couper les tiges les
plus groffes.
Qualités. En quelqu’endroit qu’on coupe lé tando,
il rend une liqueur Un peu laiteufe ou blanc-verdâ-
tre » très-abondante , d’une faveur d’abord douce
& aquenfe, mais enfuite très-auftere & aftringente,
I qui, peu après, prend une couleur rougeâtre ou
purpurine. Cette liqueuf tache le linge & les habits
fur lefquels elle tombe, & rie s’efface jamais.
! O ” fe mêle donc au jus des feuilles du Iablab où
pois de fept ans, qui donne une belle couleur verte,
pour la fixer & l’empêcher de pâlir.
Üfàgesi Malgré fâ faveur aftringente, le fruit du
tando eft d un grand ufage chez le peuple Malays,
qui en fait fa principale nourriture. Pour le rendre
mangeable il faut le faire cuire dans l’eau, ou rôtir
jufqu’à ce qu’il devienne affez mou. Oh en recommande
I’ufage à ceux qui ont le ventre libre.
On a remarque qué les feuilles du bananier jettées
au milieu des flammes , dans un incendie, les étei-
gnoient ou eh diminuoient la force, autant par l’air
humide qui eh fort", que par la quantité d’eau qu’elles
rendent. Lorfque les boutons de là petite, vérole
font mûrs & commentent à fe détacher, on enveloppe
le malade dans lés féuilles du tando pour procurer
du fioulagement.
Ses feuilles fervent aux habitans des Moluques
de nappes & de ferviettes dans leurs repas. Lorf-
qu’elles font feches fans s’être déchirées , oh leur
donne avec une pierre liffe ou une porcelaine , un
poli âppéllé bilalo, d’où vient le nom de bia bilalo
qu’on donne à ces coquillages. Par ce moyen elles
font liffes 8c unies comme un papier brun & fin.
De ce papier lès Malays font de petits rouleaux ,
longs de quatre, à cinq pouces , dans lefquels ils
enveloppent du tabac fec ; ils mettent lè feu à leur
extrémité , 8c introduifent l’autre bout dans leur
bouche pour fumer. Ils s’en fervent encore pour envelopper
diverfes chofes, fur-tout du fucre ou des
tablettes de fucre qu’on envoie quelquefois de cette
façon en Europe. On peut aufli écrire fur cette forte
de papier des lettres ; mais elles ne fe confervent
pas long-tems fans fe brifer.
Le coeur ou la fubftance moyenne qui formôit la
tige à fleurs du tando , fe fépare facilement des
gaînes des feuilles qui l’enveloppent. Sa partie inférieure
qui eft tendre , fe coupe en morceaux, fe
cuit, 8c lert comme d’autres herbages pour nourrir
les efclaves ; la partie fupérîeure plus dure, fe coupe
en morceaux , & fe cuit en bouillie pour engraif-
fer les cochons. Les gaîhés des feuilles forment des
efpeces de canaux dans lefquels on peut envelopper
des branches 8c des fruits verds de betel ott
£ 1 1 f | ij