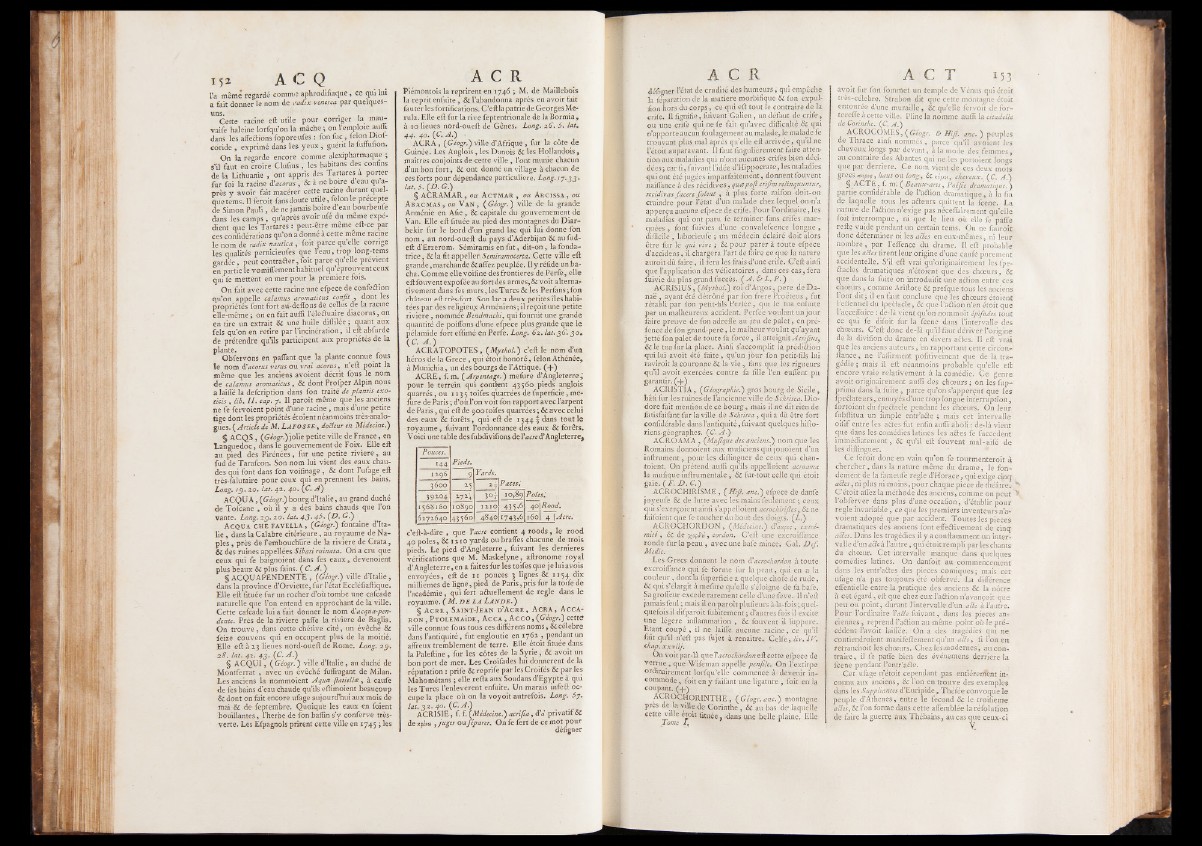
l’a même regardé comme aphrodifiaque, ce qui lui
a fait donner le nom de ïadix vtntrea par quelques-
uns. : ■ i
Cette racine eft utile pour corriger la maiw
vaife haleine lorfqu’on la mâche ; on l’emploie auffi
dans les affe&ions foporeufes : fon fu c , félon :Dioi-
coride , exprimé dans les y e u x , guérit la fuffufion.
On la regarde encore comme alexipharmaque ;
s’il faut en croire Glufius, les habitans des confins
de la Lithuanie , ont appris des Tartares à porter
fur foi la racine i'acorus , S U ne boire d eau qu a-
près y avoir fait macérer cette racine durant quelque
tems. Il feroit fans doute utile, félon le précepte
de Simon Pauli, de ne jamais boire d’eau bourbeufe
dans les camps, qu’après avoir ufe du meme expédient
que les Tartares : peut-être meme ƒ ft-ce par
ces confidérations qu’on a donne à cette meme racine
le nom de radix nautica , foit parce qu’elle corrige
les qualités pernicieufes que l’eau, trop long-tems
gardée, peut contracter, foit parce qu’elle prévient
en partie le vomiffement habituel qu éprouvent ceux
qui Ce mettent en mer pour la première fois.
On fait avec cette racine une efpece de confection
qu’on appelle calamus aromaticus confit , dont les
propriétés font fort au-deflous de celles de la racine
elle-même ; on en fait auffi l’éleétuaire diacorus, on
en tire un extrait & une huile diflilee ; quant aux
fels qu’on en retire par l’incinération, il eft abfurde
de prétendre qu’ils participent aux propriétés de la
plante.
Obfervons en paffant que la plante connue fous
le nom d'acorus ver us ou vrai acorus, n eft point la
même que les anciens avoient décrit fous le nom
de calamus aromaticus, & dont Profper Alpin nous
a laifle la defcription dans fon traité de plantis exo-
ticis , lié. I I . cap. y. Il paroît même que les anciens
ne fe fervoient point d’une racine, mais d’une petite
tige dont les propriétés étoient néanmoins très-analogues.
(Article de M. LAFOSSE-, docteur en Médecine.')
§ A C Q S , (Géogr.) jolie petite ville de France, en
Languedoc, dans le gouvernement de Foix. Elle eft
au pied des Pirénées, fur une petite riviere, au
fud de Tarafcon. Son nom lui vient des eaux chaudes
qui font dans fon voifinage , & dont l’ufage eft
très-ialutaire pour ceux qui en prennent les bains.
Long. ig. 20. lat. 42. 40. (C. A )
A C Q U A , (1Géogr.) bourg d’Italie, au grand duché
de Tofcane , où il y a des bains chauds que l’on
vante. Long. 23. 20. lat. 4 3 .4 3 . (D . G.)
A cq u a ch e f a v e l l a , (Géogr.) fontaine d’Italie
, dans la Calabre citérieure, au royaume de Naples
, près de l’embouchure de la riviere de Crata,
& des ruines appellées Sibari ruinata. On a cru que
ceux qui fe baignoient dans fes eaux, devenoient
plus beaux & plus fains. ( C .A . )
§ ACQUAPENDENTE , (Géogr.) ville d’Italie,
dans la province d’Orviette, fur l’état Eccléfiaftique.
Elle eft fituée fur un rocher d’où tombe une cafcade
naturelle que l’on entend en approchant de la ville.
Cette cafcade lui a fait donner le nom d'acqua-pen-
dente. Près de la riviere paffe la riviere de Baglia.
On trou ve, dans cette chétive cité, un évêché &
feize couverts qui en occupent plus de la moitié.
Elle eft à 23 lieues nord-oueft de Rome. Long. 29-,
28. lat. 42. 43. (C. A .)
§ A C Q U I , ( Géogr. ) ville d’Italie, au duché de
Montferrat , avec un évêché fuffragant de Milan.
Les anciens la nommoient Aquot flatiella -| à caufe
de fes bains d’eau chaude qu’ils eftimoient beaucoup
& dont on fait encore ufage aujourd’hui aux mois de
mai & de feptembre. Quoique les eaux en foient
bouillantes, l’herbe de fon baffin s’y conferve très-
verte. Les Efpagnols prirent cette ville en 1745 ; les
Piémontois la reprirent en 1746 ; M. de Maillebois
la reprit enfuite, & l’abandonna après en avoir fait
fauter les fortifications. C’eft la patrie de Georges Me-
rula. Elle eft fur la rive feptentrionale de la Bormia ,
à 10 lieues nord-oueft de Gênes. Long. 26. 3. lat.
44. 40. (C. Ai) ' % 1 * 1
A C R A , (Géogr.) ville d’Afnque, fur la cote de
Guinée. Les Anglois, les Danois & les Hollandois ,
maîtres conjoints dë cette ville , l’ont munie chacun
d’un bon fo r t , &c ont donné un village à chacun de
ces forts pour dépendance particulière. Long. jy .3 3 .
lat. 3. (D . G.)
§ ACRAMAR, ou A c tmar , ou Ar c is sa , ou
A b a cm a s , ou V a n , (Géogr.) ville de la grande
Arménie en Afie, & capitale du gouvernement de
Van. Elle eft fituée au pied des montagnes du Diar-
bekir fur le bord d’un grand lac qui lui donne fon
nom , au nord-oueft du pays d’Aderbijan & aufud-
eft d’Erzerom. Sémiramis en fut, dit-on, la fondatrice,
& la fit appelletSemiramocerta. Cette ville .eft
grande, marchande & allez peuplée. Il y réfide un hacha.
Comme elle voifine des frontières de Perfe, elle
eft fouvent expofée au fortdes armes,& voit alternar
tivement dans fes murs, les Turcs & les Perfans;fion
château eft très-fort. Son lac a deux petites îles habitées
par des religieux Arméniens ; il reçoit une petite
riviere, nommée Bendmachi, qui fournit une grande
quantité de poiffons dkme efpece plus grande que le
pélamide fort eftimé en Perfe. Long. 62. lat. 36. 30 .
■ A . )
ACR A TO PO TE S , (Mythol.) c’eft le nom d’un
héros de la Grece , qui étoit honoré, félon Athénée,
à Munichia, un des bourgs de l’Attique. (+ )
ACRE , f. m. (Arpentage.) mefure d’Angleterre^
pour le terrein qui contient 43560 pieds anglois
quarrés, ou 1135 toifes q’uarrées de fuperficie, mefure
de Paris ; d’où l’on voit fon rapport avec l’arpent
de Paris, qui eft de 900 toifes quarrées ; & avec celui
des eaux & forêts, qui eft de 134 41 dans tout le
royaume, fuivant l’ordonnance des eaux & forêts.
Voici une table des fubdiviûons de Y acre d’Angleterre,
Pouces.
144 Pieds.
1296 - 9 Yards.
3600 *5 2-5 P aces'.
3 9204 272^ î °7 10,89 Pôles'..
1568160 10890 1210 43 5.6 40I Rood.
6272640 4356° 484O 1743.6 i6o| 4 | Acrei
c’eft-à-dire , que Y acre contient 4 roods, le rood
40 pôles, & 1210 yards ou braffes chacune de trois
pieds. Le pied d’Angleterre, fuivant les dernieres
vérifications que M. Maskelyne, aftronome royal
d’Angleterre, en a faites fur les toifes que je lui a vois
envoyées, eft de 11 pouces 3 lignes & 1154 dix
millièmes de ligne, pied de Paris,pris fur la toife de
l’académie, qui fert actuellement de réglé dans le
royaume. ( M . d e l a L a n d e . )
§ Ac r e , Sa in t -Jean d’A c r e , A c r a , A c c a -
ron , Pto lem aïd e, Ac c a , A c c o , (Géogr.) cettef
ville connue fous tous ces différens noms, & célébré
dans l’antiquité, fut engloutie en 1762 , pendant un
affreux tremblement de terre. Elle étoit fituée dans
la Paleftine, fur les côtes de la Syrie, & avoit un
bon port de mer. Les Croifades lui donnèrent de la
réputation : prife & reprife par les Croifes & par les
Mahométans ; elle refta aux Soudans d’Egypte à qui
les Turcs l’enleverent enfuite. Un marais infeft occupe
la place où on la voyoit autrefois. Long. 5y .
lat. 3 2 .4 0 . (C . A . ) '
ACRISIE, f. f. (Médecine.) acrifia, d’a privatif &
de kcîvu , juger ou Jéparer. On fe fert de ce mot pour
défigner
défigner l’état de crudité des humeurs, qui empêche
la feparation de la matière morbifique & fon expul-
fion hors du corps, ce qui eft tout le contraire de la
crife. Il fignifie, fuivant Galien, un défaut de crife,
ou une crife qui ne fe fait qu’avec difficulté & qui
n’apporte aucun foulagement au malade, le malade fe
trouvant plus mal après qu’elle eft arrivée, qu’il ne
l’étoit auparavant. Il faut finguliérement faire attention
aux maladies, qui n’ont aucunes crifes bien décidées;
car fi, fuivant l’idée d’Hippocrate, les maladies
qui ont été jugées imparfaitement , donnent fouvent
naiffance à des récidives, qucepoß crifimrelinquuntur,
récidivas facere foient , à plus forte raifon doit-on
craindre pour l’état d’un malade chez lequel on-n’a
apperçu aucune efpece de crife. Pour l’ordinaire, les
maladies qui ont paru fe terminer fans crifes marquées
, font fuivies d’une convalefcence longue,
difficile , laborieufe ; un médecin éclairé doit alors
être fur le qui vive ; & p o u r parer à toute efpece
d’accidens, il chargera l’art de faire ce que la nature
auroit dû faire, il fera les frais d’une crife. C’eft ainfi
que l’application des véficatoires, dans ces caSj fera
luivie du plus grand fuccès. (A . & L . P .)
ACRISIUS, (Mythol.) roi d’Argos, pere deDa-
naë , ayant été détrôné par fon frere Proëteus , fut
rétabli par fon petit-fils Perfée, qui le tua enfuite
par un malheureux accident. Perfée voulant un jour
faire preuve de fon adreffe au jeu de palet, en pré-
fencede fon grand-pere, le malheur voulut qu’ayant
jetté fon palet de toute fa force, il atteignit Acrifius,
& le tua fur la place. Ainfi s’accomplit la prédiction
qui lui avoit été faite, qu’un jour fon petit-fils lui
raviroit la couronne & la v ie , fans que les rigueurs
qu’il avoit exercées contre fa fille l’en eufl'ent pu
garantir. (+ )
A CRISTIA, (Géographie.) gros bourg de Sicile,
bâti fur les ruines de ^ancienne ville de Schritea. Dio-
dore fait mention de ce bourg, mais il ne dit rien de
fatisfàifant fur la ville de Schritea, qui a dû être fort
confidérable dans l’antiquité,fuivant quelques hifto-
riens-géographes. (C. A .)
AC RO AM A , (Mußquedes anciens.) nom que les
Romains donnoient aux muficiens qui jouoient d’un
infiniment, pour les.diftinguer de ceux qui chan-
toient. On prétend auffi qu’ils appel!oient acroama
la mufique inftrumentale , & fur-tout celle qui étoit
gaie; ( F. D . C. )
ACROCHIRISME, ( Hiß. anc.) efp.ecé de danfe
joyeufe & de lutte avec les mains-feulement ; ceux
qui.s’exerçoient ainfi s’appelloient acrochirifles, & ne
faifoient que fe toucher du bout des doigts. (Z,.)
ACROCHORDON , (Médecine.) d’axpoç , extrémité
, & de %opS'», cordon. C’eft une excroiflance
ronde fur la peau, avec une bafe mince. Gai. Def.
Medic.
Les Grecs donnent le nom d'acrochordon à toute
excroiflance qui fe forme fur la peau, qui en a la
couleur , dont la fuperficie a quelque choie de rude,
& qui s’élargit à mefure qu’elle s’éloigne de fa bafe.
Sa grofleur exc.ede rarement celle d’une feve. Il n’eft
jamais feul ; mais il en paroît plufieurs à-la-fois; quelquefois
il difparoît fubitement ; d’autres fois il excite
une légère inflammation , & fouvent il fuppure.
Etant coupé , il ne laifle. aucune racine, ce qu’il
fait qu’il n’eft pas fujet à renaître. Ce lfe, liv.IV .
chap. xxviij.
On voit par-là que Yacrochordon eft cette efpece de
verrue, que AVifeman appelle penfile. On l’extirpe
ordinairement lorfqu’elle commence à devenir incommode
, foit en y faifant une ligature , foit en la
coupant. (4.)
ACRÖCHORINTHE, ( G éogr. anc.) montagne
près de la ville de Corinthe , & au bas de laquelle
cette ville étoit fituée ,-dans une belle plaine, Elle
Tome I ,
avoit fur fon fommet un temple de Vénus qui étoit
très-célebre. Strabon dit que cette môntagne étoit
entourée d’une muraille, & qu’elle fervoit de for-
tereffe à cette ville. Pline la nomme auffi la citadelle
de Corinthe. (C. A.)
ACROCOMES, (Géogr. & Hiß. anc. ) peuples
de Thrace ainfi nommés , parce qu’il avoient les
cheveux longs par devant, à la mode des femmes,
au contraire des Abantes qui ne les portoient longs
que par derrière. Ce nom vient de ces deux mots
grecs axpoç, haut qu long, Sc kI/jai , cheveux. (C. A.)
§ A C T E , f. m. ( Beaux-arts, Poéfie dramatique.)
partie confidérable de l’aâion dramatique, à la fin
de laquelle tous, les afteurs quittent la fcene. La
nature de Paétion n’exige pas néceffairement qu’elle
foit interrompue, ni que le lieu où elle fe paffe
refte vuide pendant un certain tems. On ne fauroit
donc déterminer ni les actes en eux-mêmes, ni leur
nombre, par l’effence du drame. Il eft probable
que les actes tirent leur origine d’une caufe purement
accidentelle. S’il eft vrai qu’originairement les lpe-
ftaclês dramatiques n’étoient que des choeurs, &
que dans la fuite on introduifit une aûion entre ces
choeurs, comme Ariftote & prefque tous les anciens
l’ont dit; il en faut conclure que les choeurs étoient
l’effentiel du fpecfacle, & que l’aâion n’en étoit que
racceffoire : de-là vient qu’on nommoit épifodes tout
ce qui fe difoit fur la fcene dans l’intervalle des
choeurs. C’eft donc de-là qu’il faut dériver l’origine
de la divifion du drame en divers a&es. Il eft vrai
que les anciens auteurs, ‘en rapportant cette circ'on-
Itance, ne l’affirment pofitivement que de la tragédie
; mais il eft néanmoins probable qu’elle eft
encore vraie relativement à la comédie. Ce genre
avoit originairement auffi des choeurs ; on les fup-
prima dans la fuite, parce qu’on s’apperçuf que les
fpe&ateurs, ennuyés d’une trop longue interruption ,
fortoient du fpe&acle pendant les choeurs. On leur
fubftitua un fimple entr’afte ; mais cet intervalle
oifif entre les adles fut enfin auffi aboli : de-là vient
que dans les .comédies latines les a êtes fe fuccedent
immédiatement, & qu’il eft fouvent mal-aifé de
les.diftinguer.
Ce feroit donc en vain qu’on fe tourmenteroit à
chercher, dans la nature même du drame, le fondement
de la fameufe regle d’Horace, qui exige cinq
actes, ni plus ni moins, pour chaque piece de théâtrev '
C’étoit affez la méthode des anciens, comme on peut "
l’obferver dans plus d’une occafion, d’établir pour
regle invariable, ce que les premiers inventeurs n’a*
voient adopté que par accident. Toutes les pièces
dramatiques des anciens font effectivement de cinq
actes. Dans les tragédies il y a conftamment un intervalle
d’un acte à l’autre, qui étoit rempli par les chants
du choeur. Cet intervalle manque dans quelques
comédies'latines. On danfoit au commencement
dans les entr’aûes des pièces comiques; mais cet
ufage n’a pas toujours été obfervé. La différence
effentielle entre la pratique des anciens & la nôtre
à cet égard, eft que chez eux l’action n’avançoit que
peü ou point, durant l’intervalle d’un aâe à l’autre.
Pour l’ordinaire Y acte, fuivant, dans les pièces anciennes
, reprend l’aétion au même point où-Ie précédent
l’avoit laifîee. On a des tragédies qui ne
cpntiendroient manifeftement qu’un acte, fi l’on en
retranchoit les choeurs. -Chez lès modernes ', au contraire
, il fe paffe bien des événemens derrière la
fcene pendant l’entr’aâe.
Cet ufage n’étoit cependant pas entièrement inconnu
aux anciens, & l’on en trouve des exemples
dans les Suppliantes d’Euripide, Théfée convoque le
peuple d’Athenes, entre le fécond & le troifieme
actes, & l’on forme dans cette affemblée la réfolution
de faire la guerre aux Thébafiis, au cas que ceux-ci y