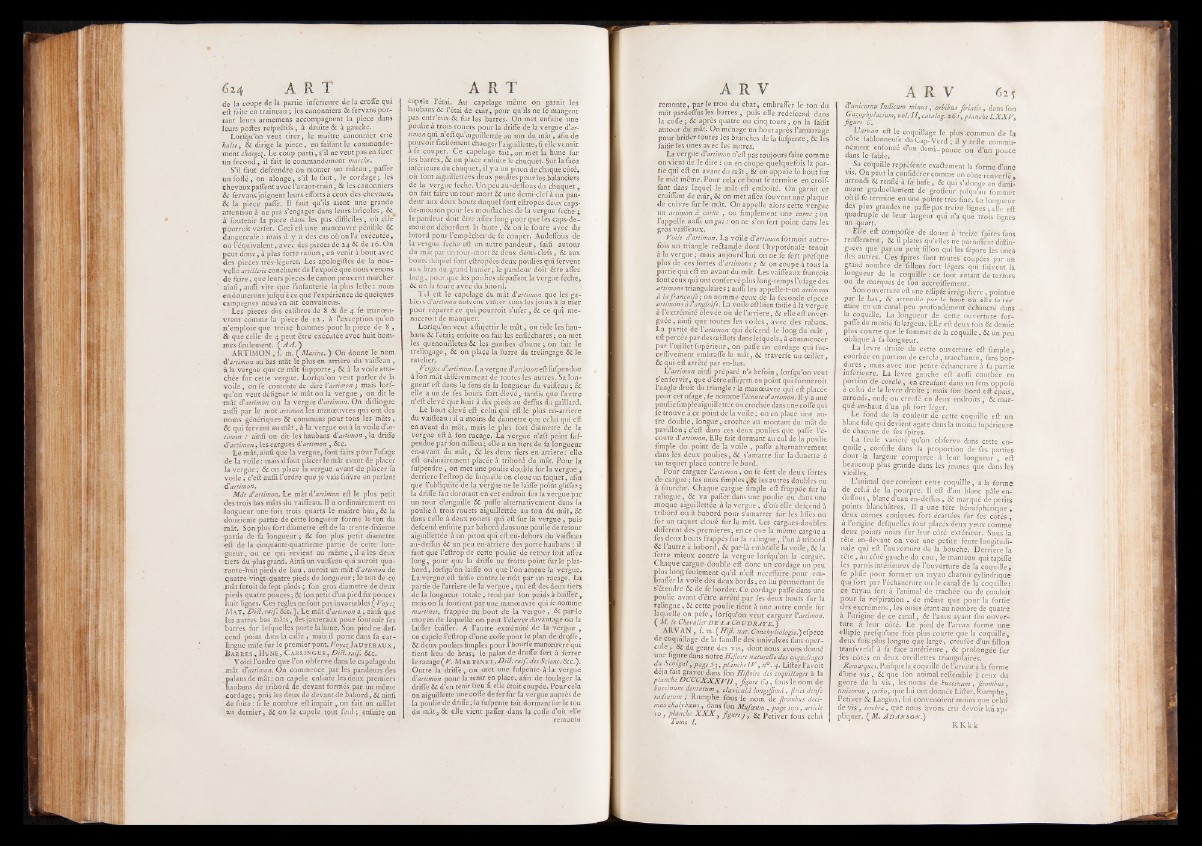
Ô 24 A R T
de la coupe de la partie inférieure de la croffe qui
eft faite en traîneau ; les canonniers & fervans portant
leurs arméniens accompagnent la piece dans
leurs poftes refpe&ifs, k droite & à gattchç.
Lorfqu’pn veut tirer, le maître canonnier crie
halte, & dirige la piece, enfaifantle commandement
chargeç. Le coitp parti, s’il ne veut pas.enivrer
lin fécond, il fait le commandement marche.
S’il faut defcendre ou monter un rideau, paffer
un foffé, on alonge, s’il le faut, le cordage; les
chevaux paffent avec l’avant-train, & les canonniers
& fervans joignent leurs efforts à ceux des chevaux,
& la piece paffe. Il faut qü’ils aient urie grande
attention à ne pas s’engager dans leurs bricoles, & .
à'foutenir la piece dans les pas difficiles, oh elle
pourfoit verfer. Ceci eft une manoeuvre pénible &
da'ngereufe : mais il y a des cas oh on l’a exécutée,
ou l’équivalent, avec des pièces dé 24 & de 16. On
peut donc, à plus forte râifon, en venir à bout avec
des pièces très-légères. Les apologiftes de Ta nouvelle
artillerie concluent de l’expofé que nous venons
de faire, que leurs pièces de canon peuvent marcher
ainfi, auffi vite que l’infanterie la plus lefte : nous
en douterons jufqu’à ce que l’expérience de quelques
campagnes nous en ait convaincus.
Les pièces des calibres de 8 & de 4 fé manoeuvrent
comme la piece de 1 2 , à l’exception qu’on
n ’emploie que treize hommes pour la piece de 8 ,
& que celle de 4 peut être exécutée avec huit hommes
feulement. ( A Ai )
ARTIMON, f. ift. ( Marine. ) On donne le nom
d’artimon au bas mât le plus en arrière du vaiffeau ,
à la vergue que ce mât iupporte , & à la voile attachée
fur cette vergue. Lorfqu’on veut parler de la
Voile, on fe contente de dire l’artimon ; mais lorsqu'on
veut défigner le mât ou la vergue , on dit le
mât $ artimon ou la vergue $ artimon. On diftingue
auffi par le mot artimon les manoeuvres qui ont des
noms génériques & communs pour tous les mâts,(
& qui fervent au iiiât, à la vergue ou à la voile $ artimon
: ainfi on dit les haubans d’artimon, la driffe
& artimon, lescargues d’artimon , &c<
Le mât, ainfi que la vergue, font faits pour l’ufage
de la voile : mais il faut placer le mât avant de placer
la vergue ; & on place la vergue avant de placer là
•voile ; c’eft auffi l’ordre que je vais fuivre en parlant
d,artimon.
Mât £ artimon. Le mât à? artimon eft le plus petit
des trois bas mâts du vaiffeau. Il a ordinairement en
longueur une fois trois quarts le maître bau, & la
douzième partie de cette longueur forme le ton du
•mât» Son plus fort diamètre eft de la trente-fixieme
-partie de fa longueur ; & fon plus petit diamètre
eft de la cinqüante-quatrieme partie de cette longueur,
ou ce qui revient au même , il a les-deux
tiers du plus grand. Ainfi un vaiffeau qui auroit quarante
huit pieds de bau, auroit un mât d'artimon de
quatre-vingt-quatre pieds de longueur ; le ton de ce
.mâtferoit de fept pieds ; fon gros diamètre de deux
pieds quatre pouces ; & fon petit d’un piedfix pouces
huit lignes. Ces réglés ne font pas invariables ( Voye£
.M a t , pict- raif. & c .) . Le mât à !artimon a , ainfi que
les autres bas mâts, des jauteraux pour foutenir fes
barres fur lefquelles porte la hune. Son pied ne défi
cend point dans la calle , mais il porte dans fa carlingue
mife fur le premier pont. Voye{ Ja u t e r a u x ,
B a r r e s , H u n e , C a r l i n g u e , Dicl. raif. &c.
Voici l’ordre que l’on obferve dans le capelage du
. mât d’artimon. On commence par les pandeurs des
alans de mât : on capele enfuite les deux premiers
aubans de tribord de devant formés par un même
.cordage; puis les deux de devant de bâbord, & ainfi
de fuite : fi le nombre eft impair ,.on fait un oeillet
au dernier, & on le capele.tout feul enfuite on
A R T
capele l’étai. Au capelage même on garnit le§
haubans & l’étai dé cuir, pour qu’ils ne fè'mangent
pas entr’eux. & fur les barres. On met enfuite une
poulie â trois, rouets pour la driffe de là vergue dW-
timon qui n’eft qu’aiguillettée au ton du mât, afin de
pouvoir facilement changer i’aiguillette, fi elle venoit
à fe couper. Ce capelage fait, on met la hune fur
fes barres , & on place enfuite le chuquet. Sur la face
inférieure du chuquet, il y a un piton de chaque côté,
oh font aiguillettées deux'poulies pour les balanciers
de la vergue feche. Un peu au-deffou^ du chuquet,
on fait faire un tour-mort & une demi-clef à un pandeur
aux deux bouts duquel font eftropés deux caps-
de-mouton pour les mouftaches de la vergue feChe ;
le pandeur doit être affez long pour que les caps-de-
moütorf débordent la hùrte , & ort le fôufe avec du
bitord pour l’empêcher de fe côuper. Audeffous de
la vergue feche eft un autre'pandeur, faifi autour
du mât par un tour-mort & deux demi-cl.eÇs, & aux
bouts duquel font eftropées deiix poulies qui fervent
.aux bras du grand hunier; l,q pandeur doit être affez
long, pour que le.s poulies dépaffent la Vergue feche,
& on la foure avec du bitord»
Tel eft le capelage du mat f ! artimon-Q^xe les gabiers
d’artimon doivent vifiter tous les jours à la mer
pour réparer ce qui pourroit s’u fer, & ce qui me-
.naceroit de manquer.
Lorlqu’on veut aflujettir le mât, on ride les haubans
& l ’étai; enfuite on fait les enfléchures; on met
les quenouilletes & les gambes d’hune ; on fait le
trelingage, & on place la Barre de trélingage & le
râtelier»
. VergUé aartim'oni La vergue d’artimon eft fufpendue
à fon mât différemment de toutes les autres. Sa lon-
gueùr eft dans le. feris de la longueur du vaiffeau ; &c
elle à un de fes Bouts fort élevé, tandis que l’autre
n’éft élevé que huit à dix pieds ait deffus du gaillard.
Lé bout éleVé eft celui qui èfl lé plus en-arrîere
du vaiffeau : il a moins de diamètre que celui qui eft
en-avant du mât, mais le plus fort diamètre de la
vergue eft à fori racage. La vergue n’eft point fiif-
peridue par fon milieu ; elle a un tiers de fa longueur
ën-avarit du mât, Si les deux tïefs en-arrière : elle
eft ordinairement placée à tribord du mât. Pour la
fiifpendr'e , ôn met une poulie double fur la vergue ,
derrière l’eftrop de laquelle ôii cloué un taquet, afin
que l’obliquité-de la vergue ne lé laiffe pdifît gliffef ;
la driffe fait dormant en cet endroit fur la vergue.par
un tour d’anguille Si paffe alternativement dans la
poulie â trois rouets aiguillettée au ton dû mât, Sc
dans celle à deux rouets qui eft fur la vergue, puis
defcend enfuite par bâbord dans une poulie de retour
aiguillettée à un piton qui eft en-dehors du' Vaiffeau
au-deffus & un peu én-arriere des porte-haubans : il
faut que l’eftrop de Cette poulie de retour foit affez
long, pour que la driffe ne frotte' point fur le plat-
bord, lorfqu’on laiffè du que l’on amené la vergue.
Lâ vergue eft faifie Contre le mât par un racage. La
partie de l’arriéré de la v éfgüe, qui èft des deux tiers
de la longueur totale, tend par fon poids à baiffet,
mais on la foutient par une manoeuvre qui fe nomme
martinet, frappée au (bout de la vergue, & parTe
moyen de laquelle on petit l’élever davantage du la
laiffer baiffer. A l’autre extrémité de la vergue ,
on capele l’ëftrop d’une Coffe pour le plan de drqffe,
& deux poulies fimples pour l’hourfe manoeuvre qui
tient lieu de bras; le palan de droffe fert à ferrer
le racage ( V. M artinet»D i3 . raif. des-Science &c.).
: Outre la driffe, on met une fufpente à la vergue
à!ar.timon pour la tenir en place, afin de foulager la
driffe & d’en tenir lieu fi elle étoit coupée. Pour cela
on aiguillette une Cdffe de fer fur la vergue auprès de
la poulie de driffe ; la fufpente fait dormant fur le ton
du mât, & elle vient paffer dans la'coffe d’ofi elle
remonte
A R V
fenionte, par le trou du chat, embraffer le ton du
mât pardeffus les barres ,' puis elle redefcend dans
la coffe ; & après quatre ou cinq tours, On la faifit
autour du mât. On ménagé un bout après l’amarrage
pour brider toutes les branches de la fufpente, & les
laifir les fines avec les autres.
La vergue d'artimon n’eft pas toujours faite comme
on vient de le dire : on en coupe quelquefois la partie
qui eft en avant du mât , & on appuie le bout fur
le mât même. Pour cela ce: bout fê termine en crôif-
fant dans lequel le mât eft emboîté. On garnit ce
croiffant de cuir, & on met affez fou vent une plaque
de cuivre fur le mât. On appelle alors cette Vergue
un artimon à corne , ou Amplement une- corne ; ôn
l’appelle auffi vin gui: on ne, s’en fert point dans les
gros vaiffeaux.
Voile £ artimon. La voile d’artimon formoit autrefois
un triangle re&angle dont l’hypoténufe tenoit
à la vergue ; mais aujourd’hui on ne fe fert prefque
plus de ces fortes Ü artimons ; & on coupe à tous la
partie qui eft en avant du mât Les vaiffeaux françois
font ceux qui ont confervé plus long-temps l’ufage des
. artimons triangulaires ; auffi les appellë-t-on animons
à lafrançoife; on nomme ceux de la fecônde efpece
artimons a Cangloife. La voile eft bien faifie à la vergue
à l’extrémité élevée ou de I’arriere, & elle eft enver-
guée, ainfi que toutes lés voiles, avec des rabans.
La partie de l ’artimon qui defcend le long du mât ,
eft percée par des oeillets dans lefquels, à commencer
par l’oeillet fupérieur, on paffe un cordage qui fuc-
ceffivement embraffe le mât, & traverfe un oeillet,
& qui eft arrêté par en-bas.
L’artimon ainfi préparé n’a befoin, lorfqu’on veut
s’enfervir, que d’êtré affujetti au point qui formëroit
l’angle droit du triangle : la manoeuvre qui eft placée
pour cet ufage, fe nomme 1 'écoute £ artimon. Il y a une
poulie fimple aiguillettée ou crochée dans une coffe qui
fe trouve à ce point de la voile ; on en place une autre
double, longue, crochée au montant du mât de
pavillon; c’eft dans ces deux poulies que paffe l’écoute
d'artimon. Elle fait dormant au cul de la poulie
fimple du point de la voile , paffe alternativement
dans les deux poulies,-& s’amarre fur la dunette à
un taquët placé contre le bord.
Pour Carguer l’artimon, on fe fert de deux fortes
de cargue ; les unes fimples, & les autres doubles ou
à fourche. Chaque cargue fimple eft frappée fur la
ralingue, & va paffer dans une poulie ou dans une
moque aiguillettée à la vergue , d’où elle defcend à
tribord ou à bâbord pour s’amarrer fur les liftes ou
fur un taquet cloué fur le mât. Les cargues-doubles
different des premières, en ce que la même cargue a
fes deux bouts frappés fur la ralingue, l’un à tribord
& l ’autre à bâbord, & par-là embraffe la voile, &Ta
ferre mieux contre la vergue Iorfqu’on la cargue.
Chaque cargue-double eft donc un cordage un peu
plus long feulement qu’il n’eft néceffaire pour embraffer
la voile des deux bords, en lui permettant de
s’étendre & de fe border. Ce cordage paffe dans une
poulie avant d’être arrêté par les deux bouts fur la
ralingue, & cette poulie tient à une autre corde fur
laquelle on pefe, lorfqu’on veut carguer l'artimon.
( M. le Chevalier D E l a Co u d î l a y e .')
ARVAN , f. m.(Hijl. nat. Conchyliologie^ efpece
de coquillage de la famille des univalves fans operculé
, & du genre des v is, dont nous avons donné
fine figure dans notre Hijloire naturelle des coquillages
du Sénégalpage planche IV , n°. 4. Lifter l’avoit
déjà fait graver dans fon Hijloire des coquillages à la
planche D CC C X X X VII, figure 64, fous le nom de
buccinum dentatum , claviculâ longijfimâ, finis d'enfe
radiatum ; Rumphe fous le nom de firombus deci-
mus chalybmis, dans fon Mufoeum , page ,00, article
'iq , planche X X X , figure j , & Petiver fous celui
lome I.
A R V 625
d unicornu Indicum minus, orbibus jlriatis, dans fon
Gaçop'hyLacium, vol. I I , catalog. z 6 /, planche LXXV,
figure C. ■
-L ’arvan eft le coquillage le plus commun de la
cote fablonneufe duCap-Verd ; il y refte communément
enfonce d’un demi-pouce ou d’un pouce
dans le fable. f
Sa coquille repréfente exaftement la forme d’une
vis. On peut la cônfidérer comme un cône renverfé
arrondi-& renflé-à fa' bafe, & qui s’alonge en diminuant
graduellement de groffeur ju{qu’au fomifiet
en un?- pointe très-fine. La longueur
des plus grandes ne paffe pas treize lignes ; elle eft
quadruplé de leur largeur qui n’a que trois lignés
un quart.
Elle eft compofeé dé douze à treize fpires fans
renflement, & fi plates qu’elles ne pàroiffent diftin-
gueës què par un petit fillon qui les fépare les unes
des autres. Ces fpirés font toutes coupées par un
grand nombre de filions fort légers qui fuivent la
longueur de la coquille-: ce font autant de termes
ou de marques de fori accroiffement.
Son ouverture eft une ellipfe irrégulière, pointue
par le bas, & arrondie par le haut où elle fe termine
en un canal peu profondément ëchancré dans
la coquille. La longueur de cette ouverture fur-
paffe de moitié fa largeur. Elle eft deux fois & demie
plus courte que le fommet de la coquille, & un peu
oblique à fa longueur.
La levre droite de cette ouverture eft fimple,
courbée en portion de cercle , tranchante, fans bordures
, mais avec une petite échancrure à fa partie
inférieure. La levre gauche eft auffi courbée en
portion de cercle, en creufant dans un fens oppofé
a celui de la levre droite ; mais fori bord eft épais,
arrondi, ondé ou crëufé en deux endroits , & marqué
en-haut d’un pli fort-léger.
Le fond de la couleur de cette coquille eft un
blanc fàle qui devient agate dans la moitié fupérieure
de chacune de fes fpires.
La feule variété qu’on obferve dans cette co~
quille , confifte dans la proportion de fes parties
dont la largeur comparée à leur longueur , eft
beaucoup plus grande dans les jeunes que dans l'es
vieilles.1
L’animal que contient cette coquille, a la formé
de celui de la pourpre. 11 eft d’un blanc pâle en-
deffous, blanc d’eau en-deffus, & marqué de petits
points blanchâtres. Il a une tête hémifphérique ,
deux cornes coniques fort écartées fur fes côtés ,
à l’origine defquelles font placés deux yeux commè
deux points noirs fur leur côté extérieur. Sous la
tête en-devant On voit une petite fente longitudinale
qui eft l’ouverture de la bouche. Derrière la
tête, au côté gauche du cou, le manteau qui tapiffe
les parois intérieures de l’ouverture de la coquille,
fe pliffe pour former un tuyau charnu cylindrique
qui fort par l’échancrure ou le canal de la coquille :
ce tuyau fert à l’animal de trachée ou de conduit
pouf la refpiration , de même que pour la fortie
des excrémens, les ouïes étant au nombre de quatre
à l’origine de ce canal , & l’anus ayant fon ouverture
à leur côté. Le pied de l’arvan forme une
ellipfe prefqu’une fois plus courte que la coquille,
deux fois plus longue que large, creufée d’un fillon
tranfverfal à fa face antérieure, & prolongée fur
fes côtés en deux oreillettes triangulaires.
■Remarques. Puifqiiela coquille de Yarvan a la forme
d’une vis , & que fon animal reffemble à ceux du
genre de la vis, les noms de buccinum , firombus,
unicornu, turbo, que lui ont donnés Lifter, Rumphe,
Petiver & Langius, lui convenoient moins que celui
de vis , terebra, que nous avons crû devoir lui appliquer.
(M . A d a n s o p .')
K K k k